Cultures franco-maghrébines – Lettre #18
ÉDITO
Notre 18ème lettre est notre modeste cadeau de ce début d’année 2018.
Puisse-t-elle contribuer à vous apporter un peu du bonheur d’une joyeuse rencontre avec des œuvres artistiques franco-maghrébines. Nous l’avons voulue un peu plus copieuse que les précédentes, et elle traite des trois pays du Maghreb, ce que l’actualité telle que nous la percevons ne permet pas chaque mois.
Nous vous souhaitons de prolonger cette rencontre pendant toute cette année, afin que patiemment nous poursuivions cet ouvrage de tissage et de broderies entre les rives nord et sud de la Méditerranée, et les personnes qui y vivent. En multipliant ces rencontres, nous avons la conviction de contribuer à un monde plus fraternel.
Et de rester dans les pas de ces amies et amis ensoleillés qui nous ont quittés en 2017, Georges, Daniel, Pierrette et Gilbert, et qui ont tant fait pour cette cause.
Merci de nous accompagner dans cette démarche, et belle année 2018, pour vous et les vôtres.
Michel Wilson

« LES BIENHEUREUX » de Sofia Djama (2017, Algérie) avec Nadia Kaci et Sami Bouadjila
Visible en salles juste après le film de Karim Moussaoui « En attendant les hirondelles », le film de Sofia Djama, qui connaît lui aussi un succès bien mérité, confirme un sentiment très euphorique : décidément, le cinéma algérien accède à une ère nouvelle et parvient à se faire reconnaître dans sa nouveauté, grâce à la réalisation talentueuse d’hommes et de femmes aptes à faire comprendre au public ce qu’il en est aujourd’hui même de leur pays.
 Quelques documentaires avaient été comme des hirondelles (pour parler comme Karim Moussaoui) annonçant cet autre printemps arabe, qui ne pouvait prendre la même forme qu’en Tunisie par exemple, du fait que toute l’histoire contemporaine de l’Algérie est marquée par ce terrible épisode qu’on appelle la décennie noire et qui est en effet le point de départ du tableau tracé dans Les Bienheureux. Avec beaucoup de retard, du fait de la politique officielle qui a privilégié la recherche d’un apaisement factice par occultation des événements, il semblerait que beaucoup d’Algériens découvrent maintenant et osent affirmer que ce terrible épisode (pas moins d’une dizaine d’années) ne peut tout simplement être caché sous le tapis, en attendant que les choses veuillent bien rentrer d’elles-mêmes dans l’oubli. Le film de Sofia Djama montre et notamment par le personnage d’Amal admirablement joué par Nadia Kaci que non seulement la décennie noire a créé une sorte de génération sacrifiée, ceux et celles qui comme Amal et son mari Samir ont réussi à survivre (comme ils le disent l’un et l’autre, c’est à la fois peu et beaucoup), mais que de plus elle compromet et laisse en suspens le sort d’un groupe socio-culturel qui ne se voit plus d’avenir en Algérie, la communauté des francophones démocrates, laïques, menacés par l’islamisation de fait , dont le film s’emploie à donner des preuves.
Quelques documentaires avaient été comme des hirondelles (pour parler comme Karim Moussaoui) annonçant cet autre printemps arabe, qui ne pouvait prendre la même forme qu’en Tunisie par exemple, du fait que toute l’histoire contemporaine de l’Algérie est marquée par ce terrible épisode qu’on appelle la décennie noire et qui est en effet le point de départ du tableau tracé dans Les Bienheureux. Avec beaucoup de retard, du fait de la politique officielle qui a privilégié la recherche d’un apaisement factice par occultation des événements, il semblerait que beaucoup d’Algériens découvrent maintenant et osent affirmer que ce terrible épisode (pas moins d’une dizaine d’années) ne peut tout simplement être caché sous le tapis, en attendant que les choses veuillent bien rentrer d’elles-mêmes dans l’oubli. Le film de Sofia Djama montre et notamment par le personnage d’Amal admirablement joué par Nadia Kaci que non seulement la décennie noire a créé une sorte de génération sacrifiée, ceux et celles qui comme Amal et son mari Samir ont réussi à survivre (comme ils le disent l’un et l’autre, c’est à la fois peu et beaucoup), mais que de plus elle compromet et laisse en suspens le sort d’un groupe socio-culturel qui ne se voit plus d’avenir en Algérie, la communauté des francophones démocrates, laïques, menacés par l’islamisation de fait , dont le film s’emploie à donner des preuves.
 Il le fait à travers une action très simple et très convaincante, tant il est vrai que les faits montrés sont connus de tout le monde et ne s’inventent pas. Le couple d’Amal et Sami décide de fêter le vingtième anniversaire de son mariage en allant dîner au restaurant (avec quelques réticences de sa part à elle qui sans doute prévoit d’éventuelles contrariétés). S’accumulent alors des difficultés en série qui ne peuvent manquer de gâcher la soirée et même au-delà : café où les femmes ne peuvent entrer, restaurant où on ne sert pas d’alcool en terrasse, obligation d’aller dans un hôtel pour touristes absolument sinistre et vraisemblablement hors de prix. Finalement le couple se retrouve au commissariat de police, un banal agent de la circulation ayant découvert qu’Amal avait bu de l’alcool avant de prendre le volant. Pas d’autre solution que d’en appeler à l’intervention d’un ami haut placé, qui se révèle efficace en effet.
Il le fait à travers une action très simple et très convaincante, tant il est vrai que les faits montrés sont connus de tout le monde et ne s’inventent pas. Le couple d’Amal et Sami décide de fêter le vingtième anniversaire de son mariage en allant dîner au restaurant (avec quelques réticences de sa part à elle qui sans doute prévoit d’éventuelles contrariétés). S’accumulent alors des difficultés en série qui ne peuvent manquer de gâcher la soirée et même au-delà : café où les femmes ne peuvent entrer, restaurant où on ne sert pas d’alcool en terrasse, obligation d’aller dans un hôtel pour touristes absolument sinistre et vraisemblablement hors de prix. Finalement le couple se retrouve au commissariat de police, un banal agent de la circulation ayant découvert qu’Amal avait bu de l’alcool avant de prendre le volant. Pas d’autre solution que d’en appeler à l’intervention d’un ami haut placé, qui se révèle efficace en effet.
La génération suivante a d’ailleurs recours au même type d’intervention : la jeune Fériel délivre grâce au commissaire de police qui la protège ses deux amis (au sens purement amical du mot). Ils se sont fait prendre en ayant sur eux la plus ordinaire des substances illicites que fument semble-t-il la plupart des jeunes gens.
On s’aperçoit assez vite que pratiquement le film tourne autour d’une question et une seule, il est vrai décisive parce qu’elle engage tout l’avenir des intéressés : partir ou rester ? La qualité du film vient de ce que la réponse n’est pas simple, ni pour les personnages, ni pour les spectateurs qui ne peuvent manquer de s’interroger. Certes Amal qui veut partir est convaincante, d’autant plus qu’elle le veut pour assurer l’avenir de son fils, qui en Algérie n’en a semble-t-il aucun. Comme dans le premier épisode d’En attendant les hirondelles, on voit un garçon supposé étudiant qui ne parvient pas à éprouver le moindre intérêt pour les études universitaires. Echec patent du système ou banal décrochage dont il y a des exemples partout ?
 Mais comme Sami qui résiste autant qu’il peut à ce projet de départ, on se dit que quitter son pays ne peut pas être la bonne solution et que ce serait vraiment dommage d’avoir résisté si longtemps pour abandonner finalement la partie. Il a, lui, un projet sur place : créer une clinique (il est gynécologue), mais est-ce à tort ou à raison qu’il se sent près du but et finalement capable de l’atteindre ?
Mais comme Sami qui résiste autant qu’il peut à ce projet de départ, on se dit que quitter son pays ne peut pas être la bonne solution et que ce serait vraiment dommage d’avoir résisté si longtemps pour abandonner finalement la partie. Il a, lui, un projet sur place : créer une clinique (il est gynécologue), mais est-ce à tort ou à raison qu’il se sent près du but et finalement capable de l’atteindre ?
Ce qui est beau et pathétique dans ce film est qu’on assiste à une sorte de balance et de basculement toujours possible entre passé et présent. Difficile de ne pas ressentir que le passéisme est un enfermement n’offrant qu’une bien maigre compensation lorsque le petit groupe d’amis devenus des « anciens combattants » se met à entonner sur l’air de Léo Ferré le poème d’Aragon L’affiche rouge en hommage au groupe Manouchian. Sans doute ont-ils été à leur manière des combattants pendant la décennie —d’ailleurs achevée depuis dix ans au moment où se situe le film (2008) —mais on croit comprendre que plusieurs d’entre eux se sont contentés de partir, en France sans doute, ce qui est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles Samir n’est pas favorable au départ.
Les raisons sont toutes autres pour lesquelles son fils lui non plus n’a pas envie de partir, c’est tout simplement qu’il ne se trouve pas mal et même plutôt bien là où il est, et c’est une raison qui mérite qu’on en tienne compte, même si les critiques du film n’en ont fait jusqu’ici aucun cas (comme d’habitude, ils ne retiennent d’un film sur l’Algérie que le tableau le plus sombre qui soit). Lorsque ce garçon se moque doucement de la peur d’être égorgé, encore vive chez ses parents, peut-être a-t-il raison d’y voir la rémanence d’une époque aujourd’hui révolue (sauf exception). On se souvient alors que le but d’un film est de montrer, pas de démontrer, et de poser des questions, pas d’y répondre. Ce que celui-ci fait admirablement.
Denise Brahimi
« LE BRIO », d’Yvan Attal (2017, France) avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana
Ce film qui vient de sortir, en cette fin d’année 2017, est une heureuse surprise parce qu’il joint un message, incontestable, à une forme originale et drôle. Ce serait si l’on veut bien le prendre sous cet angle une sorte de fable contemporaine y compris au sens précis que La Fontaine donne au mot « fable », soit en substance : une fable est une courte histoire teintée d’humour qui a pour but de distraire le lecteur tout en l’instruisant ; elle se conclut sur une leçon que l’on appelle la morale.
 L’aspect humoristique du film est dû à la fois à son sujet et aux acteurs qui incarnent les personnages (avec brio évidemment, c’est-à-dire de manière brillante et avec beaucoup de talent !). Le sujet en lui-même amuse parce qu’il surprend, il consiste en la confrontation de deux personnages que tout oppose et qui semblent se plaire eux-mêmes à signifier l’opposition de leurs personnalités. Pierre Mazard, joué par Daniel Auteuil, est professeur de droit à la faculté d’Assas, qui a la réputation, en particulier depuis mais 68, d’être un lieu hautement réactionnaire et fier de l’être, où l’on défend des valeurs « Vieille France » menacées par des intrusions diverses et un laisser aller généralisé. Il est vrai qu’en 2017, le « politiquement correct » oblige à contrôler les apparences et notamment à ne pas afficher un racisme condamné par l’opinion dominante autant que par la loi. Mais Pierre Mazard, qui est très provocateur, n’en fait qu’à sa tête et se plaît à braver les interdits contemporains. Il s’en donne à cœur joie lorsque les circonstances mettent au rang des étudiantes qui fréquentent son cours une jeune personne de banlieue parisienne et d’origine algérienne, Neïla Salah jouée par la brillante (décidément c’est le mot qui s’impose !) Camélia Jordana—d’abord connue comme chanteuse plutôt que comme actrice—qui a abandonné son nom, Riad-Aliouane, au profit de ses deux prénoms, mais pas son algérianité dont le film d’Yvan Attal tire bon parti. Par sa famille, mère et grand-mère dont il est fait des personnages attachants, elle incarne une troisième génération qui s’affirme pour commencer par ses apparences extérieures, vêtements et langage —un moyen peut-être de ne pas céder à la pression assimilationniste que la génération précédente a beaucoup subie. Pour le réalisateur Yvan Attal, c’est l’occasion de rappeler que Neïla est une figure de lui-même—et n’importe qu’il soit juif plutôt que musulman, puisqu’il se sent lié de la même façon à une origine familiale très modeste, dans cette même banlieue de Créteil où le film a été partiellement tourné.
L’aspect humoristique du film est dû à la fois à son sujet et aux acteurs qui incarnent les personnages (avec brio évidemment, c’est-à-dire de manière brillante et avec beaucoup de talent !). Le sujet en lui-même amuse parce qu’il surprend, il consiste en la confrontation de deux personnages que tout oppose et qui semblent se plaire eux-mêmes à signifier l’opposition de leurs personnalités. Pierre Mazard, joué par Daniel Auteuil, est professeur de droit à la faculté d’Assas, qui a la réputation, en particulier depuis mais 68, d’être un lieu hautement réactionnaire et fier de l’être, où l’on défend des valeurs « Vieille France » menacées par des intrusions diverses et un laisser aller généralisé. Il est vrai qu’en 2017, le « politiquement correct » oblige à contrôler les apparences et notamment à ne pas afficher un racisme condamné par l’opinion dominante autant que par la loi. Mais Pierre Mazard, qui est très provocateur, n’en fait qu’à sa tête et se plaît à braver les interdits contemporains. Il s’en donne à cœur joie lorsque les circonstances mettent au rang des étudiantes qui fréquentent son cours une jeune personne de banlieue parisienne et d’origine algérienne, Neïla Salah jouée par la brillante (décidément c’est le mot qui s’impose !) Camélia Jordana—d’abord connue comme chanteuse plutôt que comme actrice—qui a abandonné son nom, Riad-Aliouane, au profit de ses deux prénoms, mais pas son algérianité dont le film d’Yvan Attal tire bon parti. Par sa famille, mère et grand-mère dont il est fait des personnages attachants, elle incarne une troisième génération qui s’affirme pour commencer par ses apparences extérieures, vêtements et langage —un moyen peut-être de ne pas céder à la pression assimilationniste que la génération précédente a beaucoup subie. Pour le réalisateur Yvan Attal, c’est l’occasion de rappeler que Neïla est une figure de lui-même—et n’importe qu’il soit juif plutôt que musulman, puisqu’il se sent lié de la même façon à une origine familiale très modeste, dans cette même banlieue de Créteil où le film a été partiellement tourné.
 En fait, malgré un temps très court où Neïla vacille et ne sait plus où elle en est, le film maintient le contraste entre les deux personnages qui s’affrontent ô combien, jusqu’aux injures inclusivement et les pires qui soient. L’intelligence du film, ou plutôt celle de ses deux personnages principaux, est d’apprécier leurs différences et d‘en jouer, en les poussant éventuellement à l’extrême mais de comprendre aussi, et assez vite, qu’ils ont sûrement quelque chose à apprendre de cet autre qu’ils ont en face d’eux. Même lorsqu’ils sont furieux l’un contre l’autre, le moment n’est pas loin où ils s’amusent de la situation. Finalement Pierre Mazard qui partait grand vainqueur, perd sans doute plus dans l’aventure (c’est lui qui l’a voulu, il mérite donc sa punition) que Neïla qui après avoir subi mille avanies et les plus incroyables humiliations, tire parti (brillamment !) de ce qu’elle a enduré et en fait son bien.
En fait, malgré un temps très court où Neïla vacille et ne sait plus où elle en est, le film maintient le contraste entre les deux personnages qui s’affrontent ô combien, jusqu’aux injures inclusivement et les pires qui soient. L’intelligence du film, ou plutôt celle de ses deux personnages principaux, est d’apprécier leurs différences et d‘en jouer, en les poussant éventuellement à l’extrême mais de comprendre aussi, et assez vite, qu’ils ont sûrement quelque chose à apprendre de cet autre qu’ils ont en face d’eux. Même lorsqu’ils sont furieux l’un contre l’autre, le moment n’est pas loin où ils s’amusent de la situation. Finalement Pierre Mazard qui partait grand vainqueur, perd sans doute plus dans l’aventure (c’est lui qui l’a voulu, il mérite donc sa punition) que Neïla qui après avoir subi mille avanies et les plus incroyables humiliations, tire parti (brillamment !) de ce qu’elle a enduré et en fait son bien.
Le réalisateur lui-même est bien trop malin pour suggérer platement une évolution qui serait de la plus sotte banalité (et pourtant attendue peut-être par quelques âmes sentimentales dans le public !). Non, il n’y a évidemment pas d’amour possible entre ces deux-là et la différence reste ce qu’elle est. Mais ce n’est pas une raison pour être idiot ou buté et borné. Daniel Auteuil le dit à sa manière dans un entretien qu’il a donné à la suite du film : Ce qui me plaisait dans ce film, c’était que, par l’intelligence de ces deux êtres qui allaient se rencontrer, on allait pouvoir traverser les frontières, les abolir, tout comme le fossé de générations, de culture ou de religion. Il y avait à la fois un sujet drôle et grave.
Il se pourrait que dans son enthousiasme, l’acteur, dont la prestation est ici magnifique, aille un peu plus loin (dans le sens de l’optimisme) que ne l’indique le réalisateur. Ce qu’il fait dire à Neïla, dans la dernière partie du film, où elle témoigne de la brillante (!) éloquence qu’elle doit à son Maître Pierre Mazard, ne signifie pas qu’aucune des différences dont il a été question soit abolie, bien au contraire. Elles sont ce qu’elles sont et elle les maintient en tant que telles avec le franc-parler qui ne l’a jamais quittée. La preuve en est d’ailleurs dans le fait que les deux personnages ne sont pas symétriques et ne connaissent pas forcément une évolution identique. Ayant affaire avec Daniel Auteuil à un acteur hors classe au sommet de son talent, il choisit de le laisser aux prises avec de subtiles ambiguïtés, que Pierre Mazard lui-même préfère peut-être ne pas analyser complétement, pour s’éviter ce que certaines vérités auraient de trop cruel.
La morale de la fable, pour reprendre ces termes, serait alors que de fortes appartenances , et de fortes différences, ne doivent nullement empêcher des échanges —et les plus rebelles à cette idée sont peut-être ceux qui ont le plus à y gagner. Dans l’ultime épisode du film, on voit Neïla, devenue avocate, appliquer à l’un de ses clients, jeune délinquant d’origine maghrébine et se réfugiant dans les aspects les plus caricaturaux de celle-ci, les préceptes qu’elle a reçus de Pierre Mazard. Preuve qu’elle en a compris toute la valeur et l’efficacité (ce qu’elle a d’ailleurs dit plusieurs fois auparavant) et preuve aussi qu’elle croit en la possibilité de la transmission, voire en sa nécessité, sous peine d’une néfaste stagnation qui est inévitable si on s’enferme dans les limites d’un Moi identitaire.
Denise Brahimi

« L’ART DE PERDRE » d’Alice Zeniter (Flammarion, 2017)
Toute tentative pour résumer brièvement L’art de perdre est vouée à perdre ( !) ce qui fait l’originalité de ce livre, revendiquée par son auteur. Risquons une phase comme celle-ci : C’est l’histoire d’une famille de harkis rapatriée en France en 1962 et vue sur trois générations : celle du grand-père Ali, celle du père Hamid, et celle de Naïma la narratrice du livre qui est en partie une figure de l’auteure elle-même (née en 1986 et donc âgée de trente et un ans au moment où elle écrit ce livre qui est son quatrième roman).
 Dans cette présentation, seuls les détails qui concernent l’auteure sont purement factuels et peuvent être considérés comme relevant de l’information. Pour le reste, on ne peut rendre justice au livre—qui est de belle taille, 500 pages largement—sans expliquer ce qu’Alice Zeniter n’a pas voulu faire, avant d’en venir aux qualités originales et remarquables de ce qu’elle a fait. On peut certes parler d’une fresque historique, qui commence d’ailleurs bien avant 1962, par exemple au début des années 40 lorsqu’Ali s’engage dans l’armée française à l’âge de 22 ans et participe, notamment, à la tristement célèbre bataille de Cassino. Globalement et grâce à un découpage très clair en trois parties, les faits sont racontés de manière linéaire mais on comprend vite que cette trame n’est qu’un support (certes indispensable) pour que chaque situation vécue par les personnages soit analysée par l’auteure dans sa singularité individuelle. On serait tenté par exemple de dire qu’Ali n’est pas un harki selon la définition habituelle du mot, ce qui voudrait dire qu’il a servi dans une harka ou formation de supplétifs musulmans aux côtés de l’armée française, et notamment pendant la Guerre d’Algérie. Il ne l’a pas fait mais il est vrai qu’il a cru résolument au maintien de la présence française en Algérie, en dépit du combat indépendantiste mené par le FLN, dont certains comportements lui ont d’ailleurs paru inacceptables. C’était une erreur et le moment est venu où il courait grand risque de la payer au prix de sa vie et celle des siens—la seule solution étant alors de partir en France. Alice Zeniter fait à travers Ali le portrait du paysan kabyle aisé qu’il était devenu, dans le contexte villageois traditionnel qu’elle ne cherche pas à idéaliser, ni d’ailleurs l’inverse. Une partie de son art d’écrire consiste à ne pas porter elle-même de jugements (sinon subliminaux plutôt qu’explicites) mais à pousser ses lecteurs à la réflexion qui seule peut donner aux faits chair et épaisseur.
Dans cette présentation, seuls les détails qui concernent l’auteure sont purement factuels et peuvent être considérés comme relevant de l’information. Pour le reste, on ne peut rendre justice au livre—qui est de belle taille, 500 pages largement—sans expliquer ce qu’Alice Zeniter n’a pas voulu faire, avant d’en venir aux qualités originales et remarquables de ce qu’elle a fait. On peut certes parler d’une fresque historique, qui commence d’ailleurs bien avant 1962, par exemple au début des années 40 lorsqu’Ali s’engage dans l’armée française à l’âge de 22 ans et participe, notamment, à la tristement célèbre bataille de Cassino. Globalement et grâce à un découpage très clair en trois parties, les faits sont racontés de manière linéaire mais on comprend vite que cette trame n’est qu’un support (certes indispensable) pour que chaque situation vécue par les personnages soit analysée par l’auteure dans sa singularité individuelle. On serait tenté par exemple de dire qu’Ali n’est pas un harki selon la définition habituelle du mot, ce qui voudrait dire qu’il a servi dans une harka ou formation de supplétifs musulmans aux côtés de l’armée française, et notamment pendant la Guerre d’Algérie. Il ne l’a pas fait mais il est vrai qu’il a cru résolument au maintien de la présence française en Algérie, en dépit du combat indépendantiste mené par le FLN, dont certains comportements lui ont d’ailleurs paru inacceptables. C’était une erreur et le moment est venu où il courait grand risque de la payer au prix de sa vie et celle des siens—la seule solution étant alors de partir en France. Alice Zeniter fait à travers Ali le portrait du paysan kabyle aisé qu’il était devenu, dans le contexte villageois traditionnel qu’elle ne cherche pas à idéaliser, ni d’ailleurs l’inverse. Une partie de son art d’écrire consiste à ne pas porter elle-même de jugements (sinon subliminaux plutôt qu’explicites) mais à pousser ses lecteurs à la réflexion qui seule peut donner aux faits chair et épaisseur.
A la génération suivante, qui est celle des auteures de témoignages connus, tels que « Fille de harki » de Fatima Besnaci-Lancou (2005), ou « Mon père ce harki » de Dalila Kerchouche (2003), Hamid fils d’Ali est vu d’aussi près que peut l’être tout personnage d’un roman de formation soumis à une analyse aiguë, à la fois singulière et générationnelle.
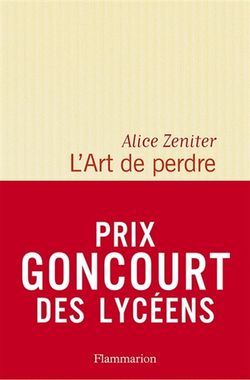 On ressent chez Alice Zeniter une sorte d’intérêt passionné pour l’adolescence et l’entrée dans la vie de cet homme qui aurait pu être son père mais qu’elle recrée en grande partie par la fiction—ce qu’elle rappelle elle-même à divers moments. Il ne s’agit pas d’un document qui voudrait se tenir au plus près de ce qu’a été la réalité à force de recherches, d’enquêtes et d’entretiens, cette manière serait d’autant moins possible qu’elle fait du personnage d’Hamid un taiseux, qui à partir d’un moment a décidé en toute conscience d’éliminer l’Algérie de sa vie et qui ne reviendra jamais sur cette décision. L’auteure fait admirablement comprendre ce qu’il en est de cette vie, qui d’une part a été entièrement déterminée par un ensemble de faits historiques très lourds, mais qui d’autre part s’est réalisée à partir de l’affirmation personnelle d’une liberté. Hamid a senti, il a su que pour devenir un homme, il lui fallait se tenir à un indispensable rejet de l’Algérie, attitude dont on ne peut rien dire sinon qu’elle est aux confins de la contrainte et de la liberté. L’empathie de la narratrice pour le personnage d’Hamid le rend pathétique, non sans que soit maintenu une certaine distance qui préserve son goût du silence et de toute manière son ou ses choix.
On ressent chez Alice Zeniter une sorte d’intérêt passionné pour l’adolescence et l’entrée dans la vie de cet homme qui aurait pu être son père mais qu’elle recrée en grande partie par la fiction—ce qu’elle rappelle elle-même à divers moments. Il ne s’agit pas d’un document qui voudrait se tenir au plus près de ce qu’a été la réalité à force de recherches, d’enquêtes et d’entretiens, cette manière serait d’autant moins possible qu’elle fait du personnage d’Hamid un taiseux, qui à partir d’un moment a décidé en toute conscience d’éliminer l’Algérie de sa vie et qui ne reviendra jamais sur cette décision. L’auteure fait admirablement comprendre ce qu’il en est de cette vie, qui d’une part a été entièrement déterminée par un ensemble de faits historiques très lourds, mais qui d’autre part s’est réalisée à partir de l’affirmation personnelle d’une liberté. Hamid a senti, il a su que pour devenir un homme, il lui fallait se tenir à un indispensable rejet de l’Algérie, attitude dont on ne peut rien dire sinon qu’elle est aux confins de la contrainte et de la liberté. L’empathie de la narratrice pour le personnage d’Hamid le rend pathétique, non sans que soit maintenu une certaine distance qui préserve son goût du silence et de toute manière son ou ses choix.
A la fois narratrice et personnage de cette histoire, Naïma qui est le double d’Alice dans la fiction, évite par cette ambiguïté le rabattement sur l’autobiographie. On sent à différents moments du récit que son rôle est annoncé et qu’elle porte une responsabilité particulière dans le rapport entre réalité et fiction mais c’est à sa place et à sa génération, en tant que personnage, qu’il lui appartient de faire ce retour en Algérie différé voire impossible pendant les deux vies successives de ceux qui l’ont précédée. Retour d’ailleurs ponctuel et incertain dans sa signification ou dans ses suites éventuelles, l’auteure s’opposant à ce qu’on y voit une sorte de dénouement attendu. Les raisons de ce retour sont en grande partie aléatoires : fidèle à la caractéristique si intéressante de son roman, Alice Zeniter donne le sentiment que sans doute, un jour, il devait avoir lieu, mais que sans doute aussi les faits finalement restent anecdotiques et sans vraie conséquence.
C’est autour d’un personnage d’artiste, peintre d’origine algérienne ayant vécu en France, que se centrent et se formulent les réflexions de Naïma à la suite de son voyage. L’art de ce peintre, tel qu’elle l’analyse, est sa manière à elle d’aller au plus profond de ce qu’elle perçoit dans l’algérianité, diffuse et pourtant présente dans sa famille paternelle. De sa mixité qu’elle revendique et qui lui plaît, l’algérianité est la partie la plus secrète voire mystérieuse et occultée (en tout cas par Hamid). L’impression complexe et forte qu’on retient du sentiment de Naïma à cet égard est que d’une part elle mesure le poids de souffrance qui en est résulté pour des êtres que l’imagination créatrice lui rend consubstantiels et profondément intimes, mais que d’autre part tout est à construire par elle et par elle seulement de sa propre vie, qui pourrait très bien ne pas être déterminée par cela.
Il est rare qu’Alice Zeniter se laisse aller à des réflexions explicites sur le sens de la vie, le rôle qu’y jouent les appartenances ou les événements. Mais beaucoup plus subtilement elle fait sentir que c’est le sujet dont elle traite et auquel on n’échappe pas.
Denise Brahimi
« LES LENDEMAINS D’HIER » d’Ali Bécheur (Elyzad, 2017)
Ali Bécheur est actuellement considéré comme le plus éminent des écrivains tunisiens, car il a derrière lui une œuvre considérable, romans et nouvelles, et a été couronné par de nombreux prix. Son dernier livre, Les Lendemains d’hier, signifie clairement qu’il pense avoir atteint l’âge des bilans, étant né en 1939 à Sousse.

Copyright-Juan-Angel-de-Corral-2015
Bien qu’il le range dans la catégorie « roman » sans doute pour se laisser une plus grande liberté, on ne peut manquer de penser que ce livre est largement autobiographique, d’autant qu’on y trouve abondance de dates, qui sont des références précises à des moments historiques marquants, aussi bien pour l’histoire de la Tunisie, qu’il suit pendant un siècle, que pour sa propre histoire. Mais il vaudrait mieux dire qu’en fait, c’est l’histoire des relations entre le narrateur et son père qui est le véritable sujet du livre ; ce père, Omar, est mort en 2008, et c’est à partir de cette date que commence le travail du souvenir. Travail d’écriture puisqu’ Ali Bécheur n’a pas cessé de se vouloir écrivain depuis son retour de France et son installation en Tunisie comme professeur de droit et comme avocat.
S’agissant de littérature et de mémoire, on ne sera pas étonné qu’Ali Bécheur se donne Proust comme référence ; mais il faut ajouter aussitôt que dans Les Lendemains d’hier (pas très convaincant, ce titre, le livre méritait mieux) on sent aussi l’influence de Céline, de son cynisme affiché et de son ton cru. C’est certainement à Proust qu’Ali Bécheur doit sa conception de la mémoire, qui ne saurait être volontaire ni organisée logiquement, mais ne cesse de circuler entre passé et présent. Le lecteur est aidé par les indications de dates déjà évoquées précédemment, mais le tissage des temps, fort complexe, auquel se livre le romancier, a parfois ou même souvent pour effet qu’on superpose l’histoire du père Omar et du fils le narrateur, que séparent une trentaine d’années. Tel est le mode d’écriture de ce livre, qui de toute façon déclare l’impossibilité de reconstituer l’histoire du père autrement que par l’imagination et l’empathie du fils : tant il est vrai qu’Omar était un homme secret, image d’une société aux valeurs anciennes où il n’était pas convenable de parler de soi. Société où les relations d’un père à son fils se fondaient sur l’autorité, l’exigence et l’expression constante de l’insatisfaction du premier à l’égard du second. Quelles que soient les bribes de la vie de son père glanées par le narrateur (mot à prendre à son sens totalement proustien), c’est par un effort personnel qu’il fait surgir cet homme du quasi mutisme où il s’enfermait et c’est sans doute pourquoi il lui a fallu plusieurs années avant de se sentir en état de livrer au public le livre qui en est résulté. Bien d’autres l’ont précédé, mais on peut penser que le sujet de celui-ci était particulièrement difficile à aborder et à exprimer.
On retrouve évidemment dans Les Lendemains d’hier des aspects ou des thèmes présents dans ses livres précédents, tels que la présence des femmes et les souvenirs d’une enfance forcément inoubliables. Ici, c’est le parcours historique de la Tunisie pendant un siècle qui permet d’encadrer cette dernière, l’enfance du narrateur, et de lui donner un arrière-plan événementiel. Toute la période du protectorat est incluse dans le livre et sans la moindre concession à la nostalgie, bien au contraire. Le diagnostic est impitoyable à l’égard de ceux que la terminologie officielle du Protectorat désignait comme « les prépondérants » nous dit l’auteur, qui ironise sur ce terme… Il est vrai que si les débuts du Néo-Destour sont racontés avec sympathie, voire avec enthousiasme, les choses se gâtent considérablement pendant la période, 1957-1987, où Bourguiba est au pouvoir. Pour autant les avatars de la période Ben Ali et ses turpitudes ne sont pas ignorés. C’est peut-être le moment de revenir aux aspects céliniens de ce roman, tant il est vrai qu’en l’espace de vingt-trois ou vingt–quatre ans (1987-2011), la situation a eu le temps de dégénérer jusqu’à atteindre les bas-fonds : « La nouveauté, c’est l’avènement d’une nouvelle mafia, intrigant, magouillant, népotisant, clientèlisant et clientèlisée, pillant, rackettant, spoliant, détournant les deniers publics, dilapidant l’argent des contribuables, s’engraissant des bénéfices de la contrebande, corrompant et corrompue. »
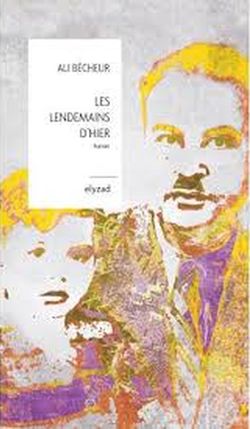 Est-ce à dire pour autant que la « Révolution du jasmin » séduit et convainc l’auteur du livre ? Le peu qu’il en dit montre son scepticisme, c’est le moins qu’on puisse dire : « Si la démocratie, c‘est pérorer sans fin, déblatérer, faire la roue, alors d’accord, pérorons, déblatérons, faisons la roue (…) C’est dans nos têtes qu’il faudra d’abord la faire, la révolution. Sinon, ce sera rebelote. »
Est-ce à dire pour autant que la « Révolution du jasmin » séduit et convainc l’auteur du livre ? Le peu qu’il en dit montre son scepticisme, c’est le moins qu’on puisse dire : « Si la démocratie, c‘est pérorer sans fin, déblatérer, faire la roue, alors d’accord, pérorons, déblatérons, faisons la roue (…) C’est dans nos têtes qu’il faudra d’abord la faire, la révolution. Sinon, ce sera rebelote. »
Globalement, il se dégage du livre un certain nihilisme, qui peut s’expliquer par le fait que, lorsque le narrateur pense à son enfance, il constate la complète disparition de ce qu’était pour lui le monde d’alors, et notamment de tous les garçons et filles qui étaient ses camarades de chaque jour, aussi divers que possible mais réunis désormais dans une même absence. Le charme et la profondeur du livre viennent de son ambiguïté à cet égard. La société tunisienne du protectorat était politiquement détestable mais humainement fort plaisante : « Pourtant les jeux de l’enfance ne s’embarrassaient guère des disparités ethniques, confessionnelles ou langagières, alors que l’âge dit de raison n’avait de cesse d’ériger des barrières derrière lesquelles les diverses communautés se barricadaient. Ceux que l’enfance rassemblait, la puberté avait tôt fait de les séparer. On peut discerner en arrière-plan de cette manière d’apartheid un impératif endogamique à forte connotation sexuelle. »
La disparité ethnique a disparu, l’enfance aussi, et la tonalité du livre s’en ressent, même si l’auteur est suffisamment sévère à l’égard de cette période pour qu’on ne puisse parler de nostalgie. Elle est forcément impensable pour ceux qui étaient les exclus de l’apartheid. Mais Ali Bécheur n’est pas de ceux qui ignorent la complexité des sentiments, c’est elle qui fait la riche matière de son roman.
Denise Brahimi
RIRES ET INSIGNIFIANCE A CASABLANCA d’Issam-Eddine Tbeur (Virgule Editions 2015)
Participant au Colloque de Lyon et de Grenoble « Créer/publier en français aujourd’hui depuis le Maghreb » du 5 au 8 décembre 2017, Fouad Mehdi, enseignant-chercheur à l’université de Meknes a bien voulu nous confier un résumé de son intervention très appréciée sur un livre de nouvelles d’issam-Eddine Tbeur.
« De la littérature comme représentation du monde à la littérature comme quête de sens »
Depuis le début des années quatre vingt-dix du siècle dernier, la littérature marocaine d’expression française rompt avec l’hermétisme d’un Khatibi ou d’un Edmond Amran El Maleh pour réhabiliter l’intrigue. La fiction narrative, devenant plus lisible, se fixe désormais pour objectif de représenter le réel à travers le prisme de la satire. Il était pour ainsi dire normal que, dans ce contexte, la nouvelle, dont la fonction première est de raconter une histoire, connaisse un regain d’intérêt.
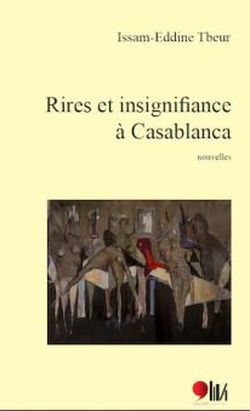 Il convient donc de replacer Rires et insignifiance à Casablanca, recueil de nouvelles paru en 2015 chez Virgule Editions, dans cette perspective. Le lecteur attendait d’Issam-Eddine Tbeur un discours sur Casablanca et, partant, sur le monde, il trouve un discours sur la littérature. D’emblée, ce qui frappe est une représentation particulière du réel d’essence mimétique car elle fait de la scène son mode d’expression privilégié. Dans bon nombre de récits, en particulier dans « Moins que zéro » et « Seul l’émerveillement est permis », l’espace diégétique est décrit comme une scène (au sens matériel) qu’il faut conquérir.
Il convient donc de replacer Rires et insignifiance à Casablanca, recueil de nouvelles paru en 2015 chez Virgule Editions, dans cette perspective. Le lecteur attendait d’Issam-Eddine Tbeur un discours sur Casablanca et, partant, sur le monde, il trouve un discours sur la littérature. D’emblée, ce qui frappe est une représentation particulière du réel d’essence mimétique car elle fait de la scène son mode d’expression privilégié. Dans bon nombre de récits, en particulier dans « Moins que zéro » et « Seul l’émerveillement est permis », l’espace diégétique est décrit comme une scène (au sens matériel) qu’il faut conquérir.
« Les hirondelles de Casablanca » est une nouvelle écrite comme une tragédie. Tous les ingrédients s’y trouvent rassemblés : un « chœur de douze voix » (p. 97), une forte unité d’action, la description d’un moment où un destin bascule et la condensation des évènements en une journée, ce qui évidemment rappelle la temporalité tragique.
Mieux encore, et au-delà du décorum tragique, les récits sont le lieu de la mise en texte d’une vision tragique. A des degrés divers, les personnages de Tbeur pâtissent de l’emprise d’une force d’autant plus irrésistible qu’elle est insaisissable. Appelée « providence » (« Moins que zéro »), ou « destin », « chance » (« Moroccan gigolo »), ou encore « fatalité » (« Les hirondelles de Casablanca »), cette force actionne la machine infernale des évènements qui s’enchaînent comme une mécanique effroyable. Tant et si bien que les personnages de Tbeur peuvent parfaitement reprendre à leur compte les célèbres vers raciniens : « Mais admire avec moi le sort dont la poursuite/Me fait courir alors au piège que j’évite. ». Dans « La barbe du prophète », Ali, que le narrateur qualifie de « piètre musulman » qui « ne priait jamais » (p. 30), devient, à son corps défendant, le dépositaire d’un objet sacré : la barbe du prophète. Dans « Moroccan gigolo », Mohamed, fort de son expérience de séducteur aguerri, pénètre dans l’enceinte du Club Med en conquérant- cette entrée est d’ailleurs fortement théâtralisée -. Il en sort avec les stigmates d’un corps conquis. Après avoir été le chasseur, il devient la proie. Dans « Moins que rien », le jeune étudiant estime que les « querelles politiques ne le regardaient pas » ; il n’empêche que bien malgré lui, il en devient un acteur privilégié.
Pourtant, cette vision est contrebalancée par un traitement littéraire qui en désamorce le caractère sérieux. Sublime et burlesque cohabitent dans une combinatoire dont les voix sont parfaitement orchestrées. Tbeur construit l’ethos d’un lecteur qui n’adhère pas à l’illusion référentielle, qui, au contraire, est conscient du caractère résolument factice du récit. Le maître-mot de cette prise de conscience est la distance.
Cette distance est intéressante à étudier surtout quand le personnage et le narrateur se confondent. Un jeu de distanciation s’installe entre les deux instances soulignant l’inconsistance du moi et par là-même de la diégèse. Le lecteur est en permanence appelé à faire preuve de vigilance. Dans « Ceci n’est pas une nouvelle », la recherche d’un positionnement dans le champ littéraire marocain passe par la stratégie de la mystification. Le narrateur, un tantinet joueur, instrumentalise le sérieux du personnage pour donner la mesure de sa compétence créative. Mais il s’empresse d’ajouter en guise de chute- et c’est précisément pourquoi « Ceci n’est pas une nouvelle » est une nouvelle-, que tout lecteur qui se laisserait prendre à ce « subterfuge » (p. 17) serait « dupe » (p. 17).
Dans « Seul l’émerveillement est permis », le jeu de distanciation impacte jusqu’au système de valeurs le condamnant à un haut coefficient d’ambiguïté. Au fond, ce récit est l’histoire d’un ambitieux qui veut pénétrer au sein du cercle intime du roi tout en se moquant de ce que ce système représente. C’est l’histoire d’une ascension tant recherchée et pourtant systématiquement décriée. Dès l’orée du texte, le ton est donné : « Evidemment j’étais attiré par le privé, pour des raisons plus culturelles que financières. Les vieux croûtons des ministères publics, les secrétaires voilées et enceintes jusqu’au menton, les chefs de services marqués par la fatigue et les stigmates de l’incompétence…Non, merci ! ». Juste après, le narrateur ajoute : « Pourtant c’est bien le secteur public que j’ai choisi. Par sens du patriotisme… » (p. 35). On le voit bien, l’argumentation va dans un sens pendant que le choix qui s’ensuit va dans le sens opposé. D’où la mise en italique de mots tels que « culturelles » et « patriotisme ». Ce choix permet au narrateur-personnage de prendre du recul par rapport à son propre système de valeurs. Le lecteur est, de ce fait même, appelé à faire preuve de défiance. Il est d’une certaine manière l’image inversée du ministre qui, impressionné par l’éloquence du personnage, « a marché à son laïus. » (p. 77). Le ministre devient ainsi dans la fiction l’image inversée du bon lecteur.
 Ce jeu de distanciation est un puissant vecteur de décalages, la marque de fabrique de l’esthétique de Tbeur. Ces décalages ont pour effet de mettre mal à l’aise le lecteur, de le gêner dans l’exercice d’une lecture reposante ou divertissante. Globalement, les nouvelles de Tbeur se caractérisent par une discordance entre l’inspiration livresque classique (par exemple Shakespeare et Edgar Allan Poe) et le lexique familier, parfois argotique. Dans « Seul l’émerveillement est permis »), une tension féconde se crée entre la sphère sacrale du roi et le registre scatologique qui envahit le récit de bout en bout. L’entrevue avec le roi devait être le point d’orgue de la nouvelle. Mais une autre action vient la reléguer dans une seconde zone : « -Pourriez-vous [demande le narrateur-personnage au maître chambellan], avant que Sa Majesté me reçoive, m’indiquer le chemin des toilettes ? Un besoin pressant !! » (p. 46).
Ce jeu de distanciation est un puissant vecteur de décalages, la marque de fabrique de l’esthétique de Tbeur. Ces décalages ont pour effet de mettre mal à l’aise le lecteur, de le gêner dans l’exercice d’une lecture reposante ou divertissante. Globalement, les nouvelles de Tbeur se caractérisent par une discordance entre l’inspiration livresque classique (par exemple Shakespeare et Edgar Allan Poe) et le lexique familier, parfois argotique. Dans « Seul l’émerveillement est permis »), une tension féconde se crée entre la sphère sacrale du roi et le registre scatologique qui envahit le récit de bout en bout. L’entrevue avec le roi devait être le point d’orgue de la nouvelle. Mais une autre action vient la reléguer dans une seconde zone : « -Pourriez-vous [demande le narrateur-personnage au maître chambellan], avant que Sa Majesté me reçoive, m’indiquer le chemin des toilettes ? Un besoin pressant !! » (p. 46).
En lisant les récits de Tbeur, le lecteur réalise que le discours sur le monde tourne au discours sur la littérature. L’écrivain donne à voir l’objet littéraire en représentation. « Ceci n’est pas une nouvelle » est l’histoire d’un récit qui se raconte en s’écrivant, c’est-à-dire qu’il met en scène sa propre genèse. Mais n’allons pas croire que la littérature se réduit à sa dimension ludique, comme c’est le cas dans le récit mentionné précédemment. Car pour peu que le jeu soit pris au sérieux, il peut virer au tragique comme cela arrive dans « La vieille du Don Quichotte » dont le protagoniste confond fiction et réalité et commet l’irréparable.
La littérature est en réalité le prisme à travers lequel la vie fait sens. C’est probablement ce qui explique que Tbeur a tendance à mettre en scène ses références littéraires. C’est que la littérature permet à la vie de se révéler à elle-même. La littérature n’est pas un arsenal de techniques ou un exercice de style. Dans « Les hirondelles de Casablanca », la bande des révolutionnaires l’a appris à ses dépens, elle qui voulait faire la révolution par une citation de Shakespeare, transformée, pour les besoins de la cause, en slogan. Sans doute faut-il voir dans cet échec la consécration de la littérature comme discours polysémique qui tourne le dos à un usage fonctionnel pour tenter de dire, au-delà des apparences, l’essence du monde.
Fouad MEHDI
Université Moulay Ismaël
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Groupe de Recherche en Art et Littérature. Meknès.
« OUALOU EN ALGERIE » (scenario de GYPS, dessins de Lounis Dahmani, éditions La boîte à bulles)
 Nos amis GYPS (Karim Mahfouf) et Dahmani sont habitués à autoéditer leurs livres. C’est un plaisir de voir cette aventure du détective privé Nadir Oualou publiée dans une maison d’édition reconnue pour son travail dans la bande dessinée. L’impression et la mise en couleurs y gagnent et mettent en relief ce récit à la fois humoristique et profond.
Nos amis GYPS (Karim Mahfouf) et Dahmani sont habitués à autoéditer leurs livres. C’est un plaisir de voir cette aventure du détective privé Nadir Oualou publiée dans une maison d’édition reconnue pour son travail dans la bande dessinée. L’impression et la mise en couleurs y gagnent et mettent en relief ce récit à la fois humoristique et profond.
Lecteur des aventures de l’inspecteur Jack Palmer (hommage au détective catastrophique de Pétillon), Nadir Oualou exerce nonchalamment son métier dans un sous-sol d’une cité du Neuf Trois. Une cliente va lui confier la mission de retrouver sa fille en Algérie. Il n’en est d’abord pas question pour lui. On retrouve une constante des histoires de détectives privés, généralement embarqués malgré eux dans des enquêtes qu’ils refusent dans un premier temps. Pour Oualou, c’est sa mère qui lui impose ce choix. Lui, « Français comme Zidane », déteste le bled, depuis tout petit.
Le voilà lancé dans une quête très bien scénarisée, qui l’amène d’Alger à Oran puis en Kabylie. Pas question d’en raconter les péripéties ni l’issue, nos lecteurs devront acquérir l’ouvrage, et aller se le faire dédicacer au prochain « Maghreb-Orient des Livres », les 2, 3 et 4 février à l’Hôtel de Ville de Paris.
 Soulignons la qualité des dessins de Dahmani, l’expressivité et la gestuelle très bien rendues de ses personnages. Le récit nous fait vivre de façon plutôt crédible et réaliste les périodes des années noires puis les sursauts qui les ont suivis par la suite, mais sur le ton cocasse cher à nos deux compères, comme le « Français comme Zidane », déjà cité et répété comme un mantra par Nadir Oualou, et les blagues sur son nom (« Ma dir oualou », tu fanfarones…).
Soulignons la qualité des dessins de Dahmani, l’expressivité et la gestuelle très bien rendues de ses personnages. Le récit nous fait vivre de façon plutôt crédible et réaliste les périodes des années noires puis les sursauts qui les ont suivis par la suite, mais sur le ton cocasse cher à nos deux compères, comme le « Français comme Zidane », déjà cité et répété comme un mantra par Nadir Oualou, et les blagues sur son nom (« Ma dir oualou », tu fanfarones…).
Cela n’empêche pas aussi des touches plus graves et très justes sur la relation compliquée de l’ « imigi » à son pays d’origine, ou la de la sentence du commissaire justicier en chaise roulante (tiens-tiens ?) « Ces derniers temps on a tellement demandé aux Algériens de pardonner ! ».
Une bande dessinée à faire entrer dans sa BDthèque.
Michel Wilson

« NATHAN LE SAGE », de Gotthold Ephraïm Lessing, mise en scène de Dominique Lurcel
 Dominique Lurcel est devenu le spécialiste incontesté de Lessing, en tout cas de cette pièce et de sa mise en scène. Les spectateurs de la région Auvergne Rhône Alpes ont pu en bénéficier en ce mois de décembre 2017 au théâtre de Givors après la représentation de novembre à Dardilly et c’est peu de dire que le metteur en scène n’en était pas à son coup d’essai. Cependant, pour qui connaît le sujet de la pièce, un magnifique éloge de la tolérance, son actualité brûlante s’impose, montrant s’il en était besoin tout ce que nous avons encore à puiser dans la pensée des Lumières, sur ce sujet indépassable. D’autant que Nathan le sage est précisément centré sur la cohabitation nécessaire et indispensable entre les trois monothéismes, chacun d’entre eux étant représenté par un des trois personnages principaux de la pièce, comme l’explique cette courte présentation qui dit l’essentiel :
Dominique Lurcel est devenu le spécialiste incontesté de Lessing, en tout cas de cette pièce et de sa mise en scène. Les spectateurs de la région Auvergne Rhône Alpes ont pu en bénéficier en ce mois de décembre 2017 au théâtre de Givors après la représentation de novembre à Dardilly et c’est peu de dire que le metteur en scène n’en était pas à son coup d’essai. Cependant, pour qui connaît le sujet de la pièce, un magnifique éloge de la tolérance, son actualité brûlante s’impose, montrant s’il en était besoin tout ce que nous avons encore à puiser dans la pensée des Lumières, sur ce sujet indépassable. D’autant que Nathan le sage est précisément centré sur la cohabitation nécessaire et indispensable entre les trois monothéismes, chacun d’entre eux étant représenté par un des trois personnages principaux de la pièce, comme l’explique cette courte présentation qui dit l’essentiel :
« Le lieu ? Jérusalem. Le moment ? 1187, la troisième Croisade : paysage de peurs, de préjugés, de violences politico-religieuses, triomphe de tous les fanatismes. Le sujet ? La rencontre, sur ce fond de ruines qu’engendrent habituellement ignorance de l’Autre et cris de « Dieu le veut ! », de trois hommes, un Musulman (Saladin), un Juif (Nathan) et un Chrétien (un jeune Templier). »
A partir de là, on comprend comment un metteur en scène contemporain peut juger indispensable la représentation de ce « Nathan le Sage », dans un monde « cerné par les replis identitaires, les folies nationalistes et intégristes », comme le dit encore la brève présentation de la pièce dont ont bénéficié les spectateurs de Givors.
L’étonnant travail accompli par Lessing, malgré ou à cause des obstacles considérables que pouvaient rencontrer ses idées en son temps et en son lieu, consiste à briser menu minutieusement, consciencieusement, les croyances les plus ancrées dans chacune des trois communautés religieuses à l’égard des deux autres, hostilité de type raciste et préjugés ancestraux évidemment réactivés par le contexte historique qui est celui des Croisades. Lessing partage pleinement la dénonciation de ces entreprises guerrières qu’on trouve aussi bien chez Voltaire. En cette affaire les agresseurs sont les Chrétiens, c’est pourquoi on ne saurait dire que Lessing maintient la balance égale entre les trois communautés, c’est de loin le jeune Templier qui est le plus agressif et à l’occasion le plus arrogant. Mais c’est d’abord chez lui une question d’âge, Nathan le Juif et Saladin le Musulman ont la sagesse du leur.
De toute manière, le problème de Lessing n’est pas de peser ni d’équilibrer les qualités ou les défauts propres aux trois monothéistes, il est de montrer, par des moyens proprement théâtraux, qu’ils sont en fait profondément imbriqués les uns dans les autres et que c’est le principe même de leur séparation et de leurs affrontements (voulus comme inexpiables par les va-t-en-guerre de tous les camps), qui est une absurdité.
Pour le faire comprendre, Lessing qui entre autres a beaucoup lu Shakespeare, procède à la manière aventureuse et parfois rocambolesque de celui-ci, à une série de révélations dont le problème n’est pas qu’elles soient vraisemblables ou non. L’humour aussi fait partie des armes dont il a besoin ! C’est ainsi qu’on découvre peu à peu toute une série de liens familiaux qui mettent en cause les clivages apparents. La fille supposée du Juif (en fait c‘est sa fille adoptive) est née de parents chrétiens, et elle se trouve être la sœur du jeune Templier. Mais ce n’est qu’un début car il se trouve que l’une et l’autre sont les enfants du Musulman Assad,
converti au christianisme et frère disparu de Saladin, qui à la suite de cette découverte les considère comme ses propres enfants. On voit donc que toute l’intrigue de la pièce vise à créer des liens entre ceux et celles que leur appartenance ethnico-religieuse montrait d’abord comme séparés irrémédiablement.
A quoi s’ajoute une affirmation de Lessing qui n’est pas moins à contre-courant et bien digne de l’Aufklärung ou pensée allemande des Lumières : la naissance biologique ne prévaut pas sur l’adoption. Qu’on mesure l’importance de cet ébranlement infligé aux plus solides convictions ! On comprend pourquoi la pièce n’a été jouée que tardivement, après la mort de Lessing.
Denise Brahimi
 La troisième mise en scène de cette pièce par Dominique Lurcel, qui en a fait aussi une traduction modernisée était justifiée par l’urgence ressentie face aux évènements récents qui ont déchiré des vies et bouleversé l’opinion.
La troisième mise en scène de cette pièce par Dominique Lurcel, qui en a fait aussi une traduction modernisée était justifiée par l’urgence ressentie face aux évènements récents qui ont déchiré des vies et bouleversé l’opinion.
Dominique Lurcel a choisi de réduire au minimum les effets de mise en scène pour mettre en avant les acteurs et leur jeu. Un tapis dessiné spécialement par un jeune créateur, et tissé par les femmes d’Alfenzine, au Maroc est le lieu géométrique autour duquel tourne une intrigue pourtant foisonnante. Et une distribution impeccable en tenue contemporaine donne vie, profondeur autant que légèreté à un texte abondant.
Le Nathan de Samuel Churin est la bonté et la sagesse même, et rivalise en noblesse avec le perspicace Saladin-Gérard Cherqui. Le jeune templier est joué comme un chien fou par le séduisant Jérôme Cochet.
Les femmes jouent un rôle essentiel dans le déroulement de l’intrigue, la jeune Laura Segret joue une vibrante fille adoptive de Nathan autour de qui se noue le récit. La servante chrétienne de Nathan, Daja, est jouée avec finesse et malice par Christine Brotons. Faustine Tournan joue avec crédibilité la clairvoyante et généreuse Sittah, sœur de Saladin. Inquiétant et machiavélique, le Patriarche de Joel Lokossou incarne toute la puissance scénique de ce comédien, qui nous avait bluffés dans le Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire, mis en scène par Renaud Lécuyer. Joel Lokossou joue également le Derviche, au début de la pièce, avec une grande drôlerie. Une mention toute particulière pour le malicieux frère lai joué par Tadié Tuéné.
 Toute cette troupe sert efficacement le message subtil de Lessing, et le public est séduit par l’intelligence et l’humour de ce spectacle. Il faut souhaiter que les programmateurs permettent d’apporter cette belle pièce au plus grand nombre de spectateurs.
Toute cette troupe sert efficacement le message subtil de Lessing, et le public est séduit par l’intelligence et l’humour de ce spectacle. Il faut souhaiter que les programmateurs permettent d’apporter cette belle pièce au plus grand nombre de spectateurs.
Michel Wilson

LA SECHERESSE DU FIGUIER DE BARBARIE (Dessins) de Fatima-Azzahra KHOUBBA
(Galerie Dettinger-Mayer 4, place Gailleton 69002 Lyon, du 2 décembre 2017 au 15 janvier 2018)
Cette galerie, expose de superbes objets d’art primitif, et des peintres contemporains, avec un axe privilégié sur des artistes mêlant des formes d’écriture à du dessin et de la peinture.
 C’est tout à fait le cas de l’œuvre de la Lyonnaise franco-marocaine Fatima-Azzahra KHOUBBA. Ses tableaux, grands ou petits, sont à première vue des silhouettes bleues, sur fond blanc, des archipels, des lagunes, des dentelles d’où ressortent des formes qu’on peut trouver menaçantes, des chevaux cabrés ou des « Quetzalcoatl » aztèques, comme celles que composent les nuages dans le ciel, qui s’évanouissent ou se transforme au grès du vent. C’est du reste par référence au ciel et à la mer que l’artiste choisit maintenant le bleu sur fond blanc.
C’est tout à fait le cas de l’œuvre de la Lyonnaise franco-marocaine Fatima-Azzahra KHOUBBA. Ses tableaux, grands ou petits, sont à première vue des silhouettes bleues, sur fond blanc, des archipels, des lagunes, des dentelles d’où ressortent des formes qu’on peut trouver menaçantes, des chevaux cabrés ou des « Quetzalcoatl » aztèques, comme celles que composent les nuages dans le ciel, qui s’évanouissent ou se transforme au grès du vent. C’est du reste par référence au ciel et à la mer que l’artiste choisit maintenant le bleu sur fond blanc.
En s’en approchant, le visiteur découvre que ces taches bleues sont composées d’une multitude de triangles dessinés à l’encre, accolés les uns aux autres, eux-mêmes remplis de petites spirales ou d’autres triangles. L’artiste, dont les parents sont de Casablanca pour l’un, du village de Tamelalt, près de Marrakech, pour l’autre, me raconte que depuis l’âge de 12 ans, elle a entrepris cette démarche qui alimentait son imaginaire, et constituait comme un exutoire à une dyslexie qui lui faisait redouter l’expression écrite. Une sorte de journal intime graphique, dont elle a gardé tous les exemplaires, classés. Tamelalt lui a fourni le titre de son exposition, avec ses grands buissons de figuiers de barbarie, qui composent eux aussi des entrelacs hérissés.
Elle n’a jamais cessé depuis, plusieurs heures par jour, d’abord un peu plus brut qu’aujourd’hui où ses « passe-temps », comme elle les appelle, sont plus fins et monochromes. Les grandes pièces sont réalisées à plat, cachées par un drap qui ne dévoile qu’à l’aboutissement la forme complète.
 Comme je lui fais remarquer qu’un exercice visuel permet au spectateur de privilégier soit la forme bleue, soit son négatif, la forme blanche, différente, comme une double lecture de chaque œuvre, l’artiste me dit qu’elle n’en a pris conscience que récemment. Comme si chaque œuvre apparaissait dans son entièreté à son insu, en bleu et en blanc. Elle souhaiterait travailler à l’avenir sur de plus grandes pièces.
Comme je lui fais remarquer qu’un exercice visuel permet au spectateur de privilégier soit la forme bleue, soit son négatif, la forme blanche, différente, comme une double lecture de chaque œuvre, l’artiste me dit qu’elle n’en a pris conscience que récemment. Comme si chaque œuvre apparaissait dans son entièreté à son insu, en bleu et en blanc. Elle souhaiterait travailler à l’avenir sur de plus grandes pièces.
Autodidacte, elle explore parallèlement un autre style, plus figuratif.
Les paysages étranges qu’elle fait émerger font parfois penser à la peinture aborigène, qui dessine des paysages symboliques et oniriques. Pour autant, l’association du bleu et du blanc donne un caractère résolument méditerranéen à son travail, qui appelle à ma mémoire des îles grecques, Sidi Boussaïd ou des façades d’Alger.
Un bel univers à découvrir avant la fin de l’exposition, pour qui passe à Lyon.
Michel Wilson

- Jusqu’au 15 janvier 2018, Exposition « La sécheresse du figuier de barbarie », de Fatima-Azzahra Khoubba, à Lyon, Galerie Dettinger-Meyer
- Jeudi 25 janvier à 18h Conférence d’Abderahmen Moumen sur « Les lieux de mémoire de la guerre d’Algérie » à Clermont-Ferrand


