Cultures franco-maghrébines – Lettre #16
ÉDITO
Notre lettre de novembre vous emmène à Sidi-Bel-Abbes où sont né-e-s deux des auteur-e-s que nous avons lu-e-s pour vous (et pour nous, rassurez-vous!). Pas la ville de Maïssa Bey d’aujourd’hui, mais la ville coloniale, théâtre de deux superbes récits. Nous parlerons aussi de femmes : les Algériennes en France confrontées à la guerre de décolonisation sur notre territoire et la jeune héroïne tunisienne de « La belle et la meute » qui mène une autre terrible bataille après le viol que lui ont fait subir des policiers. Enfin un regard intéressant et original sur Albert Camus par un auteur italien que nous avons reçu à Lyon avec d’autres associations amies.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, de suggestions sur des sujets à traiter. Et diffusez notre lettre autour de vous.
Michel Wilson

« La Belle et la meute », film tunisien, de Kaouther Ben Hania 2017
Il paraît difficile de ne pas être ému, choqué, indigné par ce film d’une Tunisienne qui d’ailleurs n’en est pas à son coup d’essai puisque, âgée d’une quarantaine d’années, elle en a déjà plusieurs autres à son actif dont Le Challat de Tunis en 2013, qui  illustrait, avec humour et originalité, le machisme régnant en Tunisie. Inutile de dire que la Tunisie n’a hélas pas le monopole des comportements dénoncés mais c’est en tout cas un pays où l’on n’a pas peur de parler et de montrer (à la différence de l’Algérie si l’on en croit ce que dit Kamel Daoud qui est bien placé pour déplorer les silences et les occultations pratiqués dans son propre pays).
illustrait, avec humour et originalité, le machisme régnant en Tunisie. Inutile de dire que la Tunisie n’a hélas pas le monopole des comportements dénoncés mais c’est en tout cas un pays où l’on n’a pas peur de parler et de montrer (à la différence de l’Algérie si l’on en croit ce que dit Kamel Daoud qui est bien placé pour déplorer les silences et les occultations pratiqués dans son propre pays).
Cependant, il importe de préciser d’emblée ce que signifie « montrer » dans le film de Kaouther Ben Hania. Car c’est une histoire de viol où le viol lui-même n’est jamais montré tant il est vrai qu’il faut surtout éviter le voyeurisme latent, une dérive toujours possible quand il s’agit de comportements sexuels surtout violents. Le seul moment où l’on croit apercevoir le viol dont il est constamment question est une image d’une seconde à peine et qu’on pourrait dire subliminale, aperçue sur le téléphone portable d’un des violeurs qui a jugé bon et plaisant d’enregistrer son forfait sans doute pour s’en vanter et pour continuer à en jouir. Kaouther Ben Hania, elle, ne montre rien, d’une part parce que l’état dans lequel est la jeune femme Mariam immédiatement après le viol suffit largement à évoquer ce qu’elle a subi et d’autre part parce que le propos du film est justement de déplacer le lieu de la violence —viol et violence étant évidemment les mots les plus proches qui soient—pour le situer partout où Mariam, pendant une interminable nuit, va essayer de se faire entendre et de faire reconnaître officiellement ce dont elle a été victime. On assiste consterné à cette sorte de dissémination et de démultiplication du fait initial, qui était physique et sexuel, sous des formes apparemment autres mais qui en fait sont de même nature que le viol, le prolongent et l’amplifient. La société toute entière, en tout cas dans ses institutions les plus connues et auxquelles Mariam essaie d’abord naïvement d’avoir recours, devient une sorte de caisse de résonance qui amplifie l’horreur ressentie par la jeune femme violée ; elle est bousculée, y compris physiquement, au point qu’à la fin de la nuit  elle est couverte de meurtrissures qu’elle n’avait pas après le viol lui-même. En dehors des coups qu’elle reçoit (qui n’autorisent pas à parler de torture au sens premier du mot mais qui pourtant vont jusqu’à lui faire perdre connaissance), elle subit un matraquage moral et psychique, rejets sans ménagements, chantage, menaces, injures, qui dure bien plus longtemps que le viol lui-même et qui est le fait d’un nombre bien plus grand de « violenteurs » sinon de violeurs : ils étaient deux, ce qui était évidemment plus qu’assez pour rendre toute résistance impossible, mais au cours de son horrible nuit, il y a un nombre bien plus important de policiers qui la malmènent, sans parler de tous ceux et de toutes celles qu’elle supplie en vain de l’aider, et qui se réfugient pour refuser de le faire derrière un ensemble d’impossibilités réelles ou supposées.
elle est couverte de meurtrissures qu’elle n’avait pas après le viol lui-même. En dehors des coups qu’elle reçoit (qui n’autorisent pas à parler de torture au sens premier du mot mais qui pourtant vont jusqu’à lui faire perdre connaissance), elle subit un matraquage moral et psychique, rejets sans ménagements, chantage, menaces, injures, qui dure bien plus longtemps que le viol lui-même et qui est le fait d’un nombre bien plus grand de « violenteurs » sinon de violeurs : ils étaient deux, ce qui était évidemment plus qu’assez pour rendre toute résistance impossible, mais au cours de son horrible nuit, il y a un nombre bien plus important de policiers qui la malmènent, sans parler de tous ceux et de toutes celles qu’elle supplie en vain de l’aider, et qui se réfugient pour refuser de le faire derrière un ensemble d’impossibilités réelles ou supposées.
Cette description consternante qui fait la matière du film n’est pas présentée sous la forme d’une longue litanie et déploration et l’on comprend que la réalisatrice voulait justement éviter cela, d’où le fait qu’elle utilise un procédé radical et en effet très efficace de découpage de l’action : le résultat en est une succession d’épisodes assez courts voire elliptiques, neuf en tout, qui sont numérotés et défilent à un rythme soutenu, de manière à ne garder que des temps forts, que le spectateur doit subir comme une sorte de harcèlement incessant. Ce n’est pas exactement un effet répétitif qui est cherché parce qu’en fait chaque nouvel épisode est comme une variation à partir d’un ensemble, mais de toute manière, la réalisatrice fait en sorte qu’on ressente à peu près la même chose que son héroïne, un effet punching ball si l’on peut dire les choses ainsi, c’est-à-dire que sitôt un coup reçu sur la tête, au propre comme au figuré et sans qu’on ait le temps de reprendre son souffle, le coup suivant est porté ; comme ces gifles qui claquent tantôt d’un côté tantôt de l’autre, escomptant la soumission d’une victime forcément « sonnée »—pour continuer l’image du sac de frappe utilisé par les boxeurs. Chacun des neuf épisodes est ressenti comme un coup de poing.
Cependant, grâce aux blancs qui séparent les temps forts, le film donne l’impression qu’il ne cherche pas à engluer le spectateur dans les méandres d’une narration unique et linéaire. Et d’autre part il y a toujours, en mineur, le fil parfois ténu d’un humanisme presque improbable (dans la possibilité de ses effets) mais qu’il est essentiel de ne pas lâcher : une infirmière qui cherche à être secourable et à accompagner la victime, un vieux policier qui l’encourage de son mieux à ne pas « craquer » et à garder sa détermination. Ce fil si mince qu’il soit fait que la Belle et la meute n’est pas un film désespéré—on dirait même l’inverse lorsque cette horrible histoire touche à son dénouement (provisoire en tout cas). Objectivement en effet, c’est Mariam qui a gagné, à sa propre surprise, lorsque ses deux ou trois derniers bourreaux se voient obligés de la relâcher.
Mais surtout, et c’est là le plus important, elle a fait en elle-même ou vis à vis d’elle-même un parcours auquel on n’avait pas forcément pensé tant elle paraissait d’abord superficielle et frivole, jolie d’une manière enfantine et très peu consciente des réalités. Or sa détermination à porter plainte, qui pourrait ressembler d’abord à un entêtement irréfléchi, apparaît bientôt comme un véritable courage, dont on est d’autant plus convaincu qu’il se forge par étapes, non sans rechute parfois, mais suivant pourtant la ligne générale d’une affirmation de soi et d’un souci grandissant de vérité. Le moment décisif à cet égard est celui où Mariam décide de téléphoner elle-même à son père pour lui dire ce qui s’est passé, alors qu’elle avait depuis le début supplié les policiers de ne pas prévenir sa famille ; ce qu’ils ne souhaitaient pas faire de toute façon mais leur permettait d’exercer sur elle un chantage et une intimidation. De manière imprévue, les suites du viol ont rendu Mariam consciente d’elle-même, violée certes mais pas seulement victime.
Denise Brahimi

« Dans l’épaisseur de la chair » de Jean-Marie Blas de Roblès (Zulma 2017)
Ce roman fait partie de la rentrée littéraire 2017 qui, comme critiques et libraires l’ont fait remarquer, comporte une riche actualité de livres consacrés au Maghreb et à l’Algérie en particulier. Donc à la Guerre d’Algérie, encore et toujours, mais aussi à la période coloniale qui l’a précédée. Beaucoup de ces livres ont valeur de témoignage et leur intérêt est qu’on y trouve des aspects méconnus ou moins connus de la grande Histoire—mais pas nécessairement un souci de la littérature en tant que telle.
 D’où l’excellente surprise qu’on éprouve lorsqu’on découvre ce dernier livre de Jean-Marie Blas de Roblès, qui s’était déjà fait connaître auparavant par deux autres, Là où les tigres sont chez eux en 2008 et L’Ile du Point Nemo en 2014 (également aux éditions Zulma).
D’où l’excellente surprise qu’on éprouve lorsqu’on découvre ce dernier livre de Jean-Marie Blas de Roblès, qui s’était déjà fait connaître auparavant par deux autres, Là où les tigres sont chez eux en 2008 et L’Ile du Point Nemo en 2014 (également aux éditions Zulma).
Du récit qui vient de paraître, on peut donner au moins deux brèves définitions : d’une part c’est un livre consacré au père, appelé dans le roman Manuel Cortès, un homme qui avait tout juste une vingtaine d’années au moment de la deuxième guerre mondiale, à laquelle il a participé, alors que son fils le romancier est né en 1954 ; d’autre part c’est un livre qui évoque l’émigration espagnole dans l’Algérie coloniale, à l’époque où on avait besoin de mains pour faire prospérer celle-ci et lui assurer un peuplement européen.
Encore faut-il dire que l’un et l’autre de ces deux thèmes ou aspects principaux du livre ne sont nullement présentés à la manière d’une chronique, d’une biographie ou d’une chronologie. On ne croit pas se tromper en disant que la préoccupation principale de l’auteur est d’être un écrivain, même si personne n’a jamais pu donner de cet état une définition claire et exhaustive. Lorsque littérature il y a, comme c’est le cas ici, elle n’en apparaît pas moins comme une évidence, qui fait que le plaisir donné par le livre va bien au-delà de ce qu’il nous apprend. Ici le plaisir commence dès les premières pages, consacrées à une magnifique scène de pêche en Méditerranée, à moins que ce ne soit en fait la synthèse de nombreuses scènes d’autant plus assimilables les unes aux autres que le père les veut du même modèle sinon identiques, par amour du rituel, des gestes devenus traditionnels et de ce fait créateurs de complicité entre son fils et lui.
La barque est là, les poissons sont là, mais plus encore que tout le reste sont là les décennies de vie écoulée, sans doute enfouies dans la mémoire mais ne demandant qu’à en ressortir pour se constituer en fragments de récits et de souvenirs, non seulement revécus mais surtout pensés ou repensés. Beau mélange d’immédiateté et de mise à distance par la réflexion et une imprégnation culturelle qui chez Blas de Roblès est grande et variée. On reconnaît au passage telle page de Victor Hugo, tel poème de Rudyard Kipling ou encore, en matière de film, les célèbres « Oiseaux » d’Alfred Hitchcock ; tout cela sans le moindre pédantisme, arrivant au contraire avec souplesse et liberté.
Du fait que le portrait (en actes) de Manuel Cortès se situe entre celui de son père, vieil Espagnol brutal empreint de paysannerie archaïque et celui de son fils le narrateur, qui représente le moment de l’écriture, c’est-à-dire le présent (2016 ou 2017), il permet d’évaluer l’évolution historique de la communauté franco-espagnole d’Algérie à laquelle cet homme appartient ; évolution entre un avant et un après mais aussi pendant la durée de sa propre vie, puisque lorsque le récit commence le narrateur nous informe : « Mon père a quatre-vingt-treize ans. » C’est donc une vision de l’Histoire qui est la meilleure et la seule vraie : celle qui montre à la fois ce qui change et ce qui ne change pas.
 De son père, le narrateur affirme qu’il a toujours ou presque été le même. Mais pendant toutes ces décennies, la société algérienne, elle, a subi une telle métamorphose qu’on ne peut le dire sans employer le mot «révolution ». Aussi pense-t-on au vers célèbre de Baudelaire : « La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel. » Il est clair que la manière dont se sont passés lesdits changements sont un des principaux sujets de réflexion de l’auteur du livre qui trouve le moyen d’être à la fois ferme et discret, précis et documenté mais jamais péremptoire. On comprend à le lire à quel point l’insurrection de 1954 a été une surprise ô combien choquante pour la communauté des Pieds Noirs qui avait fini par croire que la situation (coloniale) ne changerait jamais, malgré un avertissement aussi sévère que les événements de Sétif en 1945. Mais comme le dit très bien Blas de Roblès, il ne suffit pas de voir, il faut percevoir ce que l’on voit. Mieux vaut lui laisser la parole car ses propos sont admirables, aussi simples en apparence que profonds : « Mon père a assisté aux massacres de Sétif, il n’a rien fait, rien dit, rien ressenti, et je ne parviens ni à l’excuser ni à l’en blâmer. Il n’est pas si facile de percevoir ce que l’on voit ; il faut beaucoup d’efforts, de concentration sur l’instant présent, sur ce qu’il offre à notre regard, pour ne pas limiter nos yeux à leur simple fonction de chambre noire. » (p.241)
De son père, le narrateur affirme qu’il a toujours ou presque été le même. Mais pendant toutes ces décennies, la société algérienne, elle, a subi une telle métamorphose qu’on ne peut le dire sans employer le mot «révolution ». Aussi pense-t-on au vers célèbre de Baudelaire : « La forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel. » Il est clair que la manière dont se sont passés lesdits changements sont un des principaux sujets de réflexion de l’auteur du livre qui trouve le moyen d’être à la fois ferme et discret, précis et documenté mais jamais péremptoire. On comprend à le lire à quel point l’insurrection de 1954 a été une surprise ô combien choquante pour la communauté des Pieds Noirs qui avait fini par croire que la situation (coloniale) ne changerait jamais, malgré un avertissement aussi sévère que les événements de Sétif en 1945. Mais comme le dit très bien Blas de Roblès, il ne suffit pas de voir, il faut percevoir ce que l’on voit. Mieux vaut lui laisser la parole car ses propos sont admirables, aussi simples en apparence que profonds : « Mon père a assisté aux massacres de Sétif, il n’a rien fait, rien dit, rien ressenti, et je ne parviens ni à l’excuser ni à l’en blâmer. Il n’est pas si facile de percevoir ce que l’on voit ; il faut beaucoup d’efforts, de concentration sur l’instant présent, sur ce qu’il offre à notre regard, pour ne pas limiter nos yeux à leur simple fonction de chambre noire. » (p.241)
Sur l’échéance inévitable de la guerre d’indépendance et sur le caractère aussi brutal qu’injuste de la colonisation, il est très clair aussi mais pour autant jamais il ne renie son appartenance à une communauté qui globalement désirait le maintien de l’Algérie française. (p.241). S’agissant de son père Manuel, le narrateur le décrit comme rejeté par chacune des communautés qui s’affrontaient, parce qu’en tant que médecin et chirurgien il soignait aussi bien les malades ou blessés d’un camp que ceux de l’autre. A l’égard du gouvernement algérien d’après l’indépendance, le narrateur qui a eu des raisons professionnelles de le connaître, ne se montre pas spécialement tendre et garde ses distances, non sans une pointe d’humour. Il n’en reste pas moins que Jean-Marie Blas de Roblès n’oubliera jamais qu’il est né à Sidi –Bel-Abbès et que ce dernier roman en est la preuve s’il en fallait une. En plus des deux thèmes précédemment évoqués, l’auteur évoque l’expérience entre la vie et la mort qui lui était sans doute nécessaire pour atteindre l’apaisement et apprécier pleinement la beauté du monde, « la libre respiration du vent de et de la mer(…) la beauté nue ».
Denise Brahimi
« Femmes dévoilées: des Algériennes en France à l’heure de la décolonisation », de Marc ANDRÉ, (Lyon : ENS éditions, 2016, 378 p)
Ce livre est issu de la thèse de doctorat que Marc André (MA), professeur d’histoire au lycée de la cité internationale de Lyon, a soutenu à la Sorbonne le 4 avril 2014 -il était alors âgé de moins de 32 ans. Le sujet de la thèse était Des Algériennes à Lyon. 1947-1974. MA a publié son livre, relativement réduit au regard du volume de la thèse, et qui propose au lecteur un champ d’analyse plus large que Lyon. Il y est, entre autres, noté à bon escient le livre majeur de Daho Djerbal sur la Fédération de France du FLN ; ceci dit, il reste principalement centré sur la capitale des Gaules, qui, dès avant, a été un sujet abordé par des historiens et des témoins.
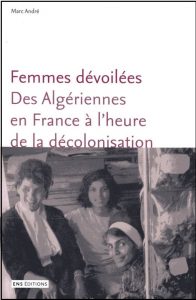 Le plan du livre de MA relève d’une charpente originale inédite, dont les quatre parties ont structurellement entremêlé chronologie, réflexion, comptes-rendus humainement factuels, espaces et temporalité :
Le plan du livre de MA relève d’une charpente originale inédite, dont les quatre parties ont structurellement entremêlé chronologie, réflexion, comptes-rendus humainement factuels, espaces et temporalité :
– La 1ère partie [-I : ANONYMATS (-1. Méconnaissances, -2. Discrétion)] insiste sur ces femmes oubliées ou mises à l’écart, mais qui se sont bel et bien engagées pour l’indépendance de l’Algérie, sur fond d’adaptation discrète à une société, pour elles étrangère, où elles ont été volens nolens exportées, et à laquelle elles ont dû s’adapter -elles et leur famille-, et si possible y trouver du travail. A relever : le livre de MA n’est pas centré sur le seul FLN : il rend minutieusement compte des affrontements entre groupes de choc FLN et les messalistes du MNA.
– La 2ème partie [-II : RENCONTRES (-3. Sympathies, -4. Liens)] étudie la présence à Lyon des Algériennes, leur adaptation aux modes de vie in situ, leur prestesse à aménager leurs logements, les relations nouées avec des humains du cru -militants anticolonialistes, membres de réseaux d’entraide, catholiques, protestants et al.-, via, entre autres, des leçons de français, des cours de rattrapage scolaire, des colonies de vacances, des repas en commun… Émouvantes, entre autres, les photos d’un pique nique lors d’un week-end organisé par la Cimade aux environs de Tarare et celle de quatre Algériennes et de deux de leurs bébés, en colonie de vacances aux environs de Lyon à l’été 1961. MA s’appuie, entre autres, sur le trop peu connu film de Béatrice Dubell El Bi’r, et sur le livre qui en a été tiré. Il y eut aussi des militants -engagés sur l’Algérie- de partis et de syndicats ; de ceux-ci, l’AGEL -l’UNEF lyonnaise- est, à juste titre, le seul à être mentionné dans la liste des abréviations.
– La 3ème partie [-III : ENGAGEMENTS (-5. Effacements, -6. Clandestinités)] examine comment nombre d’Algériennes furent engagés dans le combat pour l’indépendance de leur pays et pour la défense d’une identité nationale algérienne ; cela avec discrétion et clandestinement -elles se chargèrent de la diffusion d’informations, du transport de documents et de matériel, de la connexion, à Lyon et dans d’autres régions, entre réseaux FLN et aussi entre réseaux MNA…
– La 4ème et dernière partie [-IV : LES CONDITIONS D’UNE DOUBLE PRÉSENCE (-7. Désengagements, -8. Devenir plurielles)] est notablement bien située à sa place terminale : elle montre que l’inéluctable indépendance marque un terme, mais qu’elle ne résout pas tout : il n’y a guère de suite aux engagements des Algériennes d’avant 1962, et dès après, peu continuent à militer; c’est que la réalité politique de l’Algérie indépendante n’y incite guère. L’Amicale des Algériens en France, montée par le système de pouvoir algérien, ne suscite -euphémisme- guère d’enthousiasme : en témoigne la réaction outrée d’une femme conviée à une réunion officielle par le président Boumediene à l’hôtel des Sables d’Or de Zeralda, autour de buffets copieux, quand elle ne peut que constater par ailleurs la pénurie dont souffre le peuple algérien -tout humain ayant vécu en Algérie sous l’ère Boumediene en témoignera. Et l’algérianité se diffuse dans une plus ou moins grande fusion avec la société française : Algériennes ? Françaises ? MA atteste in fine que des identifications à paramètres multiples et en mutation permanente sont la véritable « identité ».
Vu la -remarquable- amplitude de ses sources, il n’eût guère été possible, sur tout l’hexagone, de proportionnellement consulter autant de documents et d’interroger autant de témoins, sauf à devoir y consacrer une vie entière. On ne détaillera pas la riche diversité des multiples archives -nationales, départementales, municipales-, archives de la justice militaire, registres d’écrou de la prison de Montluc, archives privées…- et des journaux consultés -notamment Dernière Heure Lyonnaise, trop méconnu de nos jours-, des témoignages autobiographiques, des romans…
 L’ouvrage de MA est vivant et émouvant, c’est un livre d’histoire vrai. Il se situe, à propos du FLN en France, politiquement en deçà, mais sur un plan humainement social, au-delà des ouvrages sur la Fédération de France du FLN. Dans les années 50, le nombre des Algériennes vivant en France augmente amplement : en 1952, le ministère de l’Intérieur en recense 4841 pour une population de 180 000 Algériens, soit près de 2,7 % des Algériens. En 1960, il en décompte 17 200, et, en 1962, sur 350 484 Algériens, 24 891 femmes -soit 7 %-, dont environ 1 300 à Lyon -MA en a identifié 500. L’un des mérites de sa recherche est qu’il s’est appuyé deux ans durant sur des documents humains vivants : il a conduit des deux côtés de la Méditerranée 69 entretiens avec des Algérien.ne.s et des Françai.se.s, avec des actrices et acteurs/témoins, militant.e.s engagé.e.s dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Ont été interrogés 22 hommes (17 Algériens, 5 Français) et 47 femmes (37 Algériennes, 7 épouses d’Algériens, 3 Françaises). Les témoignages qu’il a recueillis d’actrices et acteurs de terrain de l’histoire, et de témoins -la plupart âgés de 70 ans et plus- n’ont pas d’emblée toujours été recueillis avec facilité : au regard de ce qu’ils ont pu endurer, ils purent avoir du mal à se livrer spontanément.
L’ouvrage de MA est vivant et émouvant, c’est un livre d’histoire vrai. Il se situe, à propos du FLN en France, politiquement en deçà, mais sur un plan humainement social, au-delà des ouvrages sur la Fédération de France du FLN. Dans les années 50, le nombre des Algériennes vivant en France augmente amplement : en 1952, le ministère de l’Intérieur en recense 4841 pour une population de 180 000 Algériens, soit près de 2,7 % des Algériens. En 1960, il en décompte 17 200, et, en 1962, sur 350 484 Algériens, 24 891 femmes -soit 7 %-, dont environ 1 300 à Lyon -MA en a identifié 500. L’un des mérites de sa recherche est qu’il s’est appuyé deux ans durant sur des documents humains vivants : il a conduit des deux côtés de la Méditerranée 69 entretiens avec des Algérien.ne.s et des Françai.se.s, avec des actrices et acteurs/témoins, militant.e.s engagé.e.s dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Ont été interrogés 22 hommes (17 Algériens, 5 Français) et 47 femmes (37 Algériennes, 7 épouses d’Algériens, 3 Françaises). Les témoignages qu’il a recueillis d’actrices et acteurs de terrain de l’histoire, et de témoins -la plupart âgés de 70 ans et plus- n’ont pas d’emblée toujours été recueillis avec facilité : au regard de ce qu’ils ont pu endurer, ils purent avoir du mal à se livrer spontanément.
MA présente au lecteur sur huit pages en annexes 27 notices biographiques : une riche panoplie d’Algériennes, à parcours divers, issues du MNA ou du FLN, ou dont l’engagement a été plus social que politique, qui ont conversé avec lui. Il rend vivantes au lecteur ces témoins/actrices en lui offrant de riches extraits des entretiens qu’il eut avec elles : non sans esprit de synthèse, il offre un travail aux antipodes d’un raccourci in abstracto, mais bien plus pensé et réfléchi que limité au in concreto.
Le lecteur apprécie, aussi, les deux cartes de France où sont respectivement indiqués les effectifs des Algériens et des Algériennes par département en 1953 , et les plans de Lyon et du grand Lyon où est entre autres indiquée la répartition des célibataires algériens, des commerces algériens, des Algériennes hors bidonvilles ; où sont localisés tels événements évoqués dans le livre et par lesquels le lecteur repère arrondissements et quartiers, les bidonvilles -des Buers, du quai Fillon, de la route d’Heyrieux, et al…- et la répartition des Maghrébins (Algériens, Tunisiens) en fonction de leur origine, et les secteurs où se concentrent les Algérien.ne.s : la Guillotière autour de la place du Pont -la « médina de Lyon »- est le plus connu, mais nombre d’entre eux vivent aussi dans les ex-quartiers des canuts, dont la Croix Rousse, la rue René Leynaud dans les Basses Pentes, où se trouve l’église Saint Polycarpe, monument historique des XVIIe-XVIIIe siècles, proche du local de la Cimade, et surtout la montée de la Grande Côte, qui relie les Terreaux à la place de la Croix Rousse. Mais sur les plans le lecteur ne peut trouver ce haut lieu de traboules en pente-escargots .
Bien repérables la place Guichard, où se trouve la Bourse du Travail, près de laquelle le dénommé Badri Badri possédait le Café des Sept Chemins au 69 rue Mazenod, place forte de « l’archipel messaliste », qui fut la cible de groupes de choc du FLN -il dut affronter 17 attaques de 1957 à 1962 ; à 800 mètres au nord-est de la place Guichard, se trouvait, dans le quartier des Brotteaux, le trop célèbre commissariat Vauban ; derrière la gare de Perrache, il y avait les prisons Saint Paul et Saint Joseph, et, près du vieux cimetière de la Guillotière, le fort/prison militaire Montluc. D’autres lieux du grand Lyon mentionnés par MA ne sont pas toujours repérables, par exemple, au centre, la rue Mercière, connue à l’époque comme le cœur de la prostitution lyonnaise, ou la banlieue industrielle de Saint Fons, au sud-est de la confluence. Le livre n’est pas forcément facile à lire pour un non Lyonnais ; même l’auteur de ces lignes qui, bien que n’étant pas de souche lyonnaise, a passé un peu plus de la moitié de sa vie à Myrelingues la Brumeuse -qu’il pense assez bien connaître- a dû, pour le lire et s’y repérer, avoir à portée de main un atlas pocket de l’agglomération de Lyon. Ceci dit, nombre de lieux et quartiers du grand Lyon mentionnés dans Femmes dévoilées sont bien repérables.
MA apprend au lecteur que des Algériennes installées à Lyon ne restent pas toutes en permanence dans leur pré carré lyonnais : des femmes messalistes viennent en autocar à Paris pour rencontrer d’autres messalistes, venues de différentes régions de l’hexagone ; et nombre de militantes prennent en mains des liaisons avec l’Algérie. Même si elles sont tenues pour des auxiliaires annexes par les cadres -masculins- FLN et MNA, on réalise qu’il y eut de vraies militantes algériennes qui tinrent de vrais engagements.
On se doit in fine de signaler la richesse exceptionnelle des photos, superbement émouvantes, tirées d’archives ou de fonds personnels. A les voir, on se rend compte que la grande majorité de ces Algériennes, à Lyon, ont d’ores et déjà levé le voile et n’ont -euphémisme- guère eu envie qu’il leur soit imposé. Le lecteur réalise quelles furent leurs difficultés à s’insérer dans une société pour elle inconnue, notamment lorsqu’elles étaient les épouses d’ « indésirables » -pour le système colonial, sinon pour le FLN ou le MNA-, mais qu’elles s’ancrèrent dans l’hexagone : après 1962, nombre de celles qui voulurent à l’indépendance retourner dans leur pays d’origine d’outre-Méditerranée, firent la traversée en sens inverse pour se réinstaller en France, pour demander la nationalité française, cela même si ce ne fut guère aisé ; mais les lourds obstacles qu’elles eurent à affronter pour demander leur pension de militantes ne leur laissèrent guère envie de s’afficher en mujāhidāt normées.
Gilbert Meynier
« Albert Camus : l’union des différences. Le legs humain et politique d’un homme en révolte », d’Alessandro Bresolin (Presse Fédéraliste, 2017).
Les 9 et 10 octobre, Coup de soleil, en collaboration avec la SEC, a organisé deux rencontres autour de la sortie du livre d’Alessandro Bresolin,
Début octobre, le livre d’Alessandro Bresolin, « Albert Camus : l’union des différences » est paru aux éditions Presse Fédéraliste.  Ce livre avait déjà été publié en Italie en 2013 mais cette nouvelle édition française est traduite par l’auteur lui-même – avec une traduction revue par Jean-Louis Meunier et Jean-Francis Billion – et augmentée de certains passages concernant l’aspect fédéraliste de l’œuvre d’Albert Camus – notamment le cas Gary Davis et la citoyenneté mondiale.
Ce livre avait déjà été publié en Italie en 2013 mais cette nouvelle édition française est traduite par l’auteur lui-même – avec une traduction revue par Jean-Louis Meunier et Jean-Francis Billion – et augmentée de certains passages concernant l’aspect fédéraliste de l’œuvre d’Albert Camus – notamment le cas Gary Davis et la citoyenneté mondiale.
Afin de présenter son ouvrage au public, l’auteur nous a fait le plaisir de passer deux soirées à Lyon, la première à la Maison de l’Europe, le lundi 9 octobre, et la seconde, le lendemain, dans les locaux du Cédrats, à la Croix-rousse.
Lors de ces deux soirées, la rencontre a pris des allures de dialogue entre Alessandro et moi-même.
J’ai tenu dans un premier temps à rappeler le parcours atypique de l’auteur qui, après des études d’Histoire contemporaine à l’Université de Bologne est venu en France, à Toulouse, grâce aux échanges Erasmus. C’est là qu’il apprend à parler si bien le français. Ses travaux portent notamment sur « La naissance des mouvements nationaux en Algérie entre 1924 et 1954 ». Ses études le conduisent ensuite à Bruxelles où il travaille pendant cinq ans pour la revue Amnisty. De retour en Italie, il écrit une Anthologie de textes libertaires de Camus, La Rivolta libertaria qui paraît en 1998. Il faudra attendre dix années, pendant lesquelles Alessandro travaille dans un domaine totalement différent de celui de l’écriture, pour que le cours des choses changent : en 2008 en effet, les « Rencontres Méditerranéennes » organisées chaque année à Lourmarin par Jean-Louis Meunier, portent sur « Camus et les libertaires ». Alessandro reçoit alors un coup de téléphone pour savoir s’il accepte d’y faire une intervention : il accepte. C’est donc là, à Lourmarin, qu’il rencontre Catherine, la fille d’Albert Camus, avec laquelle il noue une belle amitié… et c’est à partir de cette date qu’il décide d’approfondir sa connaissance de Camus et surtout, son travail d’écriture sur l’auteur qui l’accompagne depuis plusieurs années…
Alessandro Bresolin a également une activité de traducteur : c’est lui par exemple qui traduit en italien les œuvres d’auteurs français très différents comme par exemple Marc Bloch, Albert Cossery, Armand Guerra, Panait Istrati, Romain Rolland, Edmond et Jules Goncourt ou encore Paul Valéry. Il a aussi traduit la « Conférence sur la tragédie » que Camus a donnée à Athènes en 1955.
Albert Camus : l’union des différences. Le legs humain et politique d’un homme en révolte est une biographie de Camus qui se présente par thèmes. L’approche en est à la fois historique et politique mais on peut également y découvrir de belles analyses de textes – je vous conseille notamment celle de L’Étranger ou les pages sur L’Envers et l’Endroit.
Le livre se découpe ainsi avec la jeunesse de Camus en Algérie, son lien avec la société algérienne, son identité espagnole, son attachement à l’Italie, la question de la Révolte, de l’Europe, la vision de l’Europe qu’en avait Camus.
Alessandro évoque en outre certaines rencontres qui furent importantes pour Camus et notamment celles de Nicola Chiaromonte, jeune exilé politique qui arrive à Alger en 1941 et avec qui Camus noue une amitié immédiate, et celle d’Ignazio Silone qui, par exemple, collabora souvent avec Camus à plusieurs revues libertaires comme Témoins, Volontà, la revue du mouvement anarchiste italien, ou encore Solidaridad Ombrera.
Alessandro offre bien sûr une place à part à l’Algérie qui ouvre le livre et qui apparaît également dans le dernier chapitre. Pour lui, elle est « la cause perdue » de Camus.  Pour préparer nos échanges, nous avons été frappés Alessandro et moi, par le fait que nos regards différents – le sien, celui de l’historien et le mien, littéraire – se croisaient tout en se rejoignant sur la question de la Guerre d’Algérie. Cette question illustre en effet selon nous à la fois l’Absurde et la tragédie. L’Absurde, c’est le divorce entre les aspirations de l’homme et du monde, ce divorce qui est le fruit du silence du monde. Quant au tragique, il est selon la définition que Camus en donne dans sa Conférence d’Athènes de 1955, le fait qu’Antigone a raison mais que Créon n’a pas tort, ce qui illustre bien la difficulté du pays ainsi que l’échec du fameux Appel à la Trêve civile lancé par Camus en 1956.
Pour préparer nos échanges, nous avons été frappés Alessandro et moi, par le fait que nos regards différents – le sien, celui de l’historien et le mien, littéraire – se croisaient tout en se rejoignant sur la question de la Guerre d’Algérie. Cette question illustre en effet selon nous à la fois l’Absurde et la tragédie. L’Absurde, c’est le divorce entre les aspirations de l’homme et du monde, ce divorce qui est le fruit du silence du monde. Quant au tragique, il est selon la définition que Camus en donne dans sa Conférence d’Athènes de 1955, le fait qu’Antigone a raison mais que Créon n’a pas tort, ce qui illustre bien la difficulté du pays ainsi que l’échec du fameux Appel à la Trêve civile lancé par Camus en 1956.
Le livre offre enfin un très bel entretien avec Catherine Camus qui se livre en toute simplicité. C’est, il me semble, une des rares fois, où elle évoque avec autant d’émotion le choc que fut la disparition brutale de Camus ; elle vivait dans « une insouciance inexplicable, qui a été brisée par le mort de [son] papa. Parce qu’un accident en voiture, pendant que tu attends l’arrivée de ton père, un lundi soir, et qu’à cinq heures on te dit que tu ne le reverras jamais plus, c’est incroyable. Irréel. Et puis il était le seul adulte, le seul adulte en qui j’avais confiance. […] Quand il est mort, je me suis sentie presque en danger absolu, comme si j’étais tombée au fond d’un ravin sans fond ».
Au-delà de sa relation intime avec son père, elle évoque également les différentes polémiques qui surgissent parfois – comme ce fut le cas par exemple avec Marseille 2013 – autour de la figure de son père. Elle regrette que la culture n’ait désormais « plus de contenu » alors qu’elle devrait précisément permettre le dialogue entre les êtres humains : « La culture n’est pas une somme de savoirs, mais une ouverture au monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, papa disait toujours qu’il faut avoir des ennemis, autrement c’est malsain. Et lui il est allé au-devant d’eux, tout seul et à visage découvert ».
Ces deux soirées ont donc permis au public de découvrir l’auteur du livre d’Alessandro Bresolin, parcours passionnant à travers l’œuvre de Camus…
Virginie Lupo
« Un loup pour l’homme » de Brigitte Giraud (Flammarion 2017)
Ce livre, écrit au présent, en phrases tour à tour courtes et directes puis en descriptions très visuelles ou en énumérations promenant le lecteur dans un univers très concret, est en fait une rencontre longtemps reportée avec un passé fondateur.  Lyonnaise, née à Sidi-Bel-Abbès, Brigitte Giraud, romancière reconnue, dit être devenue écrivain pour écrire ce livre. Il lui fallait la maîtrise de l’écriture acquise au fil de romans remarqués (« La chambre des parents », « Nous serons des héros »…) pour oser se confronter à cette mise en récit. On peut en effet imaginer qu’aller à la rencontre de son père et lui donner une incarnation dans un moment si fort de sa vie aurait pu être une forme d’intrusion et pas l’intime compréhension à laquelle il faut bien se préparer. Décrire le quotidien intime de ce père au moment où elle-même va naître, à un âge qui est celui de son fils aujourd’hui, c’est à l’évidence l’aboutissement d’une longue maturation. Il lui a fallu passer par des conversations avec ses parents, suscitant le récit de souvenirs qu’elle a ensuite fait entrer dans son imaginaire pour à son tour accoucher de ce beau livre, pudique et vibrant de sensibilité.
Lyonnaise, née à Sidi-Bel-Abbès, Brigitte Giraud, romancière reconnue, dit être devenue écrivain pour écrire ce livre. Il lui fallait la maîtrise de l’écriture acquise au fil de romans remarqués (« La chambre des parents », « Nous serons des héros »…) pour oser se confronter à cette mise en récit. On peut en effet imaginer qu’aller à la rencontre de son père et lui donner une incarnation dans un moment si fort de sa vie aurait pu être une forme d’intrusion et pas l’intime compréhension à laquelle il faut bien se préparer. Décrire le quotidien intime de ce père au moment où elle-même va naître, à un âge qui est celui de son fils aujourd’hui, c’est à l’évidence l’aboutissement d’une longue maturation. Il lui a fallu passer par des conversations avec ses parents, suscitant le récit de souvenirs qu’elle a ensuite fait entrer dans son imaginaire pour à son tour accoucher de ce beau livre, pudique et vibrant de sensibilité.
A partir des mots initiaux de son père résumant « sa guerre », dans laquelle il n’avait voulu entrer que sans arme, d’où cette formation d’infirmier affecté à l’hôpital de Sidi-Bel-Abbes, et « Il faisait beau tous les jours, et c’était comme des vacances » l’auteure bâtit une toute autre histoire. Elle nous donne à vivre le parcours initiatique d’un tout jeune homme mûri par la souffrance des autres, la peur, et l’entrée en paternité dans cet étrange ailleurs.
Parlons déjà du beau titre de ce roman. « Un loup pour l’homme », est extrait de la citation de Hobbes (Homo homini lupus est, l’homme est un loup pour l’homme) pour qui l’état initial d’hostilité des hommes contre leurs semblables ne peut se résoudre qu’en transférant au Léviathan le pouvoir de la force. Ce titre décrit bien le paradoxe où se trouvent plongés ces jeunes appelés dans cette guerre sans nom. L’Etat français-Léviathan engage tous ces jeunes hommes dans une guerre perdue d’avance, ce qui au passage, contredit un peu Hobbes… Mais aussi dans le roman, le loup, réel ou rêvé est l’animal qui sauvera Oscar, ce blessé amputé pour qui l’infirmier Antoine se prend d’une affection exclusive, et presque amoureuse (voir cet étourdissant portrait que l’auteure fait d’Oscar à travers les yeux d’Antoine à la veille de leur séparation, page 173). Mais comme dit le harki Taha, « Le loup n’est pas toujours celui qu’on croit ».
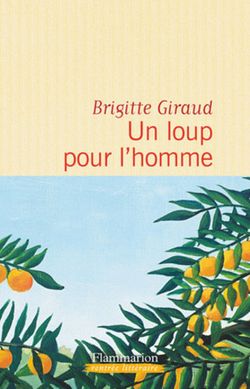 Oscar est le personnage central du roman, autour duquel le goût d’Antoine pour le soin d’autrui se développe : « Antoine comprend, en avançant dans la lumière matinale, ce que signifie prendre soin ». Jeune amputé, dans des conditions qui ne seront révélées que dans la dernière partie du livre, Oscar concentre dans sa personne la situation dramatique dans laquelle se trouvent plongés ces jeunes gens que ce conflit prive de leur avenir, de leurs amours, de leur santé… et qui fuient une vérité à laquelle ils ne peuvent faire face qu’en se murant dans le silence. Seul Antoine finira par gagner le droit aux paroles et aux confidences d’Oscar, confronté à un impossible retour. « Alors il gagnait du temps, il demeurait muet, il avait besoin de réfléchir, il lui fallait imaginer ce qu’il ferait à son retour, ce qu’il dirait à son propre père et au père de Camille. Il était terrifié à l’idée de rentrer chez lui… ».
Oscar est le personnage central du roman, autour duquel le goût d’Antoine pour le soin d’autrui se développe : « Antoine comprend, en avançant dans la lumière matinale, ce que signifie prendre soin ». Jeune amputé, dans des conditions qui ne seront révélées que dans la dernière partie du livre, Oscar concentre dans sa personne la situation dramatique dans laquelle se trouvent plongés ces jeunes gens que ce conflit prive de leur avenir, de leurs amours, de leur santé… et qui fuient une vérité à laquelle ils ne peuvent faire face qu’en se murant dans le silence. Seul Antoine finira par gagner le droit aux paroles et aux confidences d’Oscar, confronté à un impossible retour. « Alors il gagnait du temps, il demeurait muet, il avait besoin de réfléchir, il lui fallait imaginer ce qu’il ferait à son retour, ce qu’il dirait à son propre père et au père de Camille. Il était terrifié à l’idée de rentrer chez lui… ».
Brigitte Giraud a un rare talent pour faire vivre en assez peu de mots des personnages que nous voyons, entendons, que nous accompagnons…
Voici surtout Lila, belle amoureuse décidée, qui lâche tout pour retrouver Antoine et venir auprès de lui donner naissance à leur enfant que le médecin genevois a refusé de faire passer, disant « que si toutes les femmes de soldats avaient avorté, la terre serait dépeuplée ». La vie à Sidi-Bel-Abbès ne sera pas simple pour elle ni pour Antoine un peu écartelé entre sa vie militaire et leur vie de couple. Leurs retrouvailles donnent lieu à une subtile et riche description, les mots leur revenant en abondance après 3 mois de « lettres prudentes », mais la pluie privant Antoine de la surprise de Lila face à la beauté du paysage : « il voulait qu’elle soit d’emblée récompensée du voyage, de toute l’énergie qu’elle a mise à rejoindre cette rive de la Méditerranée ». Leur amour hésitant est pourtant bien beau, dans ces temps troubles et cette situation anormale.
Il y a ce médecin capitaine Tanguy, curieux personnage qui se désagrège peu à peu au fil du roman, et des évènements dans une sorte de folie. Les copains, Martin le cuistot, et Jo, le chauffeur du colonel, un temps proches du couple, mais que le retour en France séparera sans retour, les logeurs Alcaraz, et le docteur Nunez, figures de pieds-noirs représentatifs de l’atmosphère de l’époque chez les Français de Sidi-Bel-Abbès, et dépeints à touches colorées et sonores… Fatima, la domestique qui aide Lila, avec qui se noue un début de relation, avant que la montée des attentats amène les Alcaraz à lui imposer de s’en séparer… Tout un monde vit et s’anime autour de Lila et d’Antoine, et donne à leur séjour en Algérie un décor convainquant qui ajoute à la vérité des personnages centraux, comme ce qu’on dit des bons films, sublimés par la qualité des seconds rôles…
Et voici la petite Lucie. Elle arrive alors qu’Antoine est retenu à l’hôpital : « C’est une fille. Qui dort. Paisible, les poings fermés. Qui tète et qui sommeille. Trop sage dans un monde si agité… Elle n’a pas encore envie de savoir, elle a tout son temps… ». La description de la transformation que sa venue provoque en Antoine rappelle au père-lecteur, auteur de ces lignes, des sensations semblables et inoubliables quand sont nés ses enfants, si joliment décrites. Et cette scène magnifique où Antoine rentre dans leur petit appartement après avoir fait ses adieux à Oscar, et où sa toute petite fille lui fait oublier ce chagrin : « … C’est comme si Lucie avait deviné la peine de son père. Elle ne le laisse pas succomber à la tristesse. Elle intervient, courageuse et décidée, elle fixe Antoine et bientôt lui sourit. C’est un premier sourire, il n’y a pas de doute, fugace mais répété… ». Le lecteur se plaît à imaginer les sentiments de l’écrivaine, décrivant à ses lecteurs, mais aussi à son père, cette empathie de bébé envers son papa malheureux…
Un bel abîme à Sidi-Bel-Abbès.
Les bonheurs d’écriture sont abondants dans ce livre, trop pour pouvoir les mentionner tous. L’un des plus beaux moments est le chapitre où Antoine est affecté à la morgue, probablement une punition de Tanguy, de plus en plus incohérent. Dans ce lieu de mort, Antoine est paradoxalement pris d’une pulsion de vie où ce goût de soigner trouve curieusement sa plus haute expression. Quand il écrit le nom des jeunes morts dans les dossiers, avec une minutie extrême, « il sait qu’écrire le nom du garçon, sa date de naissance, son adresse et le lieu de l’accident, est encore une façon de parler de lui, de le maintenir un peu en vie … Il est leur gardien, leur compagnon, il se met à veiller sur eux… ». Il leur parle, leur raconte sa vie, les loups… Brigitte Giraud enrichit les lieux et les moments glauques avec une poésie prenante.
Vient le départ. « Avant d’embarquer, ils n’osent pas s’avouer qu’ils laissent en Algérie plus qu’un pays qu’ils n’ont pas eu le cran d’aimer, ils laissent tout ce qui fait un homme à vingt ans, et qu’ils ne retrouveront jamais… ».
Et la toute dernière phrase du livre « Lui seul savait …» nous confronte à une énigme dont nous n’avons que certains éléments. Et nous laisse pleins de questions, de réflexions… et d’envie de reprendre le livre pour trouver d’autres réponses.
Retrouvez-Brigitte Giraud avec nous à la Librairie Terre des Livres, à Lyon le 22 novembre à 19h, en dialogue avec Denise Brahimi.
Michel Wilson



Très belle lettre ; merci pour cet envoi ; je transmets.