Cultures franco-maghrébines – Lettre #17
ÉDITO
J’écris ces lignes encore tout imprégné d’un séjour de 11 jours en Algérie, passés aux côtés de militants de l’agroécologie, et de l’écologie tout court. L’Algérie et le Maghreb vivent en leur sein les mêmes mobilisations citoyennes et prises de consciences que celles qui traversent nos sociétés occidentales. Les populations communiquent entre elles et une conscience universelle est peut-être en cours de germination.
Les expressions culturelles qui émanent de ces sociétés maghrébines, souvent bien plus en osmose avec celles du nord de la Méditerranée qu’on l’imagine, sont à l’image de ces dialogues transfrontaliers. Elles sont à la fois ancrées dans les réalités complexes de chaque pays, mais abordent des sujets universels, relient le passé et le présent, et travaillent notre langue française et les idées qu’elle transmet, avec une belle vigueur. Karim Moussaoui, Nawell Madani, Kaouther Hadimi, Kamel Daoud, Mahi Binebine comme beaucoup d’autres nous insufflent une superbe énergie.
Que de liens entre nous ! Nos vraies richesses…
Michel Wilson

« EN ATTENDANT LES HIRONDELLES » Film de Karim Moussaoui
France, Allemagne, Algérie, Qatar | 2017 | 1h53 | VOSTF
avec M. Djouhri, S. Mekkiou, M. Ramdani
Sélection officielle Un Certain Regard – Cannes 2017
Ce film sorti depuis peu sur les écrans français bénéficie d’un accueil très favorable parce qu’on y voit, à juste titre, l’indice qu’un « nouveau » cinéma algérien est en train de se mettre en place, après quelques autres avancées récentes, notamment dans le domaine du documentaire. Il est donc intéressant d’inventorier tous les  indices de nouveauté qu’on trouve dans ce film attachant même s’il n’est pas dépourvu de quelques maladresses (sans doute dues au fait que le réalisateur, qui a été programmateur pour l’Institut français d’Alger, a pensé son film dans la perspective d’un public français).
indices de nouveauté qu’on trouve dans ce film attachant même s’il n’est pas dépourvu de quelques maladresses (sans doute dues au fait que le réalisateur, qui a été programmateur pour l’Institut français d’Alger, a pensé son film dans la perspective d’un public français).
L’essentiel vient du fait qu’il est l’œuvre d’un quarantenaire —Karim Moussaoui est né en 1976 en Algérie, ce qui veut dire qu’ il n’a connu ni la guerre d’indépendance ni les débuts de l’Etat-Nation à partir de 1962. De fait, il n’aura donc vécu que les suites et les effets durables de la terrible décennie noire (des années 90) sur une société algérienne d’autant plus traumatisée que rien n’est fait pour exorciser l’épouvante ni les culpabilités.
Les problèmes que pose le film de Karim Moussaoui sont résolument actuels et si par hasard on les voit avec un regard marqué par ce qu’a été le cinéma algérien depuis l’indépendance ou presque, on ne peut manquer d’être étonné. Commençons par la question des femmes puisque le réalisateur nous y incite, par quatre exemples frappants. On peut affirmer qu’aucune d’entre elles n’est victime de l’oppression séculaire et souvent dénoncée (à juste titre !) exercée par le patriarcat et ses séquelles. Le cas le plus flagrant est celui d’une jeune femme qui part à Biskra pour s’y marier avec un jeune homme qu’on ne verra pas mais dont elle affirme haut et fort que c’est elle qui l’a voulu et choisi. Certes son père veille sur elle avec beaucoup de vigilance pendant ce voyage pré-nuptial, mais aussi avec beaucoup d’impuissance et de naïveté : il est clair que sa fille gère sa vie librement, sans référence à aucune autorité que ce soit —même si l’on n’ose dire qu’elle prend elle-même les décisions qui la concernent, puisque justement son problème (montré non sans humour par Karim Moussaoui) est de ne pas parvenir à en prendre résolument !). Il est tout à fait clair qu’à tous les niveaux de la société qui nous sont montrés, les femmes exercent une autorité supérieure à celle des hommes qui se soumettent à peu près sans discuter (en tout cas pas durablement ) à ce qu’elles exigent d’eux. Dans le premier épisode, la femme française de l’entrepreneur décide de rentrer en France et quoi qu’il en pense, il ne dit rien pour tenter de l’en empêcher. Dans le troisième, une femme qui a été violée par des terroristes durant la décennie noire veut que l’enfant né de ce viol soit pris en charge par un médecin neurologue qui a été témoin des faits : il se trouvait alors aux mains de ces mêmes terroristes qui l’avaient enlevé pour soigner leurs blessés. La femme s’obstine depuis longtemps et sans relâche dans la poursuite de ce projet, jusqu’au moment où l’on comprend que l’homme va finalement céder, si incongrue que lui paraisse d’abord la demande. Comme l’entrepreneur qui est le personnage principal de la première histoire, le médecin lui aussi subit le poids d’une culpabilité qui le tourmente et dont il ne peut se débarrasser.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que les hommes sont finalement plus vulnérables et plus faibles que les femmes, ce qui rejoint nombre de témoignages contemporains sur bien d’autres sociétés que l’algérienne ; et cette intégration de l’Algérie dans le très vaste ensemble des mutations contemporaines est certainement voulue par le « nouveau » cinéma de Karim Moussaoui, conscient comme beaucoup d’autres de sa génération que le temps des nationalismes étroits est dépassé et doit l’être, même et surtout en Algérie où ce type de sentiment nationaliste constitue désormais un frein. Il n’y a pas que les printemps arabes pour faire sauter les blocages, le cinéma peut sûrement y contribuer !
Par sa faute ou par celle des autres, l’Algérie a été enfermée dans une vision folklorisante (s’agissant d’art et d’images, on parle d’orientalisme) qui est étonnamment déniée voire moquée par le film de Karim Moussaoui : le moment le plus remarquable à cet égard est celui où la jeune fille (et supposée future mariée) en route pour Biskra profite d’une pose dans un café pour se mettre à danser, grâce à deux musiciens sympathiques et de bonne volonté ; cela pourrait être une danse dite orientale, dont elle reprend quelques mouvements caractéristiques des hanches et du bassin, mais très vite cela devient une sorte de gesticulation libre et débridée, selon ses caprices et sa fantaisie ; et s’il y avait plus ou moins un modèle par lequel elle se laisse guider, il serait plus européen qu’oriental. On a assez vu de danses du ventre dans le cinéma de papa, nous dit Karim Moussaoui avec amusement ! Et ce n’est peut-être pas un hasard s’il a choisi Biskra comme point d’aboutissement du deuxième épisode, Biskra chanté par André Gide notamment pour sa douceur et ses charmes délicieusement érotiques : dans la perspective du déni de l’orientalisme, le peu que nous montre Karim Moussaoui s’inscrit en faux, consciemment ou non, contre Les Nourritures terrestres (1897) dont cent vingt ans nous séparent désormais !
Qu’il y ait une forme d’érotisme d’ailleurs dans la relation entre la jeune fille et son ancien amoureux devenu « taxieur (c’est le mot qu’on emploie en Algérie) pour l’occasion, c’est indéniable, mais il se dit autrement, et de la nuit que les deux jeunes vont passer ensemble, on ne verra pas une image, pas même selon la tradition hollywoodienne, un oreiller défraîchi au petit matin. Beaucoup de pudeur finalement dans ce « nouveau » cinéma algérien, ce qui nous change agréablement des débordements quasi pornographiques dont nous gave la télévision.
Denise Brahimi
Familles je vous aime :
« LE PRIX DU SUCCES » un Film de Teddy Lussi-Modeste
« JE SUIS LA PLUS BELGE » un spectacle de Nawell Madani
Ces deux titres ont fait partie de l’activité culturelle en cette fin d’été 2017. La raison de les joindre dans une même chronique est qu’ils font apparaître un point commun de la communauté d’origine maghrébine : on ne peut dire franco-maghrébine puisque l’humoriste Nawel Madani, comme le dit le titre de son spectacle, appartient à la Belgique francophone, ce qui ne l’empêche pas d’être très appréciée, et de plus en plus semble-t-il, dans différentes villes de France dont Lyon. Le spectacle dont on parlera ici a donné lieu à une version cinématographique qu’on a pu voir au Pathé-Gaumont, mais l’artiste annonce qu’elle viendra bientôt se montrer en chair et en os aux Lyonnais : on en reparlera le moment venu.
Le réalisateur du Prix du succès n’est pas lui-même d’origine maghrébine, il appartient au groupe des « gens du voyage », un trait qui n’est pas sans rapport  avec le sujet de cette chronique puisqu’elle porte sur une certaine conception de la famille en tant qu’elle est différente du modèle dominant dans l’Occident contemporain. Teddy Lussi-Modeste a identifié en milieu maghrébin des façons de sentir et d’agir qu’il a sans doute bien connues dans son propre groupe d’appartenance, et il a choisi pour les incarner deux excellents acteurs, Tahar Rahim et Roschdy Zem, qui jouent leur rôle avec beaucoup de conviction. Sachant leur talent et leur célébrité, on pourrait presque s’étonner qu’ils aient accepté de s’investir dans une œuvre cinématographique qui sans eux n’aurait rien de remarquable et où l’on pourrait déplorer que tout ou presque relève du cliché. Mais l’accueil assez favorable fait au film montre que dans ces clichés résident des vérités toujours bonnes à dire et importantes à montrer. Or ces vérités concernent la famille, certaines familles, ou mieux vaudrait dire les spécificités de la famille maghrébine, du point de vue des rapports entre les membres qui la composent. Les sociologues ont longtemps opposé une famille tribale à l’ancienne à la famille nucléaire dite moderne qui s’en tient à peu près au groupe formé par les parents et les enfants. En fait ce qui est montré dans Le Coût du succès n’illustre exactement aucun de ces deux modèles, le meilleur mot à employer pour en parler serait « fratrie » qui a l’avantage d’être formé sur le latin frater : le frère, car c’est précisément sur le rapport entre deux frères, l’aîné et le cadet, que se focalise cette histoire.
avec le sujet de cette chronique puisqu’elle porte sur une certaine conception de la famille en tant qu’elle est différente du modèle dominant dans l’Occident contemporain. Teddy Lussi-Modeste a identifié en milieu maghrébin des façons de sentir et d’agir qu’il a sans doute bien connues dans son propre groupe d’appartenance, et il a choisi pour les incarner deux excellents acteurs, Tahar Rahim et Roschdy Zem, qui jouent leur rôle avec beaucoup de conviction. Sachant leur talent et leur célébrité, on pourrait presque s’étonner qu’ils aient accepté de s’investir dans une œuvre cinématographique qui sans eux n’aurait rien de remarquable et où l’on pourrait déplorer que tout ou presque relève du cliché. Mais l’accueil assez favorable fait au film montre que dans ces clichés résident des vérités toujours bonnes à dire et importantes à montrer. Or ces vérités concernent la famille, certaines familles, ou mieux vaudrait dire les spécificités de la famille maghrébine, du point de vue des rapports entre les membres qui la composent. Les sociologues ont longtemps opposé une famille tribale à l’ancienne à la famille nucléaire dite moderne qui s’en tient à peu près au groupe formé par les parents et les enfants. En fait ce qui est montré dans Le Coût du succès n’illustre exactement aucun de ces deux modèles, le meilleur mot à employer pour en parler serait « fratrie » qui a l’avantage d’être formé sur le latin frater : le frère, car c’est précisément sur le rapport entre deux frères, l’aîné et le cadet, que se focalise cette histoire.
Le frère aîné, violent, incontrôlable, est incontestablement un obstacle à la carrière du jeune frère, et le problème se pose au moment où celui-ci doit franchir une nouvelle étape dans sa carrière de jeune humoriste déjà reconnu comme brillant. En fait il ne peut ni ne veut se défaire de ce frère pourtant gênant et même pire, qui d’ailleurs se retrouve finalement en prison, ce qui ne pouvait manquer d’arriver un jour ou l’autre. Les deux frères sont extrêmement différents l’un de l’autre mais il y a entre eux un lien si fort que même s’ils en viennent à se haïr, ils ne peuvent envisager sérieusement de se séparer l’un de l’autre—et surtout pas après la mort du père dont l’aîné quoi qu’il en soit devient le successeur au sein du groupe familial.
Il n’est certes pas question d’invoquer un droit d’aînesse (dont l’existence a été reconnue en France jusqu’en 1849 mais passe aujourd’hui pour un trait féodal inacceptable) mais les sentiments vécus sont parfois plus forts que les dispositions de la loi, et ceux qu’éprouve Brahim, le jeune frère, mal compris par la partie purement française de son entourage, font pour une bonne part l’intérêt du film. L’exigence d’un happy end veut qu’il sauve sa carrière sans abandonner son frère, mais on croit comprendre qu’il n’aurait pu se résoudre à le faire, de toute façon, même si sa carrière s’en était trouvée sacrifiée. En un mot comme en mille, la famille, c’est sacré, en dépit de Gide (le très oublié) et de son jadis célèbre « Familles, je vous hais ».
Il est encore plus étonnant de voir comment une rebelle, humoriste sans pitié pour le milieu maghrébin d’où elle est originaire, fait finalement pivoter son spectacle dans le sens d’un hommage à ses père et mère. On veut parler de la très talentueuse Nawell Madani, d’origine algérienne et dont le spectacle « C’est moi la plus belge » connaît un très grand succès. Au point qu’après avoir été lancée en  France grâce à l’appui du Jamel Comedy Club, elle s’est vite sentie capable de voler de ses propres ailes très au-delà de ce point de départ. La belle et talentueuse Nawell n’a pas froid aux yeux, elle n’a pas non plus sa langue dans sa poche et elle ne ménage rien. Pas même et surtout pas sa famille et l’éducation ( ?) qu’elle en a reçue. Mais … la famille c’est sacré, voir précédemment !
France grâce à l’appui du Jamel Comedy Club, elle s’est vite sentie capable de voler de ses propres ailes très au-delà de ce point de départ. La belle et talentueuse Nawell n’a pas froid aux yeux, elle n’a pas non plus sa langue dans sa poche et elle ne ménage rien. Pas même et surtout pas sa famille et l’éducation ( ?) qu’elle en a reçue. Mais … la famille c’est sacré, voir précédemment !
Concrètement donc, après avoir évoqué ses deux parents de façon fort sarcastique, elle adopte pour en parler dans toute la fin de son spectacle un ton très différent, sentimental à quelques pointes d’humour près. Finalement donc, et avec toute la fermeté dont elle est capable, elle déclare au public que ce one woman show auquel il vient d’assister n’aurait aucun sens pour elle si elle ne le faisait comme un hommage à ses parents, et comme un acte d’amour qui leur est destiné. C’est une sorte de revirement très intéressant et qui semble apprécié du public. On peut en tout cas en conclure que la structure familiale maghrébine échappe à l’humour le plus ravageur, et que le respect qu’elle suscite est indestructible.
Globalement on sait que les mœurs traditionnelles sont fortement mises en question par les jeunes générations nées dans des familles immigrées où les parents au contraire en sont encore les défenseurs, jusqu’à la violence inclusivement. Mais ce n’est pas pour autant que la communauté familiale est menacée d’abandon, elle apparaît au contraire comme une valeur refuge, d’autant plus précieuse que les jeunes font de leur attachement un choix personnel et affectif, au lieu de le considérer comme une donnée sociologique qu’il seraient contraints d’assumer. Il y a là une mutation dont on ne peut que se réjouir, c’est le bon côté de la modernité.
Denise Brahimi

La rédaction de cette lettre culturelle ne reculant devant aucune audace, un envoyé spécial a ce mois-ci accompagné notre article d’un déplacement sur les lieux qu’illustre le livre.
« NOS RICHESSES « de Kaouther Adimi (Barzakh, Seuil, 2017)
Le titre choisi par la jeune romancière est une allusion et même une citation partielle de celui que le grand Giono avait donné à l’une de ses œuvres de jeunesse (1936): Les Vraies richesses. Il s’agissait de dénoncer les fausses valeurs promues par la vie citadine de l’époque. Mais entre les deux écrivains, l’ancien et la nouvelle, le titre a transité par un lieu et non un livre, lieu très particulier cependant puisqu’il s’agit  d’une librairie, celle qu’Edmond Charlot a ouverte à Alger en cette même année 1936. Edmond Charlot était alors un tout jeune homme puisque né en 1915 et déjà passionné par les livres comme il le sera toute sa vie. Giono, appréciant l’hommage qui lui était rendu, a fait don de son titre au jeune libraire qui le lui avait demandé, et les deux hommes sont ensuite restés amis (Giono est mort en 1970 et Charlot en 2004).
d’une librairie, celle qu’Edmond Charlot a ouverte à Alger en cette même année 1936. Edmond Charlot était alors un tout jeune homme puisque né en 1915 et déjà passionné par les livres comme il le sera toute sa vie. Giono, appréciant l’hommage qui lui était rendu, a fait don de son titre au jeune libraire qui le lui avait demandé, et les deux hommes sont ensuite restés amis (Giono est mort en 1970 et Charlot en 2004).
En 2015 -2016, plusieurs manifestations culturelles ainsi qu’un ensemble de publications ont marqué l’anniversaire de la mort d’Edmond Charlot, et la jeune Kaouther Adimi, déjà auteure de deux romans, a pensé que « la bande à Charlot » (l’expression est de Jules Roy dans ses Mémoires barbares), c’est-à-dire tous les auteurs qui gravitaient autour de lui et se retrouvaient dans sa minuscule librairie, avait constitué un cénacle brillant de jeunes gens éminemment sympathiques, passionnés par la littérature et par le désir d’ouvrir au monde cette Algérie que l’école littéraire précédente, celle des Algérianistes, avait au contraire repliée sur elle-même. D’autant que parmi ceux de la bande, les gens brillants, déjà ou bientôt célèbres, ne manquaient pas : Camus était un habitué des Vraies Richesses et l’un des premiers sinon le premier des auteurs publiés par Charlot, éditeur autant que libraire (sans parler de son travail avec divers artistes).
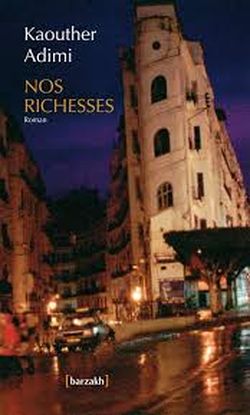 Il est très intéressant et très touchant que la romancière ait souhaité prendre pour objet de son livre ce groupe d’écrivains réunis à Alger autour d’une même librairie. On se dit qu’elle appartient à une génération qui diversifie ses centres d’intérêt au lieu de vivre dans le ressassement de ce qu’a été la Guerre d’Algérie et son aboutissement sous la forme de l’Etat-Nation. Faut-il rappeler que Nos richesses est écrit 55 ans après l’événement assurément révolutionnaire de 1962 ? Et qu’étant né en 1986, Kaouther Adimi voit sans doute cette date comme marquante dans l’histoire de son pays, mais sans en faire un premier commencement qui annulerait toutes les époques antérieures. C’est à peu près la position exprimée par un
Il est très intéressant et très touchant que la romancière ait souhaité prendre pour objet de son livre ce groupe d’écrivains réunis à Alger autour d’une même librairie. On se dit qu’elle appartient à une génération qui diversifie ses centres d’intérêt au lieu de vivre dans le ressassement de ce qu’a été la Guerre d’Algérie et son aboutissement sous la forme de l’Etat-Nation. Faut-il rappeler que Nos richesses est écrit 55 ans après l’événement assurément révolutionnaire de 1962 ? Et qu’étant né en 1986, Kaouther Adimi voit sans doute cette date comme marquante dans l’histoire de son pays, mais sans en faire un premier commencement qui annulerait toutes les époques antérieures. C’est à peu près la position exprimée par un
autre écrivain algérien, Kamel Daoud, pourtant né nettement avant elle, en 1970. Et c’est ainsi qu’elle nous invite à comprendre la sienne dans ce roman, où le possessif « nos » qu’elle a placé dans son titre « nos richesses » invite à la réflexion. A de nombreuses reprises dans le roman Kaouther Adimi s’affirme comme une Algérienne de son pays et de son temps, et participant à cette communauté en tant qu’une parmi d’autres, dont l’avis doit être pris en considération, ni plus ni moins. Or cet avis qu’elle tient à émettre s’affirme comme critique à l’égard de ce qui constitue le deuxième volet du récit, celui qui met en scène le moment présent, alors que l’histoire des Vraies richesses représente celui du passé.
Concernant le moment présent, il mêle comme on s’y attend dans un roman comme le sien, c’est–à-dire désireux de coller aux faits, une part de fiction à beaucoup de réalité. Passionnée par son sujet (« La bande à Charlot ») Kaouther Adimi est venue sur place pour retrouver les lieux devenus mythiques où se trouvait la librairie, dans cette rue qui s’est appelée longtemps Rue Charras et dont l’arabisation a fait la rue Hamani. Aucun problème pour elle dans ce changement : d’où lui viendrait la nostalgie d’un temps qu’elle n’a pas connu ? Aussi bien ce n’est aucunement de nostalgie qu’il s’agit mais plutôt, sous une forme qui s’efforce de rester calme, de reproche et de mécontentement. Car ce lieu mythique, qui fait partie comme elle dit de « nos » richesses, c’est-à-dire des richesses de l’Algérie, est en train d’être abandonné dans les pires conditions, vidé des derniers livres qui s’y trouvaient et dont on n’a pas prévu la récupération, pour faire place aux activités d’un marchand de beignets (la romancière reconnaît que ce détail est de son invention).
Le « nos » employé par Kaouthar Adimi signifie son droit à l’indignation car c’est à elle aussi qu’appartient ce patrimoine que d’aucuns s’autorisent à souiller et à bafouer. Le propre de cette auteure consiste à éviter résolument le langage politique dans lequel s’expriment beaucoup d’écrivains (pas seulement eux d’ailleurs mais aussi bien des journalistes ou même le commun des mortels) qui entendent dénoncer le régime en place et le font agressivement en espérant atteindre ainsi une plus grande efficacité.
Nos Richesses n’est pas un livre agressif parce que le sentiment principal qui l’anime est la ferveur, l’amour des livres et la foi dans le pouvoir de cet amour quand il est partagé. On pourrait d’ailleurs s’interroger sur la force de ce credo qui apparaît tout autant sous une autre forme dans le deuxième roman de Kamel Daoud paru lui aussi cette année : Zabor ou Les Psaumes. La propension actuelle étant de juger tout ce qui vient du monde arabe en fonction d’un rapport à l’islam, on a voulu voir dans ce dernier livre la dénonciation d’une suprématie attribuée au Coran par les Islamistes. Il est bien évident qu’aimer les livres au sens où les aiment Kamel Daoud et Kaouther Adimi implique leur pluralité, leur diversité et l’exaltation que donne leur présence presque innombrable, toujours renouvelée. Ce sentiment n’est pas nécessairement lié au rejet d’un livre unique qu’on voudrait vous imposer. Cependant il est vrai que la multiplicité des livres va de pair avec la liberté du choix et la recherche d’affinités personnelles qui n’obéissent à aucune soumission ou obligation.
A l’inverse la suspicion qui se porte sur les livres est le fait d’un pouvoir coercitif et inquiet de leur pouvoir de subversion. L’Inquisition a brûlé des livres autant que des hommes, le nazisme a fait pire, on ne peut donc pas dire qu’il soit anodin de proclamer que les livres sont « nos richesses » ! Et pour reprendre des termes du poète Jean Sénac cité en exergue de son livre par Kaouther Adimi, « la plus grande injustice qu’on puisse faire aux hommes » est de les en priver.
Denise Brahimi
« NOS RICHESSES AUX VRAIES RICHESSES »
Un tout récent séjour à Alger m’a donné l’occasion d’aller visiter la petite bibliothèque, héritière de la Librairie d’Edmond Charlot. La Bibliothèque Hammani dépend de l’Établissement Arts et Culture, de la Wilaya d’Alger. Elle a été réouverte en 2008, comme le relate un article d’El Watan du 17 avril 2008 qui rappelait  quelques grandes pages de l’histoire de ce « grand petit lieu », où par exemple Saint Exupéry aurait écrit quelques pages du Petit Prince. Jean-Pierre Benisti rappelle aussi que c’est dans ses murs que l’idée d’une stèle commémorant Camus à Tipasa a été discutée, dont son père Louis Bénisti assurera la conception.
quelques grandes pages de l’histoire de ce « grand petit lieu », où par exemple Saint Exupéry aurait écrit quelques pages du Petit Prince. Jean-Pierre Benisti rappelle aussi que c’est dans ses murs que l’idée d’une stèle commémorant Camus à Tipasa a été discutée, dont son père Louis Bénisti assurera la conception.
La bibliothèque fonctionne par adhésions, « des étudiants et des retraités surtout ». Un dame hésitant entre un Zola et un Laurent Ruquier surenchérit » La bibliothèque marche bien, les Algériens aiment lire! ».
Sa jeune bibliothécaire qui n’a aucun des traits du vieil Abdallah du roman, ne craint pas d’être remplacée par des vendeurs de beignets qu’on trouve du reste dans le petit restaurant d’à côté. » Aucune chance que ça se vende: c’est du patrimoine ». Elle a pourtant lu et apprécié le roman, dont l’auteure est venue la voir.
« Le livre a attiré un public nouveau, et les habitués découvrent l’histoire de ce lieu. Certains entrent et en plaisantant disent être venus pour les beignets ». Bravo à Kaouther Adimi d’avoir écrit ce beau livre et d’avoir du même coup stimulé l’énergie des usagers des « Vraies Richesses ». Le tirage initial de Barzakh, qui a co-édité le roman en Algérie, est du reste épuisé, m’indique le libraire de l’aéroport. Joli résultat pour cette fable historique en forme d’hommage à Edmond Charlot…
Michel Wilson
« ZABOR OU LES PSAUMES » de Kamel Daoud, (Actes sud, 2017)
Bien que ce livre soit de parution récente, on en a déjà beaucoup parlé, et principalement en tant que deuxième livre d’un auteur qui s’est rendu célèbre par le premier : on se souvient évidemment de Meursault, contre-enquête paru en 2013 et couvert de prix— le livre révolutionnaire en cela qu’il donne un nom à l’Arabe anonyme de Camus !
On peut d’ailleurs regretter que ce nouveau succès dans le genre romanesque détourne un peu l’attention d’un gros livre très remarquable qui l’a précédé de quelques mois seulement et qui donne une idée des qualités de Kamel Daoud en tant que journaliste, ce qui fut son premier métier. Il s’agit de Mes indépendances (Actes Sud, 2017), gros recueil de 182 chroniques parues dans la presse de 2010 à 2016, du New York Times au Point, en passant, pour la plupart, par Le Quotidien d’Oran. Les lecteurs, qui en France du moins privilégient le roman et toute forme de fiction, devraient considérer que ces Chroniques constituent une véritable « roman de formation » de leur auteur pendant les années où il conquiert liberté personnelle et maîtrise de soi.
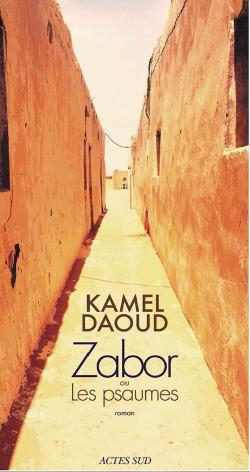 Pour en revenir à Zabor ou les Psaumes il est gênant que la critique, enivrée par le succès grandissant de l’auteur (un succès qu’on pourrait dire acquis quoi qu’il en soit) donne très peu d’informations objectives qui pourraient aider le lecteur. Il le faudrait pourtant, en commençant par le titre qui n’a rien d’évident. Et s’il convient de s’y arrêter un instant, c’est parce que ce serait une erreur de rabattre ici le mot Psaumes sur la Bible, bien qu’il l’évoque inévitablement (le plus grand nombre les Psaumes est attribué à David).
Pour en revenir à Zabor ou les Psaumes il est gênant que la critique, enivrée par le succès grandissant de l’auteur (un succès qu’on pourrait dire acquis quoi qu’il en soit) donne très peu d’informations objectives qui pourraient aider le lecteur. Il le faudrait pourtant, en commençant par le titre qui n’a rien d’évident. Et s’il convient de s’y arrêter un instant, c’est parce que ce serait une erreur de rabattre ici le mot Psaumes sur la Bible, bien qu’il l’évoque inévitablement (le plus grand nombre les Psaumes est attribué à David).
Car il se fait que les psaumes se trouvent aussi dans le Coran, assortis du mot Zabur ou Zabor, qui désigne l’un des trois livres cités par Allah comme antérieurs au Coran lui-même, les autres étant la Tawrat (Torah) et l’Injil (les Évangiles). Cependant, dans le contexte conflictuel qui caractérise l’époque actuelle dès qu’il s’agit de l’islam, beaucoup de lecteurs n’imaginent sans doute pas, du fait qu’il pourfend les islamistes autant qu’il le peut, l’importance des connaissances théologiques dans la formation de Kamel Daoud. D’ailleurs il déplore justement qu’après la disparition des grands savants orientalistes ce genre d’études soit devenu le monopole d’islamistes ignares le plus souvent.
On constate donc que Zabor, qui était un livre, devient le nom du personnage principal et narrateur dans le roman de Kamel Daoud. Ce qui nous amène à ce qui est le thème général de son livre, écrit pour faire l’éloge d’un très grand nombre d’autres livres ainsi que celui de l’écriture, auxquels Zabor son personnage considère qu’il doit tout. Les livres et l’écriture sont doublement au cœur de ce récit. D‘une part, adoptant le ton du conte, un genre dont on sait de quelle faveur il jouit en Orient, l’auteur use du merveilleux et imagine que Zabor son héros dispose d’un don étonnant qui est de pouvoir retarder la mort par son écriture. D’autre part ce même Zabor, dont le portrait en cela est très autobiographique, ne vit que grâce à l’environnement de livres qu’il a su se procurer malgré des conditions très difficiles et se meut grâce à eux dans le libre domaine de l’imaginaire. Souvent, les titres seuls suffisent à son envol et lui permettent de s’approprier des œuvres auxquelles il donne un contenu très personnel. Zabor ne cesse d’écrire, pour faire bon usage d’un don qui lui est propre, mais le romancier ne nous parle pas de ses écrits en tant qu’œuvres originales et personnelles, tout au contraire il mêle son écriture à celle d’un grand nombre d’auteurs ; et loin de cacher la présence de ceux-ci dans son livre, il la revendique et revendique le « vol » comme le plus bel hommage qui puisse leur être rendu.
 La pratique dont il use ainsi abondamment a un nom dans l’histoire récente de la critique littéraire, qui a inventé pour la désigner le mot intertextualité. Si le mot est nouveau, cette façon de faire ne l’est aucunement. Le fait récent est plutôt qu’on ait pris conscience de l’importance de cette notion pour comprendre les textes littéraires. En voici une brève définition canonique : c’est « l’ensemble des textes mis en relation (par le biais par exemple de la citation, de l’allusion, du plagiat, de la référence et du lien hypertexte) dans un texte donné ». Ce qu’on peut dire de Zabor ou les Psaumes est que ce livre est une véritable défense et illustration de l’intertextualité, comme en témoigne l’abondance des titres dont il est parsemé. Cependant le lecteur s’en aperçoit plus ou moins, selon son degré de culture et de connaissances littéraires. De toute manière, il est clair que l’intertextualité dans le livre de Kamel Daoud est un indice de la richesse et de la complexité de la culture ou des cultures dont il s’emploie à nourrir son talent personnel et son goût d’écrire.
La pratique dont il use ainsi abondamment a un nom dans l’histoire récente de la critique littéraire, qui a inventé pour la désigner le mot intertextualité. Si le mot est nouveau, cette façon de faire ne l’est aucunement. Le fait récent est plutôt qu’on ait pris conscience de l’importance de cette notion pour comprendre les textes littéraires. En voici une brève définition canonique : c’est « l’ensemble des textes mis en relation (par le biais par exemple de la citation, de l’allusion, du plagiat, de la référence et du lien hypertexte) dans un texte donné ». Ce qu’on peut dire de Zabor ou les Psaumes est que ce livre est une véritable défense et illustration de l’intertextualité, comme en témoigne l’abondance des titres dont il est parsemé. Cependant le lecteur s’en aperçoit plus ou moins, selon son degré de culture et de connaissances littéraires. De toute manière, il est clair que l’intertextualité dans le livre de Kamel Daoud est un indice de la richesse et de la complexité de la culture ou des cultures dont il s’emploie à nourrir son talent personnel et son goût d’écrire.
On peut déduire de cette pluralité que Kamel Daoud n’est certainement pas l’adepte d’un seul livre, qui dans le contexte musulman ne pourrait être que le Coran. Le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est pas de ceux qui prétendent tout trouver dans ce livre, avec majuscule le Livre, et donc se limiter à lui (exigeant qu’il en soit de même pour les autres ! ) A tous égards, Kamel Daoud prône l’ouverture, ce qui signifie particulièrement la liberté de choisir. Cette liberté est essentielle pour lui, elle l’amène à s’inscrire en faux contre le nationalisme voire le chauvinisme qui enferme son pays et l’empêche de se renouveler depuis plusieurs décennies. Il admire en revanche que dans un pays voisin du sien, la Tunisie, des femmes et des hommes luttent courageusement pour donner à leur avenir la forme de leur choix. Lui aussi se bat comme il peut et il célèbre les livres comme les armes principales de son combat.
Denise Brahimi
« LE FOU DU ROI » de Mahi Binebine (Stock, 2017)
Les lecteurs n’auront pas oublié l’un des derniers livres de Mahi Binebine dont on a beaucoup parlé, Les étoiles de Sidi Moumen (2010) dont Nabil Ayouch a tiré un film sous le titre Les Chevaux de Dieu .
 Cet auteur cumule les qualifications et les recherches artistiques puisqu’il est également peintre, sculpteur et a fait dans sa vie bien d’autres métiers. Dans son œuvre romanesque (à ce jour, neuf romans) il a abordé plusieurs fois ce qui va faire le sujet non seulement principal mais unique du Fou du roi. Ce point de départ est totalement biographique et plonge dans le règne du roi précédent Hassan II : son père en a été le courtisan et a vécu pendant quarante ans a plus près du roi, désigné sous le nom de Sidi . Ce qui en soit est déjà assez exceptionnel pour mériter un récit, mais ne constitue pourtant que l’un des deux volets d’une situation assurément tragique puisque l’autre fait, ô combien bouleversant en est à l’opposé, et concerne l’histoire violente et douloureuse vécue par le frère de l’auteur : celui-ci pour avoir participé en tant qu’officier à l’attentat bien connu de Skhirat (1971)contre le roi a passé dix-huit ans de sa vie au bagne de Tazmamart dont il fait partie des rares survivants. De ce frère aussi il est question dans Le fou du roi, surtout à la fin du livre, alors qu’auparavant c’est surtout de la douleur de Mina sa mère qu’il est question : même si elle ne peut rien obtenir de son mari le « fou du roi », elle ne cesse de croire au retour de son fils.
Cet auteur cumule les qualifications et les recherches artistiques puisqu’il est également peintre, sculpteur et a fait dans sa vie bien d’autres métiers. Dans son œuvre romanesque (à ce jour, neuf romans) il a abordé plusieurs fois ce qui va faire le sujet non seulement principal mais unique du Fou du roi. Ce point de départ est totalement biographique et plonge dans le règne du roi précédent Hassan II : son père en a été le courtisan et a vécu pendant quarante ans a plus près du roi, désigné sous le nom de Sidi . Ce qui en soit est déjà assez exceptionnel pour mériter un récit, mais ne constitue pourtant que l’un des deux volets d’une situation assurément tragique puisque l’autre fait, ô combien bouleversant en est à l’opposé, et concerne l’histoire violente et douloureuse vécue par le frère de l’auteur : celui-ci pour avoir participé en tant qu’officier à l’attentat bien connu de Skhirat (1971)contre le roi a passé dix-huit ans de sa vie au bagne de Tazmamart dont il fait partie des rares survivants. De ce frère aussi il est question dans Le fou du roi, surtout à la fin du livre, alors qu’auparavant c’est surtout de la douleur de Mina sa mère qu’il est question : même si elle ne peut rien obtenir de son mari le « fou du roi », elle ne cesse de croire au retour de son fils.
On voit la diversité des possibilités affectives et narratives dont Mahi Binebine disposait pour écrire son roman. En fait il en use avec beaucoup de modération et sur ce parti-pris qu’on est amené à réfléchir car il est vrai que le lecteur éprouve d’abord un certain étonnement. Si vraiment l’auteur du livre s’est trouvé aux prises avec ce tiraillement extrêmement violent entre le choix de son père et celui de son frère, on s’attendrait à ce que cette violence s’exprime aussi dans l’écriture et tout permettrait de supposer qu’on va avoir affaire à un récit âpre, déchiré, violent lui aussi comme la situation qui s’y trouve évoquée.
 Or il n’en est rien, le récit est celui du père, qui s’exprime à la première personne, laissant à peine poindre ça et là les difficultés de ce qu’il a vécu pendant tant d’années. Le roi qu’il a servi sidi est un despote tout puissant et les gens de son entourage payent généralement de leur vie ou d’humiliations effroyables le fait de lui avoir déplu. Le père, qui joue auprès de lui le rôle de bouffon, ne s’en tire qu’en inventant à chaque instant une plaisanterie farcesque, un trait d’humour inattendu voire risqué, et ce jusqu’à la fin du livre, qui est aussi la fin du roi, car le livre commence au moment où il est déjà quasi mourant (Hassan II est mort en 1999).
Or il n’en est rien, le récit est celui du père, qui s’exprime à la première personne, laissant à peine poindre ça et là les difficultés de ce qu’il a vécu pendant tant d’années. Le roi qu’il a servi sidi est un despote tout puissant et les gens de son entourage payent généralement de leur vie ou d’humiliations effroyables le fait de lui avoir déplu. Le père, qui joue auprès de lui le rôle de bouffon, ne s’en tire qu’en inventant à chaque instant une plaisanterie farcesque, un trait d’humour inattendu voire risqué, et ce jusqu’à la fin du livre, qui est aussi la fin du roi, car le livre commence au moment où il est déjà quasi mourant (Hassan II est mort en 1999).
Il se peut que ce jeu avec la mort, qui excite la créativité, procure un certain plaisir. En fait, Mahi Binebine n’hésite pas à aller plus loin, il fait comprendre et même dit explicitement qu’il y a une véritable amitié, très forte, entre le roi et son bouffon, par-delà la tentative d’assassinat du fils de bouffon sur la personne du roi.
Mahi Binebine dit qu’il a voulu donner la parole à son père et se placer de son point de vue, qui n’est pas le plus facile, on s’en doute, depuis la mort d’Hassan II. Il tient parole et parvient à soutenir cet étrange défi. Quelles sont les parts respectives de la vérité et de la fiction dans ce qu’il nous raconte ? Il se garde bien de le dire lui-même, invoquant le fait que de toute façon son livre est un conte, à la manière des Marocains très attachés à leur tradition orale comme on peut le voir par exemple dans le célèbre Enfant de sable de Tahar ben Jelloun. Il est clair en tout cas que Mahi Binebine veut écrire un livre non violent et un livre de réconciliation. Pour ce faire, il a choisi une écriture très fluide, sans aspérité ce qui fait que le livre se lit très facilement. A dire vrai on oublierait presque ce qu’il y a de terrible dans ce qu’il décrit. Mais il faut se dire que les Marocains, eux, ne risquent certainement pas d’oublier, du moins pour ce qui concerne la génération la plus ancienne. Ou de manière plus ambiguë, on peut penser aussi qu’ils font le choix d’un oubli volontaire, condition indispensable de la paix civile qui est leur principale aspiration.
En choisissant les derniers moments de vie du roi, Mahi Binebine rend plus facile l’option du pardon même s’il est vraisemblable qu’une petite minorité ne puisse encore surmonter ses blessures. On a vu chez beaucoup de Marocains cette alternance, ou cette simultanéité, entre l’amour et la détestation de leur roi. Par ailleurs, on trouve dans un article de Jeune Afrique l’hypothèse qu’il s’agirait d’une forme collective du syndrome de Stockholm, dont on sait qu’il caractérise certains otages ayant vécu longtemps avec leur geôlier au point d’entrer en empathie avec lui. Voici ce qu’on peut lire dans cet article du 30 mars 2017, à propos des Marocains :
« À se demander s’ils ne sont pas collectivement frappés du syndrome de Stockholm dont sont victimes les otages : elles peuvent développer de la sympathie, de l’affection et même parfois de l’amour envers leur ravisseur.
Ce à quoi Binebine répond : ‘Les années de plomb au Maroc ne sont pas une fiction. Nous avons été terrorisés, nous avons vécu l’arbitraire, l’injustice, le népotisme. Les rafles, les disparitions étaient monnaie courante… Et vous savez quoi, notre “petit père des peuples” fascinait les Marocains. À sa mort, les gens maltraités des décennies durant le pleuraient sincèrement… Syndrome de Stockholm ? Oui, certainement ! ‘»
En dépit de son sujet qui est effroyable, il est certain que le récit de Mahi Binebine se lit facilement et agréablement. Faut-il penser que l’auteur a voulu éviter une nouvelle crise nationale comme celle que le Maroc vient de vivre au moment où il écrit, la crise provoquée par le film de Nabil Ayouch, (2015), sur la prostitution au Maroc. En tout cas il a dit lui-même combien il regrettait l’inévitable dévalorisation du Maroc qui s’en est suivie :
« La cabale orchestrée contre le film a donné une bien mauvaise image du Maroc. Il y a même eu des appels au meurtre contre l’artiste. Ce qui est absurde et ne correspond nullement à l’état d’avancement de notre démocratie. Le pays a beaucoup changé. Même s’il subsiste des forces de résistance réfractaires au progrès, l’ouverture est irréversible. » Puisse-t-il dire vrai !
Denise Brahimi
- Samedi 2 décembre au CSC Peyri à Vaulx en Velin: Soirée orientale « Les chibanis s’la racontent », avec l’orchestre Nouiba
- Lundi 4 décembre à Ciné Duchère, soirée débat autour du film « En attendant les hirondelles » de Karim Moussaoui, avec Denise Brahimi et Merwane Daouzli
- Mardi 5 décembre à Lyon 2 et à Villeurbane, lancement du colloque « Créer/publier en français aujourd’hui depuis le Maghreb »
- Du mercredi 6 au vendredi 8 décembre, à Grenoble, poursuite du Colloque « créer/publier en français aujourd’hui depuis le Maghreb »
- Vendredi 8 juillet à 20h30 au Théâtre de Givors, représentation de la pièce « Nathan le Sage », de Lessing, mise en scène par Dominique Lurcel.



