Cultures franco-maghrébines – Lettre #21
ÉDITO
Après un mois de mars ponctué de nombreuses découvertes cinématographiques venues du Maghreb, relayées par notre association ( et que nous poursuivons en avril en accompagnant le film tunisien “Vent du Nord”), le mois d’avril est le rendez vous annuel des Cinémas du Sud à l’Institut Lumière de Lyon (programme dans notre agenda). Notre lettre évoque ce mois ci la dernière œuvre de Merzak Allouache.
Mais aussi quelques belles rencontres littéraires que nous vous proposons de partager avec nous.
Merci de vos retours, de vos suggestions. Et de nous relayer auprès de vos proches.
Michel Wilson

“ENQUÊTE AU PARADIS” de Merzak Allouache (2018) avec Salima Abada
 C’est toujours un plaisir de retrouver Merzak Allouache, qui ne cesse de diversifier ses sujets malgré l’évidence d’une préoccupation commune : où en est l’Algérie ? Contre quoi ceux qui y vivent doivent-ils tenter de se battre principalement ? On n’y ajoutera pas la question sans réponse qui serait : avec quelle chance de réussir dans leur combat ? En effet il ne s’agit pas de se livrer à quelque pronostic sur l’avenir de cette société, c’est déjà beaucoup de tenter d’en décrire certains aspects —d’autant que celui dont il est question dans Enquête au paradis est original, même s’il rejoint la grande et vaste problématique de la montée de l’islamisme et de ses effets.
C’est toujours un plaisir de retrouver Merzak Allouache, qui ne cesse de diversifier ses sujets malgré l’évidence d’une préoccupation commune : où en est l’Algérie ? Contre quoi ceux qui y vivent doivent-ils tenter de se battre principalement ? On n’y ajoutera pas la question sans réponse qui serait : avec quelle chance de réussir dans leur combat ? En effet il ne s’agit pas de se livrer à quelque pronostic sur l’avenir de cette société, c’est déjà beaucoup de tenter d’en décrire certains aspects —d’autant que celui dont il est question dans Enquête au paradis est original, même s’il rejoint la grande et vaste problématique de la montée de l’islamisme et de ses effets.
En fait, même lorsque c’est moins évident que dans le cas présent, Merzak Allouache se livre en effet à des enquêtes sur son pays d’origine, en y mettant parfois une part de fiction beaucoup plus grande que dans Enquête au Paradis qui relève principalement du genre documentaire, comme le signifie d’emblée son usage du noir et blanc. Pour être le plus exact possible, il faudrait dire que c’est un film de fiction qui raconte une enquête  menée par une jeune et vaillante journaliste, Nedjma, jouée dans le film par une actrice (Salima Abada) très convaincante et éminemment sympathique, meneuse de jeu à laquelle le réalisateur confie son projet original et astucieux : interroger un nombre non négligeable d’Algériens jeunes et vieux sur l’idée qu’il se font du Paradis. Et si Le mot Algériens est ici au masculin c’est qu’un grand nombre de femmes, choisies au hasard dans la foule, refusent de répondre à l’interpellation de la jeune journaliste.
menée par une jeune et vaillante journaliste, Nedjma, jouée dans le film par une actrice (Salima Abada) très convaincante et éminemment sympathique, meneuse de jeu à laquelle le réalisateur confie son projet original et astucieux : interroger un nombre non négligeable d’Algériens jeunes et vieux sur l’idée qu’il se font du Paradis. Et si Le mot Algériens est ici au masculin c’est qu’un grand nombre de femmes, choisies au hasard dans la foule, refusent de répondre à l’interpellation de la jeune journaliste.
Pour essayer de mettre un peu d’ordre dans cet ensemble de témoignages ou de prises de paroles très diverses et toujours passionnantes, on peut essayer de distinguer les principales catégories d’interlocuteurs qui animent cette enquête animée par les contrastes et les contradictions. D’un côté, une enquêtrice Nedjma, soutenue par son collègue Mustapha qui lui est tout dévoué et par sa mère très aimante qui représente la génération de la décennie noire, frappée de plein fouet par des événements traumatisants. De l’autre côté, celui des gens interrogés et consultés, deux variétés bien différentes représentant l’algérianité contemporaine : d’une part des intellectuels ou en tout cas des gens à l’esprit rationnel, complétement révulsés par les aberrations démentielles des prédicateurs salafistes qui sont au point de départ de l’enquête ; d’autre part des gens, surtout des jeunes, pris au hasard par Nedjma pour tenter de répondre à la question qu’elle leur pose sur leur idée du Paradis. Au total cela fait beaucoup de monde, d’où la longueur du film, (deux heures un quart), souvent jugée excessive et un peu inutile car on a vite compris de quelles oppositions il s’agit, même si on est passablement éberlué.
Le spectre qu’on est amené à parcourir du regard est varié, mais surtout très contrasté, et contrastée aussi la réaction du public embarqué par Merzak Allouache dans cette aventure. En mainte occasion, on éclate de rire tant il est vrai que les propos de certains prédicateurs (l’un surtout, qui est saoudien et fait florès sur les réseaux sociaux) sont d’un crétinisme hilarant : les abominations du vice moderne incitent les femmes à user de vaseline et de crème nivéa (sic) pour accroître leur séduction perverse ; les « bons » croyants (mot encore une fois au masculin car il n’est question que des hommes) seront récompensés de leurs souffrances en ce monde par l’accueil qui les attend au Paradis : pas moins de 72 houris par croyant pour leur prodiguer les plaisirs les plus sensuels –ce que l’un des commentateurs appelle la pornographie islamiste etc.
Et pourtant, en dépit du rire provoqué par ces propos grotesques, on ne peut qu’être consterné par les nombreuses réponses que Nedjma reçoit de jeunes gens interrogés qui n’ont nullement l’air de crétins mais tout simplement de garçons ordinaires répondant honnêtement aux questions posées. Oui, ils croient qu’il en sera bien comme dit le prédicateur, parce que c’est Dieu qui le veut ainsi. 72 houris, ce n’est pas trop pour un seul homme ? Non, non, à la limite, on pourrait même en souhaiter un peu plus. Désopilant et tragique, voilà donc en quoi consiste le témoignage de Merzak Allouache sur ces pauvres garçons si misérablement frustrés qu’ils sont prêts à accepter n’importe quelle compensation supposée, d’autant que manifestement ils n’ont jamais rencontré la moindre occasion ou la moindre chance de se pourvoir d’un esprit critique. Ce sont des proies innocentes, qui n’ont jamais bénéficié d’un enseignement digne de ce nom et qui sont laissées à la merci de gens finalement très dangereux, parce qu’ils exploitent sans vergogne leur crédulité. Le rappel de la décennie noire, discret mais très présent, ferait passer l’envie de rire à n’importe qui. De plus les réflexions soutenues des intellectuels, artistes et autres personnalité éminentes convoquées par le réalisateur nous invitent à nous indigner plus encore qu’à en rire, on entend des hommes et des  femmes tels que Kamel Daoud et Boualem Sansal, Biyouna et Maïssa Bey (liste non exhaustive) qui incarnent à divers degrés la réaction du bon sens, de l’humanisme et de la raison. On dirait que le réalisateur a voulu dresser en les alignant, ou plutôt en alignant leurs propos sans équivoque, une sorte de barrage contre la marée noire de la stupidité ; et on ne cesse en tant que spectateur, de les remercier d’être là —pour notre réconfort sans doute, mais c’est secondaire —contre la tentation du pessimisme, de la panique, de la désertion physique ou morale face à la réalité du danger.
femmes tels que Kamel Daoud et Boualem Sansal, Biyouna et Maïssa Bey (liste non exhaustive) qui incarnent à divers degrés la réaction du bon sens, de l’humanisme et de la raison. On dirait que le réalisateur a voulu dresser en les alignant, ou plutôt en alignant leurs propos sans équivoque, une sorte de barrage contre la marée noire de la stupidité ; et on ne cesse en tant que spectateur, de les remercier d’être là —pour notre réconfort sans doute, mais c’est secondaire —contre la tentation du pessimisme, de la panique, de la désertion physique ou morale face à la réalité du danger.
Oui il y a combat, mais dans l’Algérie de 2017, il n’est pas possible qu’on puisse entendre une seule voix, si relayée qu’elle soit par les réseaux sociaux. Le film de Merzak Allouache nous en convainc par l’intelligence, la franchise et par la beauté même des visages filmés en gros plans de ceux qui dénoncent l’entreprise d’abêtissement.
Denise Brahimi

“LE MIEL DE LA SIESTE” de Amine Zaoui (Edition Barzakh) 2017
Bienvenue en pays d’Absurdie. Amin Zaoui continue à explorer sur le mode onirique son Algérie. L’auteur de Sommeil de mimosa (Le Serpent à plume, 1998), Festin de mensonges (Barzakh/Fayard, 2007), et Le dernier juif de Tamentit (Barzakh, 2012) a  encore frappé. Son dernier roman, Le Miel de la sieste, est iconoclaste, politiquement incorrect. Les lecteurs frileux seront déroutés. Les prudes et les bigots seront choqués. Les fous de Dieu le livreront aux gémonies sans l’avoir lu. Le romancier algérien se donne toutes les libertés en choisissant le mode du conte. Cela commence comme une histoire des Mille et nuits. Anzar est le fils d’Anfar Afaya el-Kebir et de son oncle Wardane. Il ne sait pas qui est son père. Il porte la malédiction du mort-vivant parce qu’on lui a donné le prénom de son cousin mort-né (peut-être son frère). Il aime Malika mais ne sait pas si elle est la fille de Wardane ou de son père. Le ton est donné d’emblée. Les repères de filiation sont brouillés. Mensonges et vérités se télescopent. Un des chapitres commence ainsi : « Je lance une pièce dans l’air, Je l’attrape dans mes mains chaudes et tremblantes. Pile : je mens, Face : je raconte la vérité. Donc : face ». Anzar est né à Bab-el-Kamar, le village de la lune, habité par trente-deux poètes portant le même nom : « Souleymane » et sept lecteurs du Coran tous aveugles et polygames. Amin Zaoui ne recule devant aucune outrance. Anzar est doté d’une paire de testicules dont le droit est plus volumineux que le gauche, ce qui lui vaut le surnom de Bouklaoui. Cette difformité inquiète sa mère mais attire sa tante, Khala Djouhra, la femme « aux mains de soie » qui lui « murmure des prières pendant qu’elle lui caresse les couilles ». Sa première expérience sexuelle a lieu avec « une ânesse au regard doux ». Il dira à son propos : « Aucune femme ne m’a offert pareille satisfaction ». Sa première amante est une diplomate de soixante ans de l’ambassade de RDA qui le découvre dans un lycée d’Alger où il apprend l’allemand. Il se souvient de « ses gémissements de louve entrecoupés de commentaires sur les enquêtes de l’inspecteur Derrick ». Les récits délirants se suivent sans préoccupation logique, scandés par cette phrase qui revient de manière lancinante : « Et pourquoi est-ce que je reviens dans ce village des mouches bleues ?». Les hommes hurlent comme des loups et les animaux sont philosophes ou héros au destin tragique. Laïka, l’amante du président Nikita, est la première chienne envoyée dans l’espace. Sacrifiée à l’autel du progrès, elle meurt dans sa capsule. Socrate, le chien de Jean Sénac « jappe des slogans socialistes ». Après l’assassinat de son maître, il rêve de rejoindre Malika qui vit enfermée à l’hôpital psychiatrique de Sidi Chamy dans la banlieue d’Oran. Il préfère les fous aux gens de la vraie vie. Anzar se recueille souvent sur la tombe de Sénac « l’homme qui signait d’un soleil rond et qui dort dans le cimetière d’Aïn Benian, face à la mer ». Il lui raconte les blagues qui circulent sur la vie privée du président de la République. « Jean rit comme un fou ». Anzar rencontre des personnages peu recommandables : le coiffeur Langlizi , le pédophile fourbe, Al-taureau, le satyre. Il préfère les femmes aux hommes. « Tous des cons ! ». Rachel, Hana-la dodue, Ghita, Khira, ont une place de choix. Toutes le ramènent invariablement à Malika (sa cousine, sa sœur?) enfermée dans son asile. Anzar déteste son père décédé dont il garde pourtant la photo.
encore frappé. Son dernier roman, Le Miel de la sieste, est iconoclaste, politiquement incorrect. Les lecteurs frileux seront déroutés. Les prudes et les bigots seront choqués. Les fous de Dieu le livreront aux gémonies sans l’avoir lu. Le romancier algérien se donne toutes les libertés en choisissant le mode du conte. Cela commence comme une histoire des Mille et nuits. Anzar est le fils d’Anfar Afaya el-Kebir et de son oncle Wardane. Il ne sait pas qui est son père. Il porte la malédiction du mort-vivant parce qu’on lui a donné le prénom de son cousin mort-né (peut-être son frère). Il aime Malika mais ne sait pas si elle est la fille de Wardane ou de son père. Le ton est donné d’emblée. Les repères de filiation sont brouillés. Mensonges et vérités se télescopent. Un des chapitres commence ainsi : « Je lance une pièce dans l’air, Je l’attrape dans mes mains chaudes et tremblantes. Pile : je mens, Face : je raconte la vérité. Donc : face ». Anzar est né à Bab-el-Kamar, le village de la lune, habité par trente-deux poètes portant le même nom : « Souleymane » et sept lecteurs du Coran tous aveugles et polygames. Amin Zaoui ne recule devant aucune outrance. Anzar est doté d’une paire de testicules dont le droit est plus volumineux que le gauche, ce qui lui vaut le surnom de Bouklaoui. Cette difformité inquiète sa mère mais attire sa tante, Khala Djouhra, la femme « aux mains de soie » qui lui « murmure des prières pendant qu’elle lui caresse les couilles ». Sa première expérience sexuelle a lieu avec « une ânesse au regard doux ». Il dira à son propos : « Aucune femme ne m’a offert pareille satisfaction ». Sa première amante est une diplomate de soixante ans de l’ambassade de RDA qui le découvre dans un lycée d’Alger où il apprend l’allemand. Il se souvient de « ses gémissements de louve entrecoupés de commentaires sur les enquêtes de l’inspecteur Derrick ». Les récits délirants se suivent sans préoccupation logique, scandés par cette phrase qui revient de manière lancinante : « Et pourquoi est-ce que je reviens dans ce village des mouches bleues ?». Les hommes hurlent comme des loups et les animaux sont philosophes ou héros au destin tragique. Laïka, l’amante du président Nikita, est la première chienne envoyée dans l’espace. Sacrifiée à l’autel du progrès, elle meurt dans sa capsule. Socrate, le chien de Jean Sénac « jappe des slogans socialistes ». Après l’assassinat de son maître, il rêve de rejoindre Malika qui vit enfermée à l’hôpital psychiatrique de Sidi Chamy dans la banlieue d’Oran. Il préfère les fous aux gens de la vraie vie. Anzar se recueille souvent sur la tombe de Sénac « l’homme qui signait d’un soleil rond et qui dort dans le cimetière d’Aïn Benian, face à la mer ». Il lui raconte les blagues qui circulent sur la vie privée du président de la République. « Jean rit comme un fou ». Anzar rencontre des personnages peu recommandables : le coiffeur Langlizi , le pédophile fourbe, Al-taureau, le satyre. Il préfère les femmes aux hommes. « Tous des cons ! ». Rachel, Hana-la dodue, Ghita, Khira, ont une place de choix. Toutes le ramènent invariablement à Malika (sa cousine, sa sœur?) enfermée dans son asile. Anzar déteste son père décédé dont il garde pourtant la photo.  Une photo qui s’anime parfois. Son père continue à le persécuter. Terrorisé par son regard, il décide de l’accrocher la tête à l’envers. Le narrateur se joue de nous. Il nous entraîne avec jubilation dans son récit/labyrinthe, mêlant inventions et personnages réels. Patrick Chamoiseau, « facteur de son métier, passionné de rhum et de café arabica », s’éprend d’une belle Algérienne rencontrée pendant le festival panafricain. Isabelle Astier, de son vrai nom Yaguel Bensaïd, native d’El Karma, ex-Valmier, obligée de quitter l’Algérie après le meurtre de son mari en 1964, décide d’oublier la langue arabe, celle des chants d’amour qu’elle fredonnait avec Reinette l’Oranaise dans les bars de la corniche oranaise. Anzar invente des histoires fantastiques pour séduire Ghita (Rita ? Rita Hayworth ?). On y croise Philip Roth et le fantôme de Kafka. Un long soliloque de Hana-ladodue évoque la fin tragique du docteur Belkhenchir et des intellectuels assassinés pendant « la décennie noire ». Où sommes nous ? Dans l’hôpital psychiatrique de Sidi Chamy (lieu central du livre) ou dans la vraie vie. « Pile : je mens. Face : je dis la vérité. Donc : face ». Voila qui est dit.
Une photo qui s’anime parfois. Son père continue à le persécuter. Terrorisé par son regard, il décide de l’accrocher la tête à l’envers. Le narrateur se joue de nous. Il nous entraîne avec jubilation dans son récit/labyrinthe, mêlant inventions et personnages réels. Patrick Chamoiseau, « facteur de son métier, passionné de rhum et de café arabica », s’éprend d’une belle Algérienne rencontrée pendant le festival panafricain. Isabelle Astier, de son vrai nom Yaguel Bensaïd, native d’El Karma, ex-Valmier, obligée de quitter l’Algérie après le meurtre de son mari en 1964, décide d’oublier la langue arabe, celle des chants d’amour qu’elle fredonnait avec Reinette l’Oranaise dans les bars de la corniche oranaise. Anzar invente des histoires fantastiques pour séduire Ghita (Rita ? Rita Hayworth ?). On y croise Philip Roth et le fantôme de Kafka. Un long soliloque de Hana-ladodue évoque la fin tragique du docteur Belkhenchir et des intellectuels assassinés pendant « la décennie noire ». Où sommes nous ? Dans l’hôpital psychiatrique de Sidi Chamy (lieu central du livre) ou dans la vraie vie. « Pile : je mens. Face : je dis la vérité. Donc : face ». Voila qui est dit.
Derrière les ruses et les facéties de ce conte loufoque, se cache une charge impitoyable contre l’aliénation et l’instrumentalisation d’une religion dévoyée par des ignorants. Un cri de liberté lancé à la face des empêcheurs de vivre et d’aimer.
Omar Hallouche
“LOIN DE FES DISPERSES”de Francine Kahn, Maroc, Virgules éditions, 2017
De ce roman on aurait croire qu’il est autobiographique, ce qui est démenti par son auteure. Cependant, elle est manifestement très bien renseignée sur tout ce qui concerne les avatars de la communauté juive marocaine à partir de l’indépendance de 1956, et même sur son mode de vie traditionnel auparavant. Il y a dans le livre de Francine Kahn  une volonté d’expliquer qui relève du « devoir de mémoire » —c’est l’expression désormais consacrée pour dire une certaine urgence d’agir avant la disparition et l’oubli. L’auteure attribue ce genre de préoccupation au personnage de jeune fille qu’elle appelle Manda, et dont elle fait la narratrice de son premier chapitre (on ne la retrouvera qu’au dernier), d’où l’on peut conclure que ce besoin de lutter contre l’oubli en cours (déjà très avancé), se fait jour—et d’abord sous la forme d’un besoin personnel d’exhumer le passé—avec la troisième génération qui fait suite à l’exil et à la dispersion. Ces deux termes sont mis en exergue par l’auteure dans des citations qui précèdent son récit, et l’on peut voir qu’elle a volontairement utilisé le second dans son titre. Le roman est là pour s’opposer à ce que l’histoire a provoqué comme béance et comme vide, c’est pourquoi son auteure n’hésite pas à être didactique, dans des notes explicatives et par l’emploi de nombreuses dates qui figurent aux titres de ses dix chapitres.
une volonté d’expliquer qui relève du « devoir de mémoire » —c’est l’expression désormais consacrée pour dire une certaine urgence d’agir avant la disparition et l’oubli. L’auteure attribue ce genre de préoccupation au personnage de jeune fille qu’elle appelle Manda, et dont elle fait la narratrice de son premier chapitre (on ne la retrouvera qu’au dernier), d’où l’on peut conclure que ce besoin de lutter contre l’oubli en cours (déjà très avancé), se fait jour—et d’abord sous la forme d’un besoin personnel d’exhumer le passé—avec la troisième génération qui fait suite à l’exil et à la dispersion. Ces deux termes sont mis en exergue par l’auteure dans des citations qui précèdent son récit, et l’on peut voir qu’elle a volontairement utilisé le second dans son titre. Le roman est là pour s’opposer à ce que l’histoire a provoqué comme béance et comme vide, c’est pourquoi son auteure n’hésite pas à être didactique, dans des notes explicatives et par l’emploi de nombreuses dates qui figurent aux titres de ses dix chapitres.
En fait l’histoire événementielle qui constitue le livre comme narration commence en 1957, juste après que la France a renoncé à exercer son protectorat sur le Maroc. Mais il y a dans le roman des indications antérieures à cette date, à la fois pour évoquer le mode de vie séculaire et les mœurs traditionnelles des juifs marocains, (en tout cas dans le milieu très modeste des petits artisans dont le personnage exemplaire, Mordechaï, meurt en 1959) ; et aussi parce que le départ en nombre de cette communauté pour Israël a commencé avant l’indépendance marocaine, dès la création de l’Etat d’Israël en 1948.
La première génération est celle de Mordechaï et de sa femme Sarah qui lui survit mais quitte Fès pour Paris en juin 1960. A cette date, la deuxième génération, celle de leurs enfants, a déjà quitté le Maroc, l’aîné Maurice est venu en France dès 1957 pour y mener la vie d’un militant politique, communiste et engagé contre la guerre d’Algérie. Son cadet Ruben part lui aussi en 1961 mais dans des conditions beaucoup plus dramatiques et angoissantes, parce qu’il part pour Israël et qu’à cette date il doit le faire clandestinement, suivant les consignes très rigoureuses de l’organisation sioniste à laquelle il s‘est rallié. Il y a d’ailleurs dans la vie de Ruben une autre forme de clandestinité, due au fait qu’il est homosexuel, ce dont à l’époque et dans son milieu il lui fallait impérativement se cacher. La troisième génération est celle des enfants de Maurice, un garçon et une fille, Emile (en hommage à Zola et à son célèbre « J’accuse » !) et Manda, nés de mères différentes. Ils se retrouvent dans ce qui constitue le dernier moment du livre, en 2014, juste après le voyage à Fès de Manda, partie à la recherche de sa lignée, les Assayag, jusque dans le cimetière où se trouve la tombe de son grand-père Mordéchaï.
 Si l’on réfléchit à ce que Francine Kahn nous dit de ces trois générations, il apparaît que la personne la plus durement touchée par ces perturbations historiques considérables a été Sarah, dont la vie à Paris à partir de 1960 a été très difficile à tous égards, matériellement et physiquement, affectivement et moralement. Sans aucun appui de la part de ses deux aînés, Maurice et Ruben, elle a dû élever seule les deux plus jeunes, Raphaël et Fortune, dont le premier surtout a connu une adolescence violente et tourmentée. La transplantation de Sarah, devenue ouvrière française au niveau le plus précaire du prolétariat, se fait entre deux mondes si totalement différents qu’on voit mal ce qu’aurait pu signifier pour elle les mots « adaptation » ou « intégration ».
Si l’on réfléchit à ce que Francine Kahn nous dit de ces trois générations, il apparaît que la personne la plus durement touchée par ces perturbations historiques considérables a été Sarah, dont la vie à Paris à partir de 1960 a été très difficile à tous égards, matériellement et physiquement, affectivement et moralement. Sans aucun appui de la part de ses deux aînés, Maurice et Ruben, elle a dû élever seule les deux plus jeunes, Raphaël et Fortune, dont le premier surtout a connu une adolescence violente et tourmentée. La transplantation de Sarah, devenue ouvrière française au niveau le plus précaire du prolétariat, se fait entre deux mondes si totalement différents qu’on voit mal ce qu’aurait pu signifier pour elle les mots « adaptation » ou « intégration ».
Cependant la destinée de ses deux aînés, Maurice et Ruben, témoigne aussi pour l’un comme pour l’autre de grandes difficultés. On est d’abord au fait de ce qui concerne Ruben, de sa vie au kibboutz et de ses déboires d’homosexuel amoureux. Le roman de Francine Kahn n’est pas une œuvre de dénonciation mais elle n’hésite pas non plus à faire certains constats. On peut s’interroger avec elle sur le bien-fondé de l’action menée par les organisations sionistes. En tout cas, certains de leurs arguments étaient de pure propagande et se sont révélés mensongers : les juifs marocains n’ont pas été bien accueillis en Israël et y ont été traités comme un catégorie de population inférieure, à peine civilisée. Ce témoignage est le même que celui d’un film dont on a beaucoup parlé dans les années 2012-2014 : De Tinghir à Jérusalem, du réalisateur Kamal Hachkar. Il y est question de juifs qui habitaient un village berbère marocain du sud, au pied du Haut-Atlas et qui, partis en masse en Israël, disent à ce propos leur déception et leurs regrets.
Autres regrets et déceptions, chez Maurice cette fois, père de Manda et Milou. Maurice, qui a choisi Paris, gâche sa vie personnelle par impossibilité de choisir entre deux femmes, et même si l’on observe à cet égard la discrétion dont fait preuve Francine Kahn, qui en matière de psychologie n’a pas la prétention d’expliquer, on se dit que sa transplantation entre deux pays n’est sans doute pas sans rapport avec ses flottements et son impossibilité à se fixer. Par ailleurs il est au nombre des nombreux militants déçus par le communisme et amenés à constater l’écart grandissant entre leurs idéaux et la politique de ce parti. Selon le récit qu’Emile en fait à Manda, Maurice a passé toute la fin de sa vie dans un état dépressif et prostré. Il apparaît donc que même le départ volontaire de ceux qui ont quitté le Maroc en ayant un projet de vie n’a pas toujours débouché sur des réussites, loin de là. Si la première génération a presque forcément été sacrifiée, la deuxième a connu d’autres formes d’un mal-être parfois difficile ou impossible à surmonter.
Francine Kahn tisse habilement des liens entre la situation historique et les destinées individuelles, ce qui est la vocation essentielle du roman.
Denise Brahimi
“L’ISLAM, UNE RELIGION FRANCAISE” de Hakim el Karoui : Gallimard, (le débat) 2018
Un essai sur l’islam en France sinon de France, n’a rien d’une nouveauté dira-t-on, et peut-être même que ce sera avec un soupire accablé, signifiant : un de plus ou encore un.
Il y a pourtant quelques bonnes raisons de lire celui-là, à commencer par sa date : c’est vraiment si l’on ose dire le dernier-né ou presque, ce qui a son importance dans un domaine placé au cœur de l’actualité, et où l’on est amené à apprendre chaque jour des faits nouveaux. Si passionnant que cela puisse être, cette position doit d’ailleurs inspirer la plus grande méfiance car la présentation des faits par les médias est absolument 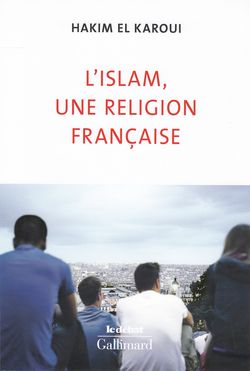 redoutable, et telle qu’il n’est pas question de s’y fier. Or le livre de Hakim el Karoui a le gros avantage de s’appuyer sur une enquête sérieuse et chiffrée, menée en 2016 par un organisme qui ne prendrait sûrement pas le risque d’écrire n’importe quoi, puisqu’il s’agit de ce qu’on appelle en français un Think Tank (groupe de réflexion), l’Institut Montaigne, qui s’efforce de définir des politiques publiques dans plusieurs domaines, dont la gestion de l’islam fait partie.
redoutable, et telle qu’il n’est pas question de s’y fier. Or le livre de Hakim el Karoui a le gros avantage de s’appuyer sur une enquête sérieuse et chiffrée, menée en 2016 par un organisme qui ne prendrait sûrement pas le risque d’écrire n’importe quoi, puisqu’il s’agit de ce qu’on appelle en français un Think Tank (groupe de réflexion), l’Institut Montaigne, qui s’efforce de définir des politiques publiques dans plusieurs domaines, dont la gestion de l’islam fait partie.
Cette enquête dont le livre de Hakim el Karoui exploite très largement les résultats permet à l’auteur de revendiquer « un regard calme sur les Musulmans de France » : c’est le titre de son premier chapitre, le plus riche en chiffres qui permettent de contester des idées fausses et pourtant très répandues. Il en ressort par exemple qu’il y a en France 5 millions de Musulmans et non pas 22 comme le disent ceux qui se sentent menacés par un véritable raz de marée destructeur des valeurs françaises. Français, Musulmans, on voit déjà à quel point tous ces termes demandent à être précisés et le livre justement s’y emploie, d’une manière à la fois précise et claire, ce dont évidemment on lui sait gré. Oui, il est absolument vrai que l’islam est le première religion pratiquée en France, oui, le halal et le voile sont des marqueurs islamistes qui ne cessent de gagner en visibilité, oui il est vrai que beaucoup de jeunes gens, et surtout dans les quartiers défavorisés, sont tentés par l’islamisme, qui bien évidemment fait tout pour les attirer. L’essai de Hakim el Karaoui veut cependant éviter la panique, ce qui ne signifie pas qu’il cherche tout prix à rassurer.
En fait il s’agit d’abord dans son livre d’expliquer ce qu’il en est de l’islamisme, en caractérisant ses principaux aspects, sans ménager les moins acceptables (en soulignant même le fait qu’aucun ne l’est !) Et comme la réponse à l’islamisme prend souvent la forme de ce qu’on appelle, à tort ou à raison, l’islamophobie, l’auteur cherche aussi à expliquer ce qu’il y a de typiquement français (c’est-à-dire lié à la longue histoire d’un pays) dans certaines réactions négatives à l’égard de l’islam —et pas seulement de l’islamisme car il n’y a malheureusement rien de mystérieux dans le rejet qu’inspire ce dernier). Tout ce qui concerne dans le livre « le modèle français d’assimilation » est d’autant plus intéressant que l’auteur recourt à la manière comparatiste pour en parler, l’opposant au « modèle américain » lui aussi explicable historiquement.
Fort heureusement le livre échappe ou presque, aux polémiques qui fleurissent dans le domaine de l’islamologie. Un chapitre, le plus court des six qui composent le livre, leur est cependant consacré, mais plutôt comme une sorte de typologie des positions repérables chez les intellectuels français qui, selon l’auteur en tout cas, « tombent dans le piège islamiste ». Et c’est ainsi qu’on voit défiler des gens comme Edwy Plenel, Caroline Fourest, Alain Finkelkraut ou Eric Zemmour, sans tendresse de cœur pour qui que ce soit mais sans le déferlement d’injures auquel les réseaux sociaux s’adonnent sans modération.
 En fait lorsqu’il en arrive à son 6e et dernier chapitre qui est certainement pour lui le plus important, on comprend que les précédents, certes indispensables, ont servi de préambule à la proposition pratique dans laquelle l’auteur se trouve impliqué personnellement. Il l’expose de manière très détaillée, et sans qu’il y ait le moindre doute sur la nature du projet et ses intentions. « Combattre l’islamisme en créant un islam français », tel est le titre de ce chapitre, qui n’hésite pas à entrer dans des questions matérielles de financement, car il ne s’agit pas d’un vœu pieux, c’est le cas de le dire, mais de la création et du fonctionnement de deux institutions, la Fondation pour l’islam de France, qui date de décembre 2016, aujourd’hui dirigée par Jean-Pierre Chevènement, et une deuxième organisation qui n’a pas encore vu le jour, mais qui devrait être chargée du financement des projets. La conviction d’Hakim el Karoui est qu’il n’y a aucune chance de succès dans cette entreprise tant que des pays étrangers y exerceront leur tutelle alors qu’elle ne doit incomber qu’à l’Etat français et notamment au Ministère de l’Intérieur. Il conviendra de désigner un grand Imam de France, de nationalité française, représentant spirituel de l’islam français et ainsi défini par Hakim el Karaoui : « Il portera un discours et une ligne idéologique qui puiseront au plus profond de valeurs spirituelles de l’islam tout en étant en adéquation avec la société française du XXIe siècle ».
En fait lorsqu’il en arrive à son 6e et dernier chapitre qui est certainement pour lui le plus important, on comprend que les précédents, certes indispensables, ont servi de préambule à la proposition pratique dans laquelle l’auteur se trouve impliqué personnellement. Il l’expose de manière très détaillée, et sans qu’il y ait le moindre doute sur la nature du projet et ses intentions. « Combattre l’islamisme en créant un islam français », tel est le titre de ce chapitre, qui n’hésite pas à entrer dans des questions matérielles de financement, car il ne s’agit pas d’un vœu pieux, c’est le cas de le dire, mais de la création et du fonctionnement de deux institutions, la Fondation pour l’islam de France, qui date de décembre 2016, aujourd’hui dirigée par Jean-Pierre Chevènement, et une deuxième organisation qui n’a pas encore vu le jour, mais qui devrait être chargée du financement des projets. La conviction d’Hakim el Karoui est qu’il n’y a aucune chance de succès dans cette entreprise tant que des pays étrangers y exerceront leur tutelle alors qu’elle ne doit incomber qu’à l’Etat français et notamment au Ministère de l’Intérieur. Il conviendra de désigner un grand Imam de France, de nationalité française, représentant spirituel de l’islam français et ainsi défini par Hakim el Karaoui : « Il portera un discours et une ligne idéologique qui puiseront au plus profond de valeurs spirituelles de l’islam tout en étant en adéquation avec la société française du XXIe siècle ».
Vaste programme assurément mais rien ne dit a priori qu’il soit irréalisable. L’auteur procède par affirmations prudentes, et ne semble pas adepte d’une rêverie utopiste. Les chiffres viennent à l’appui de ce qu’il considère comme des raisons d’être optimiste : en France on constate de plus en plus de mariages mixtes franco-maghrébins ; le modèle français ne manque pas de réussites, qu’on ne fait pas assez connaître, tant on est obnubilé par la situation des quartiers populaires les plus défavorisés. Oui, il y a là beaucoup de jeunes gens qui sont attirés par le fondamentalisme, mais combien de Musulmans en revanche « s’intègrent à petit bruit » pour reprendre une belle formule de l’auteur.
Denise Brahimi
BOULEVARD DES ORANGERS par Mireille Piris (N&B Récit, 2017)
Dans un petit livre très récent de Mireille Piris , Boulevard des Orangers, on trouve la brève évocation d’un souvenir de l’auteure qui a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans à Blida, ayant quitté l’Algérie pour la France, comme tant d’autres, en 1962. Plutôt que de faire un récit linéaire de ce qui a précédé ce départ, elle choisit de l’évoquer sous la forme de fragments poétiques, qui relèvent de la mémoire affective, en marge de l’Histoire et ne l’évoquant que très indirectement et sans dates.
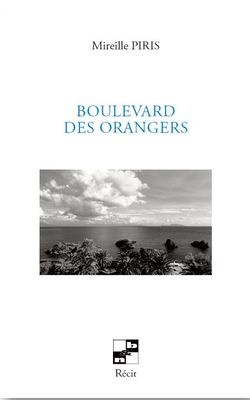 Incontestablement, comme on l’aura compris, sa famille appartient à la communauté Pied-noir, et c’est dans cette malheureuse partition entre les deux camps qu’elle vit les épisodes sanglants de la Guerre d’Algérie. On a souvent dit à très juste titre à quel point les enfants sont traumatisés quand ils se trouvent mêlés à d’aussi terribles événements. Or ce n’est pas dans cet esprit qu’elle évoque un bref épisode qui date sans doute de la période de l’OAS. Quoi qu’il en soit, elle se trouve prise en pleine rue dans une fusillade, crépitements, claquements, cris etc. mais elle n’est pas la seule à y risquer sa vie : un petit garçon kabyle est là lui aussi et voici comment elle évoque, à sa manière indirecte, ce qui s’est passé : « Si dans le même instant je n’avais pas entraîné cet enfant kabyle dans un plongeon sur le trottoir, je n’aurais jamais rencontré, dans l’ineffable silence qui suivit, son regard, je n’y aurais pas vu la stupeur, la terreur, l’étonnement qu’une Française le protège et le prenne dans ses bras. »
Incontestablement, comme on l’aura compris, sa famille appartient à la communauté Pied-noir, et c’est dans cette malheureuse partition entre les deux camps qu’elle vit les épisodes sanglants de la Guerre d’Algérie. On a souvent dit à très juste titre à quel point les enfants sont traumatisés quand ils se trouvent mêlés à d’aussi terribles événements. Or ce n’est pas dans cet esprit qu’elle évoque un bref épisode qui date sans doute de la période de l’OAS. Quoi qu’il en soit, elle se trouve prise en pleine rue dans une fusillade, crépitements, claquements, cris etc. mais elle n’est pas la seule à y risquer sa vie : un petit garçon kabyle est là lui aussi et voici comment elle évoque, à sa manière indirecte, ce qui s’est passé : « Si dans le même instant je n’avais pas entraîné cet enfant kabyle dans un plongeon sur le trottoir, je n’aurais jamais rencontré, dans l’ineffable silence qui suivit, son regard, je n’y aurais pas vu la stupeur, la terreur, l’étonnement qu’une Française le protège et le prenne dans ses bras. »
A ce moment il devient tout à fait évident que ce ne sont pas les faits, les actes ni les gestes (encore moins les paroles puisque de toute façon il n’y en a pas eu) qui se sont fixés dans sa mémoire mais quelque chose d’ineffable comme elle le dit, qui justement ne passe pas par les mots. C’est quelque chose qui ne s’efface pas ni à travers l’espace ni à travers la durée, quelque chose qu’elle a pu voir pendant quelques secondes, le sourire de l’enfant. Après quoi ils se sont relevés tous les deux et se sont séparés : « Chacun son chemin. Je ne crois pas l’avoir jamais revu… »Et ce sont bien ces quelques secondes-là qu’on peut appeler des moments volés à l’histoire. Libre à chacun d’imaginer et de rêver : est-ce que le petit garçon lui aussi s’en souvient grâce à cette mémoire affective (sur laquelle la volonté ne peut rien) qu’on appelle aussi la mémoire proustienne, parce que c’est sur elle que Proust a construit toute sa fresque romanesque ; et nous comprenons, grâce à ces quelques lignes de Mireille Piris, qu’elle n’a rien à voir avec la représentation objective (autant que faire se peut) recherchée par les historiens.
Mireille Piris a l’art d’évoquer des moments qui comme on peut le voir par l’exemple précédent n’ont rien d’anodin. Mais elle le fait sans pathos ni pesanteur, on dirait plutôt que de son texte se dégage une sorte de grâce, d’essence poétique, qui témoigne de son talent d’écrivain.
Denise Brahimi
 Le petit récit de Mireille Piris, joliment édité par la maison toulousaine N&B ressemble à une succession de petits poèmes en prose, autant de fractions de souvenirs d’enfance. Des traversées en bateaux scandent les parties algériennes, Blida, Chréa, Tipasa, et les parties provençales, tensions entre les appartenances du couple de ses parents, l’une, provençale, l’autre français d’Algérie, tensions tout court entre les deux parents… “Mon Dieu, je vous en supplie, faites que mes parents divorcent”.
Le petit récit de Mireille Piris, joliment édité par la maison toulousaine N&B ressemble à une succession de petits poèmes en prose, autant de fractions de souvenirs d’enfance. Des traversées en bateaux scandent les parties algériennes, Blida, Chréa, Tipasa, et les parties provençales, tensions entre les appartenances du couple de ses parents, l’une, provençale, l’autre français d’Algérie, tensions tout court entre les deux parents… “Mon Dieu, je vous en supplie, faites que mes parents divorcent”.
“Entre deux rives, entre deux nages, je rage….” Un très beau poème sur cet entre deux qui résume cette période de vie pose quelques mots justes comme la clé de ce récit.
Par petites touches, les paysages, les situations, les sentiments surgissent, peints de belles couleurs, sans omettre senteurs, températures, sonorités, goûts: la palette de l’auteure est riche et quand ses souvenirs rejoignent ceux du lecteur, on a un plaisir gourmand à partager une telle évidence
. Il faut dire que pour bien des personnes nées en Algérie, la place centrale de Blida, son kiosque et son décor de province française sont reconnaissables comme une carte postale… Les petites histoires intimes et les sensations de la petite fille ou de l’adolescente rencontrent parfois la grande Histoire (le déclenchement de la guerre en novembre 1954, appris au retour de Tipasa, la visite de De Gaulle à Blida en mai 58) ou le drame, celui évité narré ci-dessus par Denise Brahimi, ou l’annonce de la mort de l’amoureux dans un attentat à la bombe à Boufarik. terrible description si concise du corps de son amoureux de 17 ans!
Le récit est ponctué par des bains de mer qui régénèrent, font oublier…
La fin, de départ d’Algérie vient vite, avec toujours la même concision et pourtant des évocations précises et poétiques.
Ce petit livre si riche et sensuel est comme un fruit généreux, cueilli au Boulevard des orangers.
Michel Wilson

ALGERIE/LITTERATURE-ACTION, éditions Marsa, n°s 213-214 et 215-216
La revue Algérie Littérature/Action parvient à maintenir son apport dans le champ culturel des relations franco-algériennes depuis 1996, ce qui est une durée considérable pour une revue et signifie une belle aptitude à surmonter des obstacles qu’on imagine aisément. Même si elle ne parvient pas parfaitement à être mensuelle, on la retrouve toujours finalement et notamment sous la forme de numéros doubles substantiels, nourris aussi bien d’articles critiques que de création. Et surtout elle a droit à la gratitude des lecteurs parce qu’elle maintient une particularité rare voire exceptionnelle qui est de présenter des artistes peintres ou plasticiens à travers une abondance non négligeable de leurs œuvres, souvent difficiles à connaître autrement.
 Les deux derniers numéros de l’année 2017, qui sont des numéros doubles, ne manquent pas à cet excellent usage et ont l’intérêt de présenter deux artistes, un homme et une femme, dont le rapport avec l’Algérie, incontestable dans chaque cas, est aussi à chaque fois différent. C’est pourquoi il vaut la peine de les présenter ensemble, même s’ils appartiennent à deux générations différentes, le premier chronologiquement, Henry Simon, étant mort en 1987, alors que la seconde, Myriam Kendsi est heureusement bien vivante, et semble avoir été particulièrement productive en 2015-2016, dates des tableaux présentés dans le dernier numéro d’Algérie Littérature/Action.
Les deux derniers numéros de l’année 2017, qui sont des numéros doubles, ne manquent pas à cet excellent usage et ont l’intérêt de présenter deux artistes, un homme et une femme, dont le rapport avec l’Algérie, incontestable dans chaque cas, est aussi à chaque fois différent. C’est pourquoi il vaut la peine de les présenter ensemble, même s’ils appartiennent à deux générations différentes, le premier chronologiquement, Henry Simon, étant mort en 1987, alors que la seconde, Myriam Kendsi est heureusement bien vivante, et semble avoir été particulièrement productive en 2015-2016, dates des tableaux présentés dans le dernier numéro d’Algérie Littérature/Action.
S’il est intéressant de les rapprocher, c’est que leur rapport à l’Algérie est si l’on peut dire, inverse à tous égards. Henry Simon est un peintre français d’origine vendéenne qui n’a connu l’Algérie que pendant trois semaines en 1950. Brève rencontre dont les effets auraient pu être négligeables mais qui à l’inverse a provoqué une production picturale tout à fait considérable clairement liée à ce séjour algérien (puisqu’il s’agit d’une peinture figurative qui ne laisse aucun doute sur les sujets représentés). Presque tous les tableaux qu’on voit dans ce numéro d’Algérie Littérature /Action sont datés de 1950, mais il apparaît qu’on a commencé à les connaître en France beaucoup plus tard, à partir de l’an 2000. Henry Simon était parti en Algérie pour des raisons extérieures à la peinture, sans savoir ce qui l’y attendait, même s’il avait une vague idée de ce qu’il espérait bien y trouver (lumière et couleur, évidemment) . On pourrait donc parler à son sujet d’un véritable coup de foudre, comme il peut y en avoir entre une personne et un paysage aussi bien qu’entre deux être humains. Le rapport entre l’Algérie et ceux qu’on appelle les peintres voyageurs est d’ailleurs riche d’aventures comparables.
 Et pour parler maintenant de Myriam Kendsi, née à Oran mais vivant en France depuis l’âge de quatre ans, on pourrait dire qu’elle a fait le mouvement inverse, se trouvant physiquement séparée de son Algérie natale, mais continûment liée à elle d’une autre manière, intime et définitive, de telle sorte que sa peinture s’en trouve imprégnée. Par chance, Myriam Kendsi elle-même, faisant preuve d’une belle capacité à l’auto-analyse, explique ce qui nous apparaît dans sa peinture comme un mélange paradoxal de fusion par l’interpénétration des couleurs, et de failles ou lignes de rupture, laissant place cependant à des possibilités de raccordement. La dualité, dit-elle, est au cœur de son travail, faisant « écho à son histoire familiale située dans un entre-deux, un entre jeu de deux vis-à-vis, l’Algérie et la France ». Mais au vu de sa peinture, nous sommes tentés d’ajouter aussitôt qu’il s’agit d’un entre-deux surmonté, perceptible plutôt comme une tentation de la fusion, même si celle-ci n’est jamais tout à fait accomplie, même s’il reste, comme l’indique le titre d’une huile sur toile de 2015, une « fêlure », parfaitement élégante d’ailleurs et n’évoquant nullement la brutalité d’une possible rupture. Tout au plus y a-t-il un léger décalage entre les formes, créées par la couleur, qui se répondent de part et d’autre de cette mince fêlure verticale. Mince mais bien visible et continue sur toute la hauteur du tableau : il en est ainsi dans l’œuvre subtile de Myriam Kendsi, à l’égard de laquelle toute affirmation doit être aussitôt reprise et nuancée. Il y a échange (dont La Lettre peut être le support, non sans que soit intégré un décalage dans la surface même du tableau qui porte ce titre), il y a communication, il y a peut-être fusion, mais rien de tout cela ne serait possible s’il n’y avait pas au départ séparation.
Et pour parler maintenant de Myriam Kendsi, née à Oran mais vivant en France depuis l’âge de quatre ans, on pourrait dire qu’elle a fait le mouvement inverse, se trouvant physiquement séparée de son Algérie natale, mais continûment liée à elle d’une autre manière, intime et définitive, de telle sorte que sa peinture s’en trouve imprégnée. Par chance, Myriam Kendsi elle-même, faisant preuve d’une belle capacité à l’auto-analyse, explique ce qui nous apparaît dans sa peinture comme un mélange paradoxal de fusion par l’interpénétration des couleurs, et de failles ou lignes de rupture, laissant place cependant à des possibilités de raccordement. La dualité, dit-elle, est au cœur de son travail, faisant « écho à son histoire familiale située dans un entre-deux, un entre jeu de deux vis-à-vis, l’Algérie et la France ». Mais au vu de sa peinture, nous sommes tentés d’ajouter aussitôt qu’il s’agit d’un entre-deux surmonté, perceptible plutôt comme une tentation de la fusion, même si celle-ci n’est jamais tout à fait accomplie, même s’il reste, comme l’indique le titre d’une huile sur toile de 2015, une « fêlure », parfaitement élégante d’ailleurs et n’évoquant nullement la brutalité d’une possible rupture. Tout au plus y a-t-il un léger décalage entre les formes, créées par la couleur, qui se répondent de part et d’autre de cette mince fêlure verticale. Mince mais bien visible et continue sur toute la hauteur du tableau : il en est ainsi dans l’œuvre subtile de Myriam Kendsi, à l’égard de laquelle toute affirmation doit être aussitôt reprise et nuancée. Il y a échange (dont La Lettre peut être le support, non sans que soit intégré un décalage dans la surface même du tableau qui porte ce titre), il y a communication, il y a peut-être fusion, mais rien de tout cela ne serait possible s’il n’y avait pas au départ séparation.
Myriam Kendsi, alors même qu’elle dit éprouver sans fin possible la tension identitaire, se garde bien de l’exprimer en peinture sous une forme visiblement tragique. Peut-être que vivre dans l’entre-deux, contrairement aux idées reçues, c’est éviter l’unicité qu’implique toute violence. Le tempo au sens musical du terme qui correspond le mieux aux tableaux de cette artiste, est exprimé par le titre de l’un d’entre eux, Adagio, une huile sur toile de 2015. Mot qui ne signifie ni la lenteur ni au contraire la vivacité du mouvement, mais une certaine manière de se situer à mi-chemin des deux et de toute manière dans un ailleurs, non dans l’extériorité mais au contraire dans l’intime.
Pour revenir à Henry Simon, car le comparatisme est toujours éclairant, il apparaît que pour lui, l’extériorité est au contraire essentielle pour définir son rapport au monde algérien. Non pas au sens où ce mot extériorité pourrait être restrictif et péjoratif, s’il voulait dire par exemple l’impossibilité de comprendre ce qu’il a sous les yeux et qui lui restera à tout jamais étranger, mais au sens où l’Algérie lui fait comprendre ce dont tout peintre a besoin de se persuader, que la peinture est un monde d’images, de formes et de couleurs—ce qu’est éminemment l’Algérie, chance inouïe dont lui le Vendéen a merveilleusement profité— état de grâce qui s’explique peut-être par le fait qu’il y était venu, dit-on, en voyage de noces ! Ce sont des noces au sens camusien du terme qu’Henry Simon a célébrées avec le pays qu’il découvrait.
Denise Brahimi
Pour commander ces volumes d’Algérie Littérature / Action, écrire à marsa@free.fr : les frais de port vous seront offerts et vous réglerez à réception des ouvrages.
La revue se transforme:
Une nouvelle revue transculturelle
de création, de lectures, de regards
Subvertir les mots et les images ; les métisser, les partager… Surtout, transfuser les imaginaires,
pour rendre aux jours leur respiration poétique. A l’aune de notre monde, tel qu’il est, tel que nous
le rêvons.
A
Le A de Ailleurs, horizon constant du désir,
le A de Autre, notre même, tout proche,
le A des continents, des rives et des dérives, Afrique, Asie, Amériques… abondance et jouvence
de possibles,
le A des boussoles mythiques : Al ‘Andalus, Alchimie, Atlantide…
le A de Accueillir, notre splendide devoir d’humains,
le A de Arts, tous, intimement mêlés à nos mots, à notre souffle,
le A de André B., beauté convulsive toujours incandescente,
le A de Algérie(s), miroir tendu à l’Histoire et à la fraternité, pour la mémoire, pour la route,
le A de Amour sans qui rien n’advient,
le A de humour sans qui tout pèse,
le A de Action-création qui re-poétise le monde,
Le A des recommencements alphabétiques…

- Mardi 10 avril à 17h à l’IEP sur le Campus de Saint Martin d’Hères, conférence de l’historien américain Todd Shepard sur ses livres “Mâle décolonisation” et “1962 Comment l’indépendance algérienne a transformé la France”.
- Mercredi 11 avril, 14h, Todd Shepard à Lyon 2
- Jeudi 12 avril, 14h Todd Shepard à l’ENS de Lyon, 19h, à la Maison des Passages.
- lundi 23 avril 20h au Cinéma l’Opéra de Lyon, film “Vent du Nord”, à cheval sur Tunisie et France de Walid Mattar, en présence du réalisateur.Spécial copinage: Du 25 au 28 avril Festival Cinémas du Sud à l’Institut Lumière de Lyon, le rendez vous cinéma annuel de Regard Sud
La 18ème édition du Festival Cinémas du Sud a l’honneur d’être parrainée par Costa-Gavras, Président de la Cinémathèque française et cinéaste majeur, engagé et passionnant, auteur de Z (Oscar du meilleur film étranger), Missing (Palme d’Or), de Section spéciale, Music Box, Amen et Le Couperet.Notre festival présente un panorama du cinéma contemporain du Maghreb et du Moyen-Orient. Cette année, focus sur des cinématographies émergentes de ces territoires.Ces œuvres rares, car peu diffusées dans les circuits habituels, seront l’occasion d’échanges entre le public lyonnais et les réalisateurs invités pour rencontrer les réalités de ces pays si lointains et si proches à la fois.Programmation (en présence des cinéastes) :MERCREDI 25 AVRIL20h – Personal Affairs de Maha Haj (Israël-Palestine)Séance suivie d’un cocktailJEUDI 26 AVRILSoirée spéciale 50 ans du cinéma tunisien19h – Mustafa Z de Nidhal Chatta (Tunisie)21h – Whispering Sands de Nacer Khemir (Tunisie)
Séance suivie d’une collation gourmande
VENDREDI 27 AVRIL
16h30 – A Memory in Khaki (documentaire) de Alfoz Tanjour (Syrie)
19h – Withered Green de Mohammed Hammad (Egypte)
21h – Volubilis de Faouzi Bensaïdi (Maroc)
SAMEDI 28 AVRIL
14h45 – Atlal (documentaire) de Djamel Kerkar (Algérie)
17h30 – One of These Days de Nadim Tabet (Liban)
20h – Cactus Flower de Hala Elkoussy (Egypte)

