Cultures franco-maghrébines – Lettre #23
ÉDITO
Nous avons le privilège de pouvoir voir et revoir la très riche exposition d’un grand artiste, Adel Abdessemed, au Musée d’Art Contemporain de Lyon. Notre lettre se devait d’en rendre compte, et nous remercions nos deux talentueuses chroniqueuses de nous faire partager cette visite. Les visiteurs ont encore plus d’un mois pour la découvrir.
La littérature et le cinéma du Maghreb continuent à nous distiller de belles œuvres que nous avons plaisir à vous relayer. Il est aussi des livres, comme celui du sociologue Stéphane Beaud ou comme celui sur Alger de Sébastien Labaque qui nous font entrer dans des univers passionnants.
Nous vous le redisons: n’hésitez pas à nous signaler des livres, films, expositions, spectacles… que nous aurions laissé passer. Et ne vous privez pas de rediffuser notre lettre à des personnes qu’elle pourrait intéresser.
Bonne entrée dans l’été.
Michel Wilson

« L’ANTIDOTE » d’Adel Abdessemed
MAC Lyon (France), du 9 mars au 8 juillet 2018
Premier regard:
L’exposition du plasticien Adel Abdessemed au MAC (Musée d’art contemporain) est une sorte de retour sur les lieux qui ont vu ses débuts à l’École des Beaux-arts de Lyon, en 1994.  Après des études commencées à Batna, puis continuées à Alger, ce jeune Constantinois de naissance quitte l’Algérie à la suite d’un attentat contre l’École supérieure des Beaux-arts d’Alger. Il avait alors vingt-trois ans.
Après des études commencées à Batna, puis continuées à Alger, ce jeune Constantinois de naissance quitte l’Algérie à la suite d’un attentat contre l’École supérieure des Beaux-arts d’Alger. Il avait alors vingt-trois ans.
Il s’agit donc d’un retour sur les débuts lyonnais d’une histoire très personnelle, celle de sa rencontre avec sa femme, au bar L’Antidote, qui a donné son nom à cette exposition. Abdessemed en Orphée ?
Sans doute ; mais c’est un Orphée qui récuse la dimension mortifère contenue dans le mythe pour se revendiquer de celle de Jean Cocteau dans Le Testament d’Orphée. En effet, la vidéo qui introduit à l’exposition est intitulée Je ne me retourne pas. Cette déclaration sonne de manière particulièrement ironique puisque l’artiste se met en scène dans un scénario tragique où une lance lui transperce le dos.  La conjuration du regard en arrière qui fait perdre Eurydice à Orphée semble dérisoire. Abdessemed-Orphée est comme poignardé dans le dos et sa décision de ne pas se retourner sauve son Eurydice, mais fait de lui le nouveau pharmakos, figure universelle de la dimension tragique de l’humain. Voilà ce qui se présente comme une première actualisation du titre de l’exposition : le pharmakos est à la fois poison et antidote. La vidéo installée au seuil de cet univers artistique condense les effets de cette violence de l’image sacrificielle en jouant sur la durée (à peine quelques secondes) et la mise en boucle répétitive. On a l’impression d’assister à cette mise à mort sans cesse répétée, à la fois impuissant et fasciné par la force de l’image.
La conjuration du regard en arrière qui fait perdre Eurydice à Orphée semble dérisoire. Abdessemed-Orphée est comme poignardé dans le dos et sa décision de ne pas se retourner sauve son Eurydice, mais fait de lui le nouveau pharmakos, figure universelle de la dimension tragique de l’humain. Voilà ce qui se présente comme une première actualisation du titre de l’exposition : le pharmakos est à la fois poison et antidote. La vidéo installée au seuil de cet univers artistique condense les effets de cette violence de l’image sacrificielle en jouant sur la durée (à peine quelques secondes) et la mise en boucle répétitive. On a l’impression d’assister à cette mise à mort sans cesse répétée, à la fois impuissant et fasciné par la force de l’image.
D’emblée, le ton est donné. Le spectateur qui croit venir visiter une exposition s’expose lui-même dans un état de totale sidération. La puissance de l’art d’Abdessemed, ce regard de Méduse qui pétrifie le spectateur, avait fait dire à Hélène Cixous que c’est « un artiste de la douleur « .
Image 1
L’exposition se tient sur deux étages du musée et comprend des dessins au fusain ou à la craie noire, des sculptures, des vidéos, des maquettes d’architecture, des installations de camionnettes, etc. Le caractère hétéroclite des objets exposés nous introduit dans un scénario post-apocalyptique où un cercle monumental de barbelés  désigne l’Europe, où des camionnettes calcinées ou rouillées transportent d’énormes boulets ou des moutons écorchés, où le trait noir charbon dessine des labyrinthes. Mais à côté de ces installations lugubres qui font référence de manière transparente à la triste actualité, il y a aussi ces maquettes de bistrot comme celle du bar-restaurant déserté appelé ironiquement Chez Aïcha (la vivante, en arabe).
désigne l’Europe, où des camionnettes calcinées ou rouillées transportent d’énormes boulets ou des moutons écorchés, où le trait noir charbon dessine des labyrinthes. Mais à côté de ces installations lugubres qui font référence de manière transparente à la triste actualité, il y a aussi ces maquettes de bistrot comme celle du bar-restaurant déserté appelé ironiquement Chez Aïcha (la vivante, en arabe).
Il y a aussi ces trois statues blanches de nus féminins et dont l’une représente Angela Merkel dans la posture de l’une des Trois Grâces.  Les statues semblent totalement décalées dans la scénographie dystopique construite par l’artiste : la blancheur d’albâtre semble presque déplacée dans ce spectacle de ruines. Pourtant, la nudité n’a rien de celles des statues antiques : des poils pubiens viennent souligner l’allusion au naturisme si banal en Allemagne.
Les statues semblent totalement décalées dans la scénographie dystopique construite par l’artiste : la blancheur d’albâtre semble presque déplacée dans ce spectacle de ruines. Pourtant, la nudité n’a rien de celles des statues antiques : des poils pubiens viennent souligner l’allusion au naturisme si banal en Allemagne.
La nudité n’a rien de choquant comme si « le dénudement n’avait […] plus rien à dévoiler » selon les mots d’Agamben . Même dans la vidéo Le Passé simple représentant quatre personnages qui  dansent nus au son envoûtant d’une flûte.
dansent nus au son envoûtant d’une flûte.
Ainsi se côtoient, sans transition, l’intime et le collectif, le tragique et l’humour dans une espèce de simultanéité vertigineuse qui coupe le souffle, suspend le sens entre apparence et déplacement.
L’œuvre la plus impressionnante est sans doute Shams, la frise conçue sur place, au troisième étage du musée. Une humanité pétrifiée dans la glaise occupe les quatre murs de la pièce. Des scènes de labeur, des  figures d’esclaves, travailleurs ou soldats, croulant sous le joug de leurs charges, sous la menace d’un fusil tenu par un soldat tout aussi pétrifié. Dominants et dominés semblent unis dans la même malédiction, accentuée par le rouge sombre de la glaise, sa couleur naturelle.
figures d’esclaves, travailleurs ou soldats, croulant sous le joug de leurs charges, sous la menace d’un fusil tenu par un soldat tout aussi pétrifié. Dominants et dominés semblent unis dans la même malédiction, accentuée par le rouge sombre de la glaise, sa couleur naturelle.
Les œuvres de Adel Abdessemed ne laissent pas indifférent. Elles peuvent même irriter tant l’artiste multiplie les provocations et se plaît à casser certains codes de la « bienséance ». On lui reproche parfois une certaine complaisance à l’égard d’une violence sur-exposée, sans effet de stylisation, une forme de démesure dans la monstration de la violence. L’artiste lui-même le reconnaît : « Il n’y a pas de beauté sans choc et sans convulsion ».
 Et de fait, on quitte l’exposition de Adel Abdessemed avec l’impression d’un déjà-vu, mais en même temps d’une fulgurante vérité qui vient se révéler grâce à la mise en scène de l’artiste. Cette impression de déjà-vu se confirme dans l’idée d’éternel retour du même. Répétition du même récit intime, de la même histoire avec ou sans grande H/hache.
Et de fait, on quitte l’exposition de Adel Abdessemed avec l’impression d’un déjà-vu, mais en même temps d’une fulgurante vérité qui vient se révéler grâce à la mise en scène de l’artiste. Cette impression de déjà-vu se confirme dans l’idée d’éternel retour du même. Répétition du même récit intime, de la même histoire avec ou sans grande H/hache.
Si au premier abord, il apparaît difficile de trouver une unité aux différentes installations, leur mise en réseaux thématique et esthétique permet de déceler une interrogation angoissée sur le temps, le rapport de l’artiste au temps vécu, perdu, et au temps retrouvé. Mais n’est-ce pas ainsi qu’Agamben (encore lui) propose de définir la contemporanéité ? une « relation au temps qui adhère à lui par le déphasage et l’anachronisme ». Ce rapport problématique au temps dans lequel nous sommes quotidiennement immergés et qui souvent nous submerge, c’est aussi cela qui travaille l’œuvre.
Quant à Adel Abdessemed, lui-même, il semble être arrivé à savoir comment appartenir à son temps tout en travaillant à le circonvenir.
1 Hélène Cixous et Adel Abdessemed, « Le cri de la littérature », émission Un autre jour est possible, sur France culture, le 23/12/2013.
2 Giorgio Agamben, Nudités, Payot-Rivages, coll. »Bibliothèques rivages », 2009, p. 130.
3 Adel Abdessemed, Entretien avec Pier Luigi Tazzi, Arles, Actes Sud, 2012, p. 61.
4 Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain, Paris, Payot / Rivages, 2008, p. 11.
Touriya Tullon-Fili
« L’ANTIDOTE », Adel Abdessemed
Second regard
Il y a plus d’une raison de célébrer à Lyon ce plasticien (né à Constantine en 1971), car après avoir connu l’école des Beaux-Arts d’Alger, il a fréquenté celle de Lyon. Et la légende, mais pourquoi ne serait-elle pas vraie, veut qu’il ait rencontré sa future femme, Julie, dans un bar de Lyon nommé L’Antidote !
En fait cet artiste depuis des années déjà est devenu tout à fait international, tant il est vrai que les problèmes qui éclatent ou qui explosent dans son œuvre sont effectivement ceux qui au XXIe siècle ont acquis une importance mondiale. Mais c’est surtout la manière dont il les traite qui confère au spectateur le sentiment de comprendre à l’évidence ce que veut dire la modernité, ici saisie sur le vif dans l’art le plus contemporain qui soit.  Ce qui est remarquable chez Adel Abdessemed est qu’il parvient à évoquer des situations ou des événements sur un mode à la fois métaphorique et tout à fait direct. Sauf exception, on comprend parfaitement ce qu’il veut dire, et plus encore on reçoit sans le moindre ménagement ni recours esthétique la violence de son message—en fait la violence de ce qu’on peut désigner, d’un terme tout à fait général, le monde dont il nous parle.
Ce qui est remarquable chez Adel Abdessemed est qu’il parvient à évoquer des situations ou des événements sur un mode à la fois métaphorique et tout à fait direct. Sauf exception, on comprend parfaitement ce qu’il veut dire, et plus encore on reçoit sans le moindre ménagement ni recours esthétique la violence de son message—en fait la violence de ce qu’on peut désigner, d’un terme tout à fait général, le monde dont il nous parle.
D’ailleurs l’absence de ménagement fait que certaines de ses œuvres sont parfois ressenties comme insupportables ou insoutenables, et c’est ce qui s’est passé avec l’une de celles qu’il voulait présenter au MAC de Lyon, mais qu’il a finalement retirée lorsque le public a exprimé son très fort rejet sur les réseaux sociaux. Il vaut la peine de rappeler brièvement les faits, pour donner à comprendre comment Adel Abdessemed conçoit son « art », un mot que certains jugeront sans doute inadapté pour désigner ce qu’il fait (qu’on l’en blâme ou qu’on l’en loue).
Cette « installation » (peut-être est-ce le moins mauvais mot pour le dire) donnait à voir au public des poulets vivants, suspendus par des crochets et environnés de flammes qui semblaient les brûler vifs. La direction du musée a assuré qu’il s’agissait d’un trucage et que les poulets ne souffraient pas. Reste que le spectacle a été dénoncé comme d’une grande cruauté et n’ayant pas sa place dans un établissement culturel. Les défenseurs des poulets se sont indignés d’ «une expérience terrifiante et traumatisante pour ces êtres sensibles et intelligents ». L’histoire ne dit pas s’il arrive à ces défenseurs de manger du poulet et s’ils cherchent à savoir ce qui s’est passé avant que ladite viande n’arrive dans leur assiette !
Cependant l’artiste n’a pas insisté et a choisi (contre la direction du MAC) de retirer l’installation en expliquant qu’il avait déjà subi d’autres fatwas auparavant et qu’il n’avait pas envie d’en ajouter une de plus à la liste. Ce qui pourrait signifier qu’il cherche non le scandale médiatique mais la provocation au sens où celle-ci oblige à voir ce qu’on oublie ordinairement de regarder.
Faute de pouvoir évoquer toutes ses autres œuvres présentes à l’exposition de Lyon, on peut se concentrer sur la plus grande, la plus monumentale et la plus saisissante qui  occupe à elle seule tout un étage du Musée. Elle s’intitule Shams, le soleil en arabe, et représente une sorte d’immense chantier sur 500 m2, peuplé de nombreux personnages qui sont principalement des ouvriers mais aussi ceux qui les surveillent. Et la totalité de ce qui nous est donné à voir est en argile rouge, 40 tonnes d’un matériau souple qui donne très fortement l’impression d’un spectacle vivant. L’artiste se montre à la fois réaliste et visionnaire : on trouve dans Shams tous les objets susceptibles de traîner sur un chantier réel, seaux et bidons, vieilles paires de bottes, bouteilles de bière vides et boîtes en plastique etc. ; mais il y a aussi une sorte de souffle épique qui soulève et soutient l’ensemble, perçu dans sa totalité.
occupe à elle seule tout un étage du Musée. Elle s’intitule Shams, le soleil en arabe, et représente une sorte d’immense chantier sur 500 m2, peuplé de nombreux personnages qui sont principalement des ouvriers mais aussi ceux qui les surveillent. Et la totalité de ce qui nous est donné à voir est en argile rouge, 40 tonnes d’un matériau souple qui donne très fortement l’impression d’un spectacle vivant. L’artiste se montre à la fois réaliste et visionnaire : on trouve dans Shams tous les objets susceptibles de traîner sur un chantier réel, seaux et bidons, vieilles paires de bottes, bouteilles de bière vides et boîtes en plastique etc. ; mais il y a aussi une sorte de souffle épique qui soulève et soutient l’ensemble, perçu dans sa totalité.
L’artiste s’est inspiré, dit-on, d’un célèbre tableau de Delacroix, Dante et Virgile aux Enfers (1822). Cette œuvre a d’ailleurs été reprise auparavant par d’autres artistes, notamment Manet, pour une peinture qui se trouve justement au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Au MAC, on peut supposer que c’est le public de l’exposition qui occupe la place de Dante et Virgile, les ouvriers représentés par Adel Abdessemed tenant celle des damnés dans le tableau de Delacroix. Comme des fourmis se suivant les unes les autres, ils grimpent en files qui semblent interminables, courbés sous le poids de sacs énormes et visiblement accablants, pour une corvée aussi fatigante physiquement que moralement exténuante. Le travail qui leur est imposé semble une sorte de malédiction dont rien n’indique comment ils pourraient lui échapper. Et comment ne pas penser à une autre œuvre célèbre, impressionnante ô combien, la célèbre Porte de l’Enfer de Rodin, dont le titre comporte aussi l’idée de damnation. Adel Abdessemed n’a nul besoin de recourir aux grands textes sacrés ou presque, tels que la Bible ou la Divine Comédie, pour exprimer l’essence de la condition humaine dans ce qu’elle a de plus pathétique, ici le travail forcé d’hommes réduits à l’état de corps-machines.
Par delà cette vie qui ne suggère rien de divin, Shams donne pourtant l’impression d’un dépassement du réel vers un monde fantomatique, où plutôt qu’à des hommes les personnages ressemblent à des spectres hagards, en sorte qu’on pourrait parler pour dire le monde que l’artiste suggère, d’un matérialisme forcené (de la même racine que le mot forçat), ou peut-être d’une résurgence de la horde primitive et farouche, lorsque l’homme est contraint de perdre tout ce qui fait son humanité. Et puisque les défenseurs des poulets parlaient de cruauté, c’est bien là en tout cas qu’on la trouve, dans cette éradication de l’humain où l’artiste nous la fait éprouver dramatiquement.
Denise Brahimi

« THEORIE D’ALGER » de Sébastien Lapaque – – Récit – Editions Barzakh 2017
Né à Tubingen (Allemagne), Sébastien Lapaque est romancier, essayiste et critique au Figaro littéraire. Il collabore également au Monde Diplomatique. Il a écrit Théorie d’Alger à la suite de Théorie de la carte postale et Théorie de Rio. Son recueil, Mythologie française (Actes Sud, 1998) a reçu le prix Goncourt de la nouvelle. (Note de l’éditeur)

Sébastien Lapaque, auteur de « Court voyage équinoxial. Carnets brésiliens » (éditions Sabine Wespieser): un guide à l’écart des chemins balisés du tourisme.
Hormis ses connaissances spéculatives et érudites sur la capitale de l’Algérie, Sébastien Lapaque ne semble pas avoir d’ancrage personnel dans cette ville. Il ne « poursuit pas de fantômes familiaux, ne vient pas en pèlerinage. Il n’a ni maison à visiter ni tombe à fleurir » , à l’exception de celle de la mère de Camus, l’écrivain qui l’a marqué et dont le fantôme plane sur son récit. C’est en 2009 qu’il entre dans El Djazaïr. Une entrée en chansons, 20 mois après la mort de Lili Boniche, le chanteur né à la Casbah qui » aime toutes les villes mais un peu plus Paris « , en ajoutant : « mais rien ne vaut l’Algérie ». Il arrive dans la ville blanche en effervescence qui fête la victoire des fenecs, l’équipe de fotebale d’Algérie, sur celle de l’Egypte. Il se régale en écoutant Arezki, grand « tchatcheur » devant l’Eternel, commenter l’événement national en rappelant au passage la victoire sur la France en 1975 aux Jeux Méditerranéens et le triomphe sur l’Allemagne en 1982 lors de la coupe du monde. Les Algériens aiment à rappeler ces matchs mythiques qui flattent leur redjla, un mot fourre-tout qui désigne à la fois fierté, virilité, susceptibilité collective et chauvinisme. Un culte, un code de conduite. A Alger, le simple fait d’élever un maknine (un chardonneret) est un acte de redjla. On dit de cet oiseau qu’il « est fier et insolent comme un Algérien ». Les taxieurs hâbleurs sont des guides précieux, indispensables mais l’auteur infatigable et boulimique préfère la marche. Sans plan prédéfini. Il se fie à son instinct, parcourt dans tous les sens les rues et les quartiers que les habitants âgés continuent à appeler par leurs anciens noms. Rue Michelet, rue d’Isly, boulevard Bru, Square Bresson, place du Gouvernement. Victor Hugo est un des rares à avoir gardé une plaque, « ce qui prouve que les Algériens connaissent mal leur histoire », rappelle malicieusement l’auteur en lançant cette pique : « Ce qui manque à la France en Alger, c’est un peu plus de barbarie. Les Turcs allaient plus vite, ils savaient mieux couper les têtes. La première chose qui frappe le sauvage, ce n’est pas la raison, c’est la force ». Ainsi parlait le géant de la littérature française dans Le Rhin, Lettres à un ami (1842). Rencontres entre passé et présent, petites histoires du quotidien et grands événements se croisent et s’enchâssent parfois sans souci de chronologie. Les frères Barberousse, Napoléon III, Che Guevara, consuls, califes, sultans. La ville-monde reste le personnage central. Elle attire « par ses qualités mais surtout pour ses défauts, ses bruyantes querelles, sa gouaille, son désordre, ses coupures d’eau et d’électricité ». Quand on aime, on ne mégote pas sur ces détails, semble nous dire l’auteur. Il affectionne les lieux réputés sans intérêt comme ceux qui sont chargés d’histoire. Il se sent bien dans la « ville-toboggan », en adopte le rythme, y fait des rencontres insolites, improbables avec les habitants sur les bancs publics, les terrasses de café. Il se fait même inviter et prendre en charge par des militaires qui l’embarquent dans une virée à Bab-el-Oued et dans les cabarets de la Madrague. Il glane des histoires incroyables auprès d’Akmin et Tayeb. Celle de Himoud Brahimi, dit Momo, poète de la casbah, le passionne. A-t-il joué dans Pépé le Moko de Julien Duvivier. A-t-il lancé un défi à Johnny Weissmuller venu jouer Tarzan, l’homme singe à Alger en 1930 ? Les deux hommes se seraient-ils affrontés à la nage ? Momo serait-il sorti vainqueur de cet homme qui avait rapporté cinq médailles d’or aux jeux olympiques de Paris et Amsterdam ? Aucune archive n’atteste ces faits mais peu importe. Tout le monde y croit au bar du Dôme, un lieu emblématique où « l’on vient s’enivrer jusqu’au bout » et écouter les envolées lyriques de compagnons de beuverie citant les vers du poète Omar Khayyam.
La ville-labyrinthe ne se donne pas à voir facilement. « Encerclée par la montagne, généreusement ouverte sur la mer, elle est à la fois simple et compliquée ». S. Lapaque y pratique la « technique du vagabondage ». Il se lève avant le soleil, traîne dans les cafés, lit Liberté et les chroniques de Kamel Daoud, découvre le dessin quotidien de Dilem, note tout, achète des cartes postales, visite le musée des Beaux-arts où il découvre ébloui les peintures d’Etienne Dinet. L’homme converti à l’islam est enterré à Bou Saada sous le nom de Nasreddine Dinet.
 Les écrivains accompagnent le promeneur amoureux qui ne sort jamais sans glisser un livre dans sa poche. Germaine Tillion, François Mauriac, le premier à s’indigner publiquement des pratiques barbares de la baignoire et de la gégène, Bernanos, Jean Paul Sartre. Il consacre un long passage à André Mandouze, rédacteur en chef de Témoignage chrétien qui avait comparé les résistants du Vercors à ceux des Aurès. Les polémiques avec Arezki autour de Camus donnent lieu à des joutes interminables. Ils n’arriveront jamais à être d’accord, sans que cela entame leur amitié ni leur respect pour « les femmes et les hommes qui reposent dans l’argile rouge de cette terre de songe et soleil qu’ils avaient follement aimée ». S. Lapaque est passionné par les cimetières dans lesquels il aime flâner et prier. Il les visite tous et finit même par retrouver la tombe de Veuve Lucien Camus, Née Catherine Sintès, au cimetière d’El Madania, en pestant au passage contre tous ceux qui ne se sont jamais souciés d’honorer la mémoire de sa mère en entretenant sa tombe. Son hommage aux vivants et aux morts d’Alger s’achève par une messe à la basilique Notre Dame d’Afrique. Les Algérois de milieu populaire l’appellent affectueusement Madame l’Afrique. On peut lire inscrit sur le bleu de son abside : « Priez pour nous et pour les musulmans ».
Les écrivains accompagnent le promeneur amoureux qui ne sort jamais sans glisser un livre dans sa poche. Germaine Tillion, François Mauriac, le premier à s’indigner publiquement des pratiques barbares de la baignoire et de la gégène, Bernanos, Jean Paul Sartre. Il consacre un long passage à André Mandouze, rédacteur en chef de Témoignage chrétien qui avait comparé les résistants du Vercors à ceux des Aurès. Les polémiques avec Arezki autour de Camus donnent lieu à des joutes interminables. Ils n’arriveront jamais à être d’accord, sans que cela entame leur amitié ni leur respect pour « les femmes et les hommes qui reposent dans l’argile rouge de cette terre de songe et soleil qu’ils avaient follement aimée ». S. Lapaque est passionné par les cimetières dans lesquels il aime flâner et prier. Il les visite tous et finit même par retrouver la tombe de Veuve Lucien Camus, Née Catherine Sintès, au cimetière d’El Madania, en pestant au passage contre tous ceux qui ne se sont jamais souciés d’honorer la mémoire de sa mère en entretenant sa tombe. Son hommage aux vivants et aux morts d’Alger s’achève par une messe à la basilique Notre Dame d’Afrique. Les Algérois de milieu populaire l’appellent affectueusement Madame l’Afrique. On peut lire inscrit sur le bleu de son abside : « Priez pour nous et pour les musulmans ».
On referme le livre de S. Lapaque submergé de questions. Pourquoi Théorie d’Alger ? Est-ce un titre en trompe l’œil ? Une ville totalement fantasmée ? Une auberge espagnole dans laquelle l’auteur s’est passionnément cherché ? A-t-il utilisé trop d’adverbes, usé de trop de superlatifs pour l’évoquer ? Une seule chose est sûre. Cette déclaration d’amour inconditionnelle ne prétend à aucun moment à l’objectivité.
Omar Hallouche
« LA FRANCE DES BELHOUMI, PORTRAITS DE FAMILLE (1977-2017) » de Stéphane Beaud (La Découverte, mars 2018)
Disons le d’emblée : le dernier ouvrage de Stéphane Beaud, La France des Belhoumi, portraits de famille (1977-2017), est d’une totale originalité. Par sa démarche même, l’ampleur de son contenu, et la tonalité qui s’en dégage.
 Stéphane Beaud, outre ses qualités d’analyste, est un sociologue intuitif, ouvert à l’inattendu, à l’improbable, en permanence disponible à la rencontre. C’est un sociologue du « fil en aiguille ». Cette capacité d’écoute et d’empathie, la confiance qu’il instaure avec ses interlocutrices/teurs , avaient déjà donné, en 2004, Pays de malheur (La Découverte), plus d’un an d’échanges quasi quotidiens, essentiellement via le Net, avec Younès Amrani, alors emploi-jeune dans une bibliothèque du côté de Lyon ou de Saint-Etienne (Beaud préserve toujours l’anonymat des êtres qui se confient à lui, et maquille leurs lieux de vie) : un témoignage brut, sans concessions, quasi-exhaustif,sur la vie d’un « jeune des quartiers » dans les années 1990/2000 ; un témoignage qui reste aujourd’hui une référence incontournable, en dépit des transformations ultérieures de la société française, entre autres à la suite des attentats de 2015.
Stéphane Beaud, outre ses qualités d’analyste, est un sociologue intuitif, ouvert à l’inattendu, à l’improbable, en permanence disponible à la rencontre. C’est un sociologue du « fil en aiguille ». Cette capacité d’écoute et d’empathie, la confiance qu’il instaure avec ses interlocutrices/teurs , avaient déjà donné, en 2004, Pays de malheur (La Découverte), plus d’un an d’échanges quasi quotidiens, essentiellement via le Net, avec Younès Amrani, alors emploi-jeune dans une bibliothèque du côté de Lyon ou de Saint-Etienne (Beaud préserve toujours l’anonymat des êtres qui se confient à lui, et maquille leurs lieux de vie) : un témoignage brut, sans concessions, quasi-exhaustif,sur la vie d’un « jeune des quartiers » dans les années 1990/2000 ; un témoignage qui reste aujourd’hui une référence incontournable, en dépit des transformations ultérieures de la société française, entre autres à la suite des attentats de 2015.
Mais si la « mise à feu » des deux enquêtes se ressemble –dans les deux cas, une simple réponse à une demande, qui va entrainer les protagonistes bien au-delà de ce qu’ils imaginaient au départ- les différences d’ampleur des champs d’investigations de ces dernières sautent aux yeux : Pays de malheur 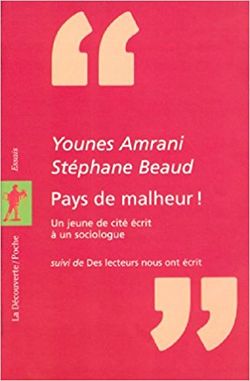 « se contentait » de creuser le quotidien et la vérité d’un individu, fût-il générique et exemplaire. La France des Belhoumi embrasse l’histoire d’une famille entière –dix personnes en tout- et s’étend sur quarante ans de leur histoire, et de celle de la société française.
« se contentait » de creuser le quotidien et la vérité d’un individu, fût-il générique et exemplaire. La France des Belhoumi embrasse l’histoire d’une famille entière –dix personnes en tout- et s’étend sur quarante ans de leur histoire, et de celle de la société française.
Un soir de juin 2012, dans le cadre d’une soirée organisée par une Mission locale de Seine Saint Denis, Stéphane Beaud est invité à parler des chemins d’intégration pris par les jeunes d’origine maghrébine, des réussites silencieuses comme des obstacles qu’ils rencontrent. A l’issue de la soirée, trois jeunes femmes l’abordent, trois sœurs. Nombre de phrases du sociologue ont fait écho en elles, elles ont envie de parler, de se raconter. Dès les premiers échanges, le temps du « pot » offert par la Mission locale, Stéphane Beaud perçoit l’importance de la rencontre, les richesses à venir qu’elle porte en elle. Lui dont les études précédentes ont, jusqu’alors, essentiellement concerné les « garçons » d’origine émigrée et l’espace social dans lequel ils se meuvent, se lance, « plonge » : il propose aux trois sœurs de les revoir en entretiens séparés, pour « démarrer par leur intermédiaire une recherche sur l’histoire de leur famille ». Accord immédiat, unanime, échange de numéros de portable : le premier entretien a lieu un mois plus tard, avec Samira, l’ainée, celle qui a pris la parole la première le soir de juin, et qui va devenir, aux dires même de Stéphane Beaud, son « alliée permanente », celle qui va entrainer peu à peu toute la famille derrière elle, pendant cinq ans, dans le tourbillon des sms, des appels téléphoniques, des échanges par mails et, bien évidemment, des heures d’entretiens, par dizaines…
Outre le père, arrivé seul en France en 1971, à 31 ans, et la mère, de dix ans sa cadette, qui l’a rejoint en 1977, la famille Belhoumi, installée à l’origine dans la banlieue ouvrière d’une petite ville de province à 400 km de Paris, comprend huit enfants : dans l’ordre des naissances, deux filles, trois garçons, puis de nouveau trois filles. Seize ans –une génération, au vu de l’évolution de la société française- séparent la naissance de Samira, l’ainée, (1970) de celle de Nadia, la « petite dernière »(1986). Les trois premiers enfants sont nés en Algérie, les autres en France. En 1978, le père, ouvrier du bâtiment, obtient, suite à des infections pulmonaires répétées, un statut d’invalidité permanente. La famille va vivre pendant des années une période de grande précarité financière, avec 80% du Smic paternel et les aides familiales, jusqu’à ce que la mère finisse par trouver un emploi.
Ce qui intéresse avant tout Stéphane Beaud, c’est la fratrie Belhoumi, le parcours individuel de celles et ceux qui la composent. Parcours différents, parfois contrastés : huit histoires qui ne cessent de croiser « la grande », huit histoires qui témoignent d’un processus d’intégration en voie de construction. Au-delà des chemins empruntés – le livre, ce n’est pas le moindre de ses attraits, recèle une très forte part de romanesque-, au-delà des obstacles plus ou moins difficilement franchis, deux constatations s’imposent: 1/ à une exception près, la famille a su éviter tous les pièges tendus aux « enfants de l’immigration » – le piège dans lequel est tombée l’ « exception » a lui-même été été dépassé ; 2/ Il n’y a pas de chômage dans la famille Belhoumi, quelle que soit la variété des métiers exercés et les formes différenciées de socialisation qui apparaissent clairement entre filles et garçons : tous les Belhoumi sont bien, malgré tout, dans « la réussite ».
 Enquête chorale, kaléidoscopique, dont on ne peut ici, rendre compte dans toute sa richesse et sa complexité, La France des Belhoumi est avant tout l’histoire d’une ascension sociale individuelle et collective, d’une « intégration silencieuse » (Le Monde, 30 mars 2018). C’était, dès le début de l’enquête, le souhait de Samira –et ce fut la raison de son engagement ultérieur dans le projet : « changer l’image de l’immigration, trop souvent synonyme de problèmes ». On est loin, de fait, de toute posture victimaire, loin de toute dramatisation. Faut-il, pour autant, y voir « une famille semblable à tant d’autres » (Le Monde, encore) ?
Enquête chorale, kaléidoscopique, dont on ne peut ici, rendre compte dans toute sa richesse et sa complexité, La France des Belhoumi est avant tout l’histoire d’une ascension sociale individuelle et collective, d’une « intégration silencieuse » (Le Monde, 30 mars 2018). C’était, dès le début de l’enquête, le souhait de Samira –et ce fut la raison de son engagement ultérieur dans le projet : « changer l’image de l’immigration, trop souvent synonyme de problèmes ». On est loin, de fait, de toute posture victimaire, loin de toute dramatisation. Faut-il, pour autant, y voir « une famille semblable à tant d’autres » (Le Monde, encore) ?
Ce qui frappe –et très souvent émeut- dans la découverte progressive que le lecteur fait de l’histoire de cette famille, c’est à la fois la force et la fragilité de celle-ci. Au fur et à mesure que Stéphane Beaud énumère et analyse tous les éléments qui, pierre après pierre, parfois infimes en apparence, ont permis-et parfois freiné- la « réussite » de l’intégration-professionnelle et « matrimoniale »- des membres de la fratrie (présence attentive des parents, quartier d’enfance, école à forte mixité sociale, poids de la précarité, taille de l’appartement, regard des enseignants, influence des copains, poids du groupe, couleur politique de la ville, etc.) et si l’on inscrit en contrepoint de tous ces éléments les dimensions d’une société en pleine mutation (chômage, évolution de l’école, retour du religieux, attentats…), on se surprend souvent à jouer au petit jeu de l’uchronie (la fameuse longueur du nez de Cléopatre…), à se demander quel eût été le destin de chacune et chacun des membres de la famille si… Questionnements vains, qui pourraient évidemment s’appliquer à toute famille, mais qui s’imposent ici avec une force et une récurrence toutes particulières . Pour ne prendre qu’un exemple : Stéphane Beaud insiste sans cesse sur le rôle déterminant, fondateur, des deux « locomotives » de la fratrie, Samira et Leila, les deux sœurs ainées, soutiens permanents, soutiens de famille et soutiens affectifs, concrets, présences protectrices, références et modèles pour tout le reste de la fratrie. Que serait-il advenu si le hasard des naissances avait fait d’elles des cadettes au lieu d’en faire des ainées, et si elles avaient eu à « subir » l’autorité d’un grand frère ? Il y a, dans le livre, des pages particulièrement nourrissantes sur le « poids du genre », les rôles assignés traditionnellement aux filles –les destins matrimoniaux, entre autres-, sur la mansuétude nettement plus laxiste qui entoure les garçons, et les différences de socialisation qui en résultent. Samira et Leila, chacune à sa manière, ont, contre vents et marées mais surtout en misant leur avenir sur leurs études, su gagner leur indépendance, professionnelle et amoureuse ; les garçons, plus choyés, plus libres, plus sensibles aux « effets de quartier » -mais également plus violemment confrontés que leurs sœurs aux discriminations- ont eu un parcours scolaire et une intégration professionnelle plus difficiles.
La grande histoire va rattraper l’enquête de Stéphane Beaud, et fragiliser le bel édifice patiemment construit par les Belhoumi : les attentats de 2015 prennent la famille de plein fouet, et font apparaitre des clivages internes (que Stéphane Beaud analyse très finement en les contextualisant) : les trois sœurs parisiennes rencontrées en juin 2012 seront à la manifestation du 11 janvier ; les autres membres de la fratrie se diront « pas trop Charlie ». Dans les semaines et les mois qui suivent, tous ressentent, dans leur quotidien, les changements à leur égard. La suspicion, les amalgames. De nouvelles formes d’hostilité –au travail, dans la rue, sur le Net- que chaque nouvel attentat ravive et accroit. Là encore, la violence est plus fortement ressentie par les hommes de la fratrie que par leurs sœurs. Mais aucun membre de la famille n’y échappe. Le livre, dont la démarche a consisté avant tout à « mettre à jour une trajectoire d’ascension sociale », s’achève ainsi sur une note plus sombre : Stéphane Beaud compare à juste titre l’effort des Belhoumi pour rejoindre le « club France » –et, à travers eux celui d’un très grand nombre de familles françaises de culture musulmane, notamment issues de l’immigration algérienne- à un travail de Sisyphe, chaque nouvel attentat depuis 2015 les faisant dégringoler de la « montagne intégration » qu’ils se voient obligés de gravir à nouveau.
En 2002/2003, les échanges directs sur le Net entre Stéphane Beaud et Younes Amrani se faisaient dans la plus grande discrétion : dix ans après la parution de Pays de malheur, l’anonymat de son auteur restait encore totalement préservé, et sa démarche ignorée de sa famille et de ses proches mêmes. A l’opposé, le pacte passé en 2012 entre Stéphane Beaud et les trois sœurs nécessitait une circulation d’informations constante entre les membres de la famille, afin que nul(le) ne reste à l’extérieur de l’enquête en voie d’élaboration. Il fallait pour ce faire un personnage/relais, unanimement reconnu et respecté au sein de la fratrie, pour relancer, vaincre certaines réticences : Samira, toujours elle, sera cette messagère sans faille, sans laquelle l’entreprise eût sans doute avorté.
Ainsi, à partir de 2012, la vie chez les Belhoumi a été, à des degrés divers mais sans exception, accompagnée, questionnée et, pour certain(e)s, transformée par l’ « intrusion » de celui que l’un des fils nomme, avec une légère ironie, « l’écrivain ». L’enquête, par son mouvement permanent, la circulation incessante des informations en interne, a fait bouger les lignes au sein de la fratrie, aidé à renouer des liens parfois distendus (vies différentes, géographiquement éloignées les unes des autres) Depuis sa parution -mars 2018-, le livre, on le sait, a été lu par chacun(e). Sauf par le père, à qui les enfants le rapportent, en lisent des passages. La mère, de son côté, le découvre à son rythme, et en a commandé deux exemplaires, pour un ancien employeur et pour une voisine. Discussions, échanges, fierté : « il y avait urgence à nous raconter, nous les silencieux » affirme Samira. Mission accomplie.
Au bout des 350 pages que constitue l’enquête de Stéphane Beaud, on s’est attaché aux Belhoumi ; on a envie de savoir la suite. De les retrouver dans cinq, dans dix ans. On se surprend à faire des vœux pour eux. On sait, par ailleurs, que Stéphane Beaud possède des dizaines d’heures d’entretiens qu’il est loin d’avoir tous livrés. On aurait pu en lire davantage. On espère pouvoir le faire un jour.
Pour l’heure, il s’agit de faire en sorte que le livre sorte des cercles des lecteurs d’ouvrages de sociologie. De trouver des espaces/publics permettant de confronter l’histoire des Belhoumi à celles d’autres familles, de constater ce qui les réunit et ce qui les distingue. De lui permettre de faire des vagues, de favoriser l’éclosion d’autres paroles. Stéphane Beaud a déjà commencé. Depuis un mois, il rencontre des lycéens de villes de la banlieue parisienne, raconte, écoute : les réactions sont passionnantes…
D.L.
« A L’ECOLE EN ALGERIE, DES ANNEES 1930 A L’INDEPENDANCE », récits inédits réunis par Martine Mathieu-Job, Bleu autour, 2018
Ces récits nous parlent d’un monde qui n’existe plus, d’où leur accent de nostalgie qu’on s’attend de toute manière à trouver dans des récits d’enfance, d’autant que ceux-ci sont souvent le fait de gens qui sont depuis lors devenus écrivains et qui nous font bénéficier de leur talent et de leur goût d’écrire. Ils sont cinquante-deux à avoir participé à cet ouvrage pour des textes de quatre à cinq pages chacun, comportant à la fois des faits (lieux et dates), des impressions sensorielles et quelques opinions et jugements. Sur ce dernier point on peut parler d’unanimité car tous et toutes (la parité est respectée) parlent à peu près de la même façon de cette école à laquelle ils veulent rendre hommage. Une autre parité eût été inexacte : les deux communautés, européenne et juive, sont 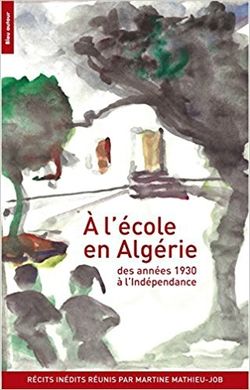 représentées en plus grand nombre que la communauté musulmane ou indigène comme on disait, ce qui ne fait que refléter la réalité de l’époque, réaffirmée par tous les témoignages qu’on trouve dans ce livre : proportionnellement les enfants de cette dernière catégorie étaient beaucoup moins scolarisés que ceux des deux autres. Ce qu’il faut compléter par un jugement non moins récurrent tout au long du livre : les instituteurs et institutrices, conformément à la conception républicaine de l’école, traitaient tous les élèves de la même façon, sans tenir compte de leur origine ethnique. Et s’agissant des résultats, on a le sentiment qu’il y avait de bons voire de très bons élèves dans toutes les catégories ; il en résulte une grande admiration de nous autres lecteurs pour l’efficacité de cet enseignement et pour l’incroyable dévouement des maîtres et maîtresses à leur métier conçu et vécu comme un véritable sacerdoce. Il est bien vrai qu’en France aussi, à la même époque, on pouvait dire la même chose des fameux « hussards de la république », mais il semble bien que les conditions de travail en Algérie étaient encore plus difficiles, les classes souvent très chargées, certains enfants très mal nourris, et de l’équipement scolaire, c’est peu de dire qu’il n’en était presque pas question.
représentées en plus grand nombre que la communauté musulmane ou indigène comme on disait, ce qui ne fait que refléter la réalité de l’époque, réaffirmée par tous les témoignages qu’on trouve dans ce livre : proportionnellement les enfants de cette dernière catégorie étaient beaucoup moins scolarisés que ceux des deux autres. Ce qu’il faut compléter par un jugement non moins récurrent tout au long du livre : les instituteurs et institutrices, conformément à la conception républicaine de l’école, traitaient tous les élèves de la même façon, sans tenir compte de leur origine ethnique. Et s’agissant des résultats, on a le sentiment qu’il y avait de bons voire de très bons élèves dans toutes les catégories ; il en résulte une grande admiration de nous autres lecteurs pour l’efficacité de cet enseignement et pour l’incroyable dévouement des maîtres et maîtresses à leur métier conçu et vécu comme un véritable sacerdoce. Il est bien vrai qu’en France aussi, à la même époque, on pouvait dire la même chose des fameux « hussards de la république », mais il semble bien que les conditions de travail en Algérie étaient encore plus difficiles, les classes souvent très chargées, certains enfants très mal nourris, et de l’équipement scolaire, c’est peu de dire qu’il n’en était presque pas question.
 Ce qui frappe en revanche, c’est le prestige dont jouissaient les enseignants et leur autorité à peu près sans limite. Pas un seul parent n’aurait songé à les mettre en question et c’est au contraire un des aspects les plus touchants de ces récits que la confiance avec laquelle les enfants étaient confiés à une école que nul ne songeait à contester, à aucun égard. Il est vrai qu’en France aussi, le regard critique porté sur l’école et l’enseignement s’est développé plus tardivement—pour le dire vite dans l’esprit de mai 68— alors que les témoignages ici réunis sur l’école en Algérie s’arrêtent avec l’indépendance, en 1962.
Ce qui frappe en revanche, c’est le prestige dont jouissaient les enseignants et leur autorité à peu près sans limite. Pas un seul parent n’aurait songé à les mettre en question et c’est au contraire un des aspects les plus touchants de ces récits que la confiance avec laquelle les enfants étaient confiés à une école que nul ne songeait à contester, à aucun égard. Il est vrai qu’en France aussi, le regard critique porté sur l’école et l’enseignement s’est développé plus tardivement—pour le dire vite dans l’esprit de mai 68— alors que les témoignages ici réunis sur l’école en Algérie s’arrêtent avec l’indépendance, en 1962.
Rétrospectivement, les cinquante-deux auteurs se montrent évidemment beaucoup plus critiques maintenant qu’on ne l’était à l’époque dont ils parlent. En fait, la mise en question actuelle, dans l’esprit de la nation et de la nationalité algérienne, porte principalement sur un point ou autour d’un problème : le contenu de l’enseignement, trop souvent résumé (même dans ce livre où le cliché est abondamment repris) par la célèbre plaisanterie sur « nos ancêtres les Gaulois ». Ne vaudrait-il pas mieux essayer de comprendre comment ce qui nous apparaît comme une aberration insensée peut s’expliquer (ce qui ne veut évidemment pas dire se justifier) dans un contexte global d’application du précepte de base à l’époque co loniale : l’Algérie c’est la France. On sait d’ailleurs que cette affirmation unitaire a donné des effets tout aussi surprenants dans le contexte franco-français, où régnait la volonté d’unifier toutes les provinces : ce qui valait pour la Savoie valait aussi pour la Bretagne ; et pour s’en tenir à cette dernière, il n’y avait pas lieu d’y évoquer la civilisation celtique plus qu’à Marseille ou n’importe où dans l’Etat national.
 Naturellement il faudrait élargir les débats à tout ce qui concerne les crédos de l’école républicaine dont on peut penser qu’ils ont été efficaces aussi longtemps qu’ils n’ont pas été mis en question. Le développement de l’esprit critique est certainement souhaitable dès l’école primaire, qui a pourtant pour autre tâche de promouvoir une confiance absolue dans le savoir. Les deux sont-ils compatibles ? À l’école en Algérie donne à cet égard certains témoignages intéressants. Il y est en effet question d’écoliers « arabes » (mais peut-être étaient-ils berbères ?) qui savaient fort bien et disaient mezzo voce à leurs petits camarades qu’une partie des descriptions, évocations etc. dont l’école les nourrissait n’avait rien à voir avec ce que nous appellerions, nous, leur propre culture. Ce qui ne les a pas empêchés de prendre ce qui était bon à prendre (Ah ! le fameux « butin de guerre » cher à Kateb Yacine !) non sans se dire sans doute ou peut-être qu’un jour il faudrait changer tout cela.
Naturellement il faudrait élargir les débats à tout ce qui concerne les crédos de l’école républicaine dont on peut penser qu’ils ont été efficaces aussi longtemps qu’ils n’ont pas été mis en question. Le développement de l’esprit critique est certainement souhaitable dès l’école primaire, qui a pourtant pour autre tâche de promouvoir une confiance absolue dans le savoir. Les deux sont-ils compatibles ? À l’école en Algérie donne à cet égard certains témoignages intéressants. Il y est en effet question d’écoliers « arabes » (mais peut-être étaient-ils berbères ?) qui savaient fort bien et disaient mezzo voce à leurs petits camarades qu’une partie des descriptions, évocations etc. dont l’école les nourrissait n’avait rien à voir avec ce que nous appellerions, nous, leur propre culture. Ce qui ne les a pas empêchés de prendre ce qui était bon à prendre (Ah ! le fameux « butin de guerre » cher à Kateb Yacine !) non sans se dire sans doute ou peut-être qu’un jour il faudrait changer tout cela.
Le problème des souvenirs surtout quand ils sont sollicités comme ceux qu’on trouve dans ce livre est qu’ils incitent à la mémoire affective plus qu’à la réflexion. Cependant, on est amené à constater que l’apport de ces cinquante-deux auteurs est beaucoup plus riche que ne laisse croire au premier abord leur apparence un peu répétitive. Et pour les lecteurs ou lectrices qui n’auraient pas connu l’Algérie de cette époque, la présence qui lui est donnée dans ce livre est une chance appréciable car pour reprendre une expression banale, « on s’y croirait ». Oui, c’est vraiment tout un monde qui ressurgit à travers l’école —ce qui tendrait à prouver que celle-ci est beaucoup plus qu’un angle d’approche. Sa force est qu’elle unit les aspects les plus humbles et concrets de la vie quotidienne à une affirmation constante de valeurs dont l’ensemble compose une « vision du monde ». À travers ce livre, on touche à ce double aspect. Surgit d’une part tout un ensemble de sensations, gustatives, olfactives —originales certes mais peut-être n’ont-elles pas tellement changé dans l’Algérie d’aujourd’hui ? Cette dernière question amène à s’en poser une autre, concernant le deuxième aspect ou aspect idéologique des témoignages : et si l’Algérie n’avait fait que changer un nationalisme contre un autre ? Cela pourrait être la preuve que le contenu idéologique qui est à l’arrière-plan d’un enseignement n’est qu’un aspect de celui-ci, dont les qualités viennent d’ailleurs; celles dont nous parle À l’école en Algérie sont émouvantes et suscitent l’admiration.
Denise Brahimi
« MÂLE DÉCOLONISATION » de Todd Shepard (Payot 2017)
Notre association s’est jointe à divers partenaires pour organiser plusieurs rencontres avec Todd Shepard dans notre région. L’historien américain a suscité un remarquable intérêt auprès des divers publics venus l’écouter et échanger avec lui. Cet intérêt provient probablement du fait que d’une part il aborde l’histoire franco algérienne après l’indépendance, ce qui un sujet finalement assez peu abordé en France, au moins pour des œuvres destinées à un large public. De plus son approche mêlant les disciplines, histoire, bien sûr, mais aussi sociologie et anthropologie, étude des médias… permet un regard non conventionnel et parfois dérangeant sur l’impact dans la société française de la fin de l’ère coloniale.
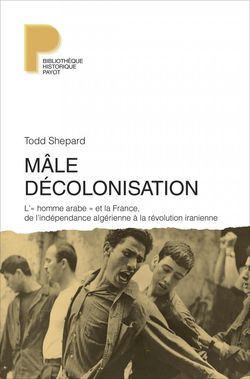 « Mâle décolonisation », après « 1962 Comment l’indépendance algérienne a transformé la France » porte sur notre pays et les débats politiques, intellectuels et culturels qui l’ont secoué pendant 20 ans un regard scrutateur qui ouvre vers bien des questionnements peu fréquents chez nous. Le premier ouvrage, tiré de la thèse de l’auteur, montre comment en très peu de temps, l’indépendance de l’Algérie a transformé les institutions françaises, et introduit de façon nouvelle les critères ethniques et religieux dans l’accès à la nationalité française : voir notamment le traitement différencié appliqué aux juifs du Mzab, rapidement francisés de manière dérogatoire, et le refus initial de reconnaître la nationalité française aux supplétifs rapatriés…
« Mâle décolonisation », après « 1962 Comment l’indépendance algérienne a transformé la France » porte sur notre pays et les débats politiques, intellectuels et culturels qui l’ont secoué pendant 20 ans un regard scrutateur qui ouvre vers bien des questionnements peu fréquents chez nous. Le premier ouvrage, tiré de la thèse de l’auteur, montre comment en très peu de temps, l’indépendance de l’Algérie a transformé les institutions françaises, et introduit de façon nouvelle les critères ethniques et religieux dans l’accès à la nationalité française : voir notamment le traitement différencié appliqué aux juifs du Mzab, rapidement francisés de manière dérogatoire, et le refus initial de reconnaître la nationalité française aux supplétifs rapatriés…
Un passage de ce livre est en quelque sorte le point de départ du deuxième : c’est celui consacré à l’image sexualisée donnée des pieds noirs notamment par certains auteurs de gauche, en particulier Pierre Nora. Ce dernier décrit l’Algérie française comme un « pays où la seule valeur reconnue est l’exhibition d’une supervirilité physiquement exacerbée ». Todd Shepard y relève quantité d’éléments d’archives où la terminologie sexuelle est largement utilisée pour exprimer le positionnement politique des uns et des autres. La nouvelle gauche alimente particulièrement ce registre de l’anormalité sexuelle des européens d’Algérie. Il expliquera lors des rencontres organisées autour de ses livres et de son approche d’historien que cette moisson d’éléments concernant le groupe des pieds noirs avait déclenché la recherche aboutissant à son deuxième livre.
Mâle décolonisation illustre et analyse avec une abondance de sources comment la période 1962/1978 a été caractérisée par une hypersexualisation de la représentation de l’ « homme arabe », à l’opposé de l’image fantasmée orientaliste longtemps liée aux pays du Maghreb, et faisant au corps des femmes une place prépondérante. Cette référence sexuelle au mâle arabe touche de nombreux milieux et courants d’opinion. Elle prend place dans des écrits politiques, dans la littérature, dans le cinéma… Pour qui, comme c’est mon cas, auraient pu passer à côté de cette exacerbation, l’argumentation et l’accumulation des références fournies par l’auteur finissent par convaincre, même s’il y a certainement un effet de loupe à rapprocher des éléments épars. La simultanéité de cette représentation érotisée de cet « autre » et de la révolution sexuelle dont mai 68 allait être un signal majeur est soulignée par l’auteur est donne à réfléchir.
 Ce livre se veut une tentative de « faire converger des histoires culturelles denses, des aspects du fait colonial et une histoire plus large, celle des histoires connectées ».
Ce livre se veut une tentative de « faire converger des histoires culturelles denses, des aspects du fait colonial et une histoire plus large, celle des histoires connectées ».
Il aborde successivement la phraséologie sexuelle de l’extrême droite, la vision politique des homosexuels, notamment dans les organisations d’extrême gauche où certains se sont engagés dans cette période en vue d’une émancipation, la façon dont les catholiques sociaux abordent le sujet de la lutte contre la prostitution et les arguments mis en avant, l’argumentaire politique construit un temps autour de la sodomie, les débats autour du viol dans les organisations féministes françaises. Ce survol du sommaire montre à lui seul combien le sujet abordé par le livre a concerné de nombreux pans de la société française.
Pour l’extrême droite, marginalisée jusqu’au début des années 70, l’imagerie employée va de l’humiliation sexuelle subie par la France à cause de de Gaulle, à, déjà, la menace d’invasion alliée à l’image de l’Algérien violeur, alimentée par des tracts, des articles dans Minute ou dans Rivarol. Puis à l’approche de mai 68, ce seront les dénonciations très détaillées et imagées des étudiants gauchistes dénoncés pour leurs mœurs déviantes favorisées par la proximité de l’Université et le bidonville de Nanterre, de Genet (« Genet en pince pour le rouquin », Minute) et des Paravents à l’Odéon, des « minets » de Nanterre… Cela se prolonge après 1969 avec la reprise d’une partie de cette imagerie par des leaders de droite.
Curieusement cette imagerie trouve aussi un écho dans l’extrême gauche, notamment chez les militants du FHAR, front homosexuel d’action révolutionnaire, qui rapprochent luttes anticoloniales, antiracisme et conquêtes de droits sexuels. Se mêlent proximités dans ces combats, et proximités érotiques crûment revendiquées dans certains appels.
La période est ponctuée d’œuvres artistiques qui croisent le sujet de l’érotisation des relations entre français et arabes : « Les Ambassadeurs, film de Naceur Ktari, les livres de Rachid Boudjedra (la Répudiation, Topographie idéale pour une agression caractérisée), de Tahar Ben Jelloun (La plus haute des solitudes : misère affective et sexuelle d’émigrés nord-africains), la Bande dessinée de Slimane Zeghidour-Saladin Les migrations de Djeha, Diabolo-Menthe, Le dernier tango à Paris, Dupont-Lajoie… L’auteur explore toutes ces œuvres pour faire apparaître en quoi elles alimentent son propos et ont participé à l’arrière-plan fantasmatique que décortique ce livre.
Le sujet de la prostitution illustre abondamment le thème du livre. Entre les BMC financés par l’Etat et où régnait une discrimination organisée par l’Armée vis-à-vis des soldats maghrébins et des prostituées également maghrébines, la non application de la loi Marthe Richard dans l’Empire colonial, la dénonciation de l’apport au FLN des proxénètes algériens, supposés du reste rafler le marché, preuve de la dévirilisation de notre pays ( !), une même fantasmatique autour de la sexualité de l’Homme arabe est une sorte de fil rouge. Les abolitionnistes ont développé à l’envi la thèse que « la misère sexuelle des immigrés est une menace pour les femmes françaises ». Entre l’affaire du Fetich’s club et le mouvement des prostituées mené par Ulla à l’église de Saint-Nizier, la Ville de Lyon apporte plusieurs illustrations au propos de l’auteur. Dans le débat de l’époque le racisme anti-arabe est très présent quant à la clientèle choisie par les professionnelles. Les abolitionnistes liés au catholicisme social ont martelé pendant tout leur combat l’argument de la traite des blanches vers les pays arabes et le Maghreb…
Le chapitre sur la sodomie « pouvoir, résistance et sodomie » abonde de références de haut niveau, de Jacques Berque à Alain Finkelkraut et Pascal Bruckner avec leur « Nouveau désordre amoureux ». C’est surtout l’analyse détaillée du « Dernier tango à Paris », avec notamment des passages un peu oubliés de ce film qui le place bien au cœur du sujet.
Le viol est ensuite tour à tour abordé comme métaphore du racisme anti arabe, notamment dans le livre de Boudjedrah, et surtout dans le film Dupont-Lajoie d’Yves Boisset dans lequel un travailleur immigré est tué par les campeurs voisins mis en furie par l’assassinat de la fille de l’un d’entre eux par Dupont Lajoie (formidable Jean Carmet). L’auteur se livre ensuite à une minutieuse analyse de la prise en compte du sujet du viol « racialisé » dirions nous aujourd’hui, par les féministes. Le témoignage de Maï, militante féministe violée « j’établis le parallèle entre l’oppression subie par les femmes et celle subie par les peuples colonisés » est emblématique des débats idéologiques de cette période. Très forts sont aussi les extraits de la plaidoirie très politique de Gisèle Halimi dans un procès contre des violeurs. Et cette réflexion des féministes sur le sort différent fait aux violeurs selon qu’ils sont « puissants ou misérables », en particulier immigrés…
Dans sa conclusion, l’auteur juge que ces références aux arabes à la sexualité dangereuse font partie de l’histoire, remplacées dans l’imaginaire collectif depuis la révolution islamique iranienne par les musulmans, et l’oppression des femmes et des homosexuels. Il site pour terminer trois œuvres récentes qui redonnent vie sous un angle nouveau au thème de son livre : le film « Caché » de Mickael Haneke, le livre « Histoire de la violence » d’Edouard Louis, et « Meursault contre-enquête » de Kamel Daoud.
Un livre riche et complexe, qui personnellement m’a ouvert les yeux sur une lecture de l’histoire que je ne soupçonnais pas.
Michel Wilson

« VENT DU NORD » de Walid Mattar (Tunisie 2018)
Ce film vient de sortir sur les écrans français, après une sortie flatteuse en Tunisie.
La belle famille des cinéastes sociaux, des Ken Loach, Guediguian, ou des frères Dardenne vient de s’enrichir d’un séduisant cinéaste tunisien, pas encore quadragénaire,  Walid Mattal, tombé dans le cinéma tout petit, comme cinéaste amateur : il est membre à 13 ans de la fédération tunisienne du cinéma amateur ! Après de solides études, son diplôme en génie civil lui vaut d’exercer des responsabilités dans une usine où il lui est demandé de « traiter » la ressource humaine : « on attendait de moi que je fasse le dur »… Au lieu de quoi, il nous livre son premier long métrage après quelques courts métrages primés. Son film a l’originalité de représenter les effets de la mondialisation des deux côtés : celui de l’usine de chaussure délocalisée de Boulogne sur mer vers Hammam Lif, dans la banlieue de Tunis, et des ouvriers affectés à un même poste de travail, et également sacrifiés. La narration se fait entre deux trajectoires parallèles du nord vers le sud et du sud vers le nord, et une succession de séquences entre Boulogne et Tunis, symboliquement reliées entre elles par les sillages des bateaux porte-conteneurs et de l’avion qui emmène l’ouvrier boulonnais, Hervé Lepoutre,
Walid Mattal, tombé dans le cinéma tout petit, comme cinéaste amateur : il est membre à 13 ans de la fédération tunisienne du cinéma amateur ! Après de solides études, son diplôme en génie civil lui vaut d’exercer des responsabilités dans une usine où il lui est demandé de « traiter » la ressource humaine : « on attendait de moi que je fasse le dur »… Au lieu de quoi, il nous livre son premier long métrage après quelques courts métrages primés. Son film a l’originalité de représenter les effets de la mondialisation des deux côtés : celui de l’usine de chaussure délocalisée de Boulogne sur mer vers Hammam Lif, dans la banlieue de Tunis, et des ouvriers affectés à un même poste de travail, et également sacrifiés. La narration se fait entre deux trajectoires parallèles du nord vers le sud et du sud vers le nord, et une succession de séquences entre Boulogne et Tunis, symboliquement reliées entre elles par les sillages des bateaux porte-conteneurs et de l’avion qui emmène l’ouvrier boulonnais, Hervé Lepoutre,  sa femme Véronique et leur fils, Vincent, pour une semaine de vacances dans un hôtel touristique tunisien. L’éphémère prospérité que leur a procurée la petite entreprise de pêche clandestine leur permet cet intermède heureux, pendant que Foued, l’ouvrier tunisien embauché au même poste de travail transpire pour un salaire de misère… Subtile message, ponctué par le mélancolique retour en train vers l’aéroport, qui fait brièvement cheminer côte à côte les Lepoutre et Foued dans leurs trains respectifs, dont les voies finissent symboliquement par diverger.
sa femme Véronique et leur fils, Vincent, pour une semaine de vacances dans un hôtel touristique tunisien. L’éphémère prospérité que leur a procurée la petite entreprise de pêche clandestine leur permet cet intermède heureux, pendant que Foued, l’ouvrier tunisien embauché au même poste de travail transpire pour un salaire de misère… Subtile message, ponctué par le mélancolique retour en train vers l’aéroport, qui fait brièvement cheminer côte à côte les Lepoutre et Foued dans leurs trains respectifs, dont les voies finissent symboliquement par diverger.
Foued a quitté ses camarades de bistrot et leur philosophie de comptoir pour ce piètre emploi, espérant ainsi financer les soins médicaux de sa mère, mais y rencontrant aussi la belle Karima, qui le fera tenir quelques temps à son poste, avant qu’elle lui préfère la fréquentation du douanier chargé d’enregistrer les cargaisons de chaussures vers la France : la mondialisation crée des avantages pour quelques-uns, dont les douaniers…
La caméra humaniste de Walid Mattar excelle à faire vivre tous ces gens ordinaires et leurs scènes de vie. C’est en cela qu’on peut le rapprocher de la lignée des cinéastes « sociaux » cités plus haut. Il a d’abord su rassembler une belle équipe d’acteurs, qui incarnent à merveille et donnent une âme à ces gens ordinaires, aux perspectives désespérantes, mais qui vivent bravement cette existence compliquée. Citons Philippe Ribbot, belle gueule de cinéma, et Corinne Masiero, plus connue comme la « Capitaine Marleau » de la télévision, et porte-parole des Insoumis. Avec leur fils, campé avec crédibilité par le jeune Kacey Mottet-Klein qui quittera ses jeux de guerre pour intégrer pour de bon l’infanterie de marine, ils incarnent une famille française que l’épreuve va ressouder, comme la trop brève aventure de l’entreprise de pêche « au black » qui finit par une saisie policière. C’est que Vincent, personnage un peu Keatonien, ne parvient pas à dénouer les nœuds des obligations administratives que de ternes « conseillers » n’en finissent pas de dresser face à lui. On le voit à la fin du film récupérer ses « droits » à pôle emploi en faisant traverser en gilet vert les enfants des écoles, aux côtés de son camarade délégué syndical de l’usine… Les scènes de l’occupation de l’usine, de l’expulsion, des démarches administratives sont réalistes. Les scènes de bistrot, de rencontres amicales sont vivantes et on y croit.
 Côté tunisien, la distribution est aussi réussie : Mohamed Amine Hamzaoui, tour à tour hâbleur, révolté, bon fils, joli cœur… compose un personnage intéressant ; la belle Abir Bennani est aussi crédible, d’abord séduite par Foued, puis réaliste dans ses choix, mais solidaire, tout de même. La brochette de buveurs de café à la terrasse du troquet tunisien fait écho, 2000 kilomètres plus au sud aux copains de comptoir du troquet boulonnais. Le dialogue surréaliste sur la mouche dans la tasse de café débouchant sur un improbable précepte religieux est un moment savoureux.
Côté tunisien, la distribution est aussi réussie : Mohamed Amine Hamzaoui, tour à tour hâbleur, révolté, bon fils, joli cœur… compose un personnage intéressant ; la belle Abir Bennani est aussi crédible, d’abord séduite par Foued, puis réaliste dans ses choix, mais solidaire, tout de même. La brochette de buveurs de café à la terrasse du troquet tunisien fait écho, 2000 kilomètres plus au sud aux copains de comptoir du troquet boulonnais. Le dialogue surréaliste sur la mouche dans la tasse de café débouchant sur un improbable précepte religieux est un moment savoureux.
 L’écriture du film est très soignée, comme les dialogues. La participation de Leila Bouzid dont on avait aimé son « A peine j’ouvre les yeux » au scénario, renouant avec d’autres collaborations, porte de beaux fruits. Pas de scènes inutiles, mêmes celles de transition. La boucle entre le feu d’artifice initial et la scène finale, dont on ne dévoilera pas la teneur est un joli message philosophique, qui vient encore approfondir le contenu politique suggéré à petites touches.
L’écriture du film est très soignée, comme les dialogues. La participation de Leila Bouzid dont on avait aimé son « A peine j’ouvre les yeux » au scénario, renouant avec d’autres collaborations, porte de beaux fruits. Pas de scènes inutiles, mêmes celles de transition. La boucle entre le feu d’artifice initial et la scène finale, dont on ne dévoilera pas la teneur est un joli message philosophique, qui vient encore approfondir le contenu politique suggéré à petites touches.
Notre époque est décidément incohérente, méprisant les faibles, tentant de mettre en concurrence les pays et les continents, pour de misérables profits. Mais les hommes et les femmes surnagent tant bien que mal, grâce aux micro-solidarités qui permettent de passer d’une étape à l’autre.
L’espoir est ténu, mais il demeure, nous dit peut-être ce film attachant et intelligent. à voir le 22 juin au cinéma les Alizés de Bron.
Michel Wilson

- 6 juin 2018 20h Rencontre autour du film « Retour à Bollène » de Saïd Hamich au cinéma Le Méliès de Saint Etienne
- 22 juin 2018 20h, Rencontre autour du film « Vent du Nord » au cinéma Les Alizés de Bron
- 23 juin 2018 14h/22h, hommage à Pierrette et Gilbert Meynier à la Maison des Passages, 44 rue Saint Georges 69005 Lyon.

