Lettre Culturelle franco-maghrébine #24
ÉDITO
Chères lectrices, chers lecteurs, voici notre dernière lettre avant l’interruption de l’été. De ce fait elle sera plus copieuse que de coutume. Mais très digeste, nous l’espérons, surtout si vous prenez le temps des vacances pour en prendre connaissance. Il est vrai que la production culturelle et artistique relative au Maghreb est abondante, souvent de qualité, et nous n’en découvrons certainement qu’une partie. Il est d’autant plus surprenant que la place faite à ces oeuvres sur les écrans de nos cinémas et les étagères de nos librairie reste limitée. Nous espérons modestement contribuer à augmenter la part qu’elles méritent, en suscitant chez un public croissant une curiosité et un goût pour ces livres, films, expositions. Bien sûr, nous comptons sur votre soutien pour nous y aider, en relayant cette lettre. Certain-e-s d’entre vous doivent le faire, puisque mois après mois, de nouvelles demandes d’abonnement nous parviennent.
Bel été revigorant, et rendez vous amical à la rentrée.
Michel Wilson

« RETOUR A BOLLENE », film de Saïd Hamich, 2018
Premier regard:
Connu comme producteur de films marocains, Saïd Hamich se lance ici dans la réalisation, d’une manière qui affirme son originalité plus que son souci des règles et des normes : c’est ainsi que l’histoire qu’il raconte s’inscrit dans une tension qui s’arrête au bout d’une heure et le film aussi.
 Cependant le propos évoqué par le titre Retour à Bollène est de ceux qu’on connaît assez bien : un personnage retourne sur les lieux de son passé et de son adolescence, les traces qu’il en garde en lui sont source d’angoisse et de tourment, ce qui est l’indice de deuils non faits et de pages non tournées, d’ailleurs Nassim en porte la marque dans sa chair, sous la forme d’une cicatrice dont on ne sait rien d’autre sinon qu’elle lui vient d’un « accident »( ?) : manifestement Saïd Hamichi, comme Nassim son personnage, n’est pas de ceux qui racontent ; le passé, pour ce dernier, n’est pas l’objet d’une narration, c’est un poids et une douleur qu’on porte en soi et avec soi, d’autant plus cruellement que Nassim sait très bien l’inutilité de continuer à se battre contre eux, comme il l’explique à son demi-frère resté à Bollène et empêtré jusqu’à la paralysie dans la velléité de régler des comptes qui bien évidemment ne pourront jamais l’être. La paralysie à Bollène c’est l’alcool, le chômage, la petite délinquance et de diverses manières la destruction de soi. Ce que le retour à Bollène apprend à Nassim (il s’agit plutôt d’une confirmation nécessaire de ce qu’il savait déjà) c’est qu’il n’y a sur place aucune issue à la difficulté de supporter la vie, et de se supporter soi-même, en tout cas pas pour lui, un garçon intelligent, exigeant et bien doué.
Cependant le propos évoqué par le titre Retour à Bollène est de ceux qu’on connaît assez bien : un personnage retourne sur les lieux de son passé et de son adolescence, les traces qu’il en garde en lui sont source d’angoisse et de tourment, ce qui est l’indice de deuils non faits et de pages non tournées, d’ailleurs Nassim en porte la marque dans sa chair, sous la forme d’une cicatrice dont on ne sait rien d’autre sinon qu’elle lui vient d’un « accident »( ?) : manifestement Saïd Hamichi, comme Nassim son personnage, n’est pas de ceux qui racontent ; le passé, pour ce dernier, n’est pas l’objet d’une narration, c’est un poids et une douleur qu’on porte en soi et avec soi, d’autant plus cruellement que Nassim sait très bien l’inutilité de continuer à se battre contre eux, comme il l’explique à son demi-frère resté à Bollène et empêtré jusqu’à la paralysie dans la velléité de régler des comptes qui bien évidemment ne pourront jamais l’être. La paralysie à Bollène c’est l’alcool, le chômage, la petite délinquance et de diverses manières la destruction de soi. Ce que le retour à Bollène apprend à Nassim (il s’agit plutôt d’une confirmation nécessaire de ce qu’il savait déjà) c’est qu’il n’y a sur place aucune issue à la difficulté de supporter la vie, et de se supporter soi-même, en tout cas pas pour lui, un garçon intelligent, exigeant et bien doué.
En peu de temps et d’images, Saïd Hamichi entrecroise les deux fils dont le nœud étrangle lentement ceux qu’il a laissés sur place trois ans auparavant, quand il a quitté Bollène pour Abou Dhabi, où il a trouvé un travail et une « fiancée » américaine amoureuse de lui. D‘un côté l’état des lieux et la situation collective, de l’autre les problèmes personnels et familiaux. Le réalisateur garde constamment la balance entre ces deux aspects, étant bien clair que leurs conséquences néfastes ne font que se renforcer. La force du cinéaste est de dire tout cela vite et d’emblée : Bollène est une ville au moins à moitié morte, où il ne se passe rien et où la communauté maghrébine est maintenue volontairement dans une stagnation mortifère, qui bien sûr encourage un conservatisme où elle trouve sa seule structure. Nassim, s’affichant comme moderniste, le dénonce sans hésiter devant ce qui ne peut manquer de passer pour de la provocation. Mais paradoxalement il est lui-même fixé au passé qui lui donne fictivement une raison d’être, le dispensant d’en chercher une autre. Ce passé, qu’on pressent sans pouvoir en juger, se résume à la haine du père, évoqué comme un despote monstrueux qui a ou aurait écrasé ses enfants. Nassim qui est revenu à Bollène à cause de la fascination négative exercée sur lui par ce père, refuse de le rencontrer pendant toute la durée de son séjour (d’ailleurs bref). On se doute qu’au dernier moment il le verra (et le spectateur avec lui) mais le suspense est maintenu jusqu’à la fin du film. Ce n’est pas révéler celle-ci que de dire ce qu’on découvre alors, c’est-à-dire, en la personne du père, un homme ému et émouvant, très seul avec les salades qu’il a pour métier de cueillir, c’est-à-dire courbé au plus près du sol, « attaché à la glèbe » comme on disait dans les manuels scolaires d’autrefois pour parler des plus pauvres paysans français, les serfs, dont le nom veut dire esclaves—remplacés aujourd’hui par les travailleurs immigrés.
On imagine bien que le père a dû changer au fil des années, et que la violence qui était sa manière d’exister s’est peu à peu usée, réduite à néant par la routine de la vie à Bollène —en sorte que dans cette image du père, les deux fils conducteurs se rejoignent, de manière poignante, si ce n’est que le nœud qui résulte de leur jonction bloque aussi et par dessus tout la possibilité d’exprimer une émotion.
Malgré le choc de la rencontre avec le père, cette impossibilité subsiste chez Nassim comme le montre l’extrême fin du film, moment où il écrit à sa fiancée ou ex-fiancée Elizabeth, nous laissant sur le sentiment d’une fin ouverte et mitigée : s’agissant de Bollène, pas d’autre solution que d’en partir et d’en repartir ; s’agissant du rapport personnel aux autres, certains dégâts sont irréversibles et à trente ans, l’âge de Nassim, beaucoup de choses sont déjà jouées. Mais enfin c’est un âge encore ouvert sur l’avenir ; pesant sur les êtres, il y a des déterminations fortes, mais pas de fatalité.
Denise Brahimi
Second regard:
Un film juste et laconique. Saïd Hamich, est un producteur Franco marocain né à Fès en 1986. On lui doit notamment la production de Much Loved, Vent du Nord, Volubilis, autant  de films que nous avons appréciés. Il réalise avec ce Retour à Bollène son premier long métrage mû par une forme d’urgence personnelle: apprenant que sa mère compte repartir de Bollène, où il a vécu quelques années, vers le Maroc, il se lance en peu de temps dans l’écriture, puis dans trois semaines de tournage de ce film qui n’est qu’en partie autobiographique. Et critiques et spectateurs apprécient. L’économie de temps, de moyens et de mots, met en valeur les failles de tous les personnages auxquels il faut ajouter celles des lieux, cette Bollène adossée à sa centrale nucléaire dont les panneaux ornés d’enfants blonds délicieux vantent « Une ville, une identité ». Nassim, le personnage central du film, au contraire du réalisateur est né ici, et y a fait toutes ses études, soutenu notamment par son professeur d’histoire marxiste monsieur Aubenard, qu’il découvre élu municipal converti aux discours racistes et « nationalo-défaitistes » de la Ligue du sud des époux Bompard. Nassim revient après quatre ans à Abu Dhabi, pour revoir sa mère et ses frères et soeurs, leur présenter sa fiancée américaine Elisabeth, mais évite son père à qui il voue une lourde rancune. Ce ressentiment est un des pivots du film entremêlé à la difficulté schizophrénique ( son copain rappeur le qualifie affectueusement » d’intello, schizophrène dans sa tête ») de celui qui a réussi, veut garder le lien avec les siens, refusant néanmoins d’être comme eux « un arabe de Bollène ».
de films que nous avons appréciés. Il réalise avec ce Retour à Bollène son premier long métrage mû par une forme d’urgence personnelle: apprenant que sa mère compte repartir de Bollène, où il a vécu quelques années, vers le Maroc, il se lance en peu de temps dans l’écriture, puis dans trois semaines de tournage de ce film qui n’est qu’en partie autobiographique. Et critiques et spectateurs apprécient. L’économie de temps, de moyens et de mots, met en valeur les failles de tous les personnages auxquels il faut ajouter celles des lieux, cette Bollène adossée à sa centrale nucléaire dont les panneaux ornés d’enfants blonds délicieux vantent « Une ville, une identité ». Nassim, le personnage central du film, au contraire du réalisateur est né ici, et y a fait toutes ses études, soutenu notamment par son professeur d’histoire marxiste monsieur Aubenard, qu’il découvre élu municipal converti aux discours racistes et « nationalo-défaitistes » de la Ligue du sud des époux Bompard. Nassim revient après quatre ans à Abu Dhabi, pour revoir sa mère et ses frères et soeurs, leur présenter sa fiancée américaine Elisabeth, mais évite son père à qui il voue une lourde rancune. Ce ressentiment est un des pivots du film entremêlé à la difficulté schizophrénique ( son copain rappeur le qualifie affectueusement » d’intello, schizophrène dans sa tête ») de celui qui a réussi, veut garder le lien avec les siens, refusant néanmoins d’être comme eux « un arabe de Bollène ».
Le film alterne entre travellings sur des paysages urbains navrants, de nombreuses rencontres soit silencieuses, soit faites de dialogues courts, et dont les mots font mouche. Celui avec son ancien professeur, rencontré par hasard dont le discours national populiste fait fuir Élisabeth, mais dit finalement justement l’impuissance sans issue de l’option politique qu’il a choisie. Cette courte rencontre déclenche en écho une scène de rupture dure et intense dans laquelle les contradictions autodestructrices de Nassim se révèlent. Il rejette cette femme qui l’aime parce qu’elle le renvoie à ses contradictions. Ce que sa soeur sait bien lui renvoyer : » Pourquoi tu nous détestes? Tu es égoïste, Nassim… ». Cet homme qui parle au moins trois langues montre une difficulté mutique à parler de lui, sauf dans de rares occasions, préférant juger, donner des leçons, à son frère, son demi-frère, sa soeur, son futur beau-frère, Elisabeth, et même sa mère, en commandant du vin devant elle au restaurant, provoquant un malaise général… Pas si sympathique, donc, mais attachant, comme ce moi que retrouve chaque spectateur, dont on n’est pas satisfait, mais qui est une incontournable facette que chacun porte en soi…
À la réflexion, ce film met en scène une jolie collection d’humains cabossés mais auxquels on croit et qu’on se prend à aimer: le grand frère Mustapha, au beau sourire, le coeur sur la main, et ses trafics de cornes de gazelles au canabis, la mère aimante, qui garde les traditions mais tolère les différences, le père tyran vaincu par le travail, mais qui ne sait que lui redire l’importance de ce travail, le demi frère qui tente de sortir de sa déchéance, l’ancienne amoureuse, heureuse malgré tout, l’ami d’école qui scande des raps déchirants.
Cela permet de souligner la place subtile et remarquable de la musique dans ce film: celle écrite par Pauline Rambeau de Baralon, qui souligne avec bonheur en leur donnant de la profondeur certains moments du film, ce rap sur Bollène, qui résume le « No future » des habitants de cette ville, et Bashung, musicien fétiche de Nassim, ce qui le distingue de son entourage.
Une partie de la récente cinématographie du Maghreb ou portant sur la Maghreb (Vent du Nord, Prendre la Large, Vivre à Bollène, et à la rentrée Tazzeka, que nous accompagnerons et « chroniquerons ») font des ponts entre sud et nord. Ils contribuent à illustrer les proximités que la Méditerranée ne peut gommer, même si tant de voyageurs s’y noient, et les relations d’amour-haine que la longue histoire a vu naître entre les peuples des pays qui la bordent.
Michel WILSON

« LE LIVRE D’AMRAY » par Yahia Belaskri, éditions Zulma, 2018
Le paradoxe de ce livre fait qu’on hésite à l’appeler « roman » bien que ce soit une convention qui l’emporte de nos jours. Quel paradoxe et pourquoi cette hésitation ?
Le livre d’Amray évoque incontestablement des faits, des lieux et des moments, comme le faisait celui qui est sans doute le plus connu des livres antérieurs de Yahia Belaskri Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (2010). 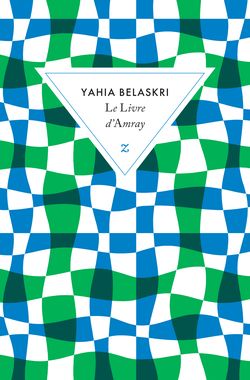 Ces faits sont d’ailleurs toujours les mêmes, ils remontent à l’enfance du personnage principal, ici Amray, et font une place importante, terriblement cruelle, à une série d’événements où l’on peut reconnaître la tristement célèbre « décennie noire » qui a plongé l’Algérie dans l’épouvante et la destruction. On peut sans doute considérer une partie de ce qui est mentionné comme d’origine autobiographique, mais l’information et la narration n’apparaissent pas comme l’essentiel du livre. Et s’il y a paradoxe c’est justement parce que ces deux aspects, quoique évidemment présents, sont aussi présentés dans le livre sans références précises ni de lieu ni de temps, celles-ci étant au contraire évitées volontairement au profit d’une sorte de « floutage »—cette technique utilisée en photographie à l’égard de certaines images qu’on veut masquer ou rendre anonymes mais qui vaut pour des textes aussi bien. En choisissant cette façon de faire, l’auteur retrouve la liberté que permet la fiction et qu’il revendique aussi en faisant de son texte un « roman ».
Ces faits sont d’ailleurs toujours les mêmes, ils remontent à l’enfance du personnage principal, ici Amray, et font une place importante, terriblement cruelle, à une série d’événements où l’on peut reconnaître la tristement célèbre « décennie noire » qui a plongé l’Algérie dans l’épouvante et la destruction. On peut sans doute considérer une partie de ce qui est mentionné comme d’origine autobiographique, mais l’information et la narration n’apparaissent pas comme l’essentiel du livre. Et s’il y a paradoxe c’est justement parce que ces deux aspects, quoique évidemment présents, sont aussi présentés dans le livre sans références précises ni de lieu ni de temps, celles-ci étant au contraire évitées volontairement au profit d’une sorte de « floutage »—cette technique utilisée en photographie à l’égard de certaines images qu’on veut masquer ou rendre anonymes mais qui vaut pour des textes aussi bien. En choisissant cette façon de faire, l’auteur retrouve la liberté que permet la fiction et qu’il revendique aussi en faisant de son texte un « roman ».
De toute manière il apparaît clairement que l’écriture réaliste n’est pas celle qui convient à Yahia Belaskri et qu’il se donne le droit d’écrire autrement, soit, pour le dire en un mot poétiquement. On serait tenté de définir son petit (142 pages) livre comme un poème en prose, si cette expression ne renvoyait dans la littérature française à un genre assez codé, qui n’est pas ce dont il s’agit dans Le livre d’Amray. Celui-ci exprime des sentiments et des états d’âme (ou de corps) qui appellent pour se dire un langage autre que celui de la narration prosaïque. Celle-ci s’emploie à cerner les mots dans une « logique du discours » comme diraient sans doute les linguistes, ce qui n’est pas ici le but de l’auteur. Cette logique serait particulièrement inadaptée à la partie finale du livre qui se situe au moment où Amray a sombré dans la folie, à la suite d’une insoutenable douleur. En fait on pourrait voir le livre tout entier, qui n’est que lointainement un récit, comme un grand ensemble à vocation poétique englobant des citations d’autres poètes, ici convoquées comme autant de variations sur un même thème.
Ces passages empruntés ponctuent Le livre d’Amray de façon récurrente et suivie, il n’y en a pas moins de huit, ce qui rend impossible de les évoquer tous, mais dont on peut dire  qu’ils correspondent à l’état d’esprit de l’auteur et à ce qu’il exprime dans son livre. Si l’on n’en prend qu’un pour preuve, ce pourrait être ces quelques vers de Jean Sénac (mort en 1973) à la fin de sa vie : J’ai vu ce pays se défaire /Avant même de s’être fait / J’ai vu la joie, l’honneur, la beauté n’être plus / qu’un masque délavé sur la plus lamentable /racaille.
qu’ils correspondent à l’état d’esprit de l’auteur et à ce qu’il exprime dans son livre. Si l’on n’en prend qu’un pour preuve, ce pourrait être ces quelques vers de Jean Sénac (mort en 1973) à la fin de sa vie : J’ai vu ce pays se défaire /Avant même de s’être fait / J’ai vu la joie, l’honneur, la beauté n’être plus / qu’un masque délavé sur la plus lamentable /racaille.
Ces extraits renvoient à des poèmes plus ou moins récents, un seul appartient à la tradition poétique ancienne du monde oriental, c’est celui du grand poète mystique persan du 13e siècle, Al Rûmî Mawlânâ, qui nous donne un indice précieux sur Yahia Belaskri, dans la mesure où Rûmî est connu comme un grand maître du soufisme. Comme on dit sans doute un peu niaisement pour certains vers du passé qui pourraient avoir été écrits aujourd’hui, ceux qui sont cités à la dernière page et aux dernières lignes du Livre d’Amray sont sidérants de modernité : Je ne suis ni de l’Est / ni de l’Ouest /ni de la terre/(…) Je ne descends ni d’Adam ni d’Eve /ni d’aucune origine /Ma place n’a pas de place, /une trace de ce qui n’a pas de trace …
Pour ce qui est de la pensée intime d’Amray et de la manière dont il ressent son rapport au monde, on en a eu des indices au cours du livre, par exemple dans les moments très touchants où il s’efforce de les transmettre comme un message à ses enfants, qu’il éduque évidemment à rebours de tout enseignement officiel (inculquant principalement aux écoliers l’intégrisme religieux). Tout donne à penser qu’il peut en effet se reconnaître dans les vers de Rûmî et qu’il peut y trouver aussi la justification de son choix grandissant en faveur de la poésie. L’éloge du vent sur lequel se termine Le Livre d’Amray, un vent assimilé à la poésie elle-même, pourrait être une allusion à ce qu’est le souffle dans la pensée et la poésie soufie.
Denise Brahimi
« NI LANGUE NI PAYS » par Leïla Houari, L’Harmattan, 2018, roman
Dans ce roman qui est évidemment autobiographique, l’auteure s’efforce de suivre au plus près les états d’âme de la femme qu’elle est devenue après les nombreuses tribulations d’une vie marquée notamment par les changements de lieu. Plus que de changement il faudrait d’ailleurs parler de rupture pour le premier d’entre eux, qui fait qu’en 1965 la famille de la narratrice alors âgée de sept ans a quitté le Maroc pour venir s’installer à Bruxelles —exil économique voulu par le père, qui cependant annonce souvent son intention de repartir au pays. D’où un sentiment d’instabilité qui a beaucoup perturbé l’enfant.
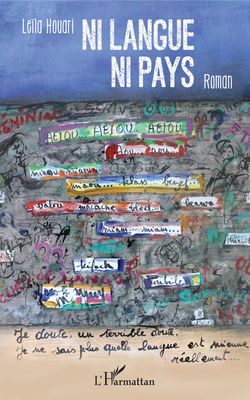 Le livre commence par plusieurs épisodes caractéristiques de ce que pouvait être alors la vie d’une petite fille et d’une adolescente née dans l’immigration, entre un père autoritaire à l’ancienne, une mère à peu près mutique et les sept enfants de ce couple d’exilés. La situation n’est d’ailleurs pas aussi désastreuse qu’elle pourrait l’être même si Fatima —puisque tel est le nom du personnage dans le roman— a bien du mal à s’en accommoder. Difficile de faire la part entre les petits chagrins d’enfance, les troubles propres à l’adolescence et les difficultés particulières aux familles d’immigrés. Leïla Houari évoque tout cela dans de courts chapitres, fragments de vie ou bribes de mémoire qui lui reviennent après plusieurs décennies.
Le livre commence par plusieurs épisodes caractéristiques de ce que pouvait être alors la vie d’une petite fille et d’une adolescente née dans l’immigration, entre un père autoritaire à l’ancienne, une mère à peu près mutique et les sept enfants de ce couple d’exilés. La situation n’est d’ailleurs pas aussi désastreuse qu’elle pourrait l’être même si Fatima —puisque tel est le nom du personnage dans le roman— a bien du mal à s’en accommoder. Difficile de faire la part entre les petits chagrins d’enfance, les troubles propres à l’adolescence et les difficultés particulières aux familles d’immigrés. Leïla Houari évoque tout cela dans de courts chapitres, fragments de vie ou bribes de mémoire qui lui reviennent après plusieurs décennies.
Paris est l’autre lieu qui va devenir tant bien que mal le sien ; mais le sent-elle vraiment comme le sien ? Toute la question est là, justement. En fait, à lire le roman, on n’est pas convaincu que le titre « Ni langue ni pays » soit tout à fait justifié. Leïla/Fatima est tout à fait francophone, même s’il y a en elle des traces de la langue maternelle, cet arabe dialectal qu’elle a parlé jusqu’à l’âge de sept ans. Traces dont il ne faut certainement pas sous-estimer l’importance, surtout dans cet univers intime, aux limites du conscient et de l’inconscient, dont le récit montre bien à quel point il envahit la vie quotidienne de celle qui est devenue une femme d’une cinquantaine d’années.
Deux circonstances contribuent d’ailleurs à cette remontée des souvenirs et aux troubles dont ils ne peuvent manquer d’être porteurs. D’une part, Fatima a une fille, âgée de dix-sept ans, et elle peut mesurer chaque jour ce qui les différencie par rapport à leur origine marocaine : la plus jeune s’intéresse à cette origine d’un point de vue qu’on pourrait dire extérieur ; même si elle ne songe pas un instant à la renier, c’est plutôt avec curiosité qu’elle l’aborde et un réel désir de lui faire place dans sa vie—sans plus cependant. Fatima en revanche porte cette origine à l’intérieur d’elle-même, comme une présence continue qui l’habite, même si elle ne sait vraiment pas quoi en faire—et justement sans doute pour cette raison-là.
 L’autre circonstance qui rend Fatima vulnérable et qui crée beaucoup de place en elle pour les questions qu’elle ne cesse de se poser est le fait qu’elle se trouve au chômage, et si l’on peut dire vacante, après une vie sans doute dispersée, néanmoins bien remplie d’occupations dont certaines ont été riches et prenantes (l’apprentissage du théâtre par exemple). La fréquentation épisodique de Pôle Emploi ne peut que renforcer son désir de trouver refuge en elle-même ; cependant ce retour sur soi est forcément piégé et la détourne d’autres urgences, qu’elle ne parvient d’ailleurs pas à définir clairement. Elle se sent dans une situation inconfortable, comme l’indique bien le titre de l’un de ses chapitres : « Malaise » et comme le prouvent un certain nombre des troubles dont elle souffre (pas besoin d’être grand psy pour diagnostiquer leur origine psycho-somatique !) ; mais la manière d’y faire face n’est pas donnée pour autant. Il est d’ailleurs intéressant d’assister à une sorte de dédoublement d’elle-même auquel elle se livre dans la fin du livre, sous couvert d’une visite rendue à sa mère, qui est devenue veuve et vit au Maroc.
L’autre circonstance qui rend Fatima vulnérable et qui crée beaucoup de place en elle pour les questions qu’elle ne cesse de se poser est le fait qu’elle se trouve au chômage, et si l’on peut dire vacante, après une vie sans doute dispersée, néanmoins bien remplie d’occupations dont certaines ont été riches et prenantes (l’apprentissage du théâtre par exemple). La fréquentation épisodique de Pôle Emploi ne peut que renforcer son désir de trouver refuge en elle-même ; cependant ce retour sur soi est forcément piégé et la détourne d’autres urgences, qu’elle ne parvient d’ailleurs pas à définir clairement. Elle se sent dans une situation inconfortable, comme l’indique bien le titre de l’un de ses chapitres : « Malaise » et comme le prouvent un certain nombre des troubles dont elle souffre (pas besoin d’être grand psy pour diagnostiquer leur origine psycho-somatique !) ; mais la manière d’y faire face n’est pas donnée pour autant. Il est d’ailleurs intéressant d’assister à une sorte de dédoublement d’elle-même auquel elle se livre dans la fin du livre, sous couvert d’une visite rendue à sa mère, qui est devenue veuve et vit au Maroc.
Elle insère dans les chapitres narratifs qui décrivent ce voyage un dialogue imaginaire avec sa mère, qui après son long mutisme a repris énergiquement la parole. Et ce que la mère dit à Fatima, nous n’avons qu’une manière de l’interpréter, c’est ce que Fatima se dit à elle-même, Leïla Houari. Propos qui ne manquent pas de lucidité voire de sévérité, comme on peut l’entendre ici : « Arrête de gémir. Tout en toi n’est que complaisance ». Ou encore, un peu plus loi : « Arrête de me labourer l’échine avec tes interrogations. Fais ce que tu as à faire au lieu de gesticuler comme un poisson sans eau. Accepte de vivre. Agis, sèche tes larmes, elles ne servent à rien ».
Les propos attribués à la vieille dame sont à la fois roboratifs et humoristiques. On se prend à rêver, pour ce roman de Leïla Houari, d’un titre il est vrai audacieux qui aurait pu être : « Les gesticulations d’un poisson sans eau ». Puisque c’est elle qui le dit ! On sait bien que l’humour est une forme de pudeur, ou encore, dans une formulation plus tragique, qu’il est la politesse du désespoir. Ni langue ni pays, en dépit de ce titre, n’est pas un livre désespéré, même si la narratrice ne voit pas beaucoup d’issues ni pour elle-même ni pour les situations dramatiques accumulées dans le monde contemporain. Cependant elle sait et réaffirme, contre la tentation du nihilisme (évoqué dans un chapitre qui s’intitule « Rien »), que rien n’existe en effet, sinon ce qu’on fabrique soi-même.
Denise Brahimi
« NUITS INCANDESCENTES » par Sophie Colliex, roman, La Cheminante, 2018
Ce roman dont l’action se passe entièrement dans deux pays du Maghreb, l’Algérie et la Tunisie, à l’époque coloniale, ne ressemble pourtant que très peu, par son style et par son ton, au grand nombre de ceux qui évoquent l’enfance et l’adolescence du héros dans ces mêmes lieux et au même moment. On s’attend à ce que celui-ci soit tourmenté par les complexités voire les contradictions que lui impose sa situation personnelle, définie par le moment historique et par d’autres déterminations (ethniques, sociales etc.)
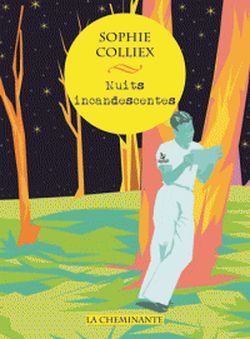 Dans Les Nuits incandescentes, le héros Emmanuel est un jeune homme qu’on suit d’assez près pendant les quelques années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale, à travers la centaine de lettres qu’il envoie à sa fiancée Berthe, originaire comme lui de l’Oranie, région alors française . A l’âge de dix-huit ans, sur un coup de tête, il s’est engagé pour cinq ans dans la marine, où il est spécialiste des liaisons radio. Il ne tarde pas à déplorer les conséquences de son choix, pourtant irréversible, qui le tient éloigné de tous ceux qu’il aime, son père, ses frères et sœurs et sa fiancée. On croit comprendre que la tendance mélancolique d’Emmanuel vient en fait de plus loin, principalement de la mort de sa mère car il a été très tôt orphelin mais dans le milieu de ses camarades et collègues, il n’est pas de bon ton de gémir sur soi-même. Certes tous ont hâte de mettre un terme à leur vie monotone et fastidieuse sur le bateau, mais il est lui d’un tempérament particulier, imaginatif et rêveur, qui l’amène à transposer tous les manques dont il souffre dans une sorte d’amour fou pour cette fiancée qu’il connaît si mal et qui est d’abord la fille d’un ami de son père. Sophie Colliex montre très bien ce qu’il en est de cette sorte de désir exacerbé qui le hante et qui n’est, semble-t-il, que pour une faible part un désir physique : la romancière, contrairement au courant dominant de notre époque, se montre très discrète sur ce point.
Dans Les Nuits incandescentes, le héros Emmanuel est un jeune homme qu’on suit d’assez près pendant les quelques années qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale, à travers la centaine de lettres qu’il envoie à sa fiancée Berthe, originaire comme lui de l’Oranie, région alors française . A l’âge de dix-huit ans, sur un coup de tête, il s’est engagé pour cinq ans dans la marine, où il est spécialiste des liaisons radio. Il ne tarde pas à déplorer les conséquences de son choix, pourtant irréversible, qui le tient éloigné de tous ceux qu’il aime, son père, ses frères et sœurs et sa fiancée. On croit comprendre que la tendance mélancolique d’Emmanuel vient en fait de plus loin, principalement de la mort de sa mère car il a été très tôt orphelin mais dans le milieu de ses camarades et collègues, il n’est pas de bon ton de gémir sur soi-même. Certes tous ont hâte de mettre un terme à leur vie monotone et fastidieuse sur le bateau, mais il est lui d’un tempérament particulier, imaginatif et rêveur, qui l’amène à transposer tous les manques dont il souffre dans une sorte d’amour fou pour cette fiancée qu’il connaît si mal et qui est d’abord la fille d’un ami de son père. Sophie Colliex montre très bien ce qu’il en est de cette sorte de désir exacerbé qui le hante et qui n’est, semble-t-il, que pour une faible part un désir physique : la romancière, contrairement au courant dominant de notre époque, se montre très discrète sur ce point.
D’ailleurs cette discrétion est en accord avec son souci d’éviter les anachronismes, son but étant de nous montrer ce qu’il en est ou ce qu’il en était de ce que Mauriac aurait appelé « un jeune homme d’autrefois ». La fixation amoureuse soutient la vie d’Emmanuel pendant plusieurs années, d’autant qu’elle se double et prend pendant ce même temps la forme d’un passage à l’écriture, qui est le seul moyen qu’il découvre à sa portée pour tenter de la canaliser. Cet aspect du livre permet d’en étendre les analyses à plusieurs époques mais en même temps, Sophie Colliex a voulu reconstituer tout l’environnement sensible qui dans le cas de son personnage en modèle la sensibilité. Elle évoque, paroles à l’appui, plusieurs chansons de Tino Rossi et de la même époque, lui adjoint Lucienne Boyer ; pour le roman c’est Francis Carco, pour le cinéma Marcel Lherbier et tant d’autres, et par dessus le tout, un air de tango car c’est aussi l’époque de Carlos Gardel et grâce à la radio, Emmanuel peut baigner dans des musiques qui entretiennent sa vie sentimentale: on pense au très joli film de Woody Allen intitulé Radio Days (1987) qui montre le rôle privilégié joué par les émissions de radio dans la vie d’un jeune garçon à la fin des années 30.
 La radio reste le lien d’Emmanuel avec le monde même pendant les années où il croupit sur son bateau dans la rade de Bizerte, faute d’avoir un obtenir un poste à Oran tellement plus près de chez lui. Le poste d’Oran, c’est un Breton qui l’obtient, alors qu’il aurait tant voulu celui de Brest, où l’attendent péniblement sa femme et son bébé ! C’est ainsi que par petites touches Sophie Colliex imprègne son roman d’une vérité sensible et quotidienne, celle des personnages et celle de l’époque intimement mêlées. Son écriture est à la fois discrète et efficace, en dehors de tous effets spectaculaires. On pense à ce que fut, il y a maintenant plusieurs décennies, la découverte de ces historiens qu’on appelle l’école des Annales, jugeant plus utile de décrire concrètement à un moment donné la manière de vivre des gens, plutôt que la composition politique des gouvernements et le déroulement des guerres petites ou grandes.
La radio reste le lien d’Emmanuel avec le monde même pendant les années où il croupit sur son bateau dans la rade de Bizerte, faute d’avoir un obtenir un poste à Oran tellement plus près de chez lui. Le poste d’Oran, c’est un Breton qui l’obtient, alors qu’il aurait tant voulu celui de Brest, où l’attendent péniblement sa femme et son bébé ! C’est ainsi que par petites touches Sophie Colliex imprègne son roman d’une vérité sensible et quotidienne, celle des personnages et celle de l’époque intimement mêlées. Son écriture est à la fois discrète et efficace, en dehors de tous effets spectaculaires. On pense à ce que fut, il y a maintenant plusieurs décennies, la découverte de ces historiens qu’on appelle l’école des Annales, jugeant plus utile de décrire concrètement à un moment donné la manière de vivre des gens, plutôt que la composition politique des gouvernements et le déroulement des guerres petites ou grandes.
La politique et les événements qui en découlent constituent ce qu’on appelle la grande histoire et elle est loin d’être absente de Nuits incandescentes où l’on voit s’aggraver, de 1936 à 1939, la montée des fascismes sur fond de guerre d’Espagne. Cependant, l’histoire est traitée par la romancière de manière encore plus indirecte dans ce deuxième livre qu’elle ne l’était dans son premier, L’enfant de Mers El-Kébir (2017), où l’on y voyait en gros plan, comme le titre permet de l’imaginer, l’effroyable attaque anglaise subie par ce port en juillet 1940. Dans l’épilogue de son dernier roman, Sophie Colliex donne un parfait exemple d’une sorte d’effacement des événements qui deviennent si l’on peut dire subliminaux, présents mais à l’état d’allusion et vus à travers la subjectivité d’un personnage : Emmanuel, pour des raisons toute personnelles, les tient à l’écart, comme de simples jalons l’aidant à fixer son évolution intérieure. Il s’agit ici de l’exode des Pieds Noirs d’Algérie au groupe desquels il appartient, et l’on croit assister au départ parmi tant d’autres de la famille qu’il a fondée avec Berthe … jusqu’au moment où l’on comprend que les autres partent en effet tandis que lui a décidé de rester.
C’est sans doute cette manière d’aller à contrecourant qui fait que l’histoire ne peut lui servir de cadre. On parle ici de la romancière aussi bien que de son personnage. A la réflexion, on se dit qu’elle n’a pu écrire sans prendre appui sur une information très importante, dans le domaine de ce qu’on appelle la grande Histoire, mais elle a choisi de la gommer, pas complétement mais presque, pour faire place à l’intériorité de ses personnages et à leurs émotions les plus intimes.
Denise Brahimi
« 1994 », roman par Adlène Meddi, Alger, Barzakh, 2017
L’auteur n’en est pas à son coup d’essai et pour ceux qui auront lu La Prière du Maure (2008), il sera évident que 1994 est écrit en continuité avec ce livre désigné comme « Polar » qui revenait déjà sur l‘incroyable mélange de toute puissance et d’anarchie sanglantes provoqué par la lutte anti-terroriste pendant une dizaine d’années.
 Adlène Meddi, né en 1975, a donc à peu près l’âge d’Amin fils de Zoubir, le personnage principal de 1994. Ce dernier est encore un lycéen qui n’a pas vingt ans lorsque se passent les événements principaux du livre, à la date du titre. Il choisit cette année-là parce qu’elle est au cœur de la terrible « décennie noire », manière de désigner une guerre civile d’une effroyable cruauté.
Adlène Meddi, né en 1975, a donc à peu près l’âge d’Amin fils de Zoubir, le personnage principal de 1994. Ce dernier est encore un lycéen qui n’a pas vingt ans lorsque se passent les événements principaux du livre, à la date du titre. Il choisit cette année-là parce qu’elle est au cœur de la terrible « décennie noire », manière de désigner une guerre civile d’une effroyable cruauté.
Des deux partis en présence, le seul qu’on voie, et de très près, dans le roman d’Adlène Meddi, est celui du pouvoir d’Etat, y compris et surtout les « services spéciaux », liés à l’armée non sans luttes fratricides et féroces, alors que les terroristes eux-mêmes n’y sont jamais présents ni vraiment décrits, sinon par de brèves allusions. Etant bien clair pour tous ses lecteurs que le terrorisme a sévi en Algérie pendant cette décennie, le romancier a choisi de représenter ceux qui se sont donné pour tâche (et finalement victorieusement) de lutter contre lui, et c’est peu de dire qu’ils l’ont fait par tous les moyens—en sorte que, si terrorisme il y a eu, la terreur profondément ressentie par les lecteurs (ainsi que par certains personnages du livre) vient de cette répression d’une violence inouïe, exercée notamment par le déjà nommé Zoubir, qui appartient aux services secrets. Bien qu’il y occupe un poste très élevé, il n’en est pas moins contrôlé par quelques personnages aussi mystérieux qu’effrayants placés encore plus haut que lui dans cette redoutable hiérarchie de la lutte anti-terroriste.
Adlène Meddi s’est sans doute inspiré de modèles réels, d’ailleurs il l’a dit lui-même et de toute façon on sent bien qu’il ne parle pas au hasard. Cependant, il ajoute à cette information précise une qualité littéraire qui rend certains passages de son roman tout à fait saisissants. Il veut et sans doute n’a-t-il pas tort, faire de la décennie et plus spécialement de l’année 1994 une sorte d’Apocalypse réalisée au présent. On s’y trouve transporté par delà le bien et le mal car il est évident qu’aucune notion morale n’apparaît où que ce soit, et aussi si l’on peut dire par delà la vie et la mort car on ne voit pas très bien où viendrait se loger quelque respect de la vie dans ce massacre quotidien dont personne ne semble concevoir ni envisager la fin.
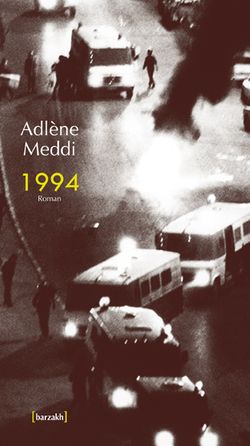 La tragédie qui est au cœur du livre est d’ailleurs une conséquence de ce dernier point. Zoubir est le père d’Amin mais il comprend trop tard que celui-ci avec quelques-uns de ses camarades, un surtout, prénommé Sidali, se croit autorisé et même appelé lui aussi à tuer parce que rien n’a prémuni ces jeunes garçons contre l‘influence mortifère du milieu ambiant. Ils constituent un groupe autoproclamé et évidemment clandestin de quatre garçons, ce qui n’est pas sans rappeler les quatre compagnons dont parle Kateb Yacine dans Nedjma. Et cette ressemblance ou influence se trouve renforcée à plusieurs reprises par la manière d’écrire d’Adlène Meddi, qui ne pratique la narration linéaire qu’à de courts moments, préférant le plus souvent parsemer son récit, longtemps un peu obscur, d’allusions à des événements qui ne prennent forme que peu à peu dans l’esprit du lecteur. Comme dans Nedjma, le récit qui semble concerner principalement les jeunes gens ne se comprend en fait que si on l’étend sur deux générations, celle des pères et celle des fils, et l’on peut tout à fait reprendre la formule connue selon laquelle les ancêtres redoublent de férocité à propos du redoutable Zoubir, lourdement chargé d’ambiguïtés. Le lien avec la période dont parle Kateb Yacine est assuré en ce sens que Nedjma se passe juste avant le début de la Guerre d’Algérie alors que 1994 nous fait remonter jusqu’à la fin de cette même guerre, celle pendant laquelle les pères comme Zoubir et Farès père de Sidali se sont battus côte à côte (non sans rivalités et haines inexpiables) et ont mis au point les méthodes qu’ils réutilisent pendant la décennie. D’ailleurs le style enflammé d’Adlène Meddi, nourri de visions épiques, doit certainement beaucoup à un certain héritage reçu de Kateb Yacine. Et comme cet encore jeune auteur trouve dans la littérature algérienne un véritable fonds culturel propre à nourrir son inspiration, on peut certainement dire que la relation entre Amin et la psychiatre qui le soigne à l’hôpital de Blida rappelle ce qu’il en est dans La Répudiation de Rachid Boudjedra, y compris pour le procédé narratif qui permet de revenir sur certains événements à travers le prisme d’une sensibilité aiguisée par la maladie et la douleur.
La tragédie qui est au cœur du livre est d’ailleurs une conséquence de ce dernier point. Zoubir est le père d’Amin mais il comprend trop tard que celui-ci avec quelques-uns de ses camarades, un surtout, prénommé Sidali, se croit autorisé et même appelé lui aussi à tuer parce que rien n’a prémuni ces jeunes garçons contre l‘influence mortifère du milieu ambiant. Ils constituent un groupe autoproclamé et évidemment clandestin de quatre garçons, ce qui n’est pas sans rappeler les quatre compagnons dont parle Kateb Yacine dans Nedjma. Et cette ressemblance ou influence se trouve renforcée à plusieurs reprises par la manière d’écrire d’Adlène Meddi, qui ne pratique la narration linéaire qu’à de courts moments, préférant le plus souvent parsemer son récit, longtemps un peu obscur, d’allusions à des événements qui ne prennent forme que peu à peu dans l’esprit du lecteur. Comme dans Nedjma, le récit qui semble concerner principalement les jeunes gens ne se comprend en fait que si on l’étend sur deux générations, celle des pères et celle des fils, et l’on peut tout à fait reprendre la formule connue selon laquelle les ancêtres redoublent de férocité à propos du redoutable Zoubir, lourdement chargé d’ambiguïtés. Le lien avec la période dont parle Kateb Yacine est assuré en ce sens que Nedjma se passe juste avant le début de la Guerre d’Algérie alors que 1994 nous fait remonter jusqu’à la fin de cette même guerre, celle pendant laquelle les pères comme Zoubir et Farès père de Sidali se sont battus côte à côte (non sans rivalités et haines inexpiables) et ont mis au point les méthodes qu’ils réutilisent pendant la décennie. D’ailleurs le style enflammé d’Adlène Meddi, nourri de visions épiques, doit certainement beaucoup à un certain héritage reçu de Kateb Yacine. Et comme cet encore jeune auteur trouve dans la littérature algérienne un véritable fonds culturel propre à nourrir son inspiration, on peut certainement dire que la relation entre Amin et la psychiatre qui le soigne à l’hôpital de Blida rappelle ce qu’il en est dans La Répudiation de Rachid Boudjedra, y compris pour le procédé narratif qui permet de revenir sur certains événements à travers le prisme d’une sensibilité aiguisée par la maladie et la douleur.
Il y a semble-t-il chez Adlène Meddi le sentiment que sa génération a été sacrifiée—encore une—et encore une fois parce que les pères n’ont eu en tête que le souci d’affirmer leur pouvoir au moyen d’une guerre qui finalement les a avalés et détruits eux aussi. Zoubir, remarquable d’intelligence, sent très bien que les victoires qu’il remporte sont payées au prix fort, par son fils mais déjà par lui-même auparavant. Qu’il en soit conscient ou pas ne change rien, les bourreaux sont aussi des victimes c’est pourquoi on ne peut les haïr, comme il ressort de ce livre où l’on sent passer ce mélange de terreur et de pitié qui sont à la base du sentiment tragique selon Aristote.
1994 a quelques aspects d’un roman policier mais bien davantage ceux d’un « roman noir », genre qui ne répond à aucune définition précise et répertoriée mais qui correspond admirablement à certains milieux et à certaines époques. Adlène Meddi n’a pas besoin d’avoir lu Dashiell Hammett (s’il l’a lu tant mieux) car mieux vaut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets : La violence dont il parle se situe entièrement dans un milieu urbain (est-ce la fin du roman paysan si représenté chez les premiers maîtres de la littérature algérienne ?), on ne voit guère dans quels repères la société mise en cause pourrait être ancrée, et s’agissant de littérature, il est évidemment très important que le romancier reproduise ou réinvente la langue de ses personnages, grossière, argotique, pittoresque aussi et l’on oserait dire talentueuse, en sorte qu’il n’est pas interdit d’en rire, au cœur même d’effroyables situations.
Denise Brahimi
« ISRAEL ET SON PROCHAIN » par Salah Guemriche, Editions de l’Aube, 2018
L’auteur précise en sous-titre de son livre qu’il l’a écrit « d’après la Bible et autres textes d’auteurs juifs anciens et contemporains ». En effet il s’en dégage pour le lecteur le sentiment d’une grande érudition qui ne peut manquer d’avoir donné lieu à un travail considérable. On imagine bien que la raison en est l’importance de l’enjeu, et le cheminement de Salah Guemriche est en effet rattaché continûment à la volonté de tirer au clair ce qu’il en est, selon le judaïsme biblique, des relations entre le peuple juif et ses voisins.
 Faut-il préciser que la référence à la situation contemporaine est constamment présente dans l’esprit de l’auteur et d’ailleurs dans le nôtre : s’agissant de l’Etat d’Israël, que trouve-t-il dans son héritage biblique qui puisse orienter sa politique à l’égard de ses voisins les plus proches que sont les Palestiniens ? Cependant cette question n’émerge (presque) clairement qu’à la fin du livre, alors que l’auteur s’attache à analyser de très près ce qu’il en est dans la Bible elle-même et ce que signifie dans certains textes le mot « prochain » qui s’y trouve employé. Pour prendre l’exemple le plus connu ou qui vient immédiatement à l’esprit, qui est le « prochain » dans la célèbre formule : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Et au risque d’être évidemment très réducteur par rapport à la complexité des analyses de Salah Guemriche, on se demandera plus précisément : s’agit-il d’un autre juif ou de tout autre personnage non juif aussi bien ?
Faut-il préciser que la référence à la situation contemporaine est constamment présente dans l’esprit de l’auteur et d’ailleurs dans le nôtre : s’agissant de l’Etat d’Israël, que trouve-t-il dans son héritage biblique qui puisse orienter sa politique à l’égard de ses voisins les plus proches que sont les Palestiniens ? Cependant cette question n’émerge (presque) clairement qu’à la fin du livre, alors que l’auteur s’attache à analyser de très près ce qu’il en est dans la Bible elle-même et ce que signifie dans certains textes le mot « prochain » qui s’y trouve employé. Pour prendre l’exemple le plus connu ou qui vient immédiatement à l’esprit, qui est le « prochain » dans la célèbre formule : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Et au risque d’être évidemment très réducteur par rapport à la complexité des analyses de Salah Guemriche, on se demandera plus précisément : s’agit-il d’un autre juif ou de tout autre personnage non juif aussi bien ?
La lecture et relecture des textes permet à l’auteur de s’appuyer sur un certain nombre d’épisodes bibliques à l’occasion desquels la question est posée en toute précision. Il en est ainsi par exemple pour l’épisode du « bon Samaritain » sur lequel il revient à plusieurs moments de ses vingt chapitres ; ou encore pour l’épisode de Ruth la Moabite que certains amateurs de Victor Hugo connaissent à travers son poème « Booz endormi» de La Légende des siècles. La richesse du livre obligeant à une présentation limitée, on s’en tiendra d’abord à ces deux exemples, qui sont très éclairants sur les questions qui se posent sinon sur les réponses.
Qui est donc le bon Samaritain, personnage d’une parabole célèbre qui n’en demande pas moins à être resituée dans son contexte ?
A l’époque de Jésus, les Samaritains étaient considérés comme des ennemis d’Israël. Et pourtant, la parabole fait d’un Samaritain le modèle à suivre aux dépens de deux Juifs qui représentent l’orthodoxie. En effet, mis en présence d’un blessé grave qui nécessite des soins, seul le premier le prend en charge et fait tout ce qui est en son pouvoir, tandis que les deux autres tirent argument de tel ou tel interdit imposé par leur religion pour ne rien faire en faveur de cette malheureuse victime. L’interprétation chrétienne de la parabole consiste à dénoncer le formalisme de la religion juive et les limites ou les bornes de celle-ci qui l’amènent à enfreindre la prescription pourtant fondamentale : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cependant, cette critique est faite d’un point de vue chrétien dans le cadre d’une prédication contre l’orthodoxie.
 Et maintenant que nous dit le livre de Salah Guemriche à propos de l’histoire de Ruth, la Moabite ? Il lui consacre un chapitre auquel il donne pour sous-titre : « L’universel juif en acte » et il appelle très joliment cette histoire une « fable pastorale ». Ruth y figure d’abord une étrangère mais Booz la rachète, en fait sa femme et ils ont une descendance dans laquelle figure, après quelques générations, David, le roi des rois d’Israël. Salah Guemriche a beau jeu d’y voir l’apologie du mariage exogame…quitte à souligner après d’autres qu’il s’agit d’un cas exceptionnel. Cependant cette signification se trouve renforcée dans le texte biblique par l’existence d’un autre personnage qui agit à l’inverse de Booz l’homme bon, et qui lui, au contraire refuse de reconnaître Ruth, c’est-à-dire, pour reprendre la parabole précédente, de l’aimer comme lui-même. On voit par là qu’à l’intérieur même de la tradition juive des courants opposés s’affrontent, entraînant une exégèse qui fait évidemment état de cette complexité.
Et maintenant que nous dit le livre de Salah Guemriche à propos de l’histoire de Ruth, la Moabite ? Il lui consacre un chapitre auquel il donne pour sous-titre : « L’universel juif en acte » et il appelle très joliment cette histoire une « fable pastorale ». Ruth y figure d’abord une étrangère mais Booz la rachète, en fait sa femme et ils ont une descendance dans laquelle figure, après quelques générations, David, le roi des rois d’Israël. Salah Guemriche a beau jeu d’y voir l’apologie du mariage exogame…quitte à souligner après d’autres qu’il s’agit d’un cas exceptionnel. Cependant cette signification se trouve renforcée dans le texte biblique par l’existence d’un autre personnage qui agit à l’inverse de Booz l’homme bon, et qui lui, au contraire refuse de reconnaître Ruth, c’est-à-dire, pour reprendre la parabole précédente, de l’aimer comme lui-même. On voit par là qu’à l’intérieur même de la tradition juive des courants opposés s’affrontent, entraînant une exégèse qui fait évidemment état de cette complexité.
Il est clair que les premiers concernés par la nécessité de ces choix décisifs voire épineux sont les juifs eux-mêmes , ce qui vaut aussi bien pour la diaspora que pour ceux qui vivent dans l’Etat d’Israël. Salah Guemriche a parfaitement raison de circonscrire avec précision les limites de sa problématique, en la ramenant toujours à la question qu’il a posée d’emblée au début de son livre : qu’est-ce que le prochain, (et par opposition qu’est-ce que l’étranger, qu’est-ce que l’ennemi ?) sinon on verrait s’engouffrer dans son livre une série pour ainsi dire illimitée de problèmes attachés aux mots qu’inévitablement il est amené à employer : antisémitisme, sionisme, judéophobie etc. Le Dieu de la Bible a fixé, dit-il, à l’usage de son peuple, « une route soigneusement balisée, avec ses bornes et ses ‘haies’ de protection. Tel est le sujet dont traite ce livre, et l’on oserait dire que l’auteur lui aussi a su se mouvoir entre les balises et les bornes. Pour autant, s’il est vrai que le lecteur se sent fermement guidé et conduit, il ne ressent ni contrainte ni manipulation. La conviction très importante qu’on retire de cet exposé minutieux est qu’on ne peut pas porter d’appréciation sur la ou plutôt sur les pensées juives actuelles sans connaître le très long passé d’où elles viennent ; Salah Guemriche a le mérite de l’explorer à travers une bonne centaine de textes.
Denise Brahimi
« L’AMOUR AU TOURNANT » par Samir Kacimi 2014 traduit de l’arabe , Barzakh 2017
Pour les lecteurs francophones c’est une grande chance d’avoir accès à l’un des huit romans écrits en arabe par cet écrivain algérien, le premier des huit à être traduit en français , avec beaucoup de talent semble-t-il par Lotfi Nia.
 C’est un livre qui donne un grand plaisir de lecture fondé sur la reconnaissance de certains traits littéraires mais aussi sur la découverte d’une manière d’écrire rare et inattendue. Parmi les traits identifiables en matière de littérature arabe, il y a un procédé directement emprunté aux célèbres Mille et une nuits : on fait connaissance avec un vieil homme dégoûté de la vie et pressé d’en finir, mais ce premier fragment de récit s’interrompt lorsqu’il fait la rencontre d’un autre vieil homme (pourtant moins âgé que lui), Qassem, qui se met à lui raconter sa propre histoire—une histoire d’amour principalement, entrecoupée de réflexions diverses, souvent philosophiques, sur le sens de la vie comme on dit banalement. Le second récit, qui est le véritable sujet du livre, se déroule dans un temps court mais en plusieurs étapes, qui constituent au total un retour en arrière sur une aventure pleine de surprises et de charme, que l’on suit passionnément car elle est écrite par Samir Kacimi avec beaucoup de talent.
C’est un livre qui donne un grand plaisir de lecture fondé sur la reconnaissance de certains traits littéraires mais aussi sur la découverte d’une manière d’écrire rare et inattendue. Parmi les traits identifiables en matière de littérature arabe, il y a un procédé directement emprunté aux célèbres Mille et une nuits : on fait connaissance avec un vieil homme dégoûté de la vie et pressé d’en finir, mais ce premier fragment de récit s’interrompt lorsqu’il fait la rencontre d’un autre vieil homme (pourtant moins âgé que lui), Qassem, qui se met à lui raconter sa propre histoire—une histoire d’amour principalement, entrecoupée de réflexions diverses, souvent philosophiques, sur le sens de la vie comme on dit banalement. Le second récit, qui est le véritable sujet du livre, se déroule dans un temps court mais en plusieurs étapes, qui constituent au total un retour en arrière sur une aventure pleine de surprises et de charme, que l’on suit passionnément car elle est écrite par Samir Kacimi avec beaucoup de talent.
Ce charme est dû en partie au mélange d’éléments littéraires assez variés, et qu’on ne s’attend pas à trouver associés dans un même livre, au total assez court (moins de 200 pages dans l’édition Barzakh). Qassem a mené la vie d’un jeune vagabond complétement désargenté, sans attache et sans autre logement que sa voiture, ce qui donne lieu à une sorte de récit picaresque, jusqu’au moment où une jeune femme assez mystérieuse entre dans sa vie, non sans de fréquentes disparitions, et lui fait découvrir la continuité d’un amour incontestable, complétement différent des rencontres sexuelles auxquelles il est habitué. Cette jeune femme dit s’appeler Loubna, jusqu’au moment où il s’avère qu’elle se prénomme Djamila, et ce n’est pas la seule des bizarreries qui ne font que lui attacher toujours davantage l’amoureux Qassem. A plusieurs égards elle fait penser aux femmes un peu étranges dont il est question dans la littérature surréaliste, telle que la Nadja d’André Breton (1928). Pourtant les vérités physiques sont aussi évoquées de manière très directe par Qassem, qui n’est pas a priori porté sur l’idéalisation.
Sa vision du monde, de sa brutalité et des laideurs qu’il comporte, apparaît dans l’évocation très peu flatteuse de la ville d’Alger. Elle est très concrète et précise en tant que topographie des lieux rues, cafés, gargotes etc.), mais la manière dont les habitants sont décrits, évidemment très subjective, les montre comme veules et misérables. La critique est sévère et tout permet de supposer qu’à travers Qassem, c’est Samir Kacimi qui s’exprime.
 Cependant le personnage et l’auteur justifient leur mépris des comportements ordinaires par la nature très philosophique de leurs réflexions sur la manière de concevoir la conduite de la vie et la prise en considération des destins individuels. Celles-ci doivent beaucoup à la présence dans le livre d’un personnage appelé Abdallah qui a marqué Qassem de son empreinte. Une influence en tout cas est perceptible, celle de la pensée hindouiste et bouddhiste, alors que les références au christianisme et à l’islam sont tout à fait absentes.
Cependant le personnage et l’auteur justifient leur mépris des comportements ordinaires par la nature très philosophique de leurs réflexions sur la manière de concevoir la conduite de la vie et la prise en considération des destins individuels. Celles-ci doivent beaucoup à la présence dans le livre d’un personnage appelé Abdallah qui a marqué Qassem de son empreinte. Une influence en tout cas est perceptible, celle de la pensée hindouiste et bouddhiste, alors que les références au christianisme et à l’islam sont tout à fait absentes.
Cependant globalement, et il est probable que là est le point qui séduira le plus grand nombre de lecteurs, L’amour au tournant (quoi que veuille dire dans ce titre le mot « tournant ») est une très belle « histoire d’amour et de mort » comme on a coutume de dire pour les récits du type Tristan et Iseult , pourtant originale en ce sens que l’amour n’y est pas contrarié par des obstacles extérieurs ni même comme il peut arriver intérieurs aux personnages. L’une des raisons pour lesquelles on est pris à ce point par le récit est qu’on voudrait connaître la nature des obstacles quels qu’ils soient. Il s’avérera qu’ils sont à la fois dicibles en termes ordinaires mais que cette manière de les dire n’est pourtant pas l’essentiel. D’ailleurs, du fait que dès le départ quelques aspects fantastiques s’introduisent malicieusement dans le récit, on comprend bien son auteur n’a pas envie d’écrire un roman réaliste ou entièrement réaliste. Il y a certes une tentative tardive des deux amoureux (elle surtout) pour inscrire leur histoire dans la vie quotidienne et ordinaire, mais on a déjà pressenti depuis longtemps que telle n’est pas sa nature et qu’elle n’y parviendra pas.
Pour autant le roman est loin d’être irrationnel et l’on y trouve même une admirable explication de ce qui éloigne les amoureux l’un de l’autre en dépit de leur désir d’amour. Comme il sied dans un conte, ceci nous est dit d’une manière allégorique, à la fois très simple et très profonde. C’est une sorte de commentaire du mot « Murs » qui circule comme un fil conducteur à travers le récit :
Un berger est amoureux d’une princesse, il voudrait lui déclarer sa flamme mais au lieu de lui parler directement il érige des murs sur lesquels il grave un poème pour lui dire combien il l’aime. Il espère qu’elle passera devant son œuvre et lira ses vers mais cela n’arrive jamais. Las d’attendre, il se décide à aller lui parler lui-même mais alors il s’aperçoit qu’il a érigé des dizaines de murs entre elle et lui…
Comment une aussi brève histoire peut-elle être à ce point bouleversante ; c’est un des secrets de Samir Kacimi. Il reste à attendre et à espérer que d’autres de ses livres soient traduits, pour que nous découvrions d’autres formes de son talent.
Denise Brahimi
ROMANS GRAPHIQUES: « LA PETITE MOSQUEE DANS LA CITE » une enquête de Solenne Jouanneau mise en bande dessinée par Kim Consigny (Casterman, collection Sociorama 2018)
« VACANCES AU BLED », une enquête de Jennifer Bidet mise en bande dessinée par Singeon (Casterman, collection Sociorama 2018).
La collection Sociorama, dirigée par Lisa Mandel et Yasmine Bouagga permet une rencontre entre bande dessinée et sociologie. Des sociologues amateurs de BD ont créé
l’association Socio en cases pour accompagner la transformation graphique d’enquêtes sociologiques et des auteurs de BD curieux de sociologie se sont lancés dans une aventure originale, à l’écart de toute adaptation littérale ou illustration anecdotique.
Les deux dernières parutions répondent parfaitement à cette ambition.

« Vacances au bled » rassemble plusieurs histoires de Lyonnaises et Lyonnais franco-algériens, originaires de Sétif, qui y vont passer des vacances d’été. Ces parcours entrecroisés décrits avec finesse par Jennifer Bidet illustrent toute la complexité de l’entre deux, « eux et nous », « ici et là-bas », le riche dessin de Singeon permettant de rendre accessible au plus grand nombre un sujet qui touche de nombreuses familles, qui pourront s’y reconnaître.
 « La petite mosquée dans la cité » traduit en bande dessinée l’ouvrage de Solenne Jouanneau « Les Imams en France : une autorité religieuse sous contrôle (Éditions Agone, 2013). Là encore, le pari de la transcription est réussi en faisant s’incarner des situations personnelles et collectives complexes. Cette BD rend tangible la vie d’une communauté religieuse de quartier sur une durée assez longue, et le parcours semé d’embûches auquel elle se confronte, face à une « raison » politique locale recherchant des compromis peu glorieux…
« La petite mosquée dans la cité » traduit en bande dessinée l’ouvrage de Solenne Jouanneau « Les Imams en France : une autorité religieuse sous contrôle (Éditions Agone, 2013). Là encore, le pari de la transcription est réussi en faisant s’incarner des situations personnelles et collectives complexes. Cette BD rend tangible la vie d’une communauté religieuse de quartier sur une durée assez longue, et le parcours semé d’embûches auquel elle se confronte, face à une « raison » politique locale recherchant des compromis peu glorieux…
Cet effort de transmission pour un plus grand public d’ouvrages de recherche savante dans le domaine de la sociologie -dont la clarté langagière n’est pas pour l’auteur de ces lignes la vertu cardinale- doit être salué. La technique du roman graphique, surtout quand elle est  pratiquée par des dessinateurs comme Kim Consigny ou Singeon se prête à merveille à la restitution d’enquêtes sociologiques dans lesquels les propos sont souvent rapportés en verbatim, donc avec une authenticité qui résonne dans cette discipline de narration. La restitution des lieux de l’action en dessins permet une approche concrète des situations. Le lecteur, la lectrice est en prise directe avec la situation évoquée par la sociologue et toute la partie analytique de la situation lui revient, certes plus subjective et donc loin des canons de la science, mais aussi ouverte aux émotions, à l’incrédulité, au rire. Un récent article du Monde à propos de Vacances au Bled, a donné lieu dans les réseaux
pratiquée par des dessinateurs comme Kim Consigny ou Singeon se prête à merveille à la restitution d’enquêtes sociologiques dans lesquels les propos sont souvent rapportés en verbatim, donc avec une authenticité qui résonne dans cette discipline de narration. La restitution des lieux de l’action en dessins permet une approche concrète des situations. Le lecteur, la lectrice est en prise directe avec la situation évoquée par la sociologue et toute la partie analytique de la situation lui revient, certes plus subjective et donc loin des canons de la science, mais aussi ouverte aux émotions, à l’incrédulité, au rire. Un récent article du Monde à propos de Vacances au Bled, a donné lieu dans les réseaux  sociaux où il était relayé à de rudes débats, de nombreux lecteurs de l’article s’indignant de la description faite de la confrontation entre riches « blédards » et jeunes des banlieues françaises dans les mêmes villages de vacances de la côte algérienne. Ils n’y voyaient qu’une description sommaire et déformante d’un journaliste survolant une situation, sans comprendre que l’article reposait sur la minutieuse enquête au long cours réalisée scientifiquement par Jennifer Bidet. Le miroir était-il trop ressemblant ?
sociaux où il était relayé à de rudes débats, de nombreux lecteurs de l’article s’indignant de la description faite de la confrontation entre riches « blédards » et jeunes des banlieues françaises dans les mêmes villages de vacances de la côte algérienne. Ils n’y voyaient qu’une description sommaire et déformante d’un journaliste survolant une situation, sans comprendre que l’article reposait sur la minutieuse enquête au long cours réalisée scientifiquement par Jennifer Bidet. Le miroir était-il trop ressemblant ?
Sur le fond, les situations travaillées par les deux sociologues, et ainsi incarnées dans le dessin sont des sujets passionnants et clivants entre les sociétés du sud et du nord de la Méditerranée, les sociétés plurielles, où se confrontent le politique, l’économique et le social, l’appartenance plus ou moins longue à la terre d’accueil. En découlent des façons différentes d’approcher l’islam, moderniste ou traditionnaliste, des difficultés de la belle-fille française à être « suffisamment algérienne » pour la belle famille sétifienne… Et la BD se plaît à juxtaposer des situations différentes, une gamme très bigarrée de cet « entre-deux », de cette multitude de situations différentes et déterminantes décrites par Abdelmalek Sayad.
Dans « La petite mosquée dans la cité » l’enquête très riche de Solenne Jouanneau est concentrée sur un seul site où vont s’illustrer une grande variété des problématiques rencontrées par le pratique de l’Islam en France, du dévouement de ses clercs bénévoles et de ses associations aux contradictions politiques auxquelles se confrontent les élus face à un besoin croissant de lieux de culte adaptés.
L’amateur de bande dessinée que reste votre serviteur depuis qu’il sait lire (et peut-être avant !) est, vous l’avez compris, séduit par la « mise en bulles » de ces ouvrages savants. Souhaitons longue vie à cette collection. Nous ne manquerons pas de provoquer dès que possible des rencontres avec ces auteur-e-s dans notre région.
Michel Wilson

« AILLEURS »NORA BOUDJEMAÏ , peinture, Galerie Regard Sud 1/3 rue des Pierre Plantées 69001 Lyon, 14 juin-15 juillet 2018
Les habitants de notre région auraient mauvaise grâce à ne pas aller voir la peinture de Nora Boudjemaï qui est née à Lyon, vit dans cette ville et y a fait déjà un grand nombre d’expositions, avant celle qu’on peut voir actuellement à la Galerie Regard Sud. De toute façon, sans préjuger des goûts individuels et même pour ceux qui la découvriront à cette occasion, il est plus que probable que la rencontre sera forte, voire impressionnante. D’emblée, on est gagné par la certitude qu’une personne existe sur les murs de cette galerie, qu’elle s’exprime et s’adresse à nous ; et que nous serions idiots de ne pas l’entendre, définitivement sourds à tout ce que la vie peut nous dire et nous apporter.
Si l’on pense au vieux débat qu’on ressort parfois à propos de peinture, opposant la couleur et la forme, on a vite fait de comprendre qu’il n’a pas lieu d’être ici. Proposons plutôt d’évoquer la matière colorée de ses tableaux, et s’il s’agit de recourir à un couple de mots pour définir ou tenter de cerner la complexité de sa peinture, disons que ce serait le couple matière et mouvement dont on voit bien que, si complexité il y a, ce n’est pas de contradiction qu’il s’agit mais de complémentarité.
 La matière parlons-en, sa riche présence ne peut échapper à personne, c’est la première chose qu’on voit en regardant les tableaux de Nora Boudjemaï, celle qui s’impose à nous par son épaisseur mais aussi sa plasticité. Car il n’y a jamais blocage, comme le ferait une substance immobile qui chercherait définitivement à s’imposer. La matière est à la fois consistante et souple, elle porte encore les traces bien visibles du mouvement par lequel elle a été posée où elle est —ou si l’on veut les traces du geste qui lui a donné forme, et qui prouve que cette matière est en rapport avec une volonté et une liberté ; on peut même y trouver quelques indices de caprice et de fantaisie, pourquoi pas, c’est le petit « plus » qui amuse et qui charme, ou qui évite qu’on ne se laisse trop impressionner par la vigueur de l’acte artistique que le tableau déploie.
La matière parlons-en, sa riche présence ne peut échapper à personne, c’est la première chose qu’on voit en regardant les tableaux de Nora Boudjemaï, celle qui s’impose à nous par son épaisseur mais aussi sa plasticité. Car il n’y a jamais blocage, comme le ferait une substance immobile qui chercherait définitivement à s’imposer. La matière est à la fois consistante et souple, elle porte encore les traces bien visibles du mouvement par lequel elle a été posée où elle est —ou si l’on veut les traces du geste qui lui a donné forme, et qui prouve que cette matière est en rapport avec une volonté et une liberté ; on peut même y trouver quelques indices de caprice et de fantaisie, pourquoi pas, c’est le petit « plus » qui amuse et qui charme, ou qui évite qu’on ne se laisse trop impressionner par la vigueur de l’acte artistique que le tableau déploie.
Chez Nora Boudjemaï, matière et mouvement participent d’une vitalité dont l’expression joyeuse est évidemment soulignée par la couleur, puissante, franche et variée. Aucune ne semble nous être refusée, même si l’exposition actuelle donne le sentiment de vouloir explorer particulièrement les possibilités de la couleur verte, de manière originale si l’on pense, en général, à la peinture d’aujourd’hui. Cependant l’artiste aime la diversité des couleurs, cela semble évident, au point de ne pas souhaiter les mêler les unes aux autres au risque de les affadir, mais plutôt de les juxtaposer, pour qu’elles se mettent en valeur réciproquement. Elle use des contrastes entre elles, mais n’en abuse pas, réservant à certaines taches claires, de moindre dimension, une luminosité presque sidérante par son éclat.
C’est dire que pour qui reçoit ces tableaux, (comme un choc visuel) et les regarde (comme objets de contemplation) la sensation est d’être comblé : on voue à l’artiste une sorte de gratitude pour l’impulsion que sa peinture communique et pour l’euphorie que nous lui devons.
Denise Brahimi

- Mercredi 4 juillet film retour à Bollène et débat au Jeu de Paume à Vizille(Isère) 20h30
- Galerie Regard Sud à Lyon jusqu’au 15 juillet Exposition Nora BOUDJEMAÏ

