Lettre Culturelle franco-maghrébine #25
ÉDITO
Chères lectrices, chers lecteurs, notre lettre de rentrée aimerait vous rendre léger ce temps un peu stressant et mélancolique. Nous avons eu le plaisir de lire pour vous en faire partager l’émotion quelques très beaux livres. Nous avons toujours le secret désir de vous donner l’envie de les lire à votre tour.
Pas de film à vous narrer en ce début septembre. Pourtant de belles sorties s’annoncent, et nous reprendrons nos chronique cinéma dès le mois prochain.
Enfin, pour les Lyonnais-e-s il vous reste un ou deux jours pour venir voir l’exposition consacrée à Fernand Pouillon et son ensemble Climat de France à Alger.
Bonne rentrée à vous, et n’hésitez pas, si elle vous paraît le mériter, à faire connaître notre lettre autour de vous. Et à nous signaler livres, expositions ou films que nous pourrions commenter et faire connaître.
Michel Wilson

« MARIE, MERIEM, MYRIAM » par Adil Jazouli, (éditions La Boîte à Pandore 2017)
 Adil Jazouli est connu principalement comme sociologue, et spécialiste des « banlieues » (au sens particulier qu’a pris ce mot) sur lesquelles il a écrit plusieurs livres. Né au Maroc il n’en est pas moins une des personnalités qui en France fait autorité pour tout ce qui concerne ce qu’on appelle aussi les « zones urbaines sensibles ».
Adil Jazouli est connu principalement comme sociologue, et spécialiste des « banlieues » (au sens particulier qu’a pris ce mot) sur lesquelles il a écrit plusieurs livres. Né au Maroc il n’en est pas moins une des personnalités qui en France fait autorité pour tout ce qui concerne ce qu’on appelle aussi les « zones urbaines sensibles ».
Marie, Meriem, Myriam est un livre de fiction qui n’en est pas moins nourri par tout le savoir de son auteur, non pas particulièrement sur les banlieues françaises mais sur une situation beaucoup plus vaste qu’elles ne font que refléter à leur niveau. Cette situation est liée au multiculturalisme dont on est bien loin de mesurer encore tous les effets, en partie parce que beaucoup de gens, dans la société française en tout cas (c’est différent en Angleterre et aux Etats-Unis) ont beaucoup de mal à l’accepter et le vivent beaucoup plus comme une menace que comme une réalité.
Le héros masculin du livre auquel Adil Jazouli a donné pour nom et pour prénom Gabriel Jibril est l’exemple même de ce multiculturalisme qui est beaucoup moins évident chez les trois personnages féminins dont les prénoms figurent au titre du livre. Gabriel Jibril est un Li banais d’origine palestinienne dont la famille s’est réfugiée au Liban, ce qui ne signifie en aucune façon, comme on a tendance à le croire dans la gauche française, que ce sont de pauvres réfugiés vivant dans des camps. Adil Jazouli, qui est très préoccupé par la situation en Palestine, n’en est pas moins très éloigné d’un grand nombre de clichés (tout simplement parce que ceux-ci sont le fait d’une profonde ignorance) et d’une totale lucidité à l’égard des manipulations politiques dont la cause palestinienne fait l’objet dans un certain nombre de pays arabes mais surtout de la part des groupes terroristes les plus virulents.
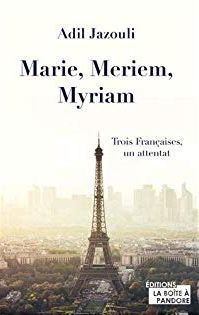 Le multiculturalisme de Gabriel vient en grande part de la diversité de son origine. Car si sa famille paternelle est d’origine palestinienne, installée à Beyrouth depuis 1948, sa mère, Lydia Hassoun, est descendante d’une grande famille juive d’Alexandrie. Ici plus que jamais, la situation des personnes dites orientales apparaît dans toute sa complexité.
Le multiculturalisme de Gabriel vient en grande part de la diversité de son origine. Car si sa famille paternelle est d’origine palestinienne, installée à Beyrouth depuis 1948, sa mère, Lydia Hassoun, est descendante d’une grande famille juive d’Alexandrie. Ici plus que jamais, la situation des personnes dites orientales apparaît dans toute sa complexité.
Par contraste, les trois femmes qui font l’objet des histoires d’amour racontées par l’auteur ont une ascendance assez simple qui explique d’ailleurs pourquoi on va les voir, à un moment du moins, adopter une attitude univoque voire simpliste. Le but du livre est de montrer (évidemment pour le déplorer) ce simplisme dans une même circonstance d’une particulière gravité, les trois histoires étant en fait des variations simultanées sur ce même événement ou ce même moment, et non pas des épisodes qui se succéderaient chronologiquement.
Adel Jazouli a choisi de confronter les trois couples, c’est-à-dire les couples du seul Gabriel et de Marie, Meriem et Myriam, avec l’événement (ou la série d’événements) qui a secoué la société française en janvier 2015. On sait que les moments principaux en ont été d’une part l’attentat contre Charlie Hebdo lorsque les frères Chérif et Saïd Kouachi pénétrèrent dans le bâtiment abritant les locaux du journal armés de fusils d’assaut et assassinèrent onze personnes, dont huit membres de la rédaction ; d’autre part la prise d’otages dans un magasin hyper cacher de la porte de Vincennes à Paris, attaque terroriste islamiste et antisémite, dont l’auteur, Amedy Coulibaly, a tué immédiatement trois personnes et en a pris en otage dix-sept autres, dont l’un fut tué peu après, portant à quatre le nombre des morts.
Adil Jazouli se garde bien de raconter ces événements tragiques, ce qui d’ailleurs n’est pas nécessaire car ils sont dans toutes les mémoires ou presque. En revanche, son propos est de montrer à ses lecteurs les conséquences désastreuses de ces actes qui au-delà même des meurtres commis ont détruit la cohésion de la société française et creusé des brèches parfois considérables entre des individus qui coexistaient sans problème auparavant et avaient établi entre eux un rapport d’amour aussi fort que celui de Gabriel avec les différentes « femmes de sa vie », Marie, Meriem et Myriam. On a immédiatement compris, au choix de ces trois prénoms, qu’elles représentent trois groupes ethniques présents au sein de la société française, celui des Français de souche, qui s’accrochent comme à un dogme intangible à la laïcité et rejettent toute idée de communautarisme, celui des Musulmans qui même parfaitement intégrés veulent signifier l’appartenance à leur groupe d’origine lorsqu’ils le sentent rejeté, celui des Juifs qui sous la menace de l’antisémitisme croient trouver un refuge dans l’Etat d’Israël et essaient d’oublier que la France quoi qu’il en soit est leur pays.
Dans la suite des événements de janvier 2015, Gabriel est soumis à un rejet cruel et violent de la part des trois femmes qui exigent de lui une adhésion totale au comportement majoritaire de leur groupe d’appartenance. L’événement traumatisant a provoqué chez elles un repli communautaire que Gabriel refuse très fermement de partager. L’attitude des femmes s’avère passagère, de plus ou moins longue durée et suivie de regrets sincères. Mais dans les deux premiers cas, ceux-ci arrivent trop tard et l’union amoureuse qu’elles avaient avec Gabriel est définitivement brisée. Pour rejoindre le point de vue sociologique d’Adil Jazouli, on pourrait dire que les attentats terroristes de janvier 2015 ont déstabilisé gravement et durablement (bien que le sens de ce mot reste vague) les deux tiers de la société française —ce qui d’ailleurs était sans doute leur but. En pareil cas, on parle d’une onde de choc qui s’étend jusque dans les vies privées, domaine où la mise en forme romanesque est plus convaincante et touche un plus vaste public que le discours des sciences de l’homme. A cet égard, on pourrait dire qu’Adil Jazouli a gagné son pari et fait entendre clairement sa démonstration.
Denise Brahimi
« POUR DONNER LA MORT TAPEZ 1 » par Ahmed Diab, éditions de l’aube, 2018
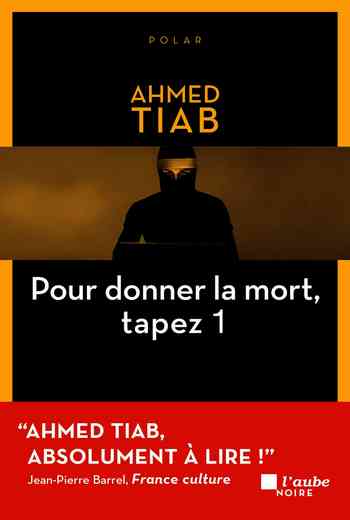 Ce livre est un roman policier, au sens plein du mot puisque le personnage principal est le commissaire Massonnier, Franck pour ses proches, dont fait partie son collègue et compagnon Lotfi. Ce couple de policiers homosexuels a fort à faire puisque aux prises avec les délinquants qui sévissent dans les quartier nord de Marseille et c’est d’ailleurs là que le livre commence, nous présentant un petit groupe de jeunes voyous qui ne trouvent rien de mieux que de se rallier à Daech, y compris à ses comportements les plus cruels et les plus répugnants, dont ils voient maint exemple complaisamment diffusé sur les réseaux sociaux. On les retrouvera dans la dernière partie du livre, après avoir fait longuement connaissance avec Franck et Lofti aux prises l’un et l’autre avec de lourds problèmes familiaux. Lotfi ne parvient pas à faire reconnaître son homosexualité par les siens, avec lesquels la rupture semble irrémédiable, Franck a divorcé d’avec sa femme, belle bourgeoise conventionnelle, pour vivre avec Lotfi, mais sa fille Maï ne lui pardonne pas ce choix et veut se venger de lui. Elle est droguée et s’est choisi pour amoureux un jeune Kurde marseillais qui ne songe qu’à l’exploiter au profit de sa cause, le nationalisme kurde, dont les adeptes comme lui ne reculent devant aucun moyen. Maï trahit son père pour complaire à son ami kurde, après quoi celui-ci et ses compagnons se débarrassent d’elle en la livrant aux émules de Daech sur lesquels ils peuvent compter pour accomplir les basses œuvres dans les plus ignobles conditions.
Ce livre est un roman policier, au sens plein du mot puisque le personnage principal est le commissaire Massonnier, Franck pour ses proches, dont fait partie son collègue et compagnon Lotfi. Ce couple de policiers homosexuels a fort à faire puisque aux prises avec les délinquants qui sévissent dans les quartier nord de Marseille et c’est d’ailleurs là que le livre commence, nous présentant un petit groupe de jeunes voyous qui ne trouvent rien de mieux que de se rallier à Daech, y compris à ses comportements les plus cruels et les plus répugnants, dont ils voient maint exemple complaisamment diffusé sur les réseaux sociaux. On les retrouvera dans la dernière partie du livre, après avoir fait longuement connaissance avec Franck et Lofti aux prises l’un et l’autre avec de lourds problèmes familiaux. Lotfi ne parvient pas à faire reconnaître son homosexualité par les siens, avec lesquels la rupture semble irrémédiable, Franck a divorcé d’avec sa femme, belle bourgeoise conventionnelle, pour vivre avec Lotfi, mais sa fille Maï ne lui pardonne pas ce choix et veut se venger de lui. Elle est droguée et s’est choisi pour amoureux un jeune Kurde marseillais qui ne songe qu’à l’exploiter au profit de sa cause, le nationalisme kurde, dont les adeptes comme lui ne reculent devant aucun moyen. Maï trahit son père pour complaire à son ami kurde, après quoi celui-ci et ses compagnons se débarrassent d’elle en la livrant aux émules de Daech sur lesquels ils peuvent compter pour accomplir les basses œuvres dans les plus ignobles conditions.
Comme on s’en doute la police finit par reprendre la situation en main et par éliminer les voyous de toute origine mais non sans dégât irréparable puisque Franck perd la vie dans l’opération, tandis que Lotfi survit mais en très piteux état. Maï qui a été récupérée in extremis semble elle aussi marquée et traumatisée d’une façon si grave qu’elle pourrait être irréversible.
Triste bilan comme on voit et les horreurs qui sont évoquées ne semblent que trop vraisemblables. On connaît bien ce genre de roman policier à base de trafic d’argent et de drogue, généralement comme c’est le cas ici « personnalisé » par des circonstances particulières concernant le policier le plus impliqué. Il y a sans doute sur le livre une grande influence des séries télévisées qui exploitent ces différents thèmes en de multiples variations. Ahmed Tiab, dit-on, conçoit ce livre comme le point de départ d’une série marseillaise (il a déjà à son actif une série oranaise) pour laquelle on voit bien qu’il a travaillé à se documenter. Son constat est assez accablant et par ailleurs correspond tout à fait à ce que les médias nous donnent régulièrement comme information. Avant de perdre la vie, le commissaire Massonnier était décidé à quitter Marseille. Le moins qu’on puisse dire est qu’on le comprend !
Denise Brahimi
Petit complément:
 Ce livre d’Ahmed Tiab démarre une série marseillaise qui prend la suite d’une trilogie oranaise. Kemal Fadil, le commissaire oranais cède la place au Commissaire Franck Massonnier, son collègue marseillais. Ils sont du reste amis et les livres précédents leur ont donné des occasions de se rencontrer. Kémal est lui aussi un commissaire peu banal, fruit des amours clandestines et extra conjugales de Léla et d’Ernesto Che Guevara ! (Le Français de Roseville, qui entremêle habilement un crime de 1962 et une enquête contemporaine).
Ce livre d’Ahmed Tiab démarre une série marseillaise qui prend la suite d’une trilogie oranaise. Kemal Fadil, le commissaire oranais cède la place au Commissaire Franck Massonnier, son collègue marseillais. Ils sont du reste amis et les livres précédents leur ont donné des occasions de se rencontrer. Kémal est lui aussi un commissaire peu banal, fruit des amours clandestines et extra conjugales de Léla et d’Ernesto Che Guevara ! (Le Français de Roseville, qui entremêle habilement un crime de 1962 et une enquête contemporaine).
Malheureusement nous n’aurons pas l’occasion de suivre le chemin de Franck qui trouve la mort dès le premier volume. Son adjoint-amant le beau Lotfi vaut à peine mieux, jeté dans le vide par des apprentis terroristes islamistes, et fracturé de toutes parts.
Il va falloir à Ahmed Tiab bien des ressources pour relancer les péripéties marseillaises. Nul doute qu’il saura faire de nouveau
le pont entre Oran et Marseille… Reconnaissons néanmoins que la nouvelle série part sur un très haut régime !
Et bravo aussi pour la qualité documentaire des pratiques des djihadistes amateurs.
Michel Wilson
» LA FAUTE A SADDAM « de Samira Sedira (Editions du Rouergue 2018)
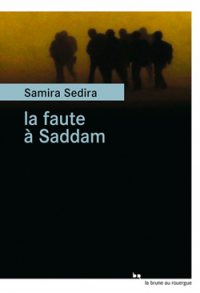 Ce roman est le troisième écrit par Samira Sedira. L’auteure est née à Annaba, a passé son enfance à La Seyne sur Mer. Elle mène une carrière de comédienne après s’être formée à l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne. En 2008 un courrier des ASSEDIC lui apprend qu’elle est en fin de droits. Plutôt que de dépendre du salaire de son mari, elle préfère travailler comme femme de ménage. Cette expérience la fait plonger dans son passé familial d’immigrée. Elle en tire un premier très beau roman, « L’odeur des planches » qui reçoit le prix Beur FM Méditerranée en 2014. Le directeur de la Comédie de Valence, le metteur en scène Richard Brunel, met en scène ce livre, qui l’a bouleversé. Elle refuse d’y jouer son rôle, qui est confié à Sandrine Bonnaire, très admirative de Samira, son œuvre et son parcours. La pièce obtient un grand succès. Samira est aujourd’hui de nouveau comédienne mais demeure romancière, avec « Majda en août » en 2016, qui relate la crise psychiatrique de Majda qui vient se réfugier chez ses parents immigrés.
Ce roman est le troisième écrit par Samira Sedira. L’auteure est née à Annaba, a passé son enfance à La Seyne sur Mer. Elle mène une carrière de comédienne après s’être formée à l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne. En 2008 un courrier des ASSEDIC lui apprend qu’elle est en fin de droits. Plutôt que de dépendre du salaire de son mari, elle préfère travailler comme femme de ménage. Cette expérience la fait plonger dans son passé familial d’immigrée. Elle en tire un premier très beau roman, « L’odeur des planches » qui reçoit le prix Beur FM Méditerranée en 2014. Le directeur de la Comédie de Valence, le metteur en scène Richard Brunel, met en scène ce livre, qui l’a bouleversé. Elle refuse d’y jouer son rôle, qui est confié à Sandrine Bonnaire, très admirative de Samira, son œuvre et son parcours. La pièce obtient un grand succès. Samira est aujourd’hui de nouveau comédienne mais demeure romancière, avec « Majda en août » en 2016, qui relate la crise psychiatrique de Majda qui vient se réfugier chez ses parents immigrés.
« La faute à Saddam » reprend le sujet de la place de l’immigré dans la société française, mais au masculin, cette fois. Adel rencontre Cesare à Toulon en même temps que la belle prostituée Violette. « Au 8 de la rue Micholet, il y avait Violette, que tout le monde connaissait parce qu’elle vendait son cœur pour pas cher, c’est ce qu’elle disait. Ce n’est pas mon cul que je vends, c’est mon cœur, je baise avec tendreté, moi !… ».
Tous les deux ont 8 ans et deviennent inséparables, le jeune fils d’italiens de Milan installés dans ce quartier près du port, et Adel, dont les parents viennent de quitter le bidonville de la Folie à Nanterre, pour la rue Trabuc, « la rue des Norafs », dans ce même quartier. « Avec ses cheveux aussi luisants qu’une coulée de pétrole, gominés et ramenés vers l’arrière, il avait l’air d’un gangster miniature… ».
La description de ce quartier populaire toulonnais qui a gardé tout son pittoresque dans ces années 80 est un joli morceau de littérature qui fait penser aux comédies italiennes de cette même période. Samira Sedira nous donne de vrais bonheurs d’écriture, que ce soit dans ces scènes de vie collective, que dans des moments d’introspection, ou la description des personnages. Le premier chapitre est tout particulièrement remarquablement ciselé.
Après une vie riche dans ce quartier bigarré, où les deux beaux garçons si complémentaires (« miscibles » dira un jour Adel) feront un joyeux apprentissage d’existence Adel décide de s’engager dans l’armée, et Cesare n’envisage pas de ne pas l’accompagner. Ils vont se retrouver dans un régiment de spahis, encalminé dans le désert du Koweit lors de la première guerre du Golfe. Et là, le joyeux Adel va se retrouver en butte au harcèlement de ses camarades, auquel ni Cesare ni lui ne sauront réagir. Adel ne trouvera pas d’autre issue que le suicide, et la découverte de son corps par ses camarades est l’objet du premier chapitre. La courte description de la fin de cette guerre rend encore plus absurde l’inutilité de cette mort…
Cesare ne se remet pas de la mort de son ami et de son incapacité à le secourir. Il traîne chez sa sœur aînée Gabrielle, à Paris, dans une dépression post traumatique qui n’en finit pas. Le courrier des parents d’Adel l’invitant à les rejoindre pour assister à la ré-inhumation de leur fils dans le carré musulman du cimetière toulonnais le fait sortir de sa léthargie et revoir les lieux de son enfance, qui ont perdu eux aussi une part de leur vie. Seule, Violette retirée du métier, et honorable épouse d’un professeur de mathématiques lui permet de retrouver la douce quiétude de ces temps passés.
leur fils dans le carré musulman du cimetière toulonnais le fait sortir de sa léthargie et revoir les lieux de son enfance, qui ont perdu eux aussi une part de leur vie. Seule, Violette retirée du métier, et honorable épouse d’un professeur de mathématiques lui permet de retrouver la douce quiétude de ces temps passés.
La scène de l’exhumation, la proximité qu’elle crée entre Cesare et le père d’Adel est dépeinte de façon bouleversante. « C’est la faute à Saddam », ce sont les mots que le vieil homme, dévoré de douleur trouve pour repousser entre eux les circonstances de la mort de son fils.
Dans ce troisième livre l’auteure nous fait entrer une nouvelle fois dans la difficile condition que rencontrent bien des immigrés, jamais complètement français même quand ils défendent au front les couleurs de leur pays… Les mots, les descriptions et les récits qu’elle assemble pour nous y donner accès sont justes et sensibles, au point de laisser dans l’esprit du lecteur une empreinte durable.
Michel Wilson
« L’ODEUR DU PAIN » de Nicole de Pontcharra (éditions Non Lieu 2018)
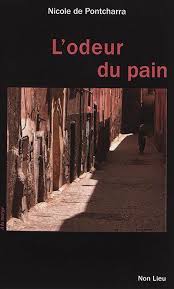 Dans ce livre aux personnages attachants, Nicole de Pontcharra illustre de multiples manières la notion d’entre deux. La savoureuse référence olfactive du titre est dès l’ouverture un voyage entre ici (Paris) et là-bas (Marrakech), entre hier et aujourd’hui, entre la vie et la mort. Laissée désemparée par la mort prématurée de sa mère Radia, psychothérapeute, qui avait consacrée sa vie à l’insertion réussie de femmes du Maghreb en France, Meriem se trouve face à un choix de vie. L’héritage de sa mère, pas seulement l’appartement de Belleville, mais surtout un sens et un contenu exigeants à donner à sa vie la conduisent à s’installer dans la maison de sa grand-mère, dans la médina de Marrakech, et d’y exercer le métier de sa mère, psychothérapeute. Elle devient la Toubiba pour une partie de ses patients, bien tolérée grâce au respect dont sa grand’mère est l’objet.
Dans ce livre aux personnages attachants, Nicole de Pontcharra illustre de multiples manières la notion d’entre deux. La savoureuse référence olfactive du titre est dès l’ouverture un voyage entre ici (Paris) et là-bas (Marrakech), entre hier et aujourd’hui, entre la vie et la mort. Laissée désemparée par la mort prématurée de sa mère Radia, psychothérapeute, qui avait consacrée sa vie à l’insertion réussie de femmes du Maghreb en France, Meriem se trouve face à un choix de vie. L’héritage de sa mère, pas seulement l’appartement de Belleville, mais surtout un sens et un contenu exigeants à donner à sa vie la conduisent à s’installer dans la maison de sa grand-mère, dans la médina de Marrakech, et d’y exercer le métier de sa mère, psychothérapeute. Elle devient la Toubiba pour une partie de ses patients, bien tolérée grâce au respect dont sa grand’mère est l’objet.
La priorité nous donne à penser l’auteure, n’est plus à accompagner l’insertion des femmes immigrées dans la société française et leur émancipation: le retour d’un certain traditionalisme d’inspiration religieuse déconcerte Meriem, certainement en cela la porte-parole de sa créatrice. Son rôle sera d’accompagner la transition marocaine entre tradition et modernité, réussite sociale des classes moyennes de Marrakech, qui ne va pas sans malaises divers, et ancrage dans la pauvreté d’une grande partie de la population. Cela se traduit par une ségrégation spatiale (la médina et le Gueliz), par le rejet progressif des quelques européens pensant pouvoir vivre en milieu populaire.
Au Maroc comme en France, Meriem est témoin de la pression de jeunes radicaux musulmans agissant pour un repli identitaire et communautaire.
Ce livre dont l’action se déroule entre la fin des années 90 et les années 2000 est  l’occasion pour Nicole de Pontcharra de poser un regard lucide sur l’évolution complexe de cette société musulmane en France et à Marrakech. Ce constat passe par les relations et les dialogues entre des personnages multiples à qui l’auteure donne une vie et une identité réelle qui accroche le lecteur.
l’occasion pour Nicole de Pontcharra de poser un regard lucide sur l’évolution complexe de cette société musulmane en France et à Marrakech. Ce constat passe par les relations et les dialogues entre des personnages multiples à qui l’auteure donne une vie et une identité réelle qui accroche le lecteur.
Radia la disparue, qui fait pour Meriem le pont entre ces divers entre deux qui la composent, peut-être inspirée de cette sociologue grenobloise à qui est dédié ce livre? Zakaria, ce géniteur éthiopien qu’elle va découvrir pour qu’il devienne progressivement son père. Au passage l’auteur de ces lignes a goûté comme de petites friandises familières l’évocation du chanteur éthiopien Mahmud Ahmed et son Ere Mela Mela, comme cette scène de l’inoubliable Stalker de Tarkovski… Farid, l’ami-amant si soutenant et respectueux, dont les lettres contribue à l’évolution du récit, tout au long du livre. François le Petit frère des Pauvres qui tente un temps de vivre sa vocation dans le Marrakech populaire. Yema la grand’mère aimante. Harry le l’anglais fou de Maroc qui vit dans une ancienne maison juive du mellah et qui renonce à son amour pour elle. Le jeune Abderrahmane qui défie les convenances en prenant ses distances avec sa famille bourgeoise pour choisir la vie avec Mona et le métier de garagiste. Le jeune Salah que Meriem aide à réussir son entrée dans la vie…
L’auteure donne vie à ce petit monde et à la ville de Marrakech dans toutes ses composantes. Nicole de Pontcharra excelle à nous faire voir, sentir, entendre cette ville qu’elle a bien connue et qu’elle aime, et dont elle nous fait découvrir les fastes anciens ou récents.
Et la Meriem qu’elle nous donne à connaître est une belle personne qu’on aimerait avoir pour amie. A qui l’on souhaite tout le bonheur du monde….
Michel Wilson

« UNE ARCHITECTURE DURABLE: LES 200 COLONNES DE FERNAND POUILLON », exposition organisée par Archipel Centre de Culture urbaine de Lyon, jusqu’au 2 septembre.
 On a pu voir cet été en plein centre de Lyon (Place des Terreaux) une exposition intéressante à plus d’un égard. En premier lieu parce qu’elle porte sur l’architecture, ce qui n’est pas si fréquent. En deuxième lieu parce que l’architecte dont il est question est ou plutôt a été une personnalité aussi fascinante que controversée, puisqu’il s’agit de Fernand Pouillon, mort en 1986 à Belcastel dans l’Aveyron où se trouve actuellement l’Association nommée « les Pierres sauvages », d’après le titre d’un de ses ouvrages (1964). En troisième lieu parce que l’exposition, qui comporte de nombreuses photos, un film documentaire et un long texte de présentation, se consacre à l’une des œuvres architecturales accomplies par Pouillon à Alger, le vaste ensemble de 5000 logements terminé en 1957 et connu sous le nom de « Climat de France ».
On a pu voir cet été en plein centre de Lyon (Place des Terreaux) une exposition intéressante à plus d’un égard. En premier lieu parce qu’elle porte sur l’architecture, ce qui n’est pas si fréquent. En deuxième lieu parce que l’architecte dont il est question est ou plutôt a été une personnalité aussi fascinante que controversée, puisqu’il s’agit de Fernand Pouillon, mort en 1986 à Belcastel dans l’Aveyron où se trouve actuellement l’Association nommée « les Pierres sauvages », d’après le titre d’un de ses ouvrages (1964). En troisième lieu parce que l’exposition, qui comporte de nombreuses photos, un film documentaire et un long texte de présentation, se consacre à l’une des œuvres architecturales accomplies par Pouillon à Alger, le vaste ensemble de 5000 logements terminé en 1957 et connu sous le nom de « Climat de France ».
A quoi il faut ajouter que non seulement l’architecte lui-même est comme on l’a dit une personnalité controversée (beaucoup mieux connu et reconnu de nos jours qu’il ne l’était de son vivant) mais que pour s’en tenir à « Climat de France », on peut aussi avoir à son sujet des commentaires et des jugements très différents. Ce qui demande quelques explications, faute de pouvoir reproduire les photos très « parlantes » qu’on peut voir dans l’exposition. Pour la clarté du débat—qui pourrait se résumer très sommairement à une question : cette réalisation a-t-elle été un échec ou un succès ?— il faut remonter à son origine, c’est-à-dire plus ou moins à la date de 1953-1954, moment où comme on sait, l’Algérie est très près de déclencher la guerre d’indépendance, et moment aussi où quelques-uns de ceux qu’on appelle les libéraux tentent d’éviter à toute force ce sanglant affrontement. Parmi les gens de ce dernier groupe, se trouve le Maire d’Alger, Jacques Chevallier, convaincu à juste titre que l’un des grands problèmes de la ville qu’il dirige est celui du logement : un nombre considérable d’Algériens parmi les catégories les plus pauvres habitent des bidonvilles où les conditions de vie sont si révoltantes qu’elles entretiennent un climat propice au soulèvement.
Jacques Chevallier fait alors venir Fernand Pouillon, qui a déjà construit deux cités à Alger, Diar el Mahçoul et Diar es Saadâ, dans des délais et pour un coût particulièrement restreints, qu’aucun autre architecte que lui n’aurait acceptés. Et les deux hommes se mettent d’accord sur un nouveau projet encore plus ambitieux : ce sera « Climat de France ». L’entreprise est clairement destinée à favoriser un rapprochement et une cohabitation entre Algériens et Français, ce qui après coup peut paraître idéaliste et voué à l’échec. Mais on comprend et on admire que des hommes aient voulu le tenter. La guerre comme on sait n’a pu être évitée ni même minimisée dans sa violence et dans ses effets, pour autant les tentatives des Libéraux et plus précisément la construction de Climat de France ne peuvent être jugées dans la seule considération de ce qu’allait être la suite des événements.
De toute façon, ceux-ci ne mettent pas en cause la qualité architecturale de Climat de France, cet énorme ensemble de HLM (5000 logements !) qui de nos jours encore provoque la sidération de ceux qui le découvrent pour la première fois. Les bâtiments composent un immense rectangle fait de barres remplies d’habitations, d’autant plus nombreuses qu’elles sont de très petite taille conformément aux normes de l’époque pour cette catégorie défavorisée.
Mais les barres, qu’on les voie de l’intérieur du rectangle ou plus souvent de l’extérieur sont allégées et diversifiées par les fenêtres et toute sorte d’ouvertures qui produisent un effet intéressant de noir sur blanc. Et surtout, toute la partie basse des bâtiments est  constituée de colonnes rectangulaires ressemblant à des pilastres mais non encastrés dans un mur. Ce sont elles qui ont valu à l’espace central du rectangle le nom de « Place des 200 colonnes ». Elles ressortent particulièrement bien sur les photos, suggérant des monuments à portique de l’Antiquité égyptienne ou gréco-romaine et donnant à l‘ensemble une sorte de classicisme prestigieux.
constituée de colonnes rectangulaires ressemblant à des pilastres mais non encastrés dans un mur. Ce sont elles qui ont valu à l’espace central du rectangle le nom de « Place des 200 colonnes ». Elles ressortent particulièrement bien sur les photos, suggérant des monuments à portique de l’Antiquité égyptienne ou gréco-romaine et donnant à l‘ensemble une sorte de classicisme prestigieux.
Prestigieux dira-t-on, Climat de France l’a sans doute été au moment de sa construction ou peu après. Mais comment employer un tel mot pour parler des bâtiments extrêmement dégradés que l’on peut voir aujourd’hui et qui manifestement n’ont bénéficié depuis des décennies d’aucun entretien d’aucune sorte : aucune réparation des bâtiments, bricolage anarchique rappelant les bidonvilles auxquels ces 5000 logements étaient pourtant destinés à se substituer, et surtout surcharge d’occupation si énorme qu’aucun fonctionnement « normal » ne pourrait y résister. Les plus récents témoignages journalistiques ne peuvent manquer d’évoquer cet état des lieux. Il est vrai que pour qui ne connaitrait pas les quartiers populaires d’une ville méditerranéenne et/ou orientale, le spectacle peut paraître effarant.
Cependant et à l ‘inverse il est difficil e de ne pas ressentir la vitalité des gens qu’on voit évoluer entre les 200 colonnes, les jeunes garçons surtout qui semblent exploser sous la pression des forces qu’ils portent en eux. Quitte à reprendre des expressions un peu datées, on a envie de dire que le peuple a pris possession de ces lieux et qu’il y est chez lui. N’était-ce pas, pour une bonne part, le projet de Jacques Chevallier et de Fernand Pouillon ?
e de ne pas ressentir la vitalité des gens qu’on voit évoluer entre les 200 colonnes, les jeunes garçons surtout qui semblent exploser sous la pression des forces qu’ils portent en eux. Quitte à reprendre des expressions un peu datées, on a envie de dire que le peuple a pris possession de ces lieux et qu’il y est chez lui. N’était-ce pas, pour une bonne part, le projet de Jacques Chevallier et de Fernand Pouillon ?
On sait à quel point sont discutables les paroles d’une célèbre chanson de Charles Aznavour :
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. A chacun son avis là-dessus. En tout cas, soleil ou pas, les habitants de Climat de France ne sont pas tristes, et s’ils sont victimes, ce n’est pas de l’architecture léguée par Fernand Pouillon.
Denise Brahimi

- Projections du Film Tazzeka, en présence de Jean-Philippe GAUD réalisateur:
- Mercredi 12/09 Ciné Mourguet Sainte foy les Lyon
- Jeudi 13/09 Cinéma Le Club à Grenoble
- Vendredi 14/09 Cinéma Les Alizées à Bron
- Samedi 15/09 Ciné Duchère à Lyon
- Dimanche 16 septembre Cinéma Paradiso à Saint Martin d’en Haut
- Mercredi 19/09 Cinéma Le Rio à Clermont-Ferrand
- vendredi 21/09 Film « Eternelles Migrations » de André Zech Maison des Association Lyon 4ème

