Lettre Culturelle franco-maghrébine #28
ÉDITO
Notre livraison de ce mois fait la part belle à l’histoire, qui inspire plusieurs des livres évoqués dans cette lettre. Une Histoire où le tragique prend une grande place, même si certains des auteurs savent aussi en rire.
Une nouvelle rubrique est inaugurée dans ce numéro 28: « A lire également » vous présentera des ouvrages dont nous avons eu connaissance, dont la part « maghrébine » est trop partielle, et qui n’entrent donc pas complètement dans notre propos. Mais nous avons voulu tout de même les porter à votre connaissance, sous forme de courtes présentations.
2018 se termine, et nous vous souhaitons de vivre de belles et heureuses fêtes de fin d’année. Et nous espérons vous retrouver encore plus nombreux et curieux de découvrir toujours plus d’œuvres culturelles maghrébines.
Michel Wilson

« DEBÂCLE », roman de Mohamed Sadoun , Alger, éditions Casbah, 2017
Ce roman vient d’obtenir le Prix Mohammed Dib, décerné tous les deux ans à Tlemcen en Algérie. Et il le méritait bien !
 Le livre est de belle taille—430 pages— ce qui n’est pas très fréquent dans la production maghrébine. Mais le lecteur ne songe pas à s’en plaindre, tant il est pris au fil de l’histoire qu’on lui raconte et qui retient autant par ses qualités intellectuelles que par son aptitude à faire vivre des personnages romanesques. Faut-il dire qu’il s’agit d’un roman historique (et dans ce cas mettre un H majuscule à Histoire) ? Oui en ce sens que tous les événements dont il est question sont datés et avérés ; cependant le but du roman n’est pas de les raconter et son génie le plus évident n’est pas l’art de la narration descriptive ou pittoresque, certainement pas non plus le récit de bataille ni même l’invention de dialogues entre les personnages dont une bonne part sont historiques et portent des noms connus, parfois même très connus par tous ceux qui s’intéressent à la colonisation de l’Algérie et à l’entrée du Maroc dans le régime du Protectorat.
Le livre est de belle taille—430 pages— ce qui n’est pas très fréquent dans la production maghrébine. Mais le lecteur ne songe pas à s’en plaindre, tant il est pris au fil de l’histoire qu’on lui raconte et qui retient autant par ses qualités intellectuelles que par son aptitude à faire vivre des personnages romanesques. Faut-il dire qu’il s’agit d’un roman historique (et dans ce cas mettre un H majuscule à Histoire) ? Oui en ce sens que tous les événements dont il est question sont datés et avérés ; cependant le but du roman n’est pas de les raconter et son génie le plus évident n’est pas l’art de la narration descriptive ou pittoresque, certainement pas non plus le récit de bataille ni même l’invention de dialogues entre les personnages dont une bonne part sont historiques et portent des noms connus, parfois même très connus par tous ceux qui s’intéressent à la colonisation de l’Algérie et à l’entrée du Maroc dans le régime du Protectorat.
Car s’il est bien vrai que ce gros roman nous conduit, étape par étape, de 1831 jusqu’au début du 20e siècle, le fil choisi par l’auteur pour nous accrocher (passionnément) à cette histoire est celui qu’indique clairement le titre du livre : débâcle. Il s’agit de nous faire assister, à travers un enchaînement pitoyable et poignant, au démembrement jusqu’à sa complète disparition d’une des tribus qui composaient l’essentiel de l’Algérie avant 1830. Elles vivaient d’élevage, sur leurs propres terres, selon les coutumes et les rituels du monde rural traditionnel, n’étant certes pas à l’abri de catastrophes diverses, d’origine naturelle ou humaine mais elles avaient l’habitude d’y faire face et de s’en relever. Tandis qu’avec l’arrivée des Français et du système colonial qui les chasse de leurs terres et les oblige à les vendre, la société tribale se trouve confrontée avec le monde capitaliste dont elle ignore tout et qui la broie inéluctablement.
Le dire en ces termes pourrait sembler une reprise de ce qui a déjà été analysé par nombre d’historiens. Mais toute la différence vient de l’aptitude de Mohamed Sadoun à donner chair, très concrètement, à ces différentes formes de décomposition de la tribu incarnées par trois ou quatre générations de personnages, hommes et femmes aussi bien. Le livre est certainement inspiré par ce qu’on pourrait appeler une conscience féministe, c’est-à-dire par une perception aiguë des injustices dont souffraient les femmes dans la société traditionnelle mais l’arrivée du nouveau monde nourri de pensée et de principes occidentaux ne peut y apporter remède que très exceptionnellement, et de toute façon, dans ce domaine comme dans d’autres, s’il y a « progrès » ou illusion de progrès, ce ne peut être qu’au prix d’un total reniement de soi. Pour une jeune femme par exemple, gravement menacée de ne pouvoir survivre qu’en se prostituant, cela consiste à faire disparaître son nom arabe au profit d’un nom espagnol, occultant complétement son origine arabe. Cependant ce reniement est loin d’être suffisant pour sauver tous les membres de la tribu de la folie et de la mort ; sauf pour certains d’entre eux (mais pendant une période limitée, soumise aux aléas du sort) il n’empêche pas la misère, l’humiliation que l’alcoolisme cherche en vain à faire oublier et aggrave au contraire ; et finalement il devient absolument clair que le mode de vie tribal n’a aucune chance de survivre. C’est exactement la définition du tragique : que des hommes se trouvent pris, et de plus lucidement pour nombre d’entre eux, dans une situation sans issue, n’offrant de choix pour aucune solution acceptable. Ils vivent désormais dans un monde où ils ont impérativement besoin d’argent liquide, puisque la tribu ne les nourrit plus, mais les quelques moyens misérables à leur disposition ne leur permettent de gagner que des sommes infimes, et leurs métiers de bonnes à tout faire ou de livreurs de pain sont à l’opposé de ce que l’honneur tribal permettait auparavant. Pour obtenir des sommes de quelque importance, il n’y a qu’une seule solution, qui est de vendre les terres mais ces sommes trop vite dépensées (et ils n’ont évidemment pas la moindre idée de ce que serait un investissement) les conduisent rapidement à la clochardisation : mendicité ou travail servile de bas niveau, on retrouve la situation précédente.
Le roman de Mohamed Sadoun n’exhibe pas les analyses théoriques sur lesquelles il repose, mais il rend absolument convaincantes les conclusions dramatiques auxquelles il aboutit. Cette vision d’une déchéance inéluctable s’établit au niveau de ceux qui la subissent et qui sont les personnages non historiques du roman. Les autres, ceux qui font l’histoire, sont montrés à leur niveau, qui est celui de la politique internationale. L’inégalité entre les supposés partenaires n’y est pas moins évidente et tragique, on voit par exemple dans quel réseau se trouve pris le Sultan du Maroc, jouet entre les mains des représentants des « grandes » nations dont l’habileté est parfois diabolique et dont les succès, y compris militaires, sont irréversibles. La force est tout entière d’un même côté, et la notion d’un équilibre mondial est totalement absente de ce monde vu globalement par ceux qui le dirigent.
 Mohamed Sadoun, dans sa réflexion sur l’histoire, fait une place intéressante à ce qui aurait pu jouer un rôle important en faveur du monde arabe, ou /et ottoman, ou /et maghrébin. Il s’agit des tentatives de réformes qui en effet ont été nombreuses au cours du 19e siècle et souvent menées par des ministres intelligents, cherchant à tirer les leçons du modèle occidental comme nous dirions aujourd’hui. Ils se sont malheureusement heurtés à l’immobilisme voire à l’esprit réactionnaire de traditionnalistes plus nombreux et plus puissants qu’eux. Et c’est ainsi qu’ils n’ont pu sauver des pays voués à subir le protectorat, comme la Tunisie, ou à disparaître en tant que tel, comme l’empire ottoman. Mohamed Sadoun n’exempte nullement l’Algérie tribale des tares qui l’ont perdue. Son livre raconte un enchaînement d’événements absolument pathétique mais il le fait sans pathos ni partialité. Il sait tenir à distance une histoire dans laquelle il s’implique complétement, ce paradoxe était un défi qu’il relève dans ce grand et beau roman.
Mohamed Sadoun, dans sa réflexion sur l’histoire, fait une place intéressante à ce qui aurait pu jouer un rôle important en faveur du monde arabe, ou /et ottoman, ou /et maghrébin. Il s’agit des tentatives de réformes qui en effet ont été nombreuses au cours du 19e siècle et souvent menées par des ministres intelligents, cherchant à tirer les leçons du modèle occidental comme nous dirions aujourd’hui. Ils se sont malheureusement heurtés à l’immobilisme voire à l’esprit réactionnaire de traditionnalistes plus nombreux et plus puissants qu’eux. Et c’est ainsi qu’ils n’ont pu sauver des pays voués à subir le protectorat, comme la Tunisie, ou à disparaître en tant que tel, comme l’empire ottoman. Mohamed Sadoun n’exempte nullement l’Algérie tribale des tares qui l’ont perdue. Son livre raconte un enchaînement d’événements absolument pathétique mais il le fait sans pathos ni partialité. Il sait tenir à distance une histoire dans laquelle il s’implique complétement, ce paradoxe était un défi qu’il relève dans ce grand et beau roman.
Denise Brahimi
« MAGMA TUNIS » de Aymen Gharbi (éditions Asphalte, 2018)
C’est un premier roman, mais pour autant, ce n’est pas le livre d’un très jeune homme puisque son auteur né en Tunisie en 1981, aura bientôt la quarantaine. Il a donc eu le temps de mûrir des réflexions nées pendant ses études littéraires sur l’art de raconter une histoire, et la façon dont il s’y prend dans Magma Tunis est sans doute bien moins naïve, spontanée ou fofolle que les apparences ne pourraient le faire croire.
 En tout cas elle est efficace et inventive, et le lecteur, qui a d’abord le sentiment d’un récit désordonné, laissant place à l’inexpliqué sinon à l’inexplicable (on n’est pas vraiment dans le fantastique et le but n’est pas de nous faire peur !), est guidé d’une main assez ferme pour que tous les fils narratifs se rejoignent en faisceau et pour que les épisodes d’abord dispersés se rejoignent en une seule histoire. Dire que cette dernière est tout à fait vraisemblable serait exagéré, mais d’une part il s’y mêle beaucoup de notations réalistes, notamment sur la ville de Tunis, et d’autre part il s’en dégage un tableau d’ensemble de la situation tunisienne ou en tout cas tunisoise sept ans après le fameux printemps arabe (le premier avant les autres) qui a attiré l’attention du monde sur cette ville.
En tout cas elle est efficace et inventive, et le lecteur, qui a d’abord le sentiment d’un récit désordonné, laissant place à l’inexpliqué sinon à l’inexplicable (on n’est pas vraiment dans le fantastique et le but n’est pas de nous faire peur !), est guidé d’une main assez ferme pour que tous les fils narratifs se rejoignent en faisceau et pour que les épisodes d’abord dispersés se rejoignent en une seule histoire. Dire que cette dernière est tout à fait vraisemblable serait exagéré, mais d’une part il s’y mêle beaucoup de notations réalistes, notamment sur la ville de Tunis, et d’autre part il s’en dégage un tableau d’ensemble de la situation tunisienne ou en tout cas tunisoise sept ans après le fameux printemps arabe (le premier avant les autres) qui a attiré l’attention du monde sur cette ville.
Les médias étant ce qu’ils sont, il est évident que ce printemps-là nous a valu un flot considérable d’informations, globalement débordantes d’enthousiasme en tout cas dans la perspective occidentale, démocratique et laïque qui a vu ces événements comme la promesse d’une évolution très positive, forcément positive, de la Tunisie. Les choses ne seraient pas faciles, on s’en doutait bien, et en effet elles ne l’ont pas été, elles continuent à ne pas l’être. Mais le discours est globalement resté le même qu’aux premiers jours de la Révolution (dite de jasmin), et on peut parler d’un discours politiquement correct, au sens bien intentionné mais aussi intransigeant que désigne cette expression, ce qui veut dire globalement qu’on ne saurait se permettre la moindre critique sur l’état actuel de la Tunisie et sur son gouvernement qui résiste si vaillamment à la menace terroriste.
On a certes bien raison d’être admiratif sur ce qui s’est passé en Tunisie au début de l’année 2011. Cependant il est clair que le but d’Aymen Gharbi n’est pas d’entonner à son tour ce même refrain à la gloire d’une partie au moins de ses concitoyens. De la Révolution il ne parle pas, mais seulement de l’état des lieux sept ans plus tard. Et pour reprendre une expression familière le résultat n’est pas triste, ce qui veut dire qu’on y fait des découvertes stupéfiantes mais aussi, en prenant les mots au pied de la lettre, que l’écrivain choisit d’en parler sur un mode drolatique et se refuse à la dramatisation.
Le personnage principal, Gaylène, porte un nom qui renvoie assez clairement à celui de l’auteur lui-même. Mais le but de ce dernier n’est manifestement pas d’écrire un récit autobiographique, ni de coller à quelque vérité que ce soit. Un procédé habile pour justifier que le récit soit inconsistant et déjanté consiste à montrer Gaylène comme adonné au cannabis, sauf lorsque les circonstances l’empêchent d’en consommer mais alors c’est le manque qui l’amène à disjoncter et à patauger dans une vision très confuse de la réalité ! Gaylène se prend pour un héros tragique qui a laissé mourir sa compagne (après l’avoir séquestrée) et a décidé de se suicider, mais finalement rien de tout cela n’est vrai, la compagne galope allégrement dans les rues de Tunis avec son véritable amoureux et lui-même oublie assez vite son projet de suicide pour se laisser flotter au gré d’aventures qui constituent ce qu’on pourrait appeler l’intrigue du livre—bien que ce terme implique une cohérence que les événements racontés n’ont pas. Ils reposent sur l’invention extravagante d’une personne qui est la fois la plus volontaire (donc la plus organisée) et la plus folle du livre, une militante supposée révolutionnaire et en tout cas fort exaltée qui croit à la vertu du happening pour exprimer ses opinions et y fait participer les autres qu’ils le veuillent ou non. Gaylène et son amie et l’ami de son amie se trouvent ainsi embarqués—c‘est presque le mot puisque ils montent à bord d’hélicoptères longuement bricolés sur le toit d’un immeuble et avec lesquels, de manière fort improbable, ils arrivent à survoler la ville de Tunis ! La police est trop heureuse de croire et de faire croire que ces farfelus sont de dangereux terroristes.
 Aymen Gharbi veut sans doute dénoncer là une espèce d’obsession, aveugle et dérisoire, de ceux qui finalement, faute de mieux sans doute, exercent le pouvoir à Tunis. En tout cas, l’état de la ville telle qu’il la décrit, ne peut manquer d’être le signe de leur incompétence : saleté généralisée, immondices partout, rats et chats se partageant l’espace public de manière menaçante pour les habitants, immeubles lamentablement délabrés faute d’entretien etc. Si on tente d’évaluer ce qui reste de la révolution, ou de l’idée de révolution, en plus du mépris qu’expriment à son égard nombre de braves gens excédés, on peut trouver dans l’épisode des hélicoptères une preuve de ce que disait Marx dans Le dix-huit brumaire de L.Bonaparte, à savoir que « tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce ».
Aymen Gharbi veut sans doute dénoncer là une espèce d’obsession, aveugle et dérisoire, de ceux qui finalement, faute de mieux sans doute, exercent le pouvoir à Tunis. En tout cas, l’état de la ville telle qu’il la décrit, ne peut manquer d’être le signe de leur incompétence : saleté généralisée, immondices partout, rats et chats se partageant l’espace public de manière menaçante pour les habitants, immeubles lamentablement délabrés faute d’entretien etc. Si on tente d’évaluer ce qui reste de la révolution, ou de l’idée de révolution, en plus du mépris qu’expriment à son égard nombre de braves gens excédés, on peut trouver dans l’épisode des hélicoptères une preuve de ce que disait Marx dans Le dix-huit brumaire de L.Bonaparte, à savoir que « tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce ».
Cependant, il serait incomplet de ne pas voir dans Magma Tunis quelques références à une sorte de sagesse populaire propre aux Tunisiens, célébrée de longue date et sans doute encore et toujours efficace pour les aider à surnager. Il n’est même pas exclu que les nouveaux aspects pris par cette ville trouvent des amateurs dont il y a un exemple dans le livre (l’ami de l’amie). Reste que globalement on ne peut espérer qu’Aymen Gharbi suscite un afflux de touristes dans son pays. Quoique…
Denise Brahimi
« LA GUERRE D’ALGERIE N’A PAS EU LIEU » de Michel Cornaton (l’Harmattan, collection Le Croquant 2018)
Le titre intrigant de ce gros livre signé par un auteur et universitaire que nous connaissons bien, en particulier à Lyon, joue notamment sur le déni de guerre qui a longtemps entouré ce conflit, et adresse un paradoxal clin d’œil à Jean Giraudoux, qui n’est pas la plus solide caution politique.
 Ce livre jalonne avec minutie une grande partie d’un parcours de vie (il nous manque les dernières 40 années d’une existence faite d’engagement, d’action et de riche réflexion ; espérons que sous une forme ou une autre, l’auteur pourra nous en faire un jour le cadeau !). Si bien que la part algérienne proprement dite du livre ne représente que la moitié de ses 447 pages.
Ce livre jalonne avec minutie une grande partie d’un parcours de vie (il nous manque les dernières 40 années d’une existence faite d’engagement, d’action et de riche réflexion ; espérons que sous une forme ou une autre, l’auteur pourra nous en faire un jour le cadeau !). Si bien que la part algérienne proprement dite du livre ne représente que la moitié de ses 447 pages.
Notre lecture attentive de l’ouvrage se centrera sur cette partie algérienne, non que l’avant et l’après Algérie ne soit passionnante, ni complètement détachée du temps de vie intense que Lacombe/Cornaton y a consacré, mais c’est la règle que cette lettre s’est donnée, nous ne nous consacrons essentiellement qu’à des sujets culturels franco-maghrébins.
Ce livre-chronique et ce livre de souvenirs, si on s’en tient aux citations de Walter Benjamin et de Charles Péguy que l’auteur place en exergue parle d’un personnage, Michel Lacombe qui est évidemment un double de l’auteur. Interrogé sur ce choix, Michel Cornaton fournit plusieurs pistes : un jeune Lacombe a compté dans sa vie au petit séminaire, la référence à Lacombe Lucien de Louis Malle lui a traversé l’esprit, le nom aurait pu être Colombe ou Latombe… C’est pour le lecteur une façon pour cette autobiographie de ne pas l’être tout à fait, comme une mise à distance pas toujours indulgente sur un chemin d’existence. Et cette évocation d’un relief jurassien, de belles vallées assez douces, réceptacles des ruissellements, s’harmonise assez du point de vue de l’auteur de ces lignes avec l’itinéraire de ce Bressan, gourmand de capter les connaissances qui convergent vers lui. Mais ce serait une combe en action, en marche, qui va au-devant de ces connaissances et de leur diffusion.
Ce qui frappe également le lecteur, c’est l’hypermnésie dont fait preuve Michel Cornaton, qui ne pratique pourtant presque jamais le journal de bord. Les noms, les lieux, le physique des personnes rencontrées, les circonstances, sont décrits avec une certaine minutie qui met le lecteur en relation concrète avec ce qui est décrit, au risque, par moments de devoir relire avec attention des passages dont la mémorisation ne se fait pas au premier regard. Et pourtant cette profusion de faits, de détails, certaines digressions entrent dans le charme de ce livre, pour peu qu’on prenne le temps de poser nos objets électroniques qui nous sollicitent par flashes vite oubliés, et de cheminer au pas montagnard de l’auteur.
L’Algérie, c’est d’abord le temps d’armée, en 1959, passé comme caporal-chef des chasseurs alpins, séminariste, dans diverses fonctions à Fort National où il ne put qu’apercevoir Mouloud Feraoun. Il s’était efforcé de prolonger son temps de service à Bourg Saint Maurice pour retarder le départ en Algérie. Elle était pourtant déjà présente, avec les détestables pratiques militaires, qu’il constate lors d’un passage au Fort d’Aiton, dans la Maurienne où des prisonniers maghrébins emprisonnés là sans que personne sache pourquoi ni comment, font l’objet de sévices sadiques de la part de leurs geôliers appelés. Premier contact avec cette sale « guerre sans nom ».
« La guerre d’Indochine avait été abandonnée à l’Armée, aux militaires de carrière et aux mercenaires. Sous la pression d’une minorité de gros colons, la nation faisait appel cette fois au contingent en décrétant que ce n’était pas une guerre… Comme elle ne l’avait jamais fait au cours de son histoire, la France prenait le parti de groupes d’intérêts particuliers, au détriment de sa jeunesse, qu’elle envoyait au casse-pipe en toute bonne conscience ».
Son « statut » de séminariste lui vaut d’être affecté à des fonctions d’état-major, ce qui n’empêche pas quelques sorties dans le cadre de « l’Opération Jumelles », lancée par Challe. Il crée avec plusieurs camarades un journal, Lambic, où ils évoqueront l’œuvre de Camus, peu après avoir appris sa mort. Dans une démarche qui préfigure le sociologue qu’il deviendra ensuite, il a des entretiens avec certains camarades dont le profil l’intéresse comme ces maîtres-chiens voués à de sales besognes lors des opérations et des interrogatoires. L’un deux lui raconte avoir été témoin d’une scène de torture particulièrement abominable sur une femme, dans la région de Tigzirt, et de multiples scènes de violences ou de viols lors des opérations auxquelles leur statut leur vaut d’être systématiquement associés. Tel soldat qui les a enchantés la veille au son de sa guitare se révèle le lendemain sous un tout autre jour en égorgeant en public un prisonnier pour faire parler ses compagnons…
Son expérience est aussi faite de belles rencontres, un officier qui lui fait lire La Chute, de Camus. Camus avec qui il partagera le goût des bains en Méditerranée, découverts à Sidi Ferruch. Plus tard, venant louer des skis chez le loueur de matériel des Saisies, René Piccard, celui-ci lui racontera qu’ayant accompagné un médecin dans une tournée dans le Djurdjura, ils aideront une femme à accoucher d’une petite Leila, prénom que René promettra de donner à sa fille. Leila Piccard, comme son frère Franck deviendront bien plus tard deux beaux fleurons de l’équipe de France de ski…
Il mettra à profit son séjour pour entrer en relation avec les « indigènes » du café maure de Fort National qu’il est le seul Européen à fréquenter, et plus tard à des internés dont il est chargé d’établir les fiches, et à qui il témoigne de la sympathie. Cela lui vaudra, comme certains des articles de son journal, quelques craintes à la veille de son retour en France.
L’Algérie ce sera ensuite cette impressionnante enquête aux lendemains de l’indépendance, dans les camps de regroupement, pour une thèse qui fera date dans la connaissance historique et sociologique de ces 2,5 millions d’Algériens déplacés, sans compter tous les « resserrés, regroupés, recasés » selon sa classification, avec les impacts multiples dénoncés quelques années auparavant par le rapport Rocard.
Cette recherche de thèse dans les toutes premières années de l’Algérie indépendante, dans sa 2CV avec son épouse est une aventure extraordinaire, sur un sujet que les officiels auraient préféré ignorer : bon nombre de ces camps en effet resteront le seul lieu d’habitat pour de très nombreux Algériens, faute pour le nouveau pouvoir de moyens et de conscience pour les sortir de cette assignation à résidence.
 Académiquement il lui faudra passer outre l’implacable hostilité à ce projet de Pierre Bourdieu, qu’il rencontre à Paris au Centre de Sociologie européenne fondé par Raymond Aron. « Quel intérêt de faire une thèse de sociologie sur quelque chose de dépassé ?… Comment pouvez-vous aller contre l’intérêt d’un pays qui a conquis chèrement son indépendance ? Rien ne vous autorise à créer des difficultés à l’Algérie, qui en a déjà bien assez, et qu’il faut aider à préserver son unité ? ». Ce verdict sans appel et la menace qu’il fait peser sur sa recherche manque de l’assommer, mais ne le fait pas reculer.
Académiquement il lui faudra passer outre l’implacable hostilité à ce projet de Pierre Bourdieu, qu’il rencontre à Paris au Centre de Sociologie européenne fondé par Raymond Aron. « Quel intérêt de faire une thèse de sociologie sur quelque chose de dépassé ?… Comment pouvez-vous aller contre l’intérêt d’un pays qui a conquis chèrement son indépendance ? Rien ne vous autorise à créer des difficultés à l’Algérie, qui en a déjà bien assez, et qu’il faut aider à préserver son unité ? ». Ce verdict sans appel et la menace qu’il fait peser sur sa recherche manque de l’assommer, mais ne le fait pas reculer.
Il parviendra notamment, avec l’amicale complicité d’un coopérant à Alger à extraire de façon rocambolesque des bureaux d’Alger et rapporter en France la cartographie des camps de regroupement élaborée en 1964, une inestimable référence, aujourd’hui encore.
Il lui restera ensuite à soutenir cette thèse, ce qui ne sera pas sans difficultés, cette première thèse sur la Guerre d’Algérie niée et passée sous silence, ne trouvant pas beaucoup de faveur dans l’Université française. Grâce au soutien et aux encouragements de personnes comme la géographe Renée Rochefort, il la fera publier à 4000 exemplaires sous le titre « Les regroupements de la décolonisation en Algérie ». Il sera réédité sous le nom « Les camps de regroupement de la Guerre d’Algérie », et a fait l’objet d’une édition algérienne. Belle victoire sur Bourdieu, même s’il découvre dans un écrit tardif que le maître s’est attribué la prescience de la survie de ces camps longtemps avant l’indépendance, alors que ses écrits de 1960 disent l’inverse…
Le livre ne manque pas, sur ce sujet comme sur d’autres liés à sa carrière universitaire, de mettre en lumière les contradictions et les petitesses bien peu académiques de personnes qui devraient être des références intellectuelles.
Cette exigence éthique, cet humble courage d’aller au bout de cette exigence sont des caractères fondamentaux qu’on retient de ce Michel Lacombe, double de cet intellectuel-acteur qu’est Michel Cornaton.
Une variété d’humain pas si fréquente…
Michel Wilson
« GHANDI AVAIT RAISON » de Rabâa ben Achour-Abdelkéfi ,(Sud éditions, Tunisie, 2016)
Amina, qu’on est en droit de considérer comme le personnage principal du roman, assiste à la chute de Ben Ali dans l’épilogue du livre, alors qu’elle a, dit-elle, soixante-et-un ans. C’est un des moyens possibles pour situer dans le temps l’action de ce roman qui (mis à part l’épilogue nettement plus tardif) s’étend sur deux générations : celle des jeunes Tunisiens, Ahmed (futur père d’Amina) le Musulman et Marcel le Juif, sans doute un peu plus âgé, qui font connaissance au début de la seconde guerre mondiale ; et celle de leurs enfants, Amina et aussi Mokhtar, le garçon dont elle est amoureuse, qui traversent très douloureusement les événements de 1968, année où la contestation du régime de Bourguiba par les étudiants a été réprimée avec une grande violence. De ce fait, l’action du livre se passe à peu près entièrement lorsque la Tunisie est sous la tutelle de Bourguiba, et il dénonce principalement les agissements de la police lorsque celui-ci est au pouvoir, un pouvoir qui a gravement dégénéré jusqu’à employer sans vergogne la torture contre les opposants.
 On peut donc considérer que la préoccupation du livre est politique, ce qui n’a rien d’étonnant puisque c’est justement un des domaines que recouvre l’écriture de son auteure, bien qu’elle soit également essayiste et romancière comme on peut le voir ici. Cependant la dénonciation qu’il contient ne porte pas seulement sur la torture pratiquée par la police d’Etat, elle porte aussi sur les relations familiales en Tunisie, en tout cas depuis l’indépendance, et l’on a plusieurs fois l’impression qu’on est très proche du célèbre « Familles, je vous hais » d’André Gide. Les parents d’Amina ont fait un mariage arrangé, qu’ils ont accepté sans protestation, mais les résultats ont été très mauvais pour chacun des deux et aussi pour leurs enfants qui en subissent le contrecoup.
On peut donc considérer que la préoccupation du livre est politique, ce qui n’a rien d’étonnant puisque c’est justement un des domaines que recouvre l’écriture de son auteure, bien qu’elle soit également essayiste et romancière comme on peut le voir ici. Cependant la dénonciation qu’il contient ne porte pas seulement sur la torture pratiquée par la police d’Etat, elle porte aussi sur les relations familiales en Tunisie, en tout cas depuis l’indépendance, et l’on a plusieurs fois l’impression qu’on est très proche du célèbre « Familles, je vous hais » d’André Gide. Les parents d’Amina ont fait un mariage arrangé, qu’ils ont accepté sans protestation, mais les résultats ont été très mauvais pour chacun des deux et aussi pour leurs enfants qui en subissent le contrecoup.
Dans la famille de Mokhtar, les choses ne se sont pas mieux passées, et comme ce malheureux garçon cumule les deux types de méfaits, politiques et sociologiques, la romancière n’hésite pas à montrer en lui l’exemple d’une vie que cette conjonction a complétement brisée. Amina, parce qu’elle a une aptitude remarquable à se révolter, finit en revanche par s’en sortir, non sans devoir quitter la Tunisie où elle reviendra peut-être (ce que laisse entendre l’épilogue du roman) grâce aux événements de 2011, l’année du fameux printemps.
Ce sont donc environ soixante-dix ans de vie tunisienne qui se trouvent évoqués dans ce roman et la tonalité générale de ce parcours ou de ce bilan est très critique, comme si le pays n’avait fait que perdre peu à peu l’élan et l’enthousiasme de la période où il s’acheminait vers l’indépendance, notamment grâce à l’action menée par de très valeureux militants communistes et anti-fascistes. A travers le personnage de Marcel, la romancière insiste sur la participation des Juifs tunisiens au combat démocratique mais elle montre aussi les graves difficultés qu’ils éprouvent ensuite à rester dans le pays. Pour ce qui est de l’amour et du couple, il est plus difficile de détecter des problèmes qui seraient typiquement tunisiens, car on sait que la fin du 20e siècle et le début du 21e se caractérisent par l’extraordinaire mutation qui se produit à cet égard dans tous les pays ou à peu près. 
Cependant on peut dire que le roman de Rabâa Ben Achour-Abdelkéfi ne va pas dans le sens d’une opinion assez répandue, qui voudrait que la Tunisie ait bénéficié, pour ce qui concerne dans l’évolution des mœurs et la rupture avec la tradition, d’avancées plus fortes que les autres pays arabes, ou musulmans, ou maghrébins—une avance qui serait due en grande partie au progressisme de Bourguiba.
Or l’auteure dément une telle idée. Certes elle fait la part des choses et montre comment le pays a cumulé les tares du mode de vie traditionnel et les perturbations de l’entrée dans la modernité, sans parler des effets de la mentalité bourgeoise qui y est particulièrement répandue. Mais c’est sur la torture au temps de Bourguiba que son livre comporte les dénonciations les plus fortes. Ce sont des témoignages autorisés, qui ne relèvent sûrement pas de la fiction, et qui sont atterrants !
Denise Brahimi
« LE CHAT DU RABBIN » Numéro 8, (Editions Poisson pilote 2018).
Le huitième opus du célébrissime félin bavard m’a donné l’envie de partager ma passion pour cette série et ma sympathie admirative pour son auteur.
 En souvenir d’Imhotep, le vrai chat de Joann Sfar, en photo en page 4 de l’album, parti à 18 ans rejoindre le paradis des chats. Grâces lui soient rendues pour avoir inspiré à son maître ce génial petit personnage, qui entre autres choses nous aide à pénétrer dans l’âme juive algérienne.
En souvenir d’Imhotep, le vrai chat de Joann Sfar, en photo en page 4 de l’album, parti à 18 ans rejoindre le paradis des chats. Grâces lui soient rendues pour avoir inspiré à son maître ce génial petit personnage, qui entre autres choses nous aide à pénétrer dans l’âme juive algérienne.
Et aussi parce que pour cet album Joan Sfar a donné à ses lectrices et lecteurs le choix de la couverture, choix difficile entre deux belles œuvres. C’est finalement la belle blonde qui veut apprendre à être juive par amour qui l’a emporté, face au jeune rabbin, mari de Zlabya. Il faut dire à propos de Zlabya que toutes les jeunes filles juives chez Sfar portent des noms de gâteux savoureux, allez savoir pourquoi. Le tome 8 est sous-titré « Petit panier aux amandes », alias Knidelette, le nom de l’amie de Zlabya, légèrement foldingue, et un peu allumeuse. Et leurs amies, Makroute et Beustel (mais celle-ci, je ne suis pas sûr qu’elle ait un nom de gâteau…).
La relation homme-femme dans la société juive est au centre de cet album, et le chat joue son rôle de révélateur de certaines incongruités et faux semblants en usant sans modération de son pouvoir de parole. Il faut dire que non seulement ce chat est doué de raison (mais cela, toute personne ayant le privilège de vivre chez son chat le sait bien !), mais son don de parole est mis au service d’une expression qui ignore tout du politiquement correct. Sa vision sans concessions des aberrations des comportements humains est une potion amère mais salutaire. Ce qui lui vaut moults taloches et expulsions vigoureuses, dont il abuse pour se faire câliner, de préférence par les belles dames qui l’entourent.
 Cet album est aussi un des plus drôles de la série. On croit entendre les accents des personnages tant les phrases mises dans les bulles restituent le caractère coloré des parlers algérois. Et le chat a même un temps un accent bourguignon après s’être fait balancer par la fenêtre par une sorte de marin Popeye à qui il faisait la morale. « Tu as un accent bourguignon » lui dit Aline, la jeune femme de la couverture ? « Non, Je krois que je me chuis auchi fendu le palais ».
Cet album est aussi un des plus drôles de la série. On croit entendre les accents des personnages tant les phrases mises dans les bulles restituent le caractère coloré des parlers algérois. Et le chat a même un temps un accent bourguignon après s’être fait balancer par la fenêtre par une sorte de marin Popeye à qui il faisait la morale. « Tu as un accent bourguignon » lui dit Aline, la jeune femme de la couverture ? « Non, Je krois que je me chuis auchi fendu le palais ».
Recommandons tout particulièrement les relations cocasses du chat avec la mère du fiancé d’Aline, mère juive, comme il se doit, qui sans lunettes, le prend pour Toulouse Lautrec… en l’appelant Grenoble ! Leurs conversations en jouant aux cartes méritent le déplacement. « En attendant, la mémé, elle me met la misère à la belote » raconte le chat.
L’Alger de Sfar est imaginaire et onirique, mais aussi belle que l’originale.
La lecture de Sfar est aussi une exploration vertigineuse au fil des albums de cette série de la vision juive du monde, pas dépourvue d’une forme de poésie baroque, sujets à débats sans fin. Nul doute que la fantaisie débridée de l’auteur n’en fasse une lecture assez personnelle, mais elle donne toujours à réfléchir, et finalement amène les lecteurs et lectrices à entrer aussi dans la ronde des questionnements perpétuels.
Les chats sont des marqueurs de l’humanité, celui de Sfar en est le champion toutes catégories.
Michel Wilson

« MON CHER ENFANT », film de Mohamed Ben Attia (2018)
On est très heureux que l’association Coup de Soleil ait accordé tous ses soins à ce film tunisien, qui mérite un vaste public par l’ampleur des problèmes qu’il aborde sous couvert d’en traiter un —l’unique qu’on cite toujours à son propos. Il est bien vrai que le jeune Tunisien du film appelé Sami, un garçon de 19 ans sur le point de passer son bac, quitte brusquement sa famille pour partir faire le djihad en Syrie. On est donc tenté de voir dans  Mon cher enfant un des nombreux films récents portant sur ce qu’on appelle la radicalisation —celle des jeunes musulmans soumis à la pression des islamistes qui recrutent pour leur cause et pour les actions terroristes sur lesquelles elle s’appuie. L’exemple parfait de ce genre de film est celui de Philippe Faucon qu’on a pu voir en 2011 sous le titre La Désintégration, film tout aussi excellent que Mon cher enfant paru en ce mois de novembre 2018, un rapprochement qui nous amène à affirmer aussitôt que par ailleurs, les deux films n’ont rien de commun !
Mon cher enfant un des nombreux films récents portant sur ce qu’on appelle la radicalisation —celle des jeunes musulmans soumis à la pression des islamistes qui recrutent pour leur cause et pour les actions terroristes sur lesquelles elle s’appuie. L’exemple parfait de ce genre de film est celui de Philippe Faucon qu’on a pu voir en 2011 sous le titre La Désintégration, film tout aussi excellent que Mon cher enfant paru en ce mois de novembre 2018, un rapprochement qui nous amène à affirmer aussitôt que par ailleurs, les deux films n’ont rien de commun !
Car loin de se focaliser sur le problème de la radicalisation et sur la détresse des familles dont un « cher enfant » se jette irrésistiblement dans cette démarche suicidaire, le film de Mohamed Ben Attia ne cesse de s’ouvrir sur des perspectives sans cesse renouvelées, amenant le spectateur à se convaincre de plus en plus qu’il est embarqué dans une réflexion exigeante et inattendue, à partir de l’énigme que représente le départ de Sami. Le réalisateur fait preuve de tant de délicatesse, d’attention pour ses personnages et pour ses spectateurs, qu’on ne mesure pas d’abord à quel point son attitude pourrait passer, chez un autre, pour de la provocation. Car à aucun moment du film, ni avant son départ en Syrie ni pendant qu’il y vit en attendant de se faire tuer, la religion qui est supposée être le mobile de son départ n’est mentionnée. On n’assiste pas au moindre endoctrinement de ce garçon ni de ses camarades de lycée, avec lesquels il partage au plus une complicité d’adolescents unis par quelque petit secret. Finalement ses parents sont les seuls pour lesquels la religion est mentionnée, comme consolation à laquelle on les renvoie le plus banalement du monde après la mort de leur fils.
Pour le spectateur il est impossible de ne pas être saisi d’un doute : et si la tristement célèbre radicalisation n’était pas vraiment le sujet du film ? Si elle n’en était que le prétexte, l’un des aspects sans doute de ce que le réalisateur veut dire ou plutôt montrer sous des formes multiples. Et de fait c’est en cela que consiste la véritable recherche du film, celle à laquelle nous sommes entraînés à la suite du remarquable acteur qui joue le rôle de Riadh le père de Sami, un nom à retenir car il semble que ce soit un acteur rare, Mohamed Dhrif.
A dire vrai, l’enquête de Riadh sur son fils commence avant même le départ imprévu et bouleversant de celui-ci en Syrie. On dira à juste titre que ce père s’occupe un peu trop de son fils et que cet amour écrasant pourrait bien être une des causes de la tragédie ; mais ce serait tout de même très paradoxal et pas du tout convaincant d’en conclure qu’il aurait dû s’en occuper beaucoup moins ! En revanche c’est sans doute de l’impuissance de l’amour qu’il faut parler car il semble bien qu’elle soit le fil conducteur et thème récurrent du film. On ne peut rien pour ceux qu’on aime et c’est ici que vient à l’esprit la double formule si pertinente du psychanalyste Jacques Lacan :
« Donner de l’amour, c’est vouloir donner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ».
Ce que Riadh le père comprend tragiquement après avoir tenté de tout son amour, comme on dit, de ramener Sami à la maison, après l’avoir retrouvé de la manière la plus improbable et presque miraculeuse aux confins désolés de la Turquie et de la Syrie. Pathétiques et dérisoires les quelques paroles par lesquelles il essaie de le convaincre de rentrer à la maison où l’attend le supposé bonheur dont justement il ne veut pas, vivre comme ses parents, se marier etc. Riadh ne peut rien proposer d’autre à son fils qu’une sorte de réappropriation alors que c’est cela que Sami a voulu fuir, cela qui éclate encore dans les propos de la mère Nazli, lorsqu’elle apprend, du fond de sa douleur de mère abandonnée, que son fils s’est marié en Syrie et a eu un enfant « C’est tout de même mon petit-fils dit-elle, et il faut entendre toute l’insistance de ce « mon »aussi naïf que pathétique, qui illustre pleinement ce que dit à Riadh un vieil homme rencontré au cours de son voyage. Alors qu’il affirme ne rechercher que le bonheur de son fils, il s’entend répliquer par le vieux sage : « On dit tous cela, mais au fond, c’est notre bonheur qui nous importe ».
Ce qui vaut pour l’amour d’un père vaut aussi pour l’amour d’un couple, tel que celui de Riadh et de Nazli. Cette dernière ressent intuitivement, probablement de manière inconsciente mais d’autant plus dommageable, un malaise qui est en elle comme une blessure et un chagrin incapables de se formuler, jusqu’au moment où le départ de Sami lui en donne l’occasion. La révolte devient alors son unique raison d’être et la famille son unique refuge, de la manière la plus traditionnelle qui soit. Riadh, parce qu’il est un être exceptionnel, retrouve finalement une raison de vivre dans la camaraderie que crée le travail, et reporte sur les jeunes gens qui l’entourent un peu de l’amour impossible pour son fils.
 Ce que Sami avait compris, mais au prix de sa vie et d’une culpabilité inexpiable vis à vis de ses parents tant aimés, c’est la vérité de cette formule si difficilement acceptable, mise en vers par le poète Blaise Cendras : « Quand tu aimes il faut partir ». Exigence qu’on dira invivable ; pour autant, la vie banalement réduite à quelques fondamentaux ne constitue pas une option plus fiable : c’est celle que propose à Riadh une de ses collègues de travail, qui veut croire aux bonnes vieilles formules, qu’il faut prendre la vie du bon côté, faire l’amour quand on peut etc. mais dont on apprend à la fin du film que son mari vient de la quitter, lui laissant le soin de s’occuper de ses filles et de son loyer !
Ce que Sami avait compris, mais au prix de sa vie et d’une culpabilité inexpiable vis à vis de ses parents tant aimés, c’est la vérité de cette formule si difficilement acceptable, mise en vers par le poète Blaise Cendras : « Quand tu aimes il faut partir ». Exigence qu’on dira invivable ; pour autant, la vie banalement réduite à quelques fondamentaux ne constitue pas une option plus fiable : c’est celle que propose à Riadh une de ses collègues de travail, qui veut croire aux bonnes vieilles formules, qu’il faut prendre la vie du bon côté, faire l’amour quand on peut etc. mais dont on apprend à la fin du film que son mari vient de la quitter, lui laissant le soin de s’occuper de ses filles et de son loyer !
On comprend pourquoi Mohamed Ben Attia est proche des frères Dardenne, pratiquant comme eux un cinéma dur et tendre qui ne juge pas et qui donne envie de vivre quoi qu’il en soit.
Denise Brahimi

 « UNE MEMOIRE D’INDIEN » de Pierre Micheletti (éditions parole, sept. 2018)
« UNE MEMOIRE D’INDIEN » de Pierre Micheletti (éditions parole, sept. 2018)
L’auteur a quitté en 1962 l’Algérie où il est né . Il a fait partie de l’organisation « Médecins du monde » qu’il a présidé, et de « Action contre la faim » dont il est vice-président, et il enseigne depuis 2009 à l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble.
Le livre évoque son expérience de médecin de campagne et de médecin humanitaire. Il s’interroge sur les influences qui ont joué sur la conduite de sa vie.
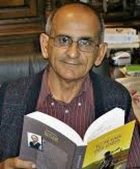 « TU TE FAIS DES IDEES » de Bisten Messaad
« TU TE FAIS DES IDEES » de Bisten Messaad
Ce livre est le récit entièrement autobiographique d’un Franco-algérien d’origine bédouine dont le père est venu en France en 1946 pour travailler dans les mines du Nord. Lui-même est né en 1955 dans un petit village de l’Isère.
Malgré son milieu familial plus que modeste mais grâce à son travail et à de bons résultats scolaires, il a pu suivre une formation qui l’a qualifié pour un travail en usine, et il est resté dans la même pendant toute sa carrière, soit plus que 44 ans. Il y a beaucoup souffert d’être souvent brimé et rejeté à cause de son origine raciale, mais il a connu aussi de grandes satisfactions professionnelles et de profondes amitiés. D’où la sagesse qui se dégage finalement de ce bilan d’une vie.
–  Le 26 novembre 2018, les insignes d’officier de l’Ordre National du Mérite ont été remis au Père Christian Delorme, aussi connu comme « le curé des Minguettes », né à Lyon il y a 68 ans, et qui nous fait l’honneur de continuer à appartenir à notre association depuis 33 ans. Cette cérémonie s’est tenue à la Mairie du 7e arrondissement choisie en tant que lieu purement républicain, de préférence à une église catholique ou à la grande mosquée fondée par son recteur actuel Kamel Kabtane par qui les insignes ont été remis. Nous espérons que les paroles prononcées par Christian Delorme à cette occasion auront de nombreux lecteurs.
Le 26 novembre 2018, les insignes d’officier de l’Ordre National du Mérite ont été remis au Père Christian Delorme, aussi connu comme « le curé des Minguettes », né à Lyon il y a 68 ans, et qui nous fait l’honneur de continuer à appartenir à notre association depuis 33 ans. Cette cérémonie s’est tenue à la Mairie du 7e arrondissement choisie en tant que lieu purement républicain, de préférence à une église catholique ou à la grande mosquée fondée par son recteur actuel Kamel Kabtane par qui les insignes ont été remis. Nous espérons que les paroles prononcées par Christian Delorme à cette occasion auront de nombreux lecteurs.

- 5/12/2018 19h à la Librairie Terre des Livres à Lyon, rencontre avec Omar Benlaala autour de son dernier livre « Tu n’habiteras jamais Paris »
- 6/12/2018 à la Librairie Athaud à Grenoble rencontre avec Omar Benlaala autour de son dernier livre « Tu n’habiteras jamais Paris »
- 7/12/2018 au Cinéma Les Alizés à Bron, filme » « Mon cher enfant » de Mohamed Ben Attia, et débat avec madame Sadia Douki Dedieu, professeure en psychiatrie

