Lettre Culturelle franco-maghrébine #30
ÉDITO
Notre lettre de février vous propose des rencontres très algériennes du moins pour les auteurs. Pourtant elles peuvent nous emmener loin de l’Algérie, comme avec Salim Bachi et son exil, Farida Hamak, sur les bords du Jourdain, Kamel Daoud au Musée Picasso. Nous diversifierons de nouveau nos sources dès le mois prochain, et retrouverons du cinéma.
Pour ce mois ci, donc, de beaux textes, et de belles images.
Et comme chaque fois, merci d’avance pour vos retours et vos suggestions.
Michel Wilson

« VIE D’UNE PIED-NOIR AVEC UN INDIGENE: Vie d’une Pied-noir avec un Indigène, Carnets d’Algérie 1919-1962, Mourir chambre 58 », de Jean-Philippe Nottelet (Paris, éditions Tirésias-Michel Reynaud, 2017)
Le titre, malgré sa longueur, ne donne pas une idée complète du contenu de ce livre qu’il convient donc d’expliciter. Certes le personnage principal en est bien la « Pied-noir mariée avec un Indigène », mais il est aussi question d’elle pour un problème qui n’est pas évoqué par cette première définition et par cette singularité. C’est le problème qui apparaît avec le deuxième sous-titre « Mourir chambre 58 » et c’est toujours de la même personne qu’il s’agit, Giselle Nottelet, mère de l’auteur. Mais dans les chapitres de la première série, elle est vue (principalement par elle-même et dans un récit autobiographique) en tant que jeune fille puis épouse de l’Indigène Salah Henri Ould Aoudia, alors que dans les chapitres de la deuxième série, elle est vue (principalement par ses enfants Madeleine et Jean-Philippe) en tant que très vieille dame de 94 ans qui en février 2014 vit ses derniers jours, 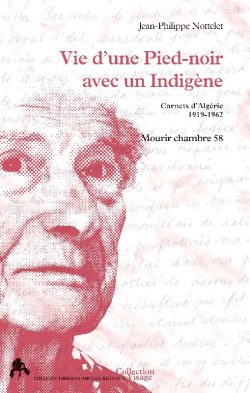 dans de très mauvaises conditions que le livre a pour but de dénoncer. Les deux séries pourraient se suivre, car elles sont chronologiquement très distinctes, la première allant jusqu’en 1962, comme l’indique le premier sous-titre du livre ; mais Jean-Philippe Nottelet, l’auteur a choisi de procéder différemment, et d’inventer une présentation romanesque originale, qui consiste à entrecroiser les chapitres correspondant aux deux séries. Il s’explique sur les raisons de ce procédé dans un bref épilogue. C’est que, dit-il, dans chacune des deux séries, sa mère Giselle, jeune femme ou vieille femme, a subi les mêmes violences ou plutôt que lui-même a constaté de part et d’autres les mêmes violences aussi inacceptables. Dans la première série il s’agit du racisme en période coloniale suivi par les meurtres commis pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie; dans la deuxième série ce sont les conditions infligées par le système médical à une vieille dame agonisante, en dépit des lois. De toute manière, l’auteur veut affirmer sa révolte contre l’insoutenable et peut-être espère-t-il par ce moyen s’aider lui-même à faire son deuil, car deuil il y a, dans les deux cas.
dans de très mauvaises conditions que le livre a pour but de dénoncer. Les deux séries pourraient se suivre, car elles sont chronologiquement très distinctes, la première allant jusqu’en 1962, comme l’indique le premier sous-titre du livre ; mais Jean-Philippe Nottelet, l’auteur a choisi de procéder différemment, et d’inventer une présentation romanesque originale, qui consiste à entrecroiser les chapitres correspondant aux deux séries. Il s’explique sur les raisons de ce procédé dans un bref épilogue. C’est que, dit-il, dans chacune des deux séries, sa mère Giselle, jeune femme ou vieille femme, a subi les mêmes violences ou plutôt que lui-même a constaté de part et d’autres les mêmes violences aussi inacceptables. Dans la première série il s’agit du racisme en période coloniale suivi par les meurtres commis pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie; dans la deuxième série ce sont les conditions infligées par le système médical à une vieille dame agonisante, en dépit des lois. De toute manière, l’auteur veut affirmer sa révolte contre l’insoutenable et peut-être espère-t-il par ce moyen s’aider lui-même à faire son deuil, car deuil il y a, dans les deux cas.
Deuil de la mère en 2014, et le livre est écrit dans son souvenir presque immédiat, quelques années après qu’elle soit morte dans des souffrances qu’elle avait pourtant très lucidement cherché à éviter. Deuil du père mort en 1962 et Gisèle, à l’ultime fin de ses « carnets » évoque la sinistre mainmise de l’OAS sur Alger, qui se termine par l’assassinat de son propre mari avec un certain nombre de ses compagnons le 15 mars 1962. Parmi les noms de ceux que l’O AS a froidement mis à mort ce jour-là on sait en effet qu’il y a celui d’Ould Aoudia, mari de Giselle et père de celui qui écrit le livre dont nous parlons.
Il n’ y a pas lieu de s’étonner que dans Vie d’une Pied-noir la figure de ce père, malheureusement célèbre à cause de cette sinistre exécution collective, ne soit que très peu présente et toujours indirectement par l’intermédiaire de sa femme (dont l’amour n’est pas à mettre en cause, tout le livre montre à quel point ce couple était fortement uni). C’est qu’en fait, Jean-Philippe le fils a déjà consacré d’autres écrits à son père que Giselle appelle de son prénom chrétien Henri, puisque il était, lui l’Indigène du titre, un Kabyle converti au christianisme, comme l’était Jean Amrouche, pour prendre un autre exemple connu. On peut citer notamment, en 1992, L’assassinat de Château-Royal, avec une postface de Pierre Vidal-Naquet. Et c’est encore une raison pour laquelle il a voulu organiser autrement le livre consacré à sa mère Giselle, sans la rabattre entièrement sur l’histoire de son mari, mais tenant compte au contraire de l’autre méfait dont elle a été victime de la part du pouvoir médical pendant son agonie.
On aimerait évidemment en savoir plus sur la vie du couple formé par Giselle et Henri, les difficultés causées par le préjugé raciste ayant commencé avant même leur mariage et à son propos, du fait que le père de Giselle y était violemment opposé. Il est clair qu’on ne doit pas se laisser prendre par la discrétion de Giselle qui n’était pas femme à se plaindre et qui pour cette raison se contente d’y faire quelques allusions, cependant significatives.  Pour la période de l’OAS, l’auteur a utilisé judicieusement des fragments de la correspondance entre Giselle et Paulette Roblès, épouse de l’écrivain Emmanuel Roblès qui était de leurs amis. On sait qu’il a été aussi celui de Mouloud Feraoun entré en 1960 aux Centre sociaux éducatifs —raison pour laquelle il a fait partie des six victimes assassinées le 15 mars 1962. On est d’ailleurs très admiratif des réseaux que ces gens de bonne volonté avaient réussi à constituer, autant qu’on est consterné par « l’incommensurable imbécillité » de leurs assassins, cette formule est de Giselle, en écho à ce qu’écrivait Germaine Tillion dans Le Monde du 17 mars 1962, pour stigmatiser « la bêtise qui froidement assassine ».
Pour la période de l’OAS, l’auteur a utilisé judicieusement des fragments de la correspondance entre Giselle et Paulette Roblès, épouse de l’écrivain Emmanuel Roblès qui était de leurs amis. On sait qu’il a été aussi celui de Mouloud Feraoun entré en 1960 aux Centre sociaux éducatifs —raison pour laquelle il a fait partie des six victimes assassinées le 15 mars 1962. On est d’ailleurs très admiratif des réseaux que ces gens de bonne volonté avaient réussi à constituer, autant qu’on est consterné par « l’incommensurable imbécillité » de leurs assassins, cette formule est de Giselle, en écho à ce qu’écrivait Germaine Tillion dans Le Monde du 17 mars 1962, pour stigmatiser « la bêtise qui froidement assassine ».
S’agissant de l’aveuglement et de la surdité des médecins auxquels Giselle a eu affaire dans les derniers jours de sa vie, il est vrai qu’on serait peut-être moins porté à vouloir les sanctionner que les racistes et les assassins dont il a été question dans les Carnets d’Algérie de 1919 à 1962.
Mais en fait le problème n’est pas de savoir s’il y a égalité quantitative ou non entre des préjugés qui seraient plus ou moins graves. Qualitativement il se fait que chacun est grave dans sa catégorie, et exige pareillement d’être combattu. Ne serait-ce que pour rendre hommage à ceux qui se sont vaillamment battus pour faire passer des lois, et on pense évidemment ici à la loi Léonetti plusieurs fois citée par Jean-Philippe Nottelet. A partir du moment où aucun des engagements inclus fermement et sans réserve dans les termes de cette loi n’a été respecté par les membres du corps médical chargés de veiller sur Giselle, il n’est pas possible d’accepter leur impunité. Et qu’on ne minimise pas ce qui ne serait qu’une « question de principe » puisque les principes ou plutôt leur non-respect se sont traduits en souffrance humaine irréparable. Ce livre nous rappelle qu’il est des crimes de toute sorte et que d’une certaine façon, en effet, c’est toujours du même mépris de l’être humain qu’il s’agit.
Denise Brahimi
« LE PEINTRE DEVORANT LA FEMME » de Kamel Daoud (Stock, 2018)
Cet essai appartient à une collection qui s’intitule « Ma nuit au Musée ». C’est en effet un excellent usage qui s’est répandu en France ces derniers temps et qui consiste à enfermer pour une nuit en solitaire dans un musée une personnalité, artiste, écrivain, en échange des impressions qu’ils auront tirées de cette expérience inédite . Le Président du Musée Picasso de Paris a eu l’idée judicieuse de proposer cette expérience à Kamel Daoud, en 2017, pendant que se tenait dans le Musée l’exposition intitulée « Picasso 1932, année érotique ». Il n’est pas difficile de deviner ses intentions et Kamel Daoud est sans doute allé encore au-delà de ce qu’il pouvait espérer, c’est-à-dire une confrontation entre l’érotisme selon Picasso et l’érotisme dit oriental dans une version très contemporaine,  celle des islamistes salafistes. Faut-il préciser que l’écrivain algérien auteur du célèbre Meursault, contre-enquête (2013-2014) n’appartient nullement à cette tendance, qui est au contraire celle de ses ennemis acharnés, et que ceux-ci sont allés jusqu’ à lancer contre lui une fatwa (2014), comme l’avait fait en son temps (1989) l’imam Khomeini contre Salman Rushdie et ses Versets sataniques. Néanmoins, le visiteur nocturne du Musée Picasso, évidemment très impressionné par la collection de tableaux qui lui sont donnés à voir, ne se lance pas dans une apologie délirante du peintre —ce qui serait d’ailleurs bien inutile tant son génie est reconnu. Il s’efforce de comprendre et d’analyser l’érotisme dont il s’agit, ce qui n’est pas si simple. En sorte que ses lecteurs dont nous sommes ne peuvent que le remercier de ses exégèses : c’était un pari difficile et l’on peut affirmer que le pari a été gagné.
celle des islamistes salafistes. Faut-il préciser que l’écrivain algérien auteur du célèbre Meursault, contre-enquête (2013-2014) n’appartient nullement à cette tendance, qui est au contraire celle de ses ennemis acharnés, et que ceux-ci sont allés jusqu’ à lancer contre lui une fatwa (2014), comme l’avait fait en son temps (1989) l’imam Khomeini contre Salman Rushdie et ses Versets sataniques. Néanmoins, le visiteur nocturne du Musée Picasso, évidemment très impressionné par la collection de tableaux qui lui sont donnés à voir, ne se lance pas dans une apologie délirante du peintre —ce qui serait d’ailleurs bien inutile tant son génie est reconnu. Il s’efforce de comprendre et d’analyser l’érotisme dont il s’agit, ce qui n’est pas si simple. En sorte que ses lecteurs dont nous sommes ne peuvent que le remercier de ses exégèses : c’était un pari difficile et l’on peut affirmer que le pari a été gagné.
Qu’est-ce donc que cette « année érotique 1932 », formulation un peu surprenante mais qui devient plus claire si l’on se reporte à quelques informations de type biographique. L’exposition donne à voir, sous les pinceaux du peintre, une jeune femme appelée Marie-Thérèse Walter, que Picasso, âgé de 50 ans, avait rencontrée quelques années plus tôt alors qu’elle n’en avait que 18. Tous les tableaux présentés sont consacrés à leur relation et uniquement à son aspect érotique. L’univers dans lequel on se trouve immergé est un monde purement physique, on y voit des corps ou des fragments de corps entremêlés, encore faut-il préciser qu’il ne s’agit aucunement d’une peinture réaliste, et s’il est vrai qu’on la ressent assez vite comme érotique, on n’est pas pour autant en état de préciser d’emblée ce que, dans ce contexte, le mot veut dire. Kamel Daoud choisit une piste d’interprétation et elle se révèle convaincante. Le titre de son essai qui d’abord est lui aussi un peu surprenant, correspond tout à fait à ce qu’il explique ensuite.
Face au corps de la jeune femme qui lui est soumise, et qui semble partager complétement la pratique érotique de Picasso comme peintre et comme amant, celui-ci, dans ses deux rôles, se jette sur son objet dans une volonté de possession totale et se livre à une sorte de démembrement qui lui permet de s’absorber en elle ou de l’absorber en lui. Il y a fabrication d’un objet global du tableau, qui est le couple érotique sans aucune fuite possible ni rêvée, sans aucune transcendance ni discours imaginaire d’accompagnement.
Ayant fait le constat de cette stupéfiante dévoration pendant toute une première partie de son livre, Kamel Daoud passe au projet comparatiste qui est à l’origine de celui-ci. Qu’en est-il de l’érotisme en islam, au Maghreb, en Algérie. C’est de ce dernier pays qu’il tire son expérience personnelle et aussi, il faut bien le dire, sa volonté de polémiquer qui n’est pas nouvelle. Mais du fait que les questions qui se posent à lui concernent aussi bien l’érotisme en général ou les pratiques quotidiennes de la rencontre amoureuse, il n’est pas étonnant que son livre prenne la forme d’un ensemble de réflexions diverses, plus ou moins longues, rejoignant des questions connues mais pour les traiter brillamment et sous une forme originale. C’est ainsi qu’on trouvera des développements tout à fait intéressants sur le musée lui-même comme institution, dont Kamel Daoud dit qu’il est par essence et par son origine de conception purement occidentale et n’existe dans les pays arabes que par imitation ou pour séduire l’Occident
 L’érotisme selon le salafisme (voué à la « rééducation morale » de la communauté musulmane) ne peut exister qu’au Paradis c’est-à-dire après la mort. Et ce d’autant mieux (et même à la condition) qu’il sera exclu auparavant de la vie des vivants, si l’on peut dire, donc de la vie tout court. Les variations sur le thème de l’érotisme paradisiaque relèvent évidemment de la mythologie et du fantasme, ce qui explique d’ailleurs leur succès auprès de ceux qui sont dépourvus de toute prise sur la réalité et maintenus volontairement dans cet état. Cet érotisme ne peut manquer d’être totalement codé et formaté, son succès étant directement lié à sa forte teneur en clichés. Sans qu’il soit besoin que l’auteur y insiste, il est évident que c’est exactement l’inverse de ce que fait Picasso. Car celui-ci est l’unique inventeur des images par lesquelles il rend compte, en tant que peintre, de son expérience érotique—prenant même le risque (qui ne l’arrête jamais) d’être difficile à comprendre voire repoussant —d’ailleurs il n’a certainement jamais fait profession de féminisme, en tout cas pas au sens actuel (il est mort en 1973) et politiquement correct du mot.
L’érotisme selon le salafisme (voué à la « rééducation morale » de la communauté musulmane) ne peut exister qu’au Paradis c’est-à-dire après la mort. Et ce d’autant mieux (et même à la condition) qu’il sera exclu auparavant de la vie des vivants, si l’on peut dire, donc de la vie tout court. Les variations sur le thème de l’érotisme paradisiaque relèvent évidemment de la mythologie et du fantasme, ce qui explique d’ailleurs leur succès auprès de ceux qui sont dépourvus de toute prise sur la réalité et maintenus volontairement dans cet état. Cet érotisme ne peut manquer d’être totalement codé et formaté, son succès étant directement lié à sa forte teneur en clichés. Sans qu’il soit besoin que l’auteur y insiste, il est évident que c’est exactement l’inverse de ce que fait Picasso. Car celui-ci est l’unique inventeur des images par lesquelles il rend compte, en tant que peintre, de son expérience érotique—prenant même le risque (qui ne l’arrête jamais) d’être difficile à comprendre voire repoussant —d’ailleurs il n’a certainement jamais fait profession de féminisme, en tout cas pas au sens actuel (il est mort en 1973) et politiquement correct du mot.
Ce qui tient au cœur de Kamel Daoud est une conséquence de ce salafisme renforcé et particulièrement rétrograde lorsqu’il s’agit de la relation entre hommes et femmes. De la misère sexuelle des Musulmans il est le témoin constant et consterné dans son propre pays l’Algérie (mais il n’hésite pas à la dénoncer aussi ailleurs comme il l’a fait à ses dépens au moment des tristement célèbres agressions sexuelles commises à Cologne la nuit du Nouvel An 2016). Et il termine sur ce constat désolé : « Je suis l’enfant d’un monde où l’érotisme est un silence. Le corps n’y est pas aimé mais subi ».
Denise Brahimi
« BAYA, RHAPSODIE ALGEROISE » de Aziz Chouaki (1989, 2018 Bleu autour)
Aziz Chouaki avait quarante ans lorsque la montée en force des islamistes l’obligea à quitter l’Algérie en 1991. A cette époque il avait déjà publié cette « rhapsodie algéroise » que beaucoup de gens vont enfin pouvoir lire grâce à sa réédition toute récente en France, par un éditeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Aziz Chouaki a écrit des pièces de théâtre et des romans ; le court texte intitulé Baya, à dire vrai inclassable, est présenté par lui comme un récit, qu’il prête à son personnage féminin ; mais on ne peut considérer Baya comme son double, ne serait-ce que pour des raisons d’âge : Baya pourrait être sa mère ou presque, il pourrait être ou presque l’un des enfants de Baya qui s’appelle Hamid, l’autre étant une fille Samira. Cependant aux côtés de Baya le personnage dont on entend le plus parler est son mari Salah, et ce sont de très jolis passages, au début du récit, que ceux où ils font connaissance et tombent amoureux l’un de l’autre.
Aziz Chouaki a écrit des pièces de théâtre et des romans ; le court texte intitulé Baya, à dire vrai inclassable, est présenté par lui comme un récit, qu’il prête à son personnage féminin ; mais on ne peut considérer Baya comme son double, ne serait-ce que pour des raisons d’âge : Baya pourrait être sa mère ou presque, il pourrait être ou presque l’un des enfants de Baya qui s’appelle Hamid, l’autre étant une fille Samira. Cependant aux côtés de Baya le personnage dont on entend le plus parler est son mari Salah, et ce sont de très jolis passages, au début du récit, que ceux où ils font connaissance et tombent amoureux l’un de l’autre.
Il en est d’ailleurs ainsi tout au long du texte, la mémoire de Baya la fait se déplacer d’un souvenir à l’autre et les moments sur lesquels elle s’attarde le plus sont ceux qu’elle a vécus avec le plus de bonheur, ce qui fait que ces retombées de la mémoire doivent leur charme à un parfum de nostalgie. Cependant Aziz Chouaki n’en abuse pas parce que, comme on le comprend assez vite, ce n’est pas son objet. Oui il aime évoquer une Algérie (ou plutôt une ville d’Alger) qui pour l’essentiel est celle des deux ou trois décennies précédant l’indépendance, puis l’englobant et la suivant de très près. Mais du fait qu’il ne l’a pas encore quittée au moment où il écrit, on ne saurait parler comme on l’a fait pour certains Pieds Noirs de « nostalgérie », c’est plutôt, de manière poétique, du goût de se laisser prendre à des remontées du passé qui doivent tout ou presque tout au langage dans lequel elles se trouvent exprimées. Le but d’Aziz Chouaki n’est pas de raconter des faits de manière réaliste, à travers une mémoire individuelle qui les aurait enregistrés, c’est plutôt de se laisser porter par un délire verbal contrôlé et pourtant créatif. Si l’on voulait faire de Baya un personnage réel reconstitué à partir des éléments qui constituent la narration romanesque, on aurait sans doute un peu de mal à savoir si elle est vue du dehors ou du dedans, car elle est essentiellement une voix, une femme qu’on entend se parler à elle-même et qui bientôt nous entraîne dans son flot de paroles comme elle s’y laisse entraîner elle-même. C’est ce flot ou ce flux qui finalement devient le véritable personnage du livre et qui retient d’autant mieux notre attention qu’on est ravi d’être emporté par lui, voire médusé.
Pour l’essentiel, le jeu auquel se livre Aziz Chouaki consiste à se laisser posséder par le récit comme oralité, à l’entendre sans chercher d’emblée à le visualiser comme texte écrit. Après quoi ou à ce même moment, des mots se présentent d’eux-mêmes pour transcrire le texte oral, sans autre raison d’être que de correspondre aux sons entendus. Evidemment lorsqu’on dit que des mots du langage écrit se présentent d’eux-mêmes, il faut comprendre que ces mots ne se présenteraient sûrement pas à tout le monde mais le font pour l’auteur Aziz Chouaki parce qu’il vit au milieu d’eux et les a apprivoisés de longue date. Là est son talent d’écrivain et tous les lecteurs s’accorderont à le trouver époustouflant.
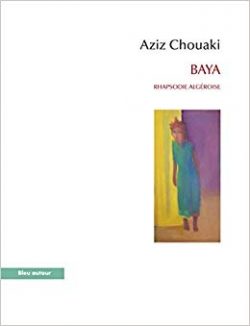 Qu’on en juge par un ou deux exemples : lorsque Baya se souvient de la célèbre fable de La Fontaine Le corbeau et le renard que son institutrice lui faisait apprendre à l’école, sans doute avant même qu’elle sache lire, Aziz Chouaki écrit « Le corps beau et l’heureux narre », non parce qu’il suppose que Baya l’aurait écrit de cette manière, mais parce que, en tant qu’écrivain, il veut que les mots soient comme des (jolis)petits cailloux à sa disposition dans une boîte et qu’il utilise librement à sa manière, pourvu que le résultat (sonore) soit obtenu.
Qu’on en juge par un ou deux exemples : lorsque Baya se souvient de la célèbre fable de La Fontaine Le corbeau et le renard que son institutrice lui faisait apprendre à l’école, sans doute avant même qu’elle sache lire, Aziz Chouaki écrit « Le corps beau et l’heureux narre », non parce qu’il suppose que Baya l’aurait écrit de cette manière, mais parce que, en tant qu’écrivain, il veut que les mots soient comme des (jolis)petits cailloux à sa disposition dans une boîte et qu’il utilise librement à sa manière, pourvu que le résultat (sonore) soit obtenu.
C’est en vue de ce seul résultat qu’il écrit «mammaire» pour «ma mère», «cadéroucelle» et «gédubontaba» pour le titre de ces deux célèbres chansons enfantines. A quoi s’ajoutent diverses contrepèteries ou déformations de mots, ces dernières suffisant à restituer les moments de l’enfance de Baya et la joie de vivre qui les accompagnait, alors même que le lecteur ravi sait très bien qu’il doit ce plaisir non à quelque souvenir de la réalité passée mais à l’agilité verbale illimitée de l’auteur. Dans cette aventure quelque chose doit lâcher prise pour produire un effet de libération et c’est la logique grammaticale du langage qui est piétinée joyeusement.
Cependant la qualité poétique du texte tient à des causes multiples : dans de nombreux passages, l’image d’Alger s’inscrit en filigrane sous le texte qu’on lit, elle est une présence qui passe par tous les sens, les odeurs et les couleurs étant aussi à l’origine d’une joie que l’auteur offre à ses lecteurs sans modération—sans doute parce qu’il veut d’abord se les offrir à lui-même pour s’en gorger, comme s’il avait le pressentiment qu’à plus ou moins longue échéance, il lui faudra apprendre à s’en passer. C’est ainsi que Baya est un très bel hommage à tout ce qu’il faut accepter de perdre après l’avoir beaucoup aimé, l’enfance certainement, où comme le bébé Hamid, on a été « cajolé, mignardé, amusé, musardé par la bienséante bonté du cœur ». Mais aussi la ville où on a vécu et qu’il va falloir quitter ; et le paysage restreint mais inépuisable qui l’environnait, comme dans ce paysage algérois, vu des hauteurs de Chréa : « Les cèdres, silencieuses sentinelles de l’altitude, en bas la plaine, Blida des roses, petit jouet blanc, carrefours anglés droits carrés et vergers petits, petits carrés verte et au loin là-bas dans la dense distance la mer tranquille des îles ».
Baya est un poème en prose d’une étonnante originalité.
Denise Brahimi
Signalons pour cette réédition le délicieux petit tableau de Louis Benisti ornant la couverture, image qui avait déjà été l’affiche de notre exposition sur « Camus et les peintres » à Lyon en 2013. Merci à son fils Jean-Pierre de continuer à faire vivre l’oeuvre picturale si sensible de ce peintre algérois.
Michel Wilson
« L’EXIL D’OVIDE » de Salim Bachi (éditions JC Lattès, 2018)
Les livres de cet auteur se succèdent de très près, au point qu’il en publie deux dans cette même année 2018. Et cela fait au total une bonne douzaine depuis qu’il a commencé à écrire, d’emblée chez Gallimard et récompensé par des prix, avec Le Chien d’Ulysse en 2001. Que ce soit ce premier titre ou son dernier L’exil d’Ovide, on ne peut manquer de remarquer que Salim Bachi trouve la source de ses livres dans ses connaissances littéraires, puisant dans la culture classique qui se trouve être ici européenne mais qui est d’autres fois celle du monde musulman.
Pour autant, et c’est toute son originalité ainsi que son talent d’écrivain, cet auteur ne nous accable jamais de son érudition, ses livres restent légers, ce qui ne veut pas dire qu’ils aient peu de contenu, mais plutôt que ce contenu est présenté sous une forme très fluide et toujours personnalisée. Cela signifie que le savoir dont Salim Bachi fait état porte le reflet de sa situation et de ses sentiments et se trouve intégré à sa propre vie. L’autobiographie est présente dans ses livres sous une forme qui va au-delà des allusions sans aller jusqu’à devenir pesante elle non plus, et contrairement à ce qui se passe dans une partie de la production romanesque contemporaine, nous ne sommes nullement dans l’autofiction.
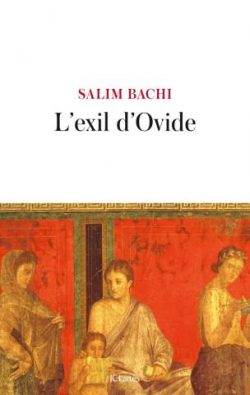 Pour comprendre cela, L’exil d’Ovide est un bon exemple : Ovide est ce poète latin qui fut exilé par l’Empereur Auguste au début de notre ère, pour quelque indiscrétion commise malgré lui. Après quoi il ne put jamais revenir à Rome et passa donc le reste de sa vie, une bonne dizaine d’années, à chanter tristement son exil dans un îlot perdu de la Mer Noire alors appelée Pont-Euxin : d’où le titre, qui est géographique, de l’un de ses recueils de vers, Les Pontiques, tandis que l’autre, de manière bien plus significative, s’intitule Les Tristes. Alors qu’il avait écrit avant cet exil sur bien d’autres sujets plus riants, Ovide ne peut finalement exprimer rien d’autre que cette douleur de l’exil sous la forme d’un lyrisme poétique pour lequel il sert désormais de référence. Et c’est bien ainsi que Salim Bachi s’empare de son nom, pour en faire le modèle exemplaire de ce qu’il vit lui-même, depuis qu’il a quitté l’Algérie pour la France pendant la tristement fameuse décennie noire.
Pour comprendre cela, L’exil d’Ovide est un bon exemple : Ovide est ce poète latin qui fut exilé par l’Empereur Auguste au début de notre ère, pour quelque indiscrétion commise malgré lui. Après quoi il ne put jamais revenir à Rome et passa donc le reste de sa vie, une bonne dizaine d’années, à chanter tristement son exil dans un îlot perdu de la Mer Noire alors appelée Pont-Euxin : d’où le titre, qui est géographique, de l’un de ses recueils de vers, Les Pontiques, tandis que l’autre, de manière bien plus significative, s’intitule Les Tristes. Alors qu’il avait écrit avant cet exil sur bien d’autres sujets plus riants, Ovide ne peut finalement exprimer rien d’autre que cette douleur de l’exil sous la forme d’un lyrisme poétique pour lequel il sert désormais de référence. Et c’est bien ainsi que Salim Bachi s’empare de son nom, pour en faire le modèle exemplaire de ce qu’il vit lui-même, depuis qu’il a quitté l’Algérie pour la France pendant la tristement fameuse décennie noire.
Cependant, à la différence du sort qu’Ovide s’est vu imposer, l’Algérien en exil a toute latitude pour voyager et devient une sorte d’errant qui promène sa tristesse ou son mal de vivre dans un certain nombre de grandes villes européennes. Ce sont des villes éminemment littéraires, ce qui veut dire qu’à leur nom s’attache celui d’un écrivain, parmi les plus célèbres, ou sinon son nom du moins le titre d’une de ses œuvres. Salim Bachi établit avec celles-ci, d’une manière qui semble très naturelle et très spontanée, un rapport de compréhension voire d’empathie, il partage les amours et les douleurs qui s’y expriment, et il n’oublie jamais de rappeler les situations historiques déterminantes de toutes les vies individuelles dont elles commandent le déroulement.
C’est pourquoi d’une manière apparemment simple, on apprend beaucoup à lire Salim Bachi. Il réactive des savoirs qu’on aurait cru un peu perdus dans les tréfonds d’une mémoire devenue inactive et il leur redonne une présence actuelle , comme si c’était nous-mêmes qui revivions les faits. Les différents chapitres, c‘est-à-dire les différentes villes ou les différentes œuvres qui sont présentes dans son livre, n’y sont pas toutes de la même façon, ce qui fait qu’on n’a jamais l’impression de lire une notice bio-bibliographique pour les secondes, encore moins touristique pour les premières.
D’ailleurs le tourisme (le fameux tourisme de masse qui l’emporte sur tous les autres aujourd’hui) est son ennemi, contre lequel il vitupère, particulièrement dans les pages consacrées à Rome où il a séjourné durablement grâce à une bourse d’écrivain à la Villa Médicis, située sur la colline du Pincio, en plein cœur de la ville. La ville ne lui a pas plu et ce n’est pas seulement parce qu’il adopte les sentiments de l’Irlandais James Joyce à son égard. Rome lui paraît comme érodée, vidée de son esprit ou de son âme par le flot touristique incessant et l’enlaidissement cruel dont il est cause. Il en est ainsi pour quelques autres hauts lieux du tourisme international dont Paris pourrait bien faire partie.
Lisbonne en revanche lui convient et c’est une ville pour laquelle il ressent des affinités, peut-être parce que la symbiose des lieux avec l’écrivain qui les a habités, Pessoa, est particulièrement intime et poétique. Il dit d’ailleurs qu’il se sent des points communs avec Pessoa, connu pour avoir publié sous des noms multiples ou hétéronymes qui lui permettaient de démultiplier sa personnalité.
 Il existe cependant au moins un lieu pour lequel il ne passe pas par la médiation d’un autre écrivain que lui-même et ce lieu est Grenade, qui occupe certainement une place à part dans sa vie et sa sensibilité, si l’on en juge par le fait qu’en 2005 il a publié un livre intitulé Autoportrait avec Grenade, récit, (Le Rocher). Comme dans le présent livre, il évoque les palais et jardins qui font la célébrité de la ville andalouse, mais plus encore son histoire personnelle d’homme qui s’est trouvé malade et hospitalisé dans cette ville avant que ne resurgisse sa force physique de manière inespérée. Il faut peut-être comprendre que dans cet exercice d’associations entre villes et écrivains qu’est L’exil d’Ovide, celle à laquelle il aspire est ou serait l’association entre lui-même et Grenade,—mais peut-être lui faudra-t-il encore un certain nombre de livres pour y arriver.
Il existe cependant au moins un lieu pour lequel il ne passe pas par la médiation d’un autre écrivain que lui-même et ce lieu est Grenade, qui occupe certainement une place à part dans sa vie et sa sensibilité, si l’on en juge par le fait qu’en 2005 il a publié un livre intitulé Autoportrait avec Grenade, récit, (Le Rocher). Comme dans le présent livre, il évoque les palais et jardins qui font la célébrité de la ville andalouse, mais plus encore son histoire personnelle d’homme qui s’est trouvé malade et hospitalisé dans cette ville avant que ne resurgisse sa force physique de manière inespérée. Il faut peut-être comprendre que dans cet exercice d’associations entre villes et écrivains qu’est L’exil d’Ovide, celle à laquelle il aspire est ou serait l’association entre lui-même et Grenade,—mais peut-être lui faudra-t-il encore un certain nombre de livres pour y arriver.
Le domaine germanique n’est pas exclu de ses réflexions, d’autant moins que c’est le plus politique de ceux qu’il aborde, avec Berlin Alexanderplatz d’Alfred Döblin et Le Docteur Faustus de Thomas Mann, l’un et l’autre exilés parce que fuyant le nazisme, ce qui entraîne Salim Bachi vers une vision particulièrement sombre de son sujet, associant la guerre et l’exil et prenant pour fond la déroute morale d’un pays. Salim Bachi pense d’autant plus sûrement à l’Algérie qu’elle était déjà à l’origine de son premier livre sur Grenade, l’ Autoportrait… et au cœur de son roman de 2017 Dieu, Allah, moi et les autres.
Denise Brahimi

» BORDER LINE, AU DETOUR DU JOURDAIN » Exposition de Farida Hamak à la galerie Regard Sud à Lyon du 15 janvier au 9 mars 2019
Farida Hamak, d’origine algéro-française, est venue à Lyon au terme d’un parcours riche et complexe où elle a mis ses talents et sa compétence de photographe au service d’une double pratique : capter des images de guerre mais aussi d’autres qui sont des perceptions de la beauté, et justement, peut-être, là où on ne l’attendait pas. Ce dernier cas est celui des images du Jourdain que nous montre l’exposition actuelle de Lyon, où l’on peut voir des photos que Farida Hamak a prises dans la vallée du Jourdain, pendant les années 2005 à 2007.
 Elle explique comment elle a passé de longs mois sur les rives de ce fleuve, dont elle a retracé l’histoire mouvementée dans un livre Au détour du Jourdain (2007), et à propos duquel elle rappelle quelques faits justifiant largement l’emploi de l’adjectif « mouvementée », un euphémisme à dire vrai ! :
Elle explique comment elle a passé de longs mois sur les rives de ce fleuve, dont elle a retracé l’histoire mouvementée dans un livre Au détour du Jourdain (2007), et à propos duquel elle rappelle quelques faits justifiant largement l’emploi de l’adjectif « mouvementée », un euphémisme à dire vrai ! :
« Né dans les montagnes libanaises, le Jourdain arrose le Liban, la Syrie, Israël, la Palestine et La Jordanie avant de finir sa route dans la mer Morte. Depuis la guerre des Six-Jours, en 1967, la vallée du nord est devenue zone militaire. »
Farida Hamak a d’ailleurs été reporter de guerre dans les années 1980, pendant la guerre du Liban. Mais pour en revenir à sa conception originale et profonde de la photographie, il faut tenter de comprendre ce que nous disent ces photos de la vallée du Jourdain actuellement exposées à Lyon. Pour cela, il est très utile de lire ce qu’elle a écrit elle-même sur sa manière de procéder, à partir d’août 2005, date de son premier voyage dans la région :
» J’ai beaucoup pris la route sans faire de photographies. J’avais d’abord besoin de découvrir, de m’imprégner de la vallée, de l’habiter, de sentir son odeur, de m’approcher de la lumière, de m’illuminer de ses couleurs. Revenant le plus souvent dans les mêmes lieux, j’ai rôdé autour du Jourdain, caché, en contrebas, fleuve exilé aux rives semées de miradors et de barrages militaires. Grâce à des amis, j’ai pu l’approcher, je l’ai même photographié… Petits bouts de miroirs interdits, série intemporelle de détails et de paysages, décalés de la réalité. »
On peut certainement regarder ces photos, et c’est la meilleure façon de le faire, en ayant à l’esprit la fameuse « histoire mouvementée » qui est dans leur arrière-plan et qui provoque l’insistance de notre regard en quête de témoignages ou au moins d’indices. Cependant ceux-ci restent toujours indirects, allusifs, et on pourrait aller jusqu’à dire qu’il ne faut pas immédiatement les superposer, c’est-à-dire les imposer aux images —mais plutôt, dans un premier temps en tout cas, laisser celles-ci « parler d’elles-mêmes », comme on dit, ou plutôt même les laisser à leur silence et à la qualité exceptionnelle de celui-ci. C’est dire que pour celui ou pour celle qui regarde, l’exercice est complexe : il est convié à une sorte d’expérience personnelle rendue possible par les images, grâce à leur qualité intense et débordant toute signification. Mais en même temps, à un niveau subliminaire, il doit savoir de quoi on parle, et pourquoi. Chaque photo produit plus ou moins l’effet de ce qu’on appelle, dans un film, un arrêt sur images. Ce procédé utilisé par le cinéma a un rapport avec le temps qui se trouve grâce à lui un moment suspendu, ce qui ne peut que nous rappeler ce que Farida Hamak dit elle-même dans ce qu’on a pu lire ci-dessus, lorsqu’elle parle d’une « série intemporelle de détails et de paysages, décalés de la réalité ».
Et c’est justement parce que ces lieux sont ou ont été si fortement mêlés à l’histoire, c’est à dire au temps sous sa forme la plus présente et la plus reconnaissable, qu’il y a un projet très fort et très impressionnant dans cette volonté de les en détacher, pour une fois, exceptionnellement. C’est en ce sens qu’on peut parler d’une expérience, à partir de la valeur documentaire des photos mais pourtant en rupture volontaire avec elles. Cette dernière produit un choc, mais c’est un choc immobile si l’on peut dire et qui nous immobilise nous aussi pour que tout se concentre dans l’intensité de notre regard.
Denise Brahimi
BORDER LINE, AU DETOUR DU JOURDAIN
Le parcours offert par la galerie Regard Sud sur cette rive jordanienne du Jourdain restituée par la photographe Farida Hamak est d’une belle poésie. Cette galerie nous donne depuis vingt ans grâce à Abdallah Zerguine, son « génie » (au sens d’Aladin), à découvrir des univers et des artistes toujours singuliers et exigeants.
Les photographies en petit format de cette exposition correspondent à cette exigence. Le choix de l’argentique permet de restituer ces grains et ces estompes qu’on retrouve moins en nos temps numérisés. Et surtout chaque regard porté par la photographe est comme

1 ©FaridaHamak-Border Line-Jourdain-1718-07
un petit poème, l’image photographiée suscitant chez le « regardeur » une cascade d’images mentales, à partir de ce qui est montré et aussi de ce qui est hors cadre.
Une partie de l’exposition suit le cours du Jourdain qui serpente au creux de collines calcaires. Les images qui nous sont offertes montrent la fragilité de ce fleuve surexploité par l’irrigation, qui n’en finit pas de « tuer » la Mer Morte où son cours s’achève, bien en dessous du niveau de la mer. Des files de moutons suivent leur berger sur le flanc des collines sans végétation. Une minuscule silhouette humaine se détache au sommet de l’une d’elles, quelque prophète égaré ? Et tout en bas, le cours ténu serpente, dessinant de curieuses sculptures torsadées.
Dans une autre salle, nous voilà chez les habitants, intérieurs paisibles, bains probablement très anciens, comme si chaleur et fraîcheur se côtoyaient pour permettre aux humains de trouver un certain confort de vie dans un univers qu’on imagine bien aride. L’eau permet de s’alimenter, de se désaltérer, de se rafraîchir. Un coup de cœur particulier pour deux clichés où s’assemblent ombre, lumière et eau, une palme qui flotte dans le cours de la rivière, les pieds d’un homme foulant la glaise, à l’ombre de palmiers comme l’entourant l’épines.
Nous avons tous un peu de Jourdain en nous sans souvent l’avoir jamais vu.
Merci à Farida Hamak d’enrichir notre bibliothèque d’images mentales de ces belles scènes si paisibles.
Michel Wilson

- Exposition » Border Line, au détour du Jourdain » de Farida Hamak à la galerie Regard Sud 3 rue des Pierres Plantées à Lyon 1er, du 15 janvier au 9 mars 2019
- Le 7/02/2019 à 18h30, au Centre culturel algérien, 171 rue de la Croix Nivert 75015 Paris, exposition « Louis Bénisti le peintre de la terre prodigue d’Algérie »
- du 8/02/2019 au 10/02/2019, à l’Hôtel de Ville de Paris, le Maghreb-Orient des Livres, organisé par Coup de Soleil et l’IREMMO


Un grand merci pour cette lettre mensuelle qui nous accompagne et nous ressource.