Lettre Culturelle franco-maghrébine #32
ÉDITO
Dans cette Lettre de Coup de soleil, nous avons voulu dire notre empathie à l’égard de l’Algérie en crise, évidemment sans la moindre ingérence dans les problèmes politiques en cours mais avec nos moyens propres qui consistent à évoquer livres, films et toutes formes d’expression susceptibles d’aider à la compréhension des événements. L’idée de revenir sur des œuvres récentes laissant pressentir la crise actuelle se heurte à une difficulté évidente du fait que la quasi totalité de ces œuvres, pour ne pas dire la totalité, entre dans cette définition. Nous nous sommes donc contentés de regrouper, dans une première partie de cette lettre, quelques recensions, analyses ou présentations concernant l’Algérie dès la fin de la période coloniale.
Le dernier ouvrage écrit par Nourredine Saadi avant sa mort fait le lien avec la période de la guerre d’Algérie.
Le film de Jacqueline Gozlan évoque à travers la cinémathèque d’Alger la période à la fois glorieuse et joyeuse qui a suivi l’indépendance .
Le documentaire de Malek Bensmaïl, Contrepouvoirs, remontant à l’époque du « 4e mandat » ne saurait être davantage dans les problématiques actuelles.
Les Prophètes du 7e art est un article consacré au rôle des réalisateurs qui impliquent depuis quelques années le cinéma algérien dans une réflexion critique sur la vie politique et sociale de leur pays.
Après quoi nous avons repris notre démarche habituelle qui consiste à évoquer des œuvres concernant la totalité des pays du Maghreb et des problématiques qui les englobent. De Nadia Tazi, on pourra lire : Le genre intraitable ; de Delphine Horvilleur et Rachid Benzine : Des mille et une façon d’être juif ou musulman ; ; d’Hassan Wahbi : La tyrannie du commun. Propos intempestifs sur la société marocaine ; d’Hamadi Redissi : L’Islam incertain; de Hela Ouardi : Les Califes maudits.
Denise Brahimi
SPECIAL ALGERIE
FILM
« MON HISTOIRE N’EST PAS ENCORE ECRITE », réalisatrice Jacqueline Gozlan, 2017
La tentation est grande de voir dans ce long métrage un hommage rendu par la réalisatrice à ce qui fut pendant vingt-cinq ans (1965-1990) un lieu culturel inoubliable, la cinémathèque d’Alger. Et naturellement cet hommage est bien présent tout au long du film à travers mainte occasion de le renouveler et maint personnage que ces évocations remplissent d’enthousiasme. Pourtant ce serait sans doute mal comprendre le projet de la réalisatrice que de voir uniquement cet aspect, qu’elle a voulu rattacher à son histoire personnelle, même si c’est une histoire encore non écrite, comme le dit le titre de son 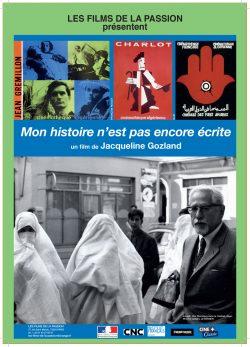 film. Celui-ci, à dire vrai un peu énigmatique, autorise des commentaires que la réalisatrice se contente de suggérer discrètement. En fait tout le film consacré à ce que fut la prodigieuse activité de la cinémathèque d’Alger se développe dans l’espace et le temps qui séparent le 25 novembre 1961, date à laquelle Jacqueline Gozlan encore enfant et sa famille quittent l’Algérie et le moment où elle y revient beaucoup plus tard (2015), dans un pays resté malgré tout le sien. La poupée que la petite fille emporte avec elle joue un peu le rôle du « rosebud » (bouton de rose) dans le célèbre film Citizen Kane d’Orson Welles(1941), symbole et témoin d’une enfance inoubliable.
film. Celui-ci, à dire vrai un peu énigmatique, autorise des commentaires que la réalisatrice se contente de suggérer discrètement. En fait tout le film consacré à ce que fut la prodigieuse activité de la cinémathèque d’Alger se développe dans l’espace et le temps qui séparent le 25 novembre 1961, date à laquelle Jacqueline Gozlan encore enfant et sa famille quittent l’Algérie et le moment où elle y revient beaucoup plus tard (2015), dans un pays resté malgré tout le sien. La poupée que la petite fille emporte avec elle joue un peu le rôle du « rosebud » (bouton de rose) dans le célèbre film Citizen Kane d’Orson Welles(1941), symbole et témoin d’une enfance inoubliable.
Pour tout ce qui concerne la cinémathèque d’Alger, Jacqueline Gozlan nous fait partager l’enthousiasme dont témoignent tous ceux qu’elle nous donne à entendre parce qu’ils ont participé à sa naissance et à son développement. Cela commence dès 1965 où l’on peut citer comme principaux créateurs de ce lieu Jean-Michel Arnold, manifestement disciple de l’homme de la Cinémathèque française, Henri Langlois (1914-1977) et Mahieddine Moussaoui qui avait commencé une partie du travail dans une agence de presse à Tunis avant l’indépendance de l’Algérie. Et très vite on voit apparaître une personnalité éminemment fondatrice, qui ne cessera de suivre comme il le fait encore aujourd’hui le parcours du cinéma algérien, Ahmed Bedjaoui, auteur du récent Le cinéma à son âge d’or : 50 ans d’écriture au service du 7e art.(éditions Chihab, (2018)
Plutôt que de citer d’autres personnalités diverses qui ont participé à l’aventure et que le film permet de voir et d’entendre, peut-être faut-il s’attacher à quelques dates et événements qui en scandent la chronologie et les étapes. De la première période, qui va jusqu’en 1969, le film marquant est celui de Gillo Pontecorvo, La Bataille d’Alger (1966)dont on entend des spectateurs algériens, enfants de la casbah, dire qu’ils y ont pleinement reconnu leur monde, y compris pour un ensemble d’impressions physiques, sons, odeurs etc. C’est d’ailleurs une époque où la cinémathèque d’Alger fonctionne dans un rapport direct avec la Casbah toute proche, d’où vient une bonne partie du personnel et qui fait l’effet d’une sorte de base arrière pour ce haut lieu du cinéma mondial. Paradoxe de ce « lieu magique », comme dit l’acteur Agoumi, où l’on voit quotidiennement les films de John Ford et de Hitchkock (pas moins de cinq séances par jour sans oublier d’aller faire entre deux films la partie traditionnelle de dominos.
Le point culminant de cette époque est certainement le Festival Panafricain d’Alger en 1969, pendant lequel la cinémathèque fait connaître nombre de films africains, parmi les plus brillants qui soient. Le « Panaf » a été un grand moment pour Alger et pour le monde.
A partir de 1970 commence une nouvelle période. Boudjemâa Karèche remplace Jean Michel Arnold et le grand critique de cinéma algérien qu’est Mouloud Mimoun pense que c’est le moment où la cinémathèque d’Alger atteint son plein rayonnement. Il est vrai que sous l’influence de cinéastes comme Farouk Beloufa (auteur en 1979 du beau film Nahla et mort il y a moins d’un an) l’Algérie se lance alors dans une politique de coproductions, dont bénéficie le cinéaste égyptien Youcef Chahine, en difficulté dans son propre pays. Mais c’est aussi l’époque où paraît ce concentré inimitable d’algérianité qu’est le célèbre Omar Gatlato de Merzak Allouache (1977), qui justifie pleinement ce que disent certains créateurs : le plus local est aussi le plus universel. Merzak Allouache est de ceux qui évoquant ses débuts dans le cinéma, auquel il n’était préparé d’aucune manière, explique qu’il doit tout à la cinémathèque d’Alger et à sa politique de formation de réalisateurs.
Dans les années 80 du siècle dernier, que faut-il penser des destinées de cet endroit prestigieux ? Le film de Jacqueline Gozlan donne à entendre le témoignage d’une personne qui considère que cette période a été très faste, pour elle en tout cas. Ahmed Bedjaoui en revanche, pense que le déclin du cinéma algérien était commencé avant la funeste décennie noire, même si l’on peut penser que celle-ci lui a donné le coup de grâce. Les chiffres, concernant la diminution (le mot est faible) du nombre de salles sont d’ailleurs irréfutables.
 Cependant la réalisatrice Jacqueline Gozlan tient à préserver le côté subjectif et personnel de son film, qu’elle ne voit sans doute pas comme un documentaire.
Cependant la réalisatrice Jacqueline Gozlan tient à préserver le côté subjectif et personnel de son film, qu’elle ne voit sans doute pas comme un documentaire.
Ce qui se dégage finalement de cette histoire est que la cinémathèque a bénéficié d’un privilège exceptionnel dans son pays, du fait qu’elle a échappé à toute censure ; son deuxième aspect, tout aussi remarquable et positif, étant que s’y est constamment maintenue une qualité des débats de la part du public et une capacité d’invention étonnante de la part des réalisateurs. De cette dernière, le film donne deux exemples, remontant à la grande époque des années 1970, Tahia ya Didou de Mohamed Zinet et Le Charbonnier de Bouamari (1973). On y trouve aussi pour finir l’évocation de films beaucoup plus récents, des années 2000, tels que Rachida de Yamina Chouikh (2003)et Révolution Zendj de Tariq Teguia (2013). Mais la réalisatrice ne dit pas où elle en est dans la recherche de sa propre histoire « non encore écrite ».
Denise Brahimi
« CONTRE-POUVOIRS », un film de Malek Bensmaïl (2016)
Depuis le 27 janvier 2016, on peut voir en France le dernier film de Malek Bensmaïl, Contre-pouvoirs, dont la diffusion reste modeste mais l’impact important, d’autant que le réalisateur s’efforce de présenter son film lui-même autant qu’il le peut : à chaque film nouveau on a l’impression qu’on comprend mieux le sens de son entreprise, et en quoi c’est une pierre de plus dans la construction de son Algérie. Dans le cas de Contre-pouvoirs, consacré aux journalistes d’El Watan, c’est de la presse qu’il s’agit, mais même si on doit dire d’emblée qu’on le reçoit comme un magnifique hommage, ce n’est pas ainsi que le film se présente et il vaut la peine d’essayer de comprendre comment le réalisateur (invisible) se situe dans son projet.
 Il s’agit d’un documentaire en ce sens qu’il n’y a aucune trace de fiction. Tout est filmé sur le vif, les images sont celles qu’on aurait vu si on avait été présent aux côtés du réalisateur. Il faut donc préciser le sens du mot documentaire, qui peut correspondre à des pratiques assez différentes. On associe ce mot à l’idée d’une certaine mise à distance d’un savoir plus ou moins commenté, sur un ton plus ou moins didactique, la voix du commentaire devenant parfois le personnage le plus important du film. Rien de tel dans Contre-pouvoirs, où le réalisateur travaille en immersion concrète avec le groupe de journalistes qui nous est montré et se garde bien de faire entendre autre chose que leur voix. On a l’impression que son but principal a été de se faire oublier et qu’il y est très bien parvenu. Mais encore fallait-il pour arriver à cela installer une totale confiance entre les journalistes et le témoin de leurs débats. On ne peut pas dire que la position du réalisateur soit plus ou moins extérieure à celle des gens qu’il montre parce que, dans ce genre de cinéma indépendant, tout le monde est à la fois extérieur à tout le monde et extrêmement proche, c’est tout l’art du directeur Omar Belhouchet que d’arriver chaque jour à faire une synthèse avec tout cela.
Il s’agit d’un documentaire en ce sens qu’il n’y a aucune trace de fiction. Tout est filmé sur le vif, les images sont celles qu’on aurait vu si on avait été présent aux côtés du réalisateur. Il faut donc préciser le sens du mot documentaire, qui peut correspondre à des pratiques assez différentes. On associe ce mot à l’idée d’une certaine mise à distance d’un savoir plus ou moins commenté, sur un ton plus ou moins didactique, la voix du commentaire devenant parfois le personnage le plus important du film. Rien de tel dans Contre-pouvoirs, où le réalisateur travaille en immersion concrète avec le groupe de journalistes qui nous est montré et se garde bien de faire entendre autre chose que leur voix. On a l’impression que son but principal a été de se faire oublier et qu’il y est très bien parvenu. Mais encore fallait-il pour arriver à cela installer une totale confiance entre les journalistes et le témoin de leurs débats. On ne peut pas dire que la position du réalisateur soit plus ou moins extérieure à celle des gens qu’il montre parce que, dans ce genre de cinéma indépendant, tout le monde est à la fois extérieur à tout le monde et extrêmement proche, c’est tout l’art du directeur Omar Belhouchet que d’arriver chaque jour à faire une synthèse avec tout cela.
Documentaire ou pas, le film est donc la représentation de ce qui a été une présence quotidienne pendant quarante-cinq jours au moins, c’est-à-dire la durée de la campagne pour les élections présidentielles, du 3 mars au 17 avril 2014. L’histoire commence à peu près au moment où le Président Bouteflika, âgé de soixante-dix-sept ans, a déposé lui-même au Conseil constitutionnel sa candidature pour un quatrième mandat. Il est au pouvoir depuis 1999 et on le sait gravement malade, ce qui est d’ailleurs clair au vu des quelques photos qu’on a de lui à ce moment-là.
Sans aucun doute et sans aucune réserve, les journalistes d’El Watan déplorent cette candidature et considèrent que leur rôle est de la combattre. L’un des membres de la rédaction fait d’ailleurs partie du mouvement baptisé « Barakat » (ça suffit) qui s’est créé spécialement pour manifester contre cette candidature. Cependant, il ne serait pas exact de voir dans Contre-pouvoirs un film engagé dans un combat politique contre le Président Bouteflika. Malek Bensmaïl ne confond certainement pas son rôle de cinéaste avec celui des journalistes qu’il a voulu montrer.
 Donc par rapport à ce que serait un film destiné à dénoncer la fameuse « candidature pour un quatrième mandat », on pourrait dire que le réalisateur agit indirectement et opère une sorte de décentrement. Il nous montre des hommes et des femmes, les journalistes, qui doivent faire face à cet événement alors qu’ils le trouvent inacceptable et en sont gravement choqués. Mais eux non plus, pas plus que le réalisateur, n’ont pour métier d’exprimer leurs états d’âme (ce qu’ils ne se privent pas de faire entre eux, évidemment, et avec l’ironie ou l’amertume qui convient). Il leur faut commenter les faits et commenter le rejet qu’ils ne peuvent manquer d’inspirer aux citoyens d’Algérie, d’une façon qui soit à la fois immédiatement claire et pourtant solidement argumentée. C’est donc finalement à la recherche des mots pour le dire et des mots les plus appropriés, que le réalisateur nous fait assister. En sorte que si l’on ne craignait d’être un peu ridicule, on pourrait dire que ce film est notamment une remarquable leçon de langue française, inspirant la plus grande admiration pour des gens qui l’utilisent avec tant d’acuité, dans un pays où on ne cesse de nous dire qu’elle se perd de plus en plus —ce qui est tout à fait plausible et facilement observable. Même sur le plan linguistique, ce sont donc des hommes qui se battent et qui le font avec autant de modestie que de persévérance voire d’acharnement.
Donc par rapport à ce que serait un film destiné à dénoncer la fameuse « candidature pour un quatrième mandat », on pourrait dire que le réalisateur agit indirectement et opère une sorte de décentrement. Il nous montre des hommes et des femmes, les journalistes, qui doivent faire face à cet événement alors qu’ils le trouvent inacceptable et en sont gravement choqués. Mais eux non plus, pas plus que le réalisateur, n’ont pour métier d’exprimer leurs états d’âme (ce qu’ils ne se privent pas de faire entre eux, évidemment, et avec l’ironie ou l’amertume qui convient). Il leur faut commenter les faits et commenter le rejet qu’ils ne peuvent manquer d’inspirer aux citoyens d’Algérie, d’une façon qui soit à la fois immédiatement claire et pourtant solidement argumentée. C’est donc finalement à la recherche des mots pour le dire et des mots les plus appropriés, que le réalisateur nous fait assister. En sorte que si l’on ne craignait d’être un peu ridicule, on pourrait dire que ce film est notamment une remarquable leçon de langue française, inspirant la plus grande admiration pour des gens qui l’utilisent avec tant d’acuité, dans un pays où on ne cesse de nous dire qu’elle se perd de plus en plus —ce qui est tout à fait plausible et facilement observable. Même sur le plan linguistique, ce sont donc des hommes qui se battent et qui le font avec autant de modestie que de persévérance voire d’acharnement.
La sympathie qu’on éprouve pour les personnages du film est indéniable et on peut supposer qu’aucun spectateur du film n’y échappe. Chacun de nous est sans doute sensible plus particulièrement à telle ou telle de leur qualité. Pour revenir sur deux de celles qui viennent d’être citées, modestie et persévérance, il est utile d’avoir à la mémoire quelques images des débats, parfois des dialogues, toujours vivaces mais sans violence ou agressivité. Le sentiment de modestie vient du fait qu’on a l’impression d’assister non pas à des prestations journalistiques mais à du bricolage intelligent. Si par exemple on a à l’esprit l’un des nombreux films que le cinéma américain consacre à la presse en tant que pilier de la démocratie, on en garde le sentiment d’être un peu sonné par le cliquetis, le brio, l’agitation, la corruption rampante, l’importance des dessous non-dits et des petits ou grands calculs d’avancement etc. Or le film de Malek Bensmaïl nous montre qu’on peut parfaitement faire un journal et pas des moindres sans tout ce fatras spectaculaire et certes impressionnant mais qui peut parfois donner l’impression que la montagne accouche d’une souris. Autres lieux autres mœurs, autre cinéma, le film de Malek Bensmaïl est émouvant parce qu’il est juste à hauteur d’hommes, des hommes qui font ce qu’ils croient devoir faire et qui ne se plaignent pas.
La persévérance et l’obstination donnent l’impression de venir d’une longue habitude, celle de se battre sans résultat immédiat comme le prouve encore cette affaire d’élection. Bouteflika réélu avec 81,53% des voix, soit 8 millions et demi de personnes qui auraient voté pour lui, ce n’est pas facile à entendre, même si plus ou moins on s’en doutait. On souffre pour ces journalistes parce qu’il est évident qu’eux-mêmes souffrent et qu’isl le font sous nos yeux, sans faux-semblant. Et en même temps on sait très bien qu’ils vont continuer à se battre. Comme pour la construction de leurs nouveaux locaux, les choses iront sans doute lentement ( !) mais ce n’est pas pour autant que des gens de cette trempe vont baisser les bras. Finalement, on n’a qu’une envie, c’est de les remercier d’être comme ils sont.
Denise Brahimi
(écrit en 2016 et d’une brûlante actualité en mars 2019 et republié pour cette raison)
« LES PROPHETES DU 7ème ART », magazine L’Obs (article pp. 32-34) du 7 au 13 mars 2019
L’importance prise par la mobilisation des Algériens pendant la période pré-électorale qu’ils vivent actuellement incite la presse française à mener et à publier des enquêtes plus fouillées qu’à l’ordinaire. La participation des cinéastes aux mouvements en cours  est un sujet tout à fait intéressant, traité par la journaliste Nathalie Funès, qui complète et précise ce que nous avaient fait pressentir certains films récents, pour la plupart objets de chronique dans La Lettre de Coup de soleil, en sorte que les noms de plusieurs de ces cinéastes sont peut-être connus de nos lecteurs. De toute manière et pour dire les choses d’une autre façon, il y a déjà longtemps que ce ne sont plus des inconnus, dans un métier où il faut pourtant beaucoup e temps avant de se faire un nom.
est un sujet tout à fait intéressant, traité par la journaliste Nathalie Funès, qui complète et précise ce que nous avaient fait pressentir certains films récents, pour la plupart objets de chronique dans La Lettre de Coup de soleil, en sorte que les noms de plusieurs de ces cinéastes sont peut-être connus de nos lecteurs. De toute manière et pour dire les choses d’une autre façon, il y a déjà longtemps que ce ne sont plus des inconnus, dans un métier où il faut pourtant beaucoup e temps avant de se faire un nom.
Le premier trait qui frappe est qu’il s’agit d’un phénomène générationnel, la plupart d’entre eux appartenant à une génération qui a entre 40 et 50 ans. Pour le dire en toute précision, cette tranche d’âge va de 40 ans, s’agissant de Sofia Djama réalisatrice des Bienheureux (2017), un film de fiction qui a eu beaucoup de succès, à 53 ans, l’âge de Malek Bensmaïl, auteur de nombreux documentaires très approfondis sur la vie actuelle en Algérie, notamment celui qui s’intitule Contrepouvoirs (2015) et qui montre au travail les journalistes du quotidien El Watan (=« La Nation »). Deux autres exemples non moins importants confirment l’appartenance à cette même génération, celui de Karim Moussaoui qui a 43 ans et qui s’est fait connaître récemment comme réalisateur de En attendant les hirondelles (2017), et Lyes Salem âgé de 45 ans, sans doute le plus populaire parce qu’il s’appuie sur effets comiques pour séduire un vaste public ; on peut citer de lui L’Oranais (2014) ou encore le plus ancien Mascarades (2008).
D’ailleurs tous ces cinéastes, car aux réalisateurs se joignent à l’occasion acteurs et techniciens, sont très conscients d’appartenir à un même mouvement tant il est vrai que c’est toujours en se groupant qu’on peut acquérir plus d’efficacité. Pour donner un corps et un nom au groupe qu’ils constituent, ils ont créé le CRAC, Collectif pour un renouveau algérien du cinéma. Le seul mot de renouveau, dans un pays comme l’Algérie est une prise de position qu’il faudrait pouvoir appeler une prise d’opposition, tant il est vrai que l’immobilisme et la perpétuation du même sont la seule politique officielle. Et point n’est besoin d’insister sur le fait que ce « renouveau »est très exactement ce que signifie le refus catégorique du 5e Mandat.
Il est certain que les œuvres de ces réalisateurs sont maintenant connues à l’échelon international et ont été primées en différents lieux hors de l’Algérie . Mais l’actualité la plus brûlante et la plus urgente fait que leur signification éclate aujourd’hui sans réserve dans le contexte algérien et l’éclaire de toute la lumière que la « lanterne magique », mieux que tout autre, est capable de dispenser.
Denise Brahimi
LIVRE / BD
« BOULEVARD DE L’ABÎME » de Nourredine Saadi (Barzakh 2017)
La Lettre de Coup de soleil rend hommage aux écrivains et artistes qui disparaissent en s’attachant à comprendre et s’il se peut à faire aimer l’une de leurs œuvres, de préférence la dernière, comme c’est le cas ici. En effet ce roman, Boulevard de l’abîme paru en 2017 précède de très peu la mort de l’écrivain, le jeudi 14 décembre 2017.
Cette imminence de la mort a certainement poussé Nourredine Saadi à exprimer son obsession la plus profonde et inaltérable en dépit des années. Il s’agit d’un souvenir et de faits liés à la guerre d’Algérie, à laquelle il n’a pu participer directement lui-même étant né en 1944 mais qui pourtant a occupé une place éminente dans toute son adolescence et qui est restée présente en lui jusqu’à la fin de sa vie, comme cet ultime roman vient justement le prouver.
 Nourredine Saadi étant né à Constantine est particulièrement attaché à cette ville, à laquelle fait allusion le titre du livre Boulevard de l’abîme. Constantine est présente dans le roman à la fois comme lieu réel pendant la période de la guerre et comme lieu mythique dont l’origine se trouve dans le célèbre roman Nedjma de Kateb Yacine. Elle est surtout présente pour une troisième raison qui est historique et que Nourredine Saadi se fait un devoir de rappeler car nul ne devrait jamais l’oublier : il y avait près de la ville une ferme que l’armée française a transformée en centre de torture et que pour cette raison le romancier désigne comme La ferme des supplices. Elle est connue des historiens et d’un nombre non négligeable de personnes informées sous le nom de « ferme Améziane » ; Jean-Luc Einaudi, entre autres, en a parlé dans son livre intitulé La ferme Améziane – Enquête sur un centre de torture pendant la guerre d’Algérie.
Nourredine Saadi étant né à Constantine est particulièrement attaché à cette ville, à laquelle fait allusion le titre du livre Boulevard de l’abîme. Constantine est présente dans le roman à la fois comme lieu réel pendant la période de la guerre et comme lieu mythique dont l’origine se trouve dans le célèbre roman Nedjma de Kateb Yacine. Elle est surtout présente pour une troisième raison qui est historique et que Nourredine Saadi se fait un devoir de rappeler car nul ne devrait jamais l’oublier : il y avait près de la ville une ferme que l’armée française a transformée en centre de torture et que pour cette raison le romancier désigne comme La ferme des supplices. Elle est connue des historiens et d’un nombre non négligeable de personnes informées sous le nom de « ferme Améziane » ; Jean-Luc Einaudi, entre autres, en a parlé dans son livre intitulé La ferme Améziane – Enquête sur un centre de torture pendant la guerre d’Algérie.
Cependant et même si l’on peut penser que ces faits atroces sont le véritable cœur du livre, Nourredine Saadi s’est attaché à construire une fiction romanesque complexe et à plusieurs voix, autour d’un personnage féminin fascinant, dont le comportement énigmatique est le fil conducteur du livre. Pourquoi cette jeune femme, comblée par la vie de tous les biens, richesse et beauté, s’est-elle suicidée, après avoir tenté en vain le recours à une psychanalyse qu’elle évoque dans un certain « carnet noir » dont le roman cite de nombreux extraits ?
Il y a une explication à ce suicide, et le romancier la révèle finalement mais il nous faut laisser les lecteurs en faire la découverte, non sans qu’on la pressente assez vite à travers la polyphonie du roman. Elle est évidemment liée au contexte historique mais on voit à quel point se justifie l’expression de « trauma colonial » employé par la psychanalyste Karima Lazali, car pour ce qui est de la jeune femme future suicidée, il est clair qu’elle ne s’est jamais remise, même après plusieurs décennies, de ce qui lui est arrivé en 1958, alors qu’elle avait dix-sept ans et qu’elle était incapable d’échapper aux manipulations familiales. Le fait d’être fille d’un grand Bachaga comme il y en a eu quelques-uns à l’époque coloniale, loin de l’en avoir préservée, est à l’origine de cette catastrophe irréversible.
Les prévenances d’un riche mari et la passion partagée avec un remarquable amant ne lui ont pas permis davantage d’échapper aux conséquences de son « trauma », terme qu’on peut s’autoriser puisque la psychanalyse est très présente dans le roman. L’histoire d’amour est évoquée de façon convaincante et belle par le romancier, mais on peut conclure de ce qu’il nous raconte à cet égard que selon une formule connue, l’amour ne suffit pas. Et ce constat sous-jacent fait partie de la mélancolie qui se dégage du livre, fondée sur le sentiment qu’ on ne se débarrasse pas d’un certain passé, quoi qu’il en soit de la vie vécue au présent— et pas même si elle l’est avec un bonheur apparent.
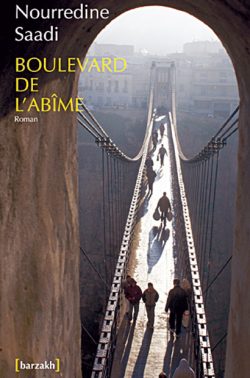 Cette cruelle vérité ne vaut pas que pour l’héroïne du livre et son destin tragique. Noureddine Saadi a équilibré son roman en y donnant une place non moins grande à un autre personnage qui fait partie des voix constituant son tissu polyphonique. Il s’agit d’un Français poursuivi par son passé qui ressurgit à l’improviste. Pendant la guerre d’Algérie et en particulier pendant cette terrible année 1958 qui a fracassé la vie de l’héroïne, il était soldat dans l’armée française (du nombre de ceux qu’on nommait les « appelés » ) et très révulsé par certaines scènes auxquelles il lui était donné d’assister—alors même qu’on voulait faire de lui un soldat d’élite particulièrement doué pour la répression. Il n’a pu ignorer à l’époque ce qui se passait à la ferme Améziane, mais il est évident que plusieurs décennies après ces pénibles événements, rien ne le préparait à les voir resurgir comme ils vont le faire cependant. Dans l’intervalle il est devenu inspecteur de police en France et le hasard fait que c’est lui qui se trouve chargé de l’enquête et du rapport sur le suicide de la belle Algérienne dont le geste lui paraît énigmatique. Quelques circonstances vont l’amener à l’identifier à la jeune fille de dix-sept ans qui s’est trouvée mêlée aux événements de Constantine en 1958 ; et c’est ainsi qu’ il se trouve rattrapé par un passé dont le retour ne peut manquer de le perturber gravement.
Cette cruelle vérité ne vaut pas que pour l’héroïne du livre et son destin tragique. Noureddine Saadi a équilibré son roman en y donnant une place non moins grande à un autre personnage qui fait partie des voix constituant son tissu polyphonique. Il s’agit d’un Français poursuivi par son passé qui ressurgit à l’improviste. Pendant la guerre d’Algérie et en particulier pendant cette terrible année 1958 qui a fracassé la vie de l’héroïne, il était soldat dans l’armée française (du nombre de ceux qu’on nommait les « appelés » ) et très révulsé par certaines scènes auxquelles il lui était donné d’assister—alors même qu’on voulait faire de lui un soldat d’élite particulièrement doué pour la répression. Il n’a pu ignorer à l’époque ce qui se passait à la ferme Améziane, mais il est évident que plusieurs décennies après ces pénibles événements, rien ne le préparait à les voir resurgir comme ils vont le faire cependant. Dans l’intervalle il est devenu inspecteur de police en France et le hasard fait que c’est lui qui se trouve chargé de l’enquête et du rapport sur le suicide de la belle Algérienne dont le geste lui paraît énigmatique. Quelques circonstances vont l’amener à l’identifier à la jeune fille de dix-sept ans qui s’est trouvée mêlée aux événements de Constantine en 1958 ; et c’est ainsi qu’ il se trouve rattrapé par un passé dont le retour ne peut manquer de le perturber gravement.
Le portrait de ce jeune Français, entraîné malgré lui dans les horreurs de la Guerre d’Algérie et obligé d’y participer alors qu’elle le révolte, donne au roman de Noureddine Saadi une dimension humaine au sens humaniste du mot. Rien de moins manichéen que cette vision d’une situation historique, la guerre, qui incite trop souvent à partager le monde en deux camps ennemis, ici ce serait les Algériens et les Français. Dans Boulevard de l’abîme, il y a certes une dénonciation qui est vive et violente, mais elle porte sur des faits, certainement pas sur un peuple ni une nation, encore moins une culture. Des valeurs universelles ne cessent de vouloir affleurer et d’ailleurs elles y parviennent souvent ; cependant elles ne peuvent empêcher que l’Histoire (comme ensemble d’événements) ne comporte des relents barbares, qu’on voudrait croire inhumains. Ils semblent sortis des profondeurs méphitiques de l’abîme, évoqué dès le titre du roman.
Denise Brahimi

« LA TYRANNIE DU COMMUN. Propos intempestifs sur la société marocaine », de Hassan Wahbi, Casablanca, La Croisée des chemins, coll. Essais sur fond blanc, 2018, 185 pages, 85 MAD / 18 €.
 Professeur de littérature francophone, spécialiste de l’œuvre de Abdelkébir Khatibi, Hassan Wahbi est aussi poète. Son dernier ouvrage, publié sous le titre de La Tyrannie du commun, relève de l’essai. Il s’agit d’un ensemble d’articles qui abordent la notion de « commun » au sens de ce qui fait communauté (« comme un »), mais aussi de ce qui est ordinaire et banal. Si la complexité de la question n’échappe à personne, chez Wahbi, c’est cette polarisation du commun en tyrannie qui constitue le fil rouge de l’ouvrage. L’auteur propose en effet une réflexion sur ce qui dysfonctionne dans sa société. Le raisonnement soutenu par une culture clairement universelle et une éthique humaniste s’énonce sur un ton polémique assumé. La démarche se veut, en effet, « confrontation entre l’expérience inachevée (du sujet) et la puissance affirmée (la tyrannie du commun) » (p. 14-15).
Professeur de littérature francophone, spécialiste de l’œuvre de Abdelkébir Khatibi, Hassan Wahbi est aussi poète. Son dernier ouvrage, publié sous le titre de La Tyrannie du commun, relève de l’essai. Il s’agit d’un ensemble d’articles qui abordent la notion de « commun » au sens de ce qui fait communauté (« comme un »), mais aussi de ce qui est ordinaire et banal. Si la complexité de la question n’échappe à personne, chez Wahbi, c’est cette polarisation du commun en tyrannie qui constitue le fil rouge de l’ouvrage. L’auteur propose en effet une réflexion sur ce qui dysfonctionne dans sa société. Le raisonnement soutenu par une culture clairement universelle et une éthique humaniste s’énonce sur un ton polémique assumé. La démarche se veut, en effet, « confrontation entre l’expérience inachevée (du sujet) et la puissance affirmée (la tyrannie du commun) » (p. 14-15).
L’ouvrage se présente comme un recueil de textes aux thèmes divers, bien que certains entretiennent des résonances évidentes les uns avec les autres. Le premier porte sur la question de l’identité marocaine (ou « marocanité ») et semble présider à tous les articles suivants. Cet ancrage ontologique n’en est pas vraiment un puisque le titre « Comment peut-on être marocain ? » n’est qu’un détournement oblique de la question qui clôt la XXXe « lettre persane » de Montesquieu. Wahbi propose de repenser ce qui fait le socle impensé de l’identité « marocaine » en se référant également au collectif coordonné par Abdesselem Cheddadi sous le même titre . Ce commun qui devrait constituer le socle de la marocanité est alors analysé à travers les valeurs de la tradition, ou plutôt « Tradition », lorsqu’elle est sacralisée et qu’elle implique le culte, qu’elle devient négation de toute subjectivité. Or, nous rappelle l’auteur, la subjectivité est précisément ce qui « permet d’octroyer un rôle au sujet qui déjoue les apparences, évite les idées reçues, s’implique dans une expérience spécifique du monde » (p. 14).
La religion en tant que ciment communautaire est interrogée non seulement en tant qu’ensemble de valeurs censées être partagées, mais en particulier, en tant qu’ensemble d’injonctions qui pèsent sur les individus. Une analyse fine d’une insulte qui revient souvent dans les propos au Maroc et qui associe religion et nationalité, devient comme le montre Wahbi un indice révélateur d’une conflictualité refoulée qui s’épanche à travers la performativité de l’injure.
L’analyse de faits de société parcourus englobe les lieux de savoir (bibliothèques, universités) et les postures (complaisance, superficialité, bavardage, imposture, absence d’écoute, absence de créativité). L’état des lieux pointe tout particulièrement un anti-intellectualisme galopant, et de solides recherches sont invisibilisées au moment où des imposteurs sont hissés au sommet et célébrés.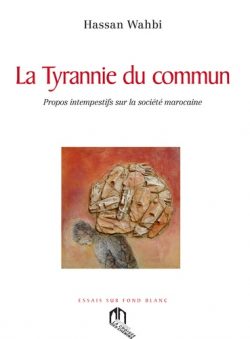
Le propos est acerbe, soutenu par des anecdotes et des observations cliniques. C’est un procès sans complaisance d’une société « malade d’elle-même », qui peine à accoucher de sa modernité et préfère se réfugier dans le simulacre d’une patrimonialisation frénétique et d’une accumulation de références hétéroclites, ce que l’auteur surnomme le « kitsh marocain ». Ce sont ces « sincérités successives », écrit l’auteur non sans humour, en référence à Jacques Ellul, qui expliquent par exemple l’association d’un jean hyper-moulant et d’un foulard islamiquement correct chez une même personne.
Propos intempestifs (à contretemps et à contrecourant) puisqu’en digne héritier de Abdelkébir Khatibi, pour Hassan Wahbi, il s’agit de « se mettre dans une infidélité stratégique » et de s’inscrire dans les « marges en éveil » (Khatibi). C’est une manière d’exprimer son inquiétude face à « l’asservissement banalisé, silencieux » (p. 15) non pas à ce qui relie (du latin religare), mais à ce qui enchaîne. En articulant le savoir universitaire et l’expérience vécue, cette réflexion permet de reconnaitre des traits de nombreuses sociétés en transition et par ricochet des sociétés postmodernes. Car ce caractère homogénéisateur, cette répétition infinie du même ne la trouve-t-on pas aussi, d’une toute autre manière, dans certains visages du capitalisme et de l’industrie ?
Écrit en français, cet essai pose néanmoins la question du public visé et de l’horizon consensuel recherché. Il mériterait d’être traduit non seulement dans les langues marocaines (arabes fusha et darija, berbère·s), mais aussi en actes médiatiques et en politiques culturelles.
Touriya Fili-Tullon
L’auteur : Hassan Wahbi est professeur de littérature à l’Université Ibn-Zohr, à Agadir.
« L’ISLAM INCERTAIN – REVOLUTIONS ET ISLAM POST-AUTORITAIRE » de Hamadi REDISSI
(Cérès Editions, 2017)
 Hamadi Redissi est Professeur de sciences politiques à l’Université de Tunis. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et études sur le monde arabo-musulman rédigés dans une perspective comparative et pluridisciplinaire (histoire, théorie et sociologie politiques). Il a bénéficié de nombreuses bourses de différentes fondations. Il est membre de l’A.I.M.S. (American Institute For Maghreb Studies), ainsi que du conseil de rédaction des revues Jura Gentium (Florence) et Iris (European Journal of Philosophy and Public Debate). Impliqué dans le débat public en Tunisie, il est président d’honneur de l’Observatoire Tunisien de la Transition Démocratique.
Hamadi Redissi est Professeur de sciences politiques à l’Université de Tunis. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et études sur le monde arabo-musulman rédigés dans une perspective comparative et pluridisciplinaire (histoire, théorie et sociologie politiques). Il a bénéficié de nombreuses bourses de différentes fondations. Il est membre de l’A.I.M.S. (American Institute For Maghreb Studies), ainsi que du conseil de rédaction des revues Jura Gentium (Florence) et Iris (European Journal of Philosophy and Public Debate). Impliqué dans le débat public en Tunisie, il est président d’honneur de l’Observatoire Tunisien de la Transition Démocratique.
Dans « L’Islam incertain, Révolutions et islam post-autoritaire », publié chez Cérès Editions en 2017, l’auteur convoque trois grandes questions qui agitent le monde arabe postrévolutionnaire, à savoir la révolution, la démocratie et l’islamisme, leurs vérités et leurs agencements entre dérives et accommodements.
Hamadi Redissi poursuit sa réflexion, initiée dans « la tragédie de l’islam moderne » entre autres, sur le jeu des islamistes dans des contextes nationaux et internationaux instables et mouvants, en partant d’exemples concrets, de la Turquie à la Tunisie. Avant même le début des dites révolutions arabes, Hamadi Redissi montrait déjà que l’islam traversait une crise. Il constatait que l’islam avait perdu son identité rigide mais qu’aucune autorité n’était en mesure de décider ce qu’était le « vrai » islam. Entre tradition et modernité, il oscillerait et pratiquerait le mélange et la cohabitation.
Dans « l’islam incertain », publié quelques années après le début des révolutions arabes, à travers des exemples concrets, tels que la Turquie ou la Tunisie, H. Redissi revient sur cette réflexion, il analyse l’évolution de la place de l’islam post-autoritaire dans les pays arabo-musulmans et montre que rien n’est encore définitivement tranché, d’où ce titre : l’islam incertain.
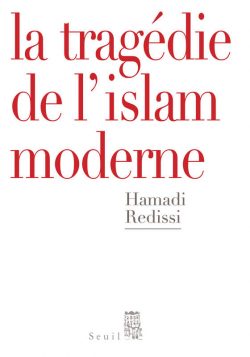 Cet ouvrage se décompose en trois parties :
Cet ouvrage se décompose en trois parties :
Dans la première, intitulée « la révolution, un tournant », il analyse, en particulier l’impact des révolutions arabes selon les différents contextes : sunnite ou chiite, pays pauvre ou riche, rural ou urbain. Avec l’émergence de la société civile dans les pays des Révolutions arabes, un environnement favorable à l’accélération du processus démocratique s’était créé. Autonomes, spontanés, les citoyens furent nombreux, lors des manifestations à affirmer leur attachement à la liberté.
Aujourd’hui, nombre de débats relatifs à l’islam présentent leur problématique sous la forme d’une unique alternative : l’abandon de la foi ou l’expression intégraliste. Cette approche a émergé à partir des années 80, dans les pays arabo-musulmans, sous l’impulsion des pays conservateurs du Golfe (Arabie Saoudite et Qatar) qui tentent d’imposer un conservatisme de plus en plus dogmatique au sein de nos sociétés par le biais de différents mouvements islamistes, intégristes ou salafistes.
D’ailleurs, le terme même de laïcité est frappé d’anathème dans le monde arabo-musulman, il est même quasiment synonyme d’athéisme dans certains milieux islamiques. Pour les plus éclairés, la démocratie et le rationalisme suffisent, la laïcité est superflue. D’autres, encore, rejettent ce concept car inadéquat ou non-pertinent dans le monde musulman.
Dans la deuxième partie, intitulée « face à la démocratie », il tente de décrypter comment l’islam (dit antiautoritaire) tente de s’adapter selon les différents contextes. Il analyse les liens subtils entre religion et pouvoir, il montre comment la religion tente de plaquer son propre système de valeurs sur la vie politique.
En se basant sur différents exemples, dont celui de la Tunisie, il analyse l’intégration des partis islamistes au jeu politique, avec une attention particulière portée à l’exercice du pouvoir. Existe-t-il une ligne dominante qui se dégage ? Est-ce que l’inclusion des partis islamistes au champ politique institué les a conduits à développer une conduite « pragmatique » et une idéologie « modérée », ou au contraire, en ont-ils profiter pour tenter d’accaparer le pouvoir et d’imposer leur idéologie ?
Dans la troisième partie, « l’islamisme à répétition », il montre les désillusions des soulèvements arabes. Au départ, l’islam est absent, on pense que l’islam politique s’est assagi, puis réapparaissent différents islamismes, dans une sorte de surenchère, différentes sortes de salafismes.
Dans certains cas ou contextes (Tunisie, Turquie), H. Redissi pointe l’affaiblissement de l’engagement proprement religieux des partis et le renoncement aux projets initiaux de bouleversement de l’ordre politique, institutionnel et social. Cependant, si la diversité interne de l’islamisme n’est plus à démontrer (des djihadistes aux partis politiques), les organisations légales seraient–elles toujours prêtes « à faire des concessions idéologiques » ?
En guise de conclusion, H. Redissi constate que le Monde Arabe hésite toujours entre démocratie et barbarie. Sachant qu’en terme de barbarie, nous avons vraiment l’embarras du choix : barbarie nationaliste dictatoriale, libéralisme sauvage ou barbarie islamiste ou toutes sortes de combinaisons des trois.
Pour discuter de toutes ces questions, ô combien actuelles, nous invitons à Lyon, le professeur Hamadi REDISSI, pour deux conférences :
• 18 avril 2019 de18h30 à 21h30, à la Maison des Passages, il abordera la libre pensée dans le monde arabo-musulman d’hier et d’aujourd’hui.
• 19 avril 2019 de 18h30 à 20h30, au salon du Conseil de la mairie de Lyon 1er, il abordera la question de l’islam, de la démocratie et de la laïcité dans le Monde arabe.
Mouloud HADDAK
23 mars 2019
« LE GENRE INTRAITABLE, politiques de la virilité dans le monde musulman » de Nadia Tazi Actes Sud, 2018
La collection dans laquelle les éditions Actes Sud viennent de publier ce livre s’intitule « Questions de société » et il est vrai qu’il paraît difficile de préciser davantage tant l’auteure touche à des sujets nombreux et variés. Le fait remarquable est qu’il ne s’agit jamais de survol ni de résumé mais au contraire d’analyses extrêmement détaillées, précises et fondées sur un savoir approfondi. Elle mobilise un ensemble de connaissances, historiques, sociologiques, philosophiques, politiques etc. Mais on échappe aux difficultés de lecture qu’entraîne parfois l’érudition grâce à une écriture littéraire qui procure le plaisir d’une langue à la fois inventive et châtiée.
 Si donc on se met au travail pour suivre l’auteure dans son long parcours exhaustif à travers le monde musulman, et aussi bien dans l’espace que dans le temps, on trouve dans les deux premiers chapitres les bases historiques et conceptuelles qui vont guider par la suite tout l’ensemble de sa recherche. Les deux notions de base qu’il s’agit de mettre au point sont, pour la première, qui nous emmène au désert et chez les Bédouins, la virilité, comme on pouvait s’y attendre d’après le titre général de l’ouvrage ; et pour la seconde le masculin, alors qu’on aurait peut-être attendu, symétriquement, la masculinité, mais ce mot laisserait supposer une analyse conceptuelle alors qu’il s’agit concrètement d’une analyse de la cité islamique telle que conçue par le Prophète et dans sa succession immédiate. Pour plus de clarté il s’agissait d’abord de bien distinguer la signification de ces deux mots en insistant sur leur différence. Et comme elle sait bien qu’il y aura par la suite des mélanges ou des contaminations de l’un par l’autre, l’auteur fait d’abord une sorte d’inventaire de tout ce qui les différencie à commencer par leurs lieux de formation et de développement, le désert maghrébin pour la virilité, la cité pour l’islam coranique dont le Prophète a défini les fondements. Il y a aussi une succession chronologique qui fait que le premier chapitre, sur la virilité, se passe à l’ère préislamique, tandis que pour le second, nous sommes en islam, et c’est l’apport considérable de cette religion qui permet de comprendre ce qu’il en est du masculin musulman.
Si donc on se met au travail pour suivre l’auteure dans son long parcours exhaustif à travers le monde musulman, et aussi bien dans l’espace que dans le temps, on trouve dans les deux premiers chapitres les bases historiques et conceptuelles qui vont guider par la suite tout l’ensemble de sa recherche. Les deux notions de base qu’il s’agit de mettre au point sont, pour la première, qui nous emmène au désert et chez les Bédouins, la virilité, comme on pouvait s’y attendre d’après le titre général de l’ouvrage ; et pour la seconde le masculin, alors qu’on aurait peut-être attendu, symétriquement, la masculinité, mais ce mot laisserait supposer une analyse conceptuelle alors qu’il s’agit concrètement d’une analyse de la cité islamique telle que conçue par le Prophète et dans sa succession immédiate. Pour plus de clarté il s’agissait d’abord de bien distinguer la signification de ces deux mots en insistant sur leur différence. Et comme elle sait bien qu’il y aura par la suite des mélanges ou des contaminations de l’un par l’autre, l’auteur fait d’abord une sorte d’inventaire de tout ce qui les différencie à commencer par leurs lieux de formation et de développement, le désert maghrébin pour la virilité, la cité pour l’islam coranique dont le Prophète a défini les fondements. Il y a aussi une succession chronologique qui fait que le premier chapitre, sur la virilité, se passe à l’ère préislamique, tandis que pour le second, nous sommes en islam, et c’est l’apport considérable de cette religion qui permet de comprendre ce qu’il en est du masculin musulman.
Pour toucher au plus près la mentalité du désert, Nadia Tazi s’appuie beaucoup sur Les Dix Grandes Odes arabes de l’anté-Islam chères à Jacques Berque qui les a publiées en 1979. Elle s’en aide pour comprendre la mentalité des grands nomades chameliers qui dominaient alors la société, caste guerrière dont les valeurs permettent de définir la virilité aristocratique du désert : courage, volonté de puissance, guerre et amour sont les éléments constants qu’on retrouve dans l’affirmation de soi viriliste. Elle est fondée sur la réputation et l’honneur mais d’une manière qui nous semble paradoxale, conjugue en les portant jusqu’à l’extrême la prodigalité et la rapacité.
Lorsqu’apparaissent l’islam et la cité, le masculin va s’élever contre ces excès, mais sans éliminer le désert ni la virilité, qui survivent principalement à travers la coutume. Cependant la souveraineté de Dieu dans l’islam implique une maîtrise des passions qui elle-même définit une tout autre éthique. Celle-ci n’a rien de stable ni de définitif, il s’agit plutôt d’une lutte continuelle, une « morale des petits pas » écrit Nadia Tazi commentant Ghazali, ce grand théologien de l’islam du 11e siècle, d’origine persane et représentant admirable du soufisme le plus élévé. Il s’ensuit des positions très nuancées sur la place de la femme et sur la pratique politique. Tableau séduisant, mais les situations réelles tendent à s’appuyer principalement sur la soumission.
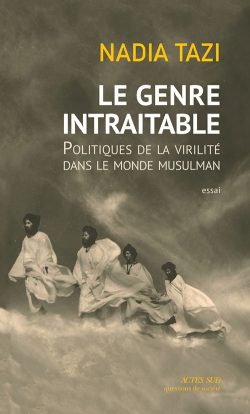 Commence alors une sorte de passage en revue des pratiques repérables au fil des siècles et jusqu’à aujourd’hui à travers le monde musulman ; et c’est surtout à la manière dont y est vécue la virilité (ou des fragments de celle-ci plus ou moins déformés) que l’auteure s’attache. La plus longue de ces études est celle qu’elle consacre à ce qu’elle appelle l’exemple ottoman. On y voit apparaître la notion de despotisme, postérieure à la virilité du désert et au masculin de la cité islamique, et ayant inventé un type de fonctionnement qui a duré plusieurs siècles, ce qui justifie qu’on lui porte un certain intérêt ! D’autant que par suite d’une erreur de jugement dont l’Occident est coutumier, on a souvent déclaré que ce despotisme ottoman tait en pleine décadence et dysfonctionnement, sans voir que ce dysfonctionnement était sans doute un mode de fonctionnement comme un autre et plus durable que beaucoup d’autres ! Cependant il serait difficile d’en donner une vision flatteuse et ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il est certain que la notion de virilité reste très présente dans le despotisme mais Nadia Tazi parle plutôt d’une « imagerie viriliste », propre à justifier différentes formes de domination. Les codes du viril sont en place, pour le reste, c’est plutôt « la domestication et la passivité générale ». Quant au masculin il apparaît comme une forme de sagesse, permettant les négociations nécessaires au maintien et à la survie.
Commence alors une sorte de passage en revue des pratiques repérables au fil des siècles et jusqu’à aujourd’hui à travers le monde musulman ; et c’est surtout à la manière dont y est vécue la virilité (ou des fragments de celle-ci plus ou moins déformés) que l’auteure s’attache. La plus longue de ces études est celle qu’elle consacre à ce qu’elle appelle l’exemple ottoman. On y voit apparaître la notion de despotisme, postérieure à la virilité du désert et au masculin de la cité islamique, et ayant inventé un type de fonctionnement qui a duré plusieurs siècles, ce qui justifie qu’on lui porte un certain intérêt ! D’autant que par suite d’une erreur de jugement dont l’Occident est coutumier, on a souvent déclaré que ce despotisme ottoman tait en pleine décadence et dysfonctionnement, sans voir que ce dysfonctionnement était sans doute un mode de fonctionnement comme un autre et plus durable que beaucoup d’autres ! Cependant il serait difficile d’en donner une vision flatteuse et ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Il est certain que la notion de virilité reste très présente dans le despotisme mais Nadia Tazi parle plutôt d’une « imagerie viriliste », propre à justifier différentes formes de domination. Les codes du viril sont en place, pour le reste, c’est plutôt « la domestication et la passivité générale ». Quant au masculin il apparaît comme une forme de sagesse, permettant les négociations nécessaires au maintien et à la survie.
De ce type de despotisme, l’auteur passe au néo-despotisme très représenté dans le monde musulman du 20e siècle. Elle fait un sort particulier à Saddam Hussein que manifestement elle a étudié de près et dont elle fait un portrait fort peu flatteur. Elle explique comment chez un dictateur comme lui la virilité prend une forme fasciste ou fascistoïde. Mais surtout elle ne pouvait manquer d’en venir pour finir aux différentes références à la virilité qui composent l’islamisme contemporain, examinant les formes qu’il prend ou qu’il a pu prendre dans l’Iran de Khoméini, en Arabie Saoudite ou chez les Afghans. Elle est amenée à employer une formule telle que « l’ordre islamico-despotique » et à montrer comment les prescriptions virilistes y semblent complétement intégrées à l’islam, définition et pratiques. De manière très dangereuse, la virilité s’est installée dans la banalité du quotidien, son excès met en échec ce qu’a été et ce que pourrait être la civilité islamique.
Denise Brahimi
« DES MILLE ET UNE FAÇONS D’ÊTRE JUIF OU MULSULMAN » de Delphine Horvilleur et Rachid Benzine. Dialogue, éditions du Seuil, 2018
 Si l’on ajoute aux indications données par le titre la présence dans ce livre d’un troisième personnage, Jean-Louis Schlegel, organisateur du dialogue annoncé et qui, lui, est notoirement chrétien, on aura vite compris l’importance du mot « dialogue ». Il désigne ici ce qu’on a coutume d’appeler un dialogue interreligieux, ce qui, dans le contexte des problèmes contemporains, signifie un dialogue entre les représentants des trois monothéismes, juif, chrétien, musulman.
Si l’on ajoute aux indications données par le titre la présence dans ce livre d’un troisième personnage, Jean-Louis Schlegel, organisateur du dialogue annoncé et qui, lui, est notoirement chrétien, on aura vite compris l’importance du mot « dialogue ». Il désigne ici ce qu’on a coutume d’appeler un dialogue interreligieux, ce qui, dans le contexte des problèmes contemporains, signifie un dialogue entre les représentants des trois monothéismes, juif, chrétien, musulman.
Cependant cette façon habituelle de présenter les choses ne rend pas compte du plus important, ici le ton du dialogue, dû à la personnalité des deux auteurs annoncés, à leur jeunesse, à leur enthousiasme et à leur accord très profond. Et pourtant la partie n’était pas gagnée  d’avance, tant il y a dans le monde actuel de raisons supposées, apparentes ou réelles mais très souvent évoquées, pour qu’on s’attende à buter sur des obstacles insurmontables. Les deux « religions du livre » représentées dans cet excellent « Des Mille et une façons d’être juif ou musulman » apparaissent généralement comme des frères ennemis et d’autant plus ennemis que proches.
d’avance, tant il y a dans le monde actuel de raisons supposées, apparentes ou réelles mais très souvent évoquées, pour qu’on s’attende à buter sur des obstacles insurmontables. Les deux « religions du livre » représentées dans cet excellent « Des Mille et une façons d’être juif ou musulman » apparaissent généralement comme des frères ennemis et d’autant plus ennemis que proches.
De plus Delphine Horvilleur est rabbin, ce qui est suffisamment rare chez une femme pour que la chose soit maintenant bien connue, et le moins qu’on puisse dire est que ce métier oblige, croirait-on, à une certaine orthodoxie. Il faut cependant préciser qu’elle appartient à la mouvance libérale des Juifs de France et qu’elle conçoit la religion et la foi avec une très grande liberté. Pour ce qui est de Rachid Benzine il est islamologue, mais il se considère aussi comme le disciple du protestant Paul Ricœur et du philosophe Michel Foucault et il est clairement à l’opposé de l’islam fondamentaliste.  Nous avons donc affaire à deux personnes en dialogue qui se rejoignent dans une même conception de ce que la religion n’est pas, de ce qu’elle ne devrait pas être, quels que soient les textes de référence dans lesquels il n’est pas question pour eux de se cantonner. Si exégèse il y a, elle n’a de sens que si elle déborde le texte et l’interprète dans le sens d’une ouverture, à l’opposé de tout immobilisme et encore plus d’un retour au passé.
Nous avons donc affaire à deux personnes en dialogue qui se rejoignent dans une même conception de ce que la religion n’est pas, de ce qu’elle ne devrait pas être, quels que soient les textes de référence dans lesquels il n’est pas question pour eux de se cantonner. Si exégèse il y a, elle n’a de sens que si elle déborde le texte et l’interprète dans le sens d’une ouverture, à l’opposé de tout immobilisme et encore plus d’un retour au passé.
Le plaisir qu’il y a à lire ce dialogue est qu’on y trouve deux personnes qui sur le fond sont profondément d’accord et de ce fait peuvent entrecroiser très souplement leur pensée. Il n’y a pas l’ombre d’une agressivité ni chez l’un ni chez l’autre, ni entre eux ni même comme on pourrait s’y attendre contre les représentants non libéraux de leur religion. Le problème n’est jamais de pourfendre l’ennemi et l’on comprend ainsi quelle facilité il y a dans l’attitude inverse qui est de loin la plus répandue. Une des phrases les plus significatives, pour laquelle ils associent leurs deux noms, est celle-ci : « Nous en sommes convaincus : être « héritier » ne consiste pas à mettre ce qui a été reçu dans un coffret fermé à clef, mais à le faire fructifier. Cela ne consiste pas à reproduire à l’identique ce qui a été reçu, mais à le renouveler. »
Ce livre est absolument indispensable pour équilibrer la vision sinistre de la religion que l’on doit aux fondamentalismes et aux mouvements identitaires. Bien que ses deux auteurs se soient déjà révélés auparavant, on est tenté de dire que c’est la bonne surprise dont nous avions besoin et envie.
Denise Brahimi
« LES CALIFES MAUDITS-La Déchirure » de Héla OUARDI (Albin Michel 2019)
Hela Ouardi est professeur de littérature et de civilisation françaises, et chercheur associé au Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM) au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Héla Ouardi vient de publier son nouveau livre, La déchirure, premier ouvrage d’une série historique consacrée aux quatre premiers califes de l’islam, Les Califes maudits, aux éditions Albin Michel, février 2019.
Dans son précédent ouvrage, « Les Derniers Jours de Muhammad », déjà édité chez Albin Michel en 2016, l’universitaire tunisienne H. Ouardi a mené une enquête sur les derniers jours du prophète de l’islam. En effet, elle a étudié la maladie, l’agonie et la mort de Muhammad en explorant l’historiographie classique tout en confrontant les sources aussi bien sunnites que chiites. Son travail est mené de pair avec la recherche contemporaine à propos de cette période de transition entre le « moment mohammadien » et le « fait islamique » inscrit dans l’histoire. Une histoire dé-dogmatisée et non idéologisée.
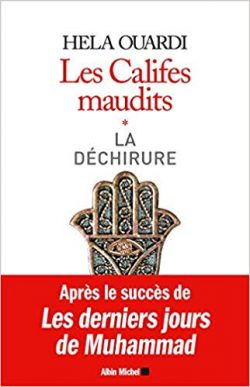 A la suite de l’intérêt suscité par « Les Derniers Jours de Muhammad », Héla Ouardi est allée creuser dans les replis des sources les plus classiques pour reconstituer cette histoire secrète. C’est dire que ce livre brise l’imaginaire musulman qui a tendance à présenter l’époque des califes comme un temps idyllique. Un premier volume intitulé « La déchirure » retrace les trahisons, les pactes secrets, la corruption et les menaces de mort des premiers compagnons du prophète pour s’emparer du pouvoir.
A la suite de l’intérêt suscité par « Les Derniers Jours de Muhammad », Héla Ouardi est allée creuser dans les replis des sources les plus classiques pour reconstituer cette histoire secrète. C’est dire que ce livre brise l’imaginaire musulman qui a tendance à présenter l’époque des califes comme un temps idyllique. Un premier volume intitulé « La déchirure » retrace les trahisons, les pactes secrets, la corruption et les menaces de mort des premiers compagnons du prophète pour s’emparer du pouvoir.
Les acteurs sont tous des figures emblématiques de l’islam naissant : Abû Bakr, le plus proche Compagnon, ‘Umar, son second impétueux et violent, ‘Alî, le gendre bien-aimé, Fâtima, la fille chérie au destin funeste, qui lancera une terrible malédiction à ses spoliateurs, les futurs premiers califes.
Dans ses interviews, Héla Ouardi a souvent parlé de tragédie, en évoquant la succession de Muhammad, il était prévisible qu’elle finisse par en écrire le récit sous forme d’une pièce de théâtre, une tragédie. Nous découvrons une tragédie en trois actes :
Acte I : Conclave dans la saqîfa
 Dans cet acte, Héla Ouardi revient sur le contexte sociopolitique à la mort de Muhammad. Elle décrit les différents clans, les alliances qui se sont nouées au fil du temps et les oppositions. Entre les Mecquois, les Médinois (Ansars), les Emigrants (ceux qui ont accompagné Muhammad lors de sa fuite de la Mecque à Médine) et la famille de Muhammad vont se nouer et se défaire des alliances, au gré des candidatures à la succession. Ils se réuniront en conclave dans la saqîfa, mais ils ne parviendront à aucun accord. Les Mecquois, derrière Abu Bakr et Omar, veulent prendre le pouvoir. Les Médinois (Ansars) et leurs alliés n’ont pas l’intention de les laisser faire, mais commettent des erreurs stratégiques qui vont les diviser. Les Ansars commencent par proposer un chef qui est loin de faire l’unanimité chez leurs alliés. Les Mecquois vont en profiter pour retourner une partie des Médinois. Les opposants à Abu Bakr et à Omar s’allieront finalement autour de la candidature de Ali, le cousin du prophète et mari de sa fille, Fatima. Mais, ce sera trop tard.
Dans cet acte, Héla Ouardi revient sur le contexte sociopolitique à la mort de Muhammad. Elle décrit les différents clans, les alliances qui se sont nouées au fil du temps et les oppositions. Entre les Mecquois, les Médinois (Ansars), les Emigrants (ceux qui ont accompagné Muhammad lors de sa fuite de la Mecque à Médine) et la famille de Muhammad vont se nouer et se défaire des alliances, au gré des candidatures à la succession. Ils se réuniront en conclave dans la saqîfa, mais ils ne parviendront à aucun accord. Les Mecquois, derrière Abu Bakr et Omar, veulent prendre le pouvoir. Les Médinois (Ansars) et leurs alliés n’ont pas l’intention de les laisser faire, mais commettent des erreurs stratégiques qui vont les diviser. Les Ansars commencent par proposer un chef qui est loin de faire l’unanimité chez leurs alliés. Les Mecquois vont en profiter pour retourner une partie des Médinois. Les opposants à Abu Bakr et à Omar s’allieront finalement autour de la candidature de Ali, le cousin du prophète et mari de sa fille, Fatima. Mais, ce sera trop tard.
Acte II : Un calife sans royaume. Par la ruse et le jeu des alliances, les Quraychites réussissent à imposer Abu Bakr, comme calife. Mais, il sera immédiatement contesté. Beaucoup de clans refuseront de lui faire allégeance. Son pouvoir est chancelant. Lui-même était-il vraiment prêt à assumer cette responsabilité ? Il aurait préféré que ce soit Omar ou un autre.
Acte III : La malédiction. Les proches du prophète seront contraints par la force de faire allégeance au calife. Il semblerait que c’est à ce moment-là que Omar frappera Fatima enceinte qui refuse d’obéir. La fille du prophète, sera la plus grande victime de ce conflit, autour de la succession du prophète. Elle sera déshéritée. Ce sera l’œuvre de son ennemie jurée, Aïcha, la fille d’Abu Bakr, la plus jeune épouse du prophète et sa préférée. Elle lancera une malédiction contre Abu Bakr. Elle mourra peu de temps après son père, suite à une fausse couche, probablement des suites de sa violente altercation avec Omar. Cette malédiction hantera le calife Abu Bakr jusqu’à ses derniers jours.
Il faut se représenter le courage qu’il a fallu à cette universitaire maghrébine, pour dire ce que sont ces légendes, en réalité ! Les ouvrages, tels que « les versets sataniques » de Salman Rushdie ou « Lajja » de Taslima Nasrin, ont soulevé des polémiques et des violences paroxystiques, il n’en est rien avec ces deux ouvrages de Héla Ouardi, le mérite lui en revient !
Dans ces 2 premiers ouvrages, Héla Ouardi démystifie la vie du prophète et des compagnons du prophète. Tout comme une autre maghrébine, Houria Abdelouahed, dans « Les femmes du prophète », a contribué à démystifié, et l’homme et ses femmes, en abordant la vie du prophète par le biais de sa vie familiale …
Ainsi on peut en analysant les écrits de l’une et de l’autre, commencer à percevoir le caractère mystificateur des vies idylliques que nous rapportait l’hagiographie des compagnons du prophète et qui avait cours jusqu’au jour d’aujourd’hui …
Et le mérite de Héla Ouardi est de nous raconter tout cela, simplement, avec aplomb, dans un style simple comme s’il s’agissait de la saga familiale d’un quelconque monarque, à l’image de celle des rois maudits de Maurice Druon.
Peut-être que c’est ce style simple qui a contribué à faire que toutes ces révélations soient passées comme une lettre à la poste … Même s’il y a aussi le travail de recherche de l’auteur, un travail minutieux, digne d’une historienne et dont témoignent la centaine de pages de références de chacun des ouvrages.
C’est aussi, un des mérites et non des moindres, des ouvrages de Héla Ouardi, de réussir à ne pas nous incommoder dans la lecture de cette passionnante histoire, par les références et les témoignages qu’elle a réussi à collationner et qui sont regroupés, à chaque fois, en fin d’ouvrage. Réussir à nous épargner la démonstration de cet effort de travail de recherche, mérite toute notre gratitude.
Un autre intérêt de cet ouvrage est l’effort de contextualisation de ces conflits et alliances dans le cadre économique, sociologique et culturel arabe/bédouin de l’époque, qui a eu une influence prépondérante, y compris sur le texte coranique.
Mouloud HADDAK

« CINÉMAS DU SUD », du mercredi 10 au samedi 13 avril 2019, Lyon, Institut Lumière
Les gens qui habitent Lyon ou sa région bénéficient chaque année (depuis 19 ans !) d’un festival de cinéma qui pendant quelques jours leur donne à voir des films de plusieurs pays arabes, dont le Maghreb.
Il ne peut s’agir que d’un choix évidemment restreint, cette année 8 pays et donc 8 films, dont 3 pour les cinémas maghrébins. Les projections ont lieu dans le cadre prestigieux de l’Institut Lumière, lieu historique s’il en est et cher au cœur des cinéphiles. S’y rattache l’équipe de Regard Sud qui gère également, tout au long de l’année, une galerie d’art. Il en résulte une sélection de films que pour la plupart, on n’aurait pas la chance de voir autrement, et qui sont tout à la fois représentatifs des pays d’où ils viennent mais aussi originaux voire inattendus parce qu’on connaît trop mal (sinon pas du tout) les artistes auteurs de ces œuvres.
Pour ce qui concerne les 3 films du Maghreb, tous de l’année 2018, ils sont révélateurs d’une originalité certaine, du moins les recevons-nous comme tels par rapport à ce que nous croyons savoir des caractéristiques dominantes de ces cinémas.
Yasmine Chouikh est réalisatrice du film algérien Jusqu’à la fin des temps. Issue d’une famille de cinéastes, elle n’ignore rien des thématiques qui se sont imposées à ses parents dans les décennies précédentes, mais s’engage dans une toute autre voie. Elle décrit les rapports qui s’instaurent entre une femme et un homme d’âge plus que mûr, et qui ne s’attendaient certainement pas à éprouver des sentiments dont elle analyse la complexité.
Nejib Belkadi, réalisateur tunisien dont le film Regarde-moi était au programme des journées cinématographiques de Carthage en 2018, introduit dans l’histoire de son personnage principal Lotfi, figure assez typique d’immigré, un problème qui est sans doute de tous les pays, celui que pose un enfant autiste, son fils Amr qu’il découvre à l’âge de neuf ans.
Le film du Marocain Mohcine Besri, Une urgence ordinaire, attire l’attention dès son titre, car une urgence ne devrait pas être ordinaire, si ce n’était malheureusement le cas dans les hôpitaux du Maroc pour ne parler que de ce pays. Il faut beaucoup de courage et de délicatesse pour aborder sans pathos l’angoisse des parents d’un petit Ayoub de six ans qui a besoin d’être opéré en urgence pour avoir une chance de survie.
Ceux qui auront la chance de voir ces films y verront comment les cinémas du Maghreb sont incontestablement à la recherche de nouvelles voies.
Denise Brahimi

- Le 4 avril à Lyon, Librairie Terre des Livres, à 19h, rencontre avec Mehdi CHAREF et son dernier livre « Rue des Pâquerettes »
- Le 5 avril à la Maison des Passages, à 19h, conférence/débat de Hassan WAHBI autour de son livre « La tyrannie du commun ».
- Le 9 avril, de 14 à 18h à l’ENS de Lyon, Amphi Descartes rencontre autour du livre collectif « Ecrire l’histoire de l’Algérie » en hommage à l’historien Gilbert Meynier
- Le 9 avril, à 18h45 au Cinéma Lumière Bellecour, projection suivie d’un échange sur le Film « Contre Pouvoirs » de Malek BENSMAIL
-
- Le 11 avril à 19h, à la MJC Duchère, Lyon: Lecture-spectacle du « Contraire de l’amour », le Journal de Mouloud Ferraoun (1955-1962) par Dominique LURCEL et la contrebasse de Marc LAURAS, suivie d’un débat en présence de Jean-Philippe OULD-AOUDIA.
- Le 18 avril à 18h à la Maison des Passages, Lyon, rencontre avec Hamadi REDISSI « La libre pensée dans le Monde arabo musulman d’hier et d’aujourd’hui ».
- Le 19 avril à 18h à la Salle du Conseil de la Mairie du 1er arrondissement de Lyon rencontre avec Hamadi REDISSI « Islam, démocratie et laïcité dans le monde arabe ».
- Le 3 et le 4 mai, à Lyon, Rencontre avec Hela OUARDI auteure du livre « Les derniers jours de Muhamad », et « Les califes maudits-la déchirure »

