Lettre Culturelle franco-maghrébine #33
ÉDITO
Nous souhaitons que notre lettre vous aide à entrer joyeusement dans ce « joli mois de mai » qui commence dans de multiples endroits par des défilés populaires.
Nous vous offrons notre regard sur plusieurs livres et films, certains en prise avec une actualité que nous vivons au quotidien avec sa part de drames, d’autres tournés vers un passé plus ou moins lointain.
La mort, l’amour y ont une large place.
Comme dans toute vie, en somme…
Bonne lecture.
Michel Wilson

« TOUS LES HOMMES DESIRENT NATURELLEMENT SAVOIR » de Nina Bouraoui (éditions Jean-Claude Lattès, 2018)
Quiconque a vu récemment une photo de Nina Bouraoui aura du mal à imaginer que cette écrivaine est maintenant plus que cinquantenaire et a déjà publié, depuis 1991, un nombre impressionnant de romans(tous accessibles en collection de poche). Elle  a gardé toute la grâce androgyne de l’adolescence, et semble échapper à tout ce qui marque ordinairement les individus, écrivains ou pas, homosexuels ou pas. C’est sans doute la raison pour laquelle il est important qu’elle raconte son histoire comme elle le fait, aussi clairement que possible, et on ne saurait en effet être plus clair qu’elle ne l’est dans ce dernier roman. Et pourtant rien n’est facile à expliquer dans son histoire, qui certes n’a rien d’exceptionnel mais qui cependant est complexe. Car la complexité est en elle à plusieurs niveaux dont on ne sait pas très bien s’ils ont un rapport entre eux ou s’il s’agit de séries indépendantes. D’une part Nina Bouraoui, née du couple mixte d’une Française et d’un Algérien, assume la double culture ou en tout cas la double appartenance qui en découle pour elle, d’autant qu’elle a effectivement vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 14 ans, ce qui n’est nullement négligeable (surtout pour une enfant précoce comme elle) avant de vivre à peu près exclusivement en France, et notamment à Rennes dans le milieu maternel de ses grands parents, on ne peut plus franco-français. Cependant elle ne parle pas de ce qui pourrait être un tiraillement provoqué par cette dualité familiale, et on ne voit aucun conflit significatif pour elle découlant de cette situation (même si la famille française a d’abord refusé le mariage mixte de ses parents). Il faut dire que le haut niveau et l’homogénéité des milieux sociaux dans lesquels elle a vécu lui a permis d’échapper au sentiment d’être cernée par des préjugés de type raciste ou racialiste. D’ailleurs c’est peut-être cette trop grande homogénéité qui l’a poussée à vouloir découvrir des aspects du monde plus problématiques et plus mêlés lorsque s’est fait sentir pour elle le désir d’écrire et de devenir écrivain. C’est d’elle-même qu’elle parle autant que des autres lorsqu’elle évoque dans le titre de son dernier roman le désir naturel de savoir.
a gardé toute la grâce androgyne de l’adolescence, et semble échapper à tout ce qui marque ordinairement les individus, écrivains ou pas, homosexuels ou pas. C’est sans doute la raison pour laquelle il est important qu’elle raconte son histoire comme elle le fait, aussi clairement que possible, et on ne saurait en effet être plus clair qu’elle ne l’est dans ce dernier roman. Et pourtant rien n’est facile à expliquer dans son histoire, qui certes n’a rien d’exceptionnel mais qui cependant est complexe. Car la complexité est en elle à plusieurs niveaux dont on ne sait pas très bien s’ils ont un rapport entre eux ou s’il s’agit de séries indépendantes. D’une part Nina Bouraoui, née du couple mixte d’une Française et d’un Algérien, assume la double culture ou en tout cas la double appartenance qui en découle pour elle, d’autant qu’elle a effectivement vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 14 ans, ce qui n’est nullement négligeable (surtout pour une enfant précoce comme elle) avant de vivre à peu près exclusivement en France, et notamment à Rennes dans le milieu maternel de ses grands parents, on ne peut plus franco-français. Cependant elle ne parle pas de ce qui pourrait être un tiraillement provoqué par cette dualité familiale, et on ne voit aucun conflit significatif pour elle découlant de cette situation (même si la famille française a d’abord refusé le mariage mixte de ses parents). Il faut dire que le haut niveau et l’homogénéité des milieux sociaux dans lesquels elle a vécu lui a permis d’échapper au sentiment d’être cernée par des préjugés de type raciste ou racialiste. D’ailleurs c’est peut-être cette trop grande homogénéité qui l’a poussée à vouloir découvrir des aspects du monde plus problématiques et plus mêlés lorsque s’est fait sentir pour elle le désir d’écrire et de devenir écrivain. C’est d’elle-même qu’elle parle autant que des autres lorsqu’elle évoque dans le titre de son dernier roman le désir naturel de savoir.
Cependant les fréquentations marginales qu’elle se met à chercher, alors qu’elle est seule et vit à Paris, ne sont liées que partiellement au désir de savoir. Il est vrai qu’à dix-huit ans, elle a tout à apprendre de la vie, et n’y sera pas aidée par l’université d’Assas où elle fait (ou est supposée faire) des études de droit. Ce n’est évidemment pas un hasard si elle choisit pour ce faire un lieu du 6e arrondissement de Paris réservé aux femmes homosexuelles et leur permettant de se rencontrer pour y former des liaisons plus ou moins sulfureuses et souvent cruelles. Nina Bouraoui évoque avec une précision assez grande ce et celles qu’elle a connues dans cet endroit, mais l’étonnant miracle que lui permet son talent d’écriture est qu’elle parvient à éviter tout ce qui pourrait susciter le voyeurisme, sans pour autant gommer quoi que ce soit des très difficiles relations induites par l’homosexualité. Il est vrai que ce dont elle nous parle date de la fin du siècle dernier et que l’homosexualité n’avait pas encore bénéficié de ce qui la rend—peut-être ?—moins difficile à vivre aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, il ressort de ce qu’elle raconte que beaucoup des femmes dont elle fait alors connaissance vivent leur situation en recourant à l’alcool ou à la drogue, et que ne manquent pas pour autant les tentatives de suicide ou les suicides si l’on peut dire réussis. On croit comprendre que l’auteure à laquelle sa jeunesse donne alors un statut particulier échappe personnellement à de telles tragédies, en revanche elle n’échappe pas aux drames passionnels, jalousie, dépit, souffrance de l’exclusion etc. Mais on croit comprendre aussi qu’en un sens c’est justement ce qu’elle cherche, connaissant de très longue date (elle dit quelque part qu’elle en a été consciente dès l’âge de huit ans) cette particularité qui sera son destin, l’homosexualité, —qu’elle ne refuse pas, sans pour autant se présenter comme une militante de la cause, et sans davantage gémir sur son sort. Le plus étonnant dans cette histoire est l’attitude parfaitement compréhensive de ses deux parents, la Française et l’Algérien, auxquels d’ailleurs 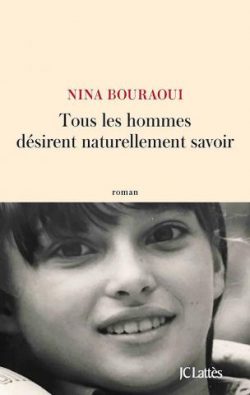 elle rend hommage en leur dédiant son livre. Pendant la partie algérienne de sa vie, il est certain qu’une certaine violence s’exerce contre toute forme de dissidence par rapport à la norme sociale exi gée, c’est-à-dire aussi bien à l’égard de sa mère, qui vit comme une femme libre, passionnée par la lecture et les arts, qu’à son propre égard, la moindre de insultes qu’elle reçoit étant d’être traitée de « pédé ». Au moment où elle quitte l’Algérie avec ses parents, en 1981, on est encore loin de la pression islamiste qui prendra toute sa force pendant la décennie suivante, mais la violence sous-jacente est extrêmement perceptible et l’on ne peut ignorer les dangers de la situation. Outre les problématiques déjà évoquées, le livre peut passer pour un hommage à la mère, qu’on ne connaît qu’indirectement à travers cette fille qui veut aussi être son fils, mais dont se dégage une sorte de lumière qui rayonne sur tout le livre. Il se peut que par la suite et pour toujours, Nina Bouraoui ait été à la recherche d’une « image de Mère »la ramenant à la première qu’elle ait connue et aimée ; il faudrait alors mettre un M majuscule à Mère, comme Lacan met un P majuscule à Père.
elle rend hommage en leur dédiant son livre. Pendant la partie algérienne de sa vie, il est certain qu’une certaine violence s’exerce contre toute forme de dissidence par rapport à la norme sociale exi gée, c’est-à-dire aussi bien à l’égard de sa mère, qui vit comme une femme libre, passionnée par la lecture et les arts, qu’à son propre égard, la moindre de insultes qu’elle reçoit étant d’être traitée de « pédé ». Au moment où elle quitte l’Algérie avec ses parents, en 1981, on est encore loin de la pression islamiste qui prendra toute sa force pendant la décennie suivante, mais la violence sous-jacente est extrêmement perceptible et l’on ne peut ignorer les dangers de la situation. Outre les problématiques déjà évoquées, le livre peut passer pour un hommage à la mère, qu’on ne connaît qu’indirectement à travers cette fille qui veut aussi être son fils, mais dont se dégage une sorte de lumière qui rayonne sur tout le livre. Il se peut que par la suite et pour toujours, Nina Bouraoui ait été à la recherche d’une « image de Mère »la ramenant à la première qu’elle ait connue et aimée ; il faudrait alors mettre un M majuscule à Mère, comme Lacan met un P majuscule à Père.
L’image si gracieuse et toujours jeune que l’auteure donne d’elle-même est aussi une image énigmatique sur laquelle on reconnaît le sourire du Sphinx. Comme par ailleurs elle parle, à propos de son propre cas, d’un œdipe inversé, on se dit que la clarté apparente et réelle de son récit n’en cache pas moins beaucoup de mystères qui le rendent très attachant, très poétique aussi, comme si une sorte d’arrière-plan métaphysique sous-tendait la transparence du récit. On pourrait être chez Jean Genet si l’on n’était en même temps chez la Princesse de Clèves. Références certes un peu lourdes mais entre lesquelles elle glisse subtilement.
Denise Brahimi
« MAGIC BAB EL OUED » de Sabrina Kassa, (éditions Emmanuelle Collas, 2019)
Ce petit livre, assez drôle en dépit du sujet annoncé, pourrait être une sorte de nouvelle, car il s’agit d’un récit, dont beaucoup d’aspects sont tout juste esquissés, et non pas d’un roman qui aurait à cœur de développer les personnages et les situations. En fait il n’y a pas seulement un mais même deux sujets annoncés, connus l’un et l’autre par d’autres ouvrages qui les ont traités de manière approfondie et font date en la matière.
 L’un est la situation vécue dans le milieu algéro-français par l’une de ces jeunes filles qu’on appelait « beurettes » il y a quelque temps, du fait que son père a été harki, c’est-à-dire militaire supplétif dans l’armée française et considéré de ce fait comme traître à la cause de l’indépendance algérienne. Pour s’en tenir à un seul titre on peut citer le livre de Dalila Kerchouche paru en 2003 sous le titre explicite : Mon père, ce harki. Or tel n’est pas mais tel pourrait être le sujet du livre de Sabrina Kassa, dont l’héroïne, la jeune Anissa, décide de partir en Algérie pour enquêter sur son défunt père dont elle croit comprendre qu’il a été harki. Secrets de familles, vérités tues, occultées, déformées etc., voilà à quoi pourrait s’attendre le lecteur de bonne foi.
L’un est la situation vécue dans le milieu algéro-français par l’une de ces jeunes filles qu’on appelait « beurettes » il y a quelque temps, du fait que son père a été harki, c’est-à-dire militaire supplétif dans l’armée française et considéré de ce fait comme traître à la cause de l’indépendance algérienne. Pour s’en tenir à un seul titre on peut citer le livre de Dalila Kerchouche paru en 2003 sous le titre explicite : Mon père, ce harki. Or tel n’est pas mais tel pourrait être le sujet du livre de Sabrina Kassa, dont l’héroïne, la jeune Anissa, décide de partir en Algérie pour enquêter sur son défunt père dont elle croit comprendre qu’il a été harki. Secrets de familles, vérités tues, occultées, déformées etc., voilà à quoi pourrait s’attendre le lecteur de bonne foi.
Et d’autre part il se trouve que la même Anissa, qui est étudiante à Paris, a entrepris un travail qu’elle pense même avoir mené à bien sur ceux qu’on appelle les « chibanis », ces vieux travailleurs algériens dont la vie s’est passée en France, jusqu’à ce que la retraite les laisse face à un vide assez poignant. Un des sujets de son livre pourrait être la rencontre avec certains d’entre eux, de la génération de son père ou de son oncle paternel encore vivant et que son voyage en Algérie va lui permettre de rencontrer.
Or le moins qu’on puisse dire est que la narratrice se contente de frôler l’éventualité de tels sujets, et préfère nous gratifier de quelques fragments de récits, qui se passent soit à Alger après l’arrivée d’Anissa dans sa famille paternelle, soit au bled comme on dit là-bas, quelque part dans la montagne où vivent les bergers. Tout cela est fort rocambolesque, principalement fondé sur le fait qu’un cousin d’Anissa, de peau noire parce que né du viol de sa mère par un tirailleur sénégalais, présente une ressemblance frappante avec le président américain Barack Obama ! Des  Américains de passage à Alger s’en avisent, et comme ce sont des petits malins, ils décident d’en tirer parti financièrement, de manière plus ou moins honnête—ce qui fait que leur minable projet, comme on s’en doute, n’ira pas bien loin !
Américains de passage à Alger s’en avisent, et comme ce sont des petits malins, ils décident d’en tirer parti financièrement, de manière plus ou moins honnête—ce qui fait que leur minable projet, comme on s’en doute, n’ira pas bien loin !
Ne pas s’attendre, évidemment, à beaucoup de sérieux dans la suite des événements ! Si toutefois on peut parler d’événements puisque justement il n’y en a à peu près pas. En revanche on a droit à un joli voyage en autobus d’Anissa et de sa cousine algéroise et surtout pour finir à un non moins joli éloge de la vie de berger, en tout cas à titre provisoire et pour se ressourcer au besoin—mais que l’on soit de France ou d’Algérie, ce besoin pourrait bien être la chose du monde la plus répandue.
On se dit pour finir que le coup de baguette magique annoncé par le titre n’est en effet pas absent de la manière dont procède Sabrina Kassa. Et ce défi lancé à tous nos discours habituels pour analyser, comprendre, essayer de comprendre etc. a pour mérite de balayer les pesanteurs idéologiques accumulées depuis des décennies. De toute manière, les problèmes sérieux reviendront toujours sur l’avant-scène, ils existent et nous n’y échapperons pas. Alors s’aider par ci par là d’un petit coup de baguette magique est une grâce qui ne se refuse pas !
Denise Brahimi
« LES YEUX DE MANSOUR » de Ryad Girod, (Barzakh,2018)
Il semble bien que Ryad Girod occupe actuellement en Algérie et même un peu au-delà la position d’ « écrivain qui monte » et ce n‘est pas sans raisons. Ces raisons concernent aussi bien l’écriture et le style que les thèmes voire les problématiques abordées ; et dans les deux domaines, tout lecteur est vite convaincu des hautes ambitions de ce romancier.
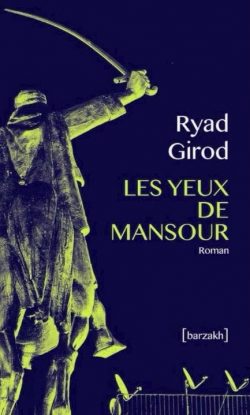 Pour commencer par l’écriture, c’est bien le mot qui convient (plutôt que par exemple le mot « langue » ou « langage »)car il s’agit justement d’un livre « très écrit », très éloigné de la langue orale et de ses facilités, au profit d’une syntaxe complexe, qu’on pourrait dire proustienne par la longueur des phrases et le grand nombre de propositions relatives qui s’enchaînent les une aux autres ; Ryad Girod ne recule jamais devant l’emploi d’un imparfait du subjonctif, sa grande réussite étant que pour autant, son livre ne donne pas l’impression d’archaïsme ni de préciosité ; et curieusement, il reste parfaitement clair dans son propos. Il est vrai qu’en de nombreux passages, on est saisi par le sentiment que l’auteur s’adonne à une prose poétique plutôt qu’à une narration et à une description prosaïquement romanesques. Mais le narrateur ne perd pas le fil de son récit ou plutôt les fils car ceux-ci sont plusieurs à s’entrecroiser.
Pour commencer par l’écriture, c’est bien le mot qui convient (plutôt que par exemple le mot « langue » ou « langage »)car il s’agit justement d’un livre « très écrit », très éloigné de la langue orale et de ses facilités, au profit d’une syntaxe complexe, qu’on pourrait dire proustienne par la longueur des phrases et le grand nombre de propositions relatives qui s’enchaînent les une aux autres ; Ryad Girod ne recule jamais devant l’emploi d’un imparfait du subjonctif, sa grande réussite étant que pour autant, son livre ne donne pas l’impression d’archaïsme ni de préciosité ; et curieusement, il reste parfaitement clair dans son propos. Il est vrai qu’en de nombreux passages, on est saisi par le sentiment que l’auteur s’adonne à une prose poétique plutôt qu’à une narration et à une description prosaïquement romanesques. Mais le narrateur ne perd pas le fil de son récit ou plutôt les fils car ceux-ci sont plusieurs à s’entrecroiser.
Le narrateur, proche ami de Mansour qui figure dans le titre, raconte une histoire au présent, qui se déroule sur quelques mois et s’achève au moment où par décision de justice, on coupe la tête de Mansour en public. Dans la mesure où leur amitié remonte loin, à l’époque où ils fréquentaient ensemble le lycée français de Damas en Syrie, leur passé personnel est plusieurs fois convoqué, mais surtout celui de Mansour qui comporte un trait original assez remarquable : il est un descendant du célèbre Emir Abdelkader dont l’histoire est assez longuement contée, à partir du moment où il s’est rendu à l’armée française (23 décembre 1847) et a cru pouvoir faire confiance aux promesses de ses chefs. Le retour des cendres de l’Emir dans l’Algérie indépendante, en 1965, fait également partie des événements rapportés, et c’est d’ailleurs un miracle de voir tout ce que contient le livre alors même qu’en apparence il est plutôt mince ! Côté Histoire, le roman se passant à Riyadh en Arabie Saoudite, on bénéficie aussi de nombreuses considérations sur un autre grand homme le Roi Fayçal, assassiné en 1975 comme on sait, non sans avoir posé à tous égards les fondements de son pays entré grâce à lui dans la modernité.
Côté géographie, le roman n’est pas moins développé, non sur le mode scientifique et didactique mais davantage comme nous le disions sur le mode poétique, et c’est un des grands sujets de l’admiration que suscite ce livre. La ville elle-même moderne et luxueuse y est certes présente mais grâce à la très puissante voiture acquise par Mansour, une Chevrolet Camaro qui incite à la promenade ( !) on parcourt très fréquemment le désert du Nadj aux environs de Riyadh, dunes de sable, hauts plateaux rocheux etc. qui devient ainsi bien plus qu’un simple décor. A dire vrai, tout un aspect de l’histoire de Mansour ne se conçoit peut-être que comme une émanation de ce paysage —et c’est pourquoi il faut prendre ce dernier mot à un sens très fort, bien au-delà de toute espèce de pittoresque.
 Il est tout à fait clair, d’autant que Ryad Girod ne cesse lui-même de le répéter, que cette conception géographique et poétique du roman l’apparente à l’écrivain français qu’il admire le plus, Julien Gracq. De celui-ci, le roman le plus connu pourrait bien être le Rivage des Syrtes, publié en septembre 1951 ; avec quelques autres, il constitue une œuvre très appréciée d’une élite plus que du grand public. Le choix d’un tel modèle confirme donc l’originalité du romancier algérien (né en 1970) —mieux vaudrait dire les originalités, car il en présente plusieurs, la moindre n’étant pas de joindre deux sources d’inspiration aussi éloignées que Julien Gracq d’une part et le soufisme de l’autre, ce dernier étant très présent dans Les Yeux de Mansour à travers la figure d’El Hallaj.
Il est tout à fait clair, d’autant que Ryad Girod ne cesse lui-même de le répéter, que cette conception géographique et poétique du roman l’apparente à l’écrivain français qu’il admire le plus, Julien Gracq. De celui-ci, le roman le plus connu pourrait bien être le Rivage des Syrtes, publié en septembre 1951 ; avec quelques autres, il constitue une œuvre très appréciée d’une élite plus que du grand public. Le choix d’un tel modèle confirme donc l’originalité du romancier algérien (né en 1970) —mieux vaudrait dire les originalités, car il en présente plusieurs, la moindre n’étant pas de joindre deux sources d’inspiration aussi éloignées que Julien Gracq d’une part et le soufisme de l’autre, ce dernier étant très présent dans Les Yeux de Mansour à travers la figure d’El Hallaj.
Mansour dans le roman de Ryad est un personnage double, ou personnage à deux faces. Il appartient à la fois à l’intrigue moderne du livre, en tant que compagnon du narrateur et possesseur d’une belle Camaro rouge « capable de monter jusqu’à deux cent soixante kilomètres-heure en une quinzaine de secondes » ; et d’autre part à la dimension soufie des l’inspiration du romancier, qui superpose l’histoire d’El Hallaj à celle de Mansour par delà le millénaire qui les sépare. Le premier, grand mystique persan et maître soufi a eu la tête coupée en 922 à Bagdad, sous prétexte de déclarations qui l’ont rendu coupable d’hérésie. De la même façon si l’un des deux Mansour est condamné pour adultère, l’autre Mansour, dans un procès distinct, l’est pour cause d’hérésie, ou en tout cas sur la foi de déclarations que ses juges déclarent hérétiques. Ce parallélisme, très appuyé par le romancier, est une manière d’inciter à une double lecture de son livre, mais encore une fois « double » n’est pas assez dire.
Car la figure du Christ n’en est pas absente ou pas très éloignée de celle des deux héros sacrificiels, Hallaj et Mansour. Et l’auteur étend la liste des figures de référence encore bien au-delà. Ryad Girod, qui est professeur de mathématiques dans sa vie professionnelle, n’hésite pas à joindre aux autres le personnage du mathématicien Henri Poincaré (1854-1912), chez lequel l’avancée des connaissances se fait selon des modalités comparables à celles qui permettent au Soufi d’approcher la vérité. Poincaré étant aussi homme de lettres et philosophe, on comprend d’autant mieux qu’il puisse entrer dans la liste des plus éminents et des plus exigeants modèles que se donne le romancier.
Non sans humour de la part de Ryad Girod, le narrateur s’entend dire par un inconnu de passage auquel il livre en vrac quelques aspects de sa vie : « Vous devriez remettre de l’ordre dans vos idées… l’ordre a toujours son importance pour comprendre… et c’est précisément ce que vous souhaitez… Non ? »
Bon conseil, mais qui de toute manière ne peut rien contre la foule haineuse hurlant à la mort : « Gassouh ! Gassouh ! » (coupez-lui la tête), cri horrible qui résonne tout au long du livre. Difficile à oublier.
Denise Brahimi
« ALLAH AU PAYS DES ENFANTS PERDUS » de Karim Akouche, (éditions Ecriture, 2019)
Nous avons déjà parlé dans La Lettre d’un roman de ce même auteur paru en 2017, La Religion de ma mère. Cette fois encore Karim Akouche se montre virulent dans une dénonciation qui est multiple, concernant l’état de l’Algérie au moment où il écrit —puisque nul ne peut savoir ce qu’il en sera pour ce pays dans un plus ou moins proche avenir. Mais le moins qu’on puisse dire est que dans l’état qu’il décrit, la chanson d’un éboueur, qui nous est donnée à lire aux dernières pages du livre, semble cruellement justifiée :
Quel pays de galère !
La vie est amère !
 Karim Akouche fait partie des écrivains algériens dont la dénonciation est sans limite ni réserve, il écrit avec l’approbation de celui qui passe pour un maître en la matière et dont le nom est bien connu pour cette raison, Boualem Sansal. Dans ce livre court (150 pages) on sent que l’auteur est aussi un dramaturge, ce qui peut être une indication de lecture. Les dernières pages du livre, notamment, sont à lire comme un ensemble d’indications scéniques, plutôt que comme un récit romanesque au sens le plus habituel du mot.
Karim Akouche fait partie des écrivains algériens dont la dénonciation est sans limite ni réserve, il écrit avec l’approbation de celui qui passe pour un maître en la matière et dont le nom est bien connu pour cette raison, Boualem Sansal. Dans ce livre court (150 pages) on sent que l’auteur est aussi un dramaturge, ce qui peut être une indication de lecture. Les dernières pages du livre, notamment, sont à lire comme un ensemble d’indications scéniques, plutôt que comme un récit romanesque au sens le plus habituel du mot.
Il y a pourtant dans ce livre des personnages dont on va suivre un moment la destinée, en tout cas jusqu’à la mort dramatique de deux d’entre eux. Au commencement, ils forment un groupe de trois jeunes hommes qui vivent tant bien que mal mais évidemment plutôt mal dans le village kabyle d’Ath Wadhou, dépeint en quelques traits comme caractéristique de tant d’autres qui appartiennent à la même catégorie. D’ailleurs les trois personnages eux aussi sont stylisés pour être représentatifs. Il y a un berger, Zof, qui est le seul à être occupé puisque chaque jour il doit mener son troupeau dans la montagne ; un musicien chanteur Ahwawif qui se verrait bien dans la catégorie des chanteurs kabyles à succès si ce n’est qu’il n’a aucune chance d’y parvenir s’il reste confiné à Ath Wadhou ; et le troisième, Zar, un étudiant très doué, inscrit à la faculté des sciences, qui aurait besoin d’une aide de l’Etat pour concrétiser une découverte qui lui paraît réalisable.
Zof ne croit guère aux rêveries de ses deux compagnons et d’emblée son scepticisme est confirmé pour ce qui concerne Zar, dont le dossier pour une demande d’aide se voit refusée. On voit pourtant apparaître un espoir lorsque les jeunes du village parviennent à construire une maison de la culture polyvalente, qui rencontre un grand succès. Malheureusement une intervention musclée de barbus en armes fait tout disparaître, ce sont des terroristes qui mettent le feu aux cris d’Allah Akbar.
Pour échapper au désespoir Zar et Ahwawi ne voient plus qu’une solution, qui est de partir —ou plutôt fuir, car ils n’ont d’autre moyen que de le faire clandestinement.
Avec cette rigueur implacable qui caractérise le déroulement de son récit, Karim Akouche passe à l’étape suivante, qui est la préparation de cette fuite, avec l’aide d’un passeur. Une fois encore, il préfère styliser le sujet plutôt que d’entrer dans le détail réaliste (et d’ailleurs connu) de cette effroyable aventure. Cependant il dresse à cette occasion le portrait du passeur qu’il appelle « le faiseur de nouveaux immigrés » (sans doute comme on parlait des « faiseuses d’anges au temps des avortements clandestins !) et qui est désigné comme « le Caporal »—personnage haut en couleur à la fois sinistre et drôle, poético-cynique selon un mélange bien à lui.
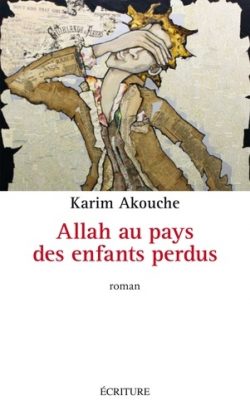 Karim Akouche a aussi l’art des dialogues, toujours percutants, et il en donne la preuve lorsqu’Ahwawi retourne au village pour prévenir Zof le berger de leur départ. Dialogue au meilleur sens du mot puisque le lecteur est libre d’hésiter entre les deux thèses en présence, partir ou rester. Ahwawi cherche en vain à se faire comprendre du berger, qui profite de l’occasion pour un règlement de compte longtemps refoulé avec ses supposés compagnons (qu’il soupçonne, pas tout à fait à tort, de l’avoir toujours méprisé). Zof en arrive à une formule radicale, et forcément un peu injuste : « L’exilé est un traître ! » Cependant Ahwawi, dans son désir de justification, représente peut-être l’auteur lui-même.
Karim Akouche a aussi l’art des dialogues, toujours percutants, et il en donne la preuve lorsqu’Ahwawi retourne au village pour prévenir Zof le berger de leur départ. Dialogue au meilleur sens du mot puisque le lecteur est libre d’hésiter entre les deux thèses en présence, partir ou rester. Ahwawi cherche en vain à se faire comprendre du berger, qui profite de l’occasion pour un règlement de compte longtemps refoulé avec ses supposés compagnons (qu’il soupçonne, pas tout à fait à tort, de l’avoir toujours méprisé). Zof en arrive à une formule radicale, et forcément un peu injuste : « L’exilé est un traître ! » Cependant Ahwawi, dans son désir de justification, représente peut-être l’auteur lui-même.
Reste alors à évoquer le voyage clandestin, et il est probable qu’aucun lecteur ne se fait d’illusion sur son issue. Comme dans la tragédie, la question n’est pas de savoir si ou non non le héros va s’en sortir, chacun sait bien qu’il est d’ores et déjà condamné. D’ailleurs cette histoire est une tragédie qui se termine par une double mort. Zar meurt pendant la traversée brutalement interrompue par les gardes-côtes, Ahwawi fait partie des rescapés ramenés à Alger où ils passent en jugement. Lorsqu’il se rend compte que son juge n’est autre que le Caporal lui-même (ce qu’on appelle au théâtre … un coup de théâtre), son comportement de vient suicidaire, il fait mine de vouloir étrangler le Caporal et néanmoins juge, et meurt la tête explosée par un vigile. Avant qu’il en arrive à cet ultime soubresaut, on a entendu dans sa bouche des répliques qui ressemblent beaucoup à celles de manifestants de mars 2019.
C’est un des rôles de la littérature que de servir de porte-voix et d’amplificateur. Karim Akouche l’assume totalement.
Denise Brahimi

« JUSQU’A LA FIN DES TEMPS » de la réalisatrice Yasmine Chouikh, 2018
Difficile d’imaginer un lieu plus propice à ce que nous dit ce film, à savoir la lutte éternelle et omniprésente entre désir de vie et désir de mort ou encore, mis en termes freudiens, entre pulsion de vie et pulsion de mort. Tout le centre de l’action est en effet un cimetière, situé en Algérie dans une zone de hauts plateaux qu’on aperçoit de temps à autre comme autant de magnifiques paysages ; il s’agit à la fois d’un cimetière et d’un village, certes très excentrés mais tirant parti de leur isolement même puisque ce lieu, appelé Boulekbour, fait l’objet d’un pèlerinage annuel de trois jours et que l’on y vient de loin semble-t-il, par autobus et par camion.
Il est certain que ce pèlerinage, quoique consacré à des morts et à la mort, est pour tous les habitants une source de vie, à dire vrai la seule car on ne leur en voit pas d’autre et tout le reste du temps, ils vivotent au contraire misérablement. Pendant trois jours en revanche, on voit passer abondance de couscous et on entend des chants accompagnés de musique, de tonalité religieuse mais d’une très belle vigueur.
 D’où l’idée qui germe dans la tête d’un jeune homme du village, Nabil, à la fois inventif et farfelu, et qui rêve de créer une entreprise grandiose. Contre le versement d’argent sonnant, les gens pourraient lui confier le soin d’organiser leurs funérailles et celles de leurs proches, et comme il est généreux, il compte bien faire en sorte que tout le village puisse en profiter. Ce serait évidemment une manière de tirer profit de la mort des gens mais l’argument assez juste de Nabil est que tous les habitants de Boulekbour le font déjà par l’intermédiaire du pèlerinage. Et il dénonce l’hypocrisie de ceux qui rejettent à grands cris son projet.
D’où l’idée qui germe dans la tête d’un jeune homme du village, Nabil, à la fois inventif et farfelu, et qui rêve de créer une entreprise grandiose. Contre le versement d’argent sonnant, les gens pourraient lui confier le soin d’organiser leurs funérailles et celles de leurs proches, et comme il est généreux, il compte bien faire en sorte que tout le village puisse en profiter. Ce serait évidemment une manière de tirer profit de la mort des gens mais l’argument assez juste de Nabil est que tous les habitants de Boulekbour le font déjà par l’intermédiaire du pèlerinage. Et il dénonce l’hypocrisie de ceux qui rejettent à grands cris son projet.
Il est évident que Nabil voudrait sauver le village en y introduisant l’argent, comme puissance magique et source infinie de bienfaits. Cependant on comprend vite que l’autre mal dont on y souffre aussi est l’absence d’amour et pour une fois, s’agissant d’un film qui se passe en Algérie, on ne nous explique pas que c’est la faute de la religion. Bien au contraire, le cheikh, qui est le chef de la communauté des Musulmans, pousse ces derniers à se marier dès que faire se peut (étant entendu qu’il ne confond pas l’amour et le mariage—mais enfin, il ne les dissocie pas forcément non plus …)Les difficultés viennent plutôt de ce qu’on appelle d’un mot immense et vague la tradition, qui rend les hommes à peu près incapables de se déclarer auprès de la femme qu’ils désirent et les femmes tout aussi réticentes et ambiguës face à cette déclaration. D’où des résultats inégaux, que le film montre d’une manière intéressante par sa diversité. Entre la très belle et pétillante Nassima, véritable incarnation de la vie, et son amoureux éperdu Jelloul, préposé au blanchiment des tombes, le mariage se fait, grâce à elle évidemment, mais aussi pour son plus grand bonheur à lui. En revanche, l’histoire qui est le sujet principal du film, entre le fossoyeur Ali , vieil homme touchant de sensibilité blessée , et la nouvelle venue au village, Joher, femme mûre et désirable, cette histoire donc se termine par un échec, qui va au-delà même de leur couple et qui répond par une victoire de la mort au conflit évoqué entre les deux pulsions.
 Le portrait psychologique de Joher n’était pas facile à faire car c’est une femme complexe, rouée et dissimulatrice, ce qu’on ressent dès qu’on assiste à son arrivée au village ; elle n’en présente pas moins quelques aspects contradictoires, qu’elle se garde bien d’avouer aux autres et sans doute pas non plus à elle-même. Au fossoyeur Ali elle ne parle que de ses futures funérailles, qu’elle souhaite préparer dit-elle, et toutes les demandes qu’elle lui fait semblent orientées vers ce moment de sa mort. Néanmoins on comprend vite qu’il s’agit d’un procédé et d’une dénégation, procédé pour pouvoir réclamer sans réserve l’aide et la présence d’Ali, dénégation de son désir véritable qui est le désir de vivre et non pas de mourir. Il y a d’ailleurs quelques très belles scènes où on la voit s’abandonner à la joie d’être vivante, à commencer par le plaisir physique de courir et de gambader, alors que sa démarche naturelle, d’ailleurs harmonieuse, est pleine de dignité et de componction. Joher pourrait tout à fait être heureuse et rendre un homme heureux si elle consentait à vivre et à aimer, mais quelque chose l’empêche de le reconnaître et elle provoque une tragédie en refusant la demande d’Ali qui voudrait l’épouser. Ali terriblement blessé, quitte Boulekbour définitivement sans qu’on sache pour quel autre endroit, et Joher comprend trop tard l’erreur qu’elle a commise en niant son propre désir de vie, de manière irréparable. On ne saura jamais quel a été dans toute cette histoire son degré de conscience et de manipulation. En fait quand elle est venue à Boulekbour où vivait sa sœur El Alia (qui avait quitté sa famille pour des raisons un peu obscures), Joher ne savait plus où aller et c’est une véritable aubaine pour elle de récupérer la maison d’El Alia, avec l’autorisation d’Ali qui a été semble-t-il un ami très proche d’El Alia. Il y a beaucoup à deviner dans l’histoire antérieure que Joher prétend ne découvrir que peu à peu alors que peut-être elle ne cherche qu’à l’occulter. Le souci de respectabilité est probablement la plus grande des contraintes qu’elle s’impose et qui l’empêche de vivre, telle serait la clef de cet intéressant portrait de femme tracé par Yasmine Chouikh, femme victime certes et principalement d’elle-même quoi que on ne sache pas tout de son passé, mais aussi femme qui fait des victimes et c’est ici qu’apparaît l’originalité du portrait. Ses comportements sont beaucoup plus élaborés et prémédités que ceux des habitants de Boulekbour mais ils ne sont pas adaptés à la vie de ce village.
Le portrait psychologique de Joher n’était pas facile à faire car c’est une femme complexe, rouée et dissimulatrice, ce qu’on ressent dès qu’on assiste à son arrivée au village ; elle n’en présente pas moins quelques aspects contradictoires, qu’elle se garde bien d’avouer aux autres et sans doute pas non plus à elle-même. Au fossoyeur Ali elle ne parle que de ses futures funérailles, qu’elle souhaite préparer dit-elle, et toutes les demandes qu’elle lui fait semblent orientées vers ce moment de sa mort. Néanmoins on comprend vite qu’il s’agit d’un procédé et d’une dénégation, procédé pour pouvoir réclamer sans réserve l’aide et la présence d’Ali, dénégation de son désir véritable qui est le désir de vivre et non pas de mourir. Il y a d’ailleurs quelques très belles scènes où on la voit s’abandonner à la joie d’être vivante, à commencer par le plaisir physique de courir et de gambader, alors que sa démarche naturelle, d’ailleurs harmonieuse, est pleine de dignité et de componction. Joher pourrait tout à fait être heureuse et rendre un homme heureux si elle consentait à vivre et à aimer, mais quelque chose l’empêche de le reconnaître et elle provoque une tragédie en refusant la demande d’Ali qui voudrait l’épouser. Ali terriblement blessé, quitte Boulekbour définitivement sans qu’on sache pour quel autre endroit, et Joher comprend trop tard l’erreur qu’elle a commise en niant son propre désir de vie, de manière irréparable. On ne saura jamais quel a été dans toute cette histoire son degré de conscience et de manipulation. En fait quand elle est venue à Boulekbour où vivait sa sœur El Alia (qui avait quitté sa famille pour des raisons un peu obscures), Joher ne savait plus où aller et c’est une véritable aubaine pour elle de récupérer la maison d’El Alia, avec l’autorisation d’Ali qui a été semble-t-il un ami très proche d’El Alia. Il y a beaucoup à deviner dans l’histoire antérieure que Joher prétend ne découvrir que peu à peu alors que peut-être elle ne cherche qu’à l’occulter. Le souci de respectabilité est probablement la plus grande des contraintes qu’elle s’impose et qui l’empêche de vivre, telle serait la clef de cet intéressant portrait de femme tracé par Yasmine Chouikh, femme victime certes et principalement d’elle-même quoi que on ne sache pas tout de son passé, mais aussi femme qui fait des victimes et c’est ici qu’apparaît l’originalité du portrait. Ses comportements sont beaucoup plus élaborés et prémédités que ceux des habitants de Boulekbour mais ils ne sont pas adaptés à la vie de ce village.
Pour autant, elle n’est pas la seule à connaître l’échec. Nabil, qui se rêvait en jeune entrepreneur perd pied le jour où il se croit menacé d’une mort prochaine et tout l’édifice qui le tenait debout s’effondre d’un coup. Lorsque le film s’achève après une ultime tricherie (cérémonie officielle sur la tombe d’un prétendu martyr de la Révolution), on voit mal sur quoi peut compter ce malheureux village pour s’en sortir.
Denise Brahimi
« L’ADIEU A LA NUIT » d’André Téchiné, avril 2019
Les amateurs du réalisateur André Téchiné seront ravis de le retrouver dans ce film où il s’associe pour la huitième fois à son actrice favorite Catherine Deneuve. Il semble que les avis soient unanimes, ce film est une réussite. Pourtant on ne peut dire que son sujet soit une nouveauté mais il a le mérite de regarder en face et de traiter de bout en bout un des sujets d’actualité dans quelques pays dont la France : la conversion de jeunes gens à l’Islam et leur désir de partir rejoindre une organisation islamiste en Syrie(ou ailleurs) pour se battre sous ses ordres. Alex est le jeune héros de cette histoire, il est le petit-fils de Muriel qui est jouée par  Catherine Deneuve et qui veut à toute force l’empêcher de partir quand elle comprend la folie qu’il va commettre. C’est de cet affrontement entre les deux personnages principaux que le film tire sa substance, beaucoup plus que des mécanismes par lesquels des jeunes gens comme Alex se font endoctriner. En cela L’Adieu à la nuit est différent du film très intéressant de Philippe Faucon, La Désintégration (2011) qui analysait minutieusement cette procédure d’embrigadement. Mais différent aussi du film tunisien consacré au même sujet, Mon cher enfant, de Mohamed Ben Attia (2018). A la différence de Philippe Faucon, André Téchiné ne cherche pas à être un analyste, il montre une situation très concrète, à travers des images sensibles, faisant toute confiance à la spécificité du cinéma. Et à la différence de Mohamed Ben Attia, il ne cherche pas à évaluer la responsabilité voire la culpabilité de l’entourage immédiat à savoir les parents.
Catherine Deneuve et qui veut à toute force l’empêcher de partir quand elle comprend la folie qu’il va commettre. C’est de cet affrontement entre les deux personnages principaux que le film tire sa substance, beaucoup plus que des mécanismes par lesquels des jeunes gens comme Alex se font endoctriner. En cela L’Adieu à la nuit est différent du film très intéressant de Philippe Faucon, La Désintégration (2011) qui analysait minutieusement cette procédure d’embrigadement. Mais différent aussi du film tunisien consacré au même sujet, Mon cher enfant, de Mohamed Ben Attia (2018). A la différence de Philippe Faucon, André Téchiné ne cherche pas à être un analyste, il montre une situation très concrète, à travers des images sensibles, faisant toute confiance à la spécificité du cinéma. Et à la différence de Mohamed Ben Attia, il ne cherche pas à évaluer la responsabilité voire la culpabilité de l’entourage immédiat à savoir les parents.
Concernant ce dernier point, une telle évaluation est d’autant moins possible qu’Alex n’a plus de parents, ne lui reste que sa grand-mère comme famille. En fait il a encore son père mais celui-ci est parti très loin refaire sa vie lorsque la mère d’Alex est morte, en sorte que le fils ne veut plus avoir aucune relation avec son père et ne se rattache affectivement qu’au seul souvenir de sa mère morte. Ce ne sont pas à proprement parler des motivations psychologiques que le réalisateur nous donne là car son but n’est pas d’expliquer le comportement de son personnage : le mot « explication » ne saurait convenir, en ce sens qu’ aucune explication n’apparaît comme suffisante. C’est d’ailleurs une des formes torturantes de ce qu’éprouve Muriel, femme pratique, volontaire, intelligente, mais nullement intellectuelle ni psychologue. Le moment vient assez vite où Muriel pense que le plus important n’est pas de s’interroger (même si elle ne peut s’empêcher de le faire) mais d’agir —c’est-dire, concrètement et physiquement, d’empêcher Alex de partir. C’est une femme forte, qui sait ce qu’il en est de l’action : elle est capable par exemple, de s’armer d’un fusil pour chasser le sanglier qui vient faire des dégâts sur ses terres pendant la nuit. Par ailleurs, ces convictions ne sont pas fragiles, elle est convaincue, comme le réalisateur et les spectateurs, qu’Alex va faire une terrible bêtise, sans doute irrémédiable, la question n’étant même pas de porter un jugement sur cet islam auquel Alex s’est converti avec une foi fervente. L’islam dans cette histoire est, si l’on peut dire, hors jeu, l’important étant ce à quoi il sert de prétexte ou d’alibi.
Mais il n’empêche que Muriel, pour autant, n’est pas et ne sera pas une gagnante. Bien au contraire, c’est elle que nous voyons à l’état de victime à la fin du film et elle est pathétique, en toute simplicité, c’est–à-dire sans aucune forme de pathos théâtralisé. Les admirateurs de Catherine Deneuve seront comblés par les talents d’actrice dont elle fait preuve dans un moment comme celui-là : au rebours du style hollywoodien et du célèbre Actor’s Studio, elle est d’un naturel confondant, d’instinct semble-t-il, et sans la moindre théâtralité. En fait elle se trouve dans une situation qui correspond tout à fait aux définitions classiques du tragique, comme enfermement dans une contradiction indépassable. D’une part il lui fallait absolument empêcher Alex de partir (ce pourquoi elle a eu recours à la police qui a arrêté les trois candidats au djihad dont il faisait partie sur le chemin de l’aéroport ; d’autre part, elle a brisé ce garçon qu’elle aime plus que tout au monde dans sa pulsion vitale et dans la foi qui lui donnait la force de vivre, et peut-être l’a-t-elle séparé d’elle-même définitivement.
 D’Alex il est trop jeune et il est plongé dans une trop grave crise pour qu’on puisse affirmer quoi que ce soit. Pour lui la foi en l’islam n’est ni un prétexte ni un alibi, elle est la seule raison de vivre qu’il se soit trouvé—alors même qu’il n’est pas vraiment amoureux de Lila la jeune fille qui a tout fait pour qu’ils partent ensemble parce qu’elle tient très fort à Alex et était prête à tout pour partir avec lui. Alex vit l’unicité d’une grande passion, celle qui le pousse à faire le djihad, et l’on peut craindre qu’il ne se remette jamais de cet élan brisé. Le film propose pourtant une forme d’espoir en la personne d’un « repenti » qui a d’abord fait l’expérience du djihad en Syrie avant d’en revenir désillusionné et tout à fait persuadé qu’il était tombé dans une grave erreur. Muriel s’attache à lui parce qu’il le mérite et parce qu’elle veut croire qu’Alex fera un jour le même chemin que lui. Cependant Alex n’aura pas pu vivre la même expérience puisqu’il n’est pas parti et peut-être en gardera-t-il une irrémédiable frustration. André Téchiné se garde bien de trancher. Il montre, de façon belle et convaincante, tout ce qui peut donner envie de vivre comme le fait Muriel, à la tête d’un élevage de chevaux et d’un magnifique champ de cerisiers dans un pays sans doute cher au cœur du réalisateur—Capcir, Cerdagne et autre lieux des Pyrénées Orientales que d’aucuns diraient sans doute très « enclavés ». Pays encore imprégné de mœurs paysannes et d’une joie de vivre à l’ancienne mais pourtant soumis à un vieillissement que symbolisent les tristes Ehpad. Muriel aime la vie qu’elle mène et cet amour lui donne sa force, Alex semble l’avoir aimé un peu ou même beaucoup quand il était enfant, mais l’adolescence, ce qui comme on sait arrive fréquemment, l’a jeté dans d’autres voies qui au moment où le film s’achève ont abouti à l’impasse de la prison, en attendant son procès. Faible lueur d’espoir, terrible angoisse et culpabilité, le film ne peut aller au-delà.
D’Alex il est trop jeune et il est plongé dans une trop grave crise pour qu’on puisse affirmer quoi que ce soit. Pour lui la foi en l’islam n’est ni un prétexte ni un alibi, elle est la seule raison de vivre qu’il se soit trouvé—alors même qu’il n’est pas vraiment amoureux de Lila la jeune fille qui a tout fait pour qu’ils partent ensemble parce qu’elle tient très fort à Alex et était prête à tout pour partir avec lui. Alex vit l’unicité d’une grande passion, celle qui le pousse à faire le djihad, et l’on peut craindre qu’il ne se remette jamais de cet élan brisé. Le film propose pourtant une forme d’espoir en la personne d’un « repenti » qui a d’abord fait l’expérience du djihad en Syrie avant d’en revenir désillusionné et tout à fait persuadé qu’il était tombé dans une grave erreur. Muriel s’attache à lui parce qu’il le mérite et parce qu’elle veut croire qu’Alex fera un jour le même chemin que lui. Cependant Alex n’aura pas pu vivre la même expérience puisqu’il n’est pas parti et peut-être en gardera-t-il une irrémédiable frustration. André Téchiné se garde bien de trancher. Il montre, de façon belle et convaincante, tout ce qui peut donner envie de vivre comme le fait Muriel, à la tête d’un élevage de chevaux et d’un magnifique champ de cerisiers dans un pays sans doute cher au cœur du réalisateur—Capcir, Cerdagne et autre lieux des Pyrénées Orientales que d’aucuns diraient sans doute très « enclavés ». Pays encore imprégné de mœurs paysannes et d’une joie de vivre à l’ancienne mais pourtant soumis à un vieillissement que symbolisent les tristes Ehpad. Muriel aime la vie qu’elle mène et cet amour lui donne sa force, Alex semble l’avoir aimé un peu ou même beaucoup quand il était enfant, mais l’adolescence, ce qui comme on sait arrive fréquemment, l’a jeté dans d’autres voies qui au moment où le film s’achève ont abouti à l’impasse de la prison, en attendant son procès. Faible lueur d’espoir, terrible angoisse et culpabilité, le film ne peut aller au-delà.
Denise Brahimi

- Du 3 au 5 mai, au MUCEM, à Marseille: Tunisie: »Travail, dignité, liberté », exposition, rencontres, conférences (voir le site du MUCEM en cliquant sur ce mot)
- Le 3 mai, à 18h30 à la Mairie du 1er arrondissement de Lyon, conférence de madame Hela OUARDi autour de son livre « Les derniers jours de Muhamad » (Coup de Soleil ARA et FORSEM)
- Le 4 mai à 15h, à la Librairie Terre des Livres à Lyon Héla OUARDI échangera sur son dernier livre « Les califes maudits » et le dédicacera.
- Le 4 mai à 18h30, à l’espace Bancel de Lyon, le CCAM organise une rencontre avec le journaliste Akram BELKAID autour de son livre « L’Algérie un pays empêché ».
- 16 mai à 19h à Le Cartel à Lyon, rencontre avec Karim AKOUCHE autour de son livre « Allah au pays des enfants perdus », (Coup de Soleil ARA) ANNULEE
- 22 mai à 19h30 au Palais duTravail de Villeurbanne, Table ronde « regards croisés d’éditrices du Maghreb et de France » avec Elisabeth Daldoul (Tunisie), Selma Hellal (Algérie), Kenza Sefrioui (Maroc), et Oristelle Bonis (France). Organisation collectif France Maghreb les chemins de la rencontre AFARA, CARA, COMARA, Coup de Soleil ARA, Maison des passages.
- 28 mai Maison de l’environnement Lyon Journée Rencontre sur l’agroécologie dans les pays du Maghreb et en Auvergne-Rhône-Alpes.

