Lettre culturelle franco-maghrébine # 40
ÉDITO
Cette Lettre se présente comme un ensemble de deux dossiers sur des sujets bien distincts. Chaque dossier comporte deux articles, soit autour d’une même thématique, celle des langues au Maroc, soit autour d’un même livre consacré à l’architecture en Algérie à la fin de l’époque coloniale. Le cinéma n’étant pas en reste, nous vous proposons la présentation de deux films dont les réalisateurs, d’origine algérienne, témoignent d’intentions et de procédés très différents : L’un aborde un problème de société très précis, l’homosexualité en milieu franco-maghrébin (Le Choix d’Ali) l’autre élargit une problématique souvent traitée, en refusant de la localiser (Terminal Sud). Bonne lecture. Denise Brahimi et Michel Wilson

Deux regards sur un livre:
« ARCHITECTURE DE LA CONTRE-REVOLUTION » par Samia Henni , éditions B42, Paris 2019, traduit de l’anglais Samia Henni a choisi une perspective intéressante pour parler des actions et réactions du gouvernement colonial français en Algérie dès le moment où se développe ce qu’on consentira à appeler plus tard la guerre d’indépendance. Conformément à ses compétences, puisque son domaine de recherche est l’architecture, elle consacre son travail, qui est une thèse de doctorat, aux différentes manières dont l’armée française a tenté de mieux contrôler l’espace algérien, celles-ci évoluant à travers le temps de 1954 à 1962. Elle appelle à la rescousse une très riche illustration, dessins, photos etc. et surtout, pour toute la période concernée, elle retrace, en allant au-delà de l’architecture et de l’urbanisme, les différentes phases d’une réflexion politique d’où il ressort que le pouvoir colonial a très vite compris la gravité de ce qui le menaçait. Le grand intérêt du livre est de montrer qu’il a voulu y faire face concrètement : sur le terrain, l’expression étant ici à prendre au sens propre. Il paraît certain qu’à partir d’un certain moment (et les historiens pourraient le préciser), l’idée s’installe chez les gouvernants d’une évolution inéluctable vers l’indépendance, mais en même temps il leur faut continuer à pratiquer un certain nombre d’actions, que le travail de Samia Henni nous permet de suivre précisément et clairement, dans un ordre qui ne pouvait être autre que chronologique.
Samia Henni a choisi une perspective intéressante pour parler des actions et réactions du gouvernement colonial français en Algérie dès le moment où se développe ce qu’on consentira à appeler plus tard la guerre d’indépendance. Conformément à ses compétences, puisque son domaine de recherche est l’architecture, elle consacre son travail, qui est une thèse de doctorat, aux différentes manières dont l’armée française a tenté de mieux contrôler l’espace algérien, celles-ci évoluant à travers le temps de 1954 à 1962. Elle appelle à la rescousse une très riche illustration, dessins, photos etc. et surtout, pour toute la période concernée, elle retrace, en allant au-delà de l’architecture et de l’urbanisme, les différentes phases d’une réflexion politique d’où il ressort que le pouvoir colonial a très vite compris la gravité de ce qui le menaçait. Le grand intérêt du livre est de montrer qu’il a voulu y faire face concrètement : sur le terrain, l’expression étant ici à prendre au sens propre. Il paraît certain qu’à partir d’un certain moment (et les historiens pourraient le préciser), l’idée s’installe chez les gouvernants d’une évolution inéluctable vers l’indépendance, mais en même temps il leur faut continuer à pratiquer un certain nombre d’actions, que le travail de Samia Henni nous permet de suivre précisément et clairement, dans un ordre qui ne pouvait être autre que chronologique.
On commence donc par les camps de regroupement, où l’on entasse une partie non négligeable (mais difficile à évaluer quantitativement) de la population villageoise, qui se trouve privée à la fois de son habitat traditionnel et de ses moyens économiques de survie. Cette entreprise a été particulièrement destructrice à tous égards, et d’ailleurs dénoncée en 1959 par un rapport de Michel Rocard, suivie d’une campagne de presse qui nécessita le réaménagement du projet. Ce qui fut pris en charge par le délégué général Paul Delouvrier, et par Maurice Papon, préfet de Constantine ; mais Samia Henni n’a pas de peine à démontrer que derrière le pouvoir politique, c’est l’armée qui pense et exécute ces diverses opérations.
Après l’arrivée au pouvoir du Général de Gaulle en 1958, on passe au Plan de Constantine dont une part importante est consacrée à « l’habitat musulman » et prise en charge par des architectes qui y consacrent tous leurs soins, tels que Marcel Lathuillière, président du conseil régional des architectes en Algérie ou Pierre-André Émery. On tente aussi d’améliorer ou de résorber les bidonvilles mais on restera loin des 200.000 logements prévus par le plan. A partir de 1960, la perspective de l’indépendance commence à influer sur les différents projets.
C’est aussi à partir de là qu’on se pose quelques questions sur la position de l’auteure par rapport à ce qu’elle analyse et décrit. On se sent tiraillé entre le grand intérêt des projets dont elle parle ainsi que de leur réalisation partielle qu’elle présente avec soin, et d’autre part son parti pris idéologique de minimiser ce qu’ils apportent sur le plan conceptuel et technique.
Ayant substitué le mot « contre-révolution » à « guerre d’indépendance », l’auteure fait une œuvre à thèse en ce sens que tous les projets architecturaux qu’elle décrit sont ramenés par elle à la seule volonté des autorités françaises de maintenir l’oppression coloniale en Algérie. Or s’il est possible en effet et même sûr que ce soit leur but principal dans l’esprit de certains de leurs concepteurs, cela ne signifie pas forcément loin de là qu’il s’agisse d’une mauvaise architecture ou d’une architecture d’intérêt négligeable. On constate au contraire qu’un nombre important d’architectes de valeur y ont participé.
Il fallait sans doute distinguer clairement entre les aspects politiques de cette question et les problèmes souvent très intéressants d’architecture et d’urbanisme qu’il s’agissait de résoudre. Même si on peut évidemment dire que ces solutions provisoires n’avaient aucune chance d’être durables dans le contexte historique qui était de plus en plus et notamment dans les deux ou trois dernières années de la guerre celui d’une marche inéluctable vers l’indépendance. Ce qui est cependant remarquable et intéressant est que les entreprises architecturales ont continué jusqu’au bout, lors même qu’était devenu caduque toute espèce de projet conçu dans la perspective coloniale.
Pour en venir donc aux dernières actions entreprises par l’Etat franco-algérien de 1961 à 1962, elles comportent la construction d’une nouvelle capitale administrative au lieu appelé Rocher Noir, à une cinquantaine de kilomètres d’Alger. Mais seule la première partie de ce programme put être réalisée et d’ailleurs compromise par les exactions de l’OAS, et de ce vaste programme ne resta après l’indépendance qu’une « cité fantôme », pour reprendre les termes de Samia Henni, qui en arrive là à la fin de son parcours dans l’espace et dans le temps.
On peut dire qu’en dehors des positions idéologiques qui sont les siennes, elle s’appuie sur des faits dont le sens est incontestable. Oui la France a vraiment cherché à donner, grâce au travail d’architectes et d’urbanistes souvent compétents, une réalité concrète, inscrite dans l’espace, à sa présence en Algérie. Il n’en est pas moins vrai que les aspects politiques de celle-ci vouaient tout autre effort à l’échec.
Denise Brahimi
« Architecture de la contre-révolution – L’armée française dans le nord de l’Algérie », la thèse de doctorat en histoire et théorie de l’architecture de Samia Henni ouvre à une lecture particulière, précise et remarquablement documentée de ce qu’on a fini par appeler « la guerre d’Algérie ». Elle analyse pour cela le processus de destruction/construction de l’espace que celle-ci a généré entre 1954 et 1962 – et au-delà – qu’il soit urbain ou rural. Cette lecture met en corrélation – et c’est, me semble-t-il, une grande partie de son intérêt, les actions de l’armée sur le terrain, l’évolution des politiques qui en dépendent, ses différents acteurs et l’espace qui en résulte.
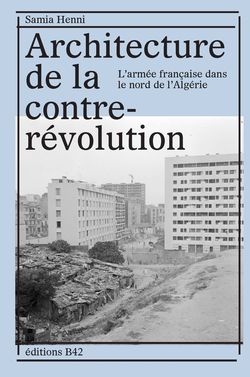 Les déductions que Samia Henni en tire sont une condamnation sans appel, non seulement de la colonisation, mais de tout ce qui, de près ou de loin, s’y rattache. Cette position radicale ouvre à un double questionnement : d’abord sur la mémoire, tant en Algérie qu’en France, de ce qu’on a appelé pendant longtemps « les événements d’Algérie « et concrètement sur la valeur et l’avenir de ce qui a été produit sur le sol algérien pendant la guerre d’indépendance en particulier en architecture. Cette période qui a été aussi bien celle des centres de regroupement que celle des « grands ensembles » a été très prolifique. A terme, elle ouvre aussi à la question du patrimoine.
Les déductions que Samia Henni en tire sont une condamnation sans appel, non seulement de la colonisation, mais de tout ce qui, de près ou de loin, s’y rattache. Cette position radicale ouvre à un double questionnement : d’abord sur la mémoire, tant en Algérie qu’en France, de ce qu’on a appelé pendant longtemps « les événements d’Algérie « et concrètement sur la valeur et l’avenir de ce qui a été produit sur le sol algérien pendant la guerre d’indépendance en particulier en architecture. Cette période qui a été aussi bien celle des centres de regroupement que celle des « grands ensembles » a été très prolifique. A terme, elle ouvre aussi à la question du patrimoine.
La lecture de ce livre a représenté pour moi qui suis née à Alger et qui y ait vécu et travaillé jusqu’en 1987, une sorte de remise en mémoire d’une période particulièrement violente et intense. Il a aussi alimenté une réflexion qui a déjà été celle de mon travail de géographe et d’enseignante, axé sur l’urbanisme et l’architecture.
Sans mettre en question de quelque façon que ce soit ni la violence, ni le mépris sous-jacent à toute entreprise coloniale, il n’est pas sans intérêt de rappeler que l’Algérie fut pendant 130 ans une colonie de peuplement, c’est à dire une forme exceptionnelle de colonisation qui non seulement et comme partout ailleurs dans le « monde colonial », expropria de ses terres les plus fertiles la population autochtone décimée et humiliée, mais détruisit aussi son organisation traditionnelle, à la différence par exemple du Maroc et de la Tunisie. La France y attire et installe une population de diverses origines – française, mais aussi espagnole, italienne, maltaise, pour les plus importantes, en majorité pauvre, qui sera nationalisée française en 1889 et qui, petit à petit, s’organisera sur le modèle français, sur ce territoire que la France lui aura frauduleusement octroyé, sans limites..
L’Algérie ce sera la France, avec ses villes, ses villages, mais avec aussi ses grands – et petits – « colons », ses fonctionnaires, ses commerçants, ses artisans… : ses classes sociales.
L’Algérie vivra 130 ans dans une double ségrégation dont elle héritera dans la douleur à l’Indépendance : une ségrégation ethnique de base, à l’échelle du pays, et reproduite dans l’espace urbain entre quartiers «européens » et quartiers « musulmans » et une stratification sociale très marquée entre « beaux quartiers » bourgeois, quartiers ouvriers et quartiers « intermédiaires » de classe moyenne… et leurs architectures. On peut ajouter en parenthèse que dans le « vide » laissé par la population européenne en 1962, cette stratification sociale se reproduira.
La croissance démographique, à laquelle s’ajoutent les déplacements déterminés par la guerre, décuplèrent la surcharge des villes, agrandissant les bidonvilles. Les périphéries connurent les premiers « grands ensembles » avec à partir de 1958, les effets du Plan de Constantine du général de Gaule, ses technocrates, ses « plans-types », ses «barres »…et son déni d’architecture. Le tout dans une ambiance intense de spéculation foncière et immobilière. Depuis plus de 50 ans – et comme partout dans le monde – ce modèle continue à polluer les périphéries urbaines des villes algériennes.
Dans ce contexte, peut-on conclure avec Samia Henni que « tous ces espaces bâtis étaient indéniablement au service des objectifs de la violence coloniale française en Algérie » ? (p.302).
Il n’est pas question, une fois de plus, de nier le poids de la colonisation sur l’urbanisme et l’architecture de l’Algérie coloniale : ségrégation spatiale d’abord, ségrégation normative ensuite, de la misère des cités de « recasement » des bidonvilles aux grands ensembles dédiés à la population musulmane. Et ce, en dépit du talent de quelques architectes.
Pour autant, est-ce que toute architecture produite pendant la colonisation est à rejeter parce que « coloniale » ?
Il n’est pas de ma compétence de répondre à cette interrogation que la thèse de Samia Henni suggère.
Par contre, Jean-Jacques Deluz, architecte et urbaniste qui, entre 1956 et jusqu’à sa mort en 2009, a travaillé en Algérie et dont les ouvrages sont cités à plusieurs reprises par Samia Henni, a apporté sa réponse dans « Le tout et le fragment », chapitre 24 : « Architecture coloniale ou architecture en territoire colonisé ? » :
« Nous pensons que le problème du patrimoine architectural est avant tout un problème culturel. Une architecture peut être porteuse de qualités signifiantes au niveau de l’esthétique et de l’histoire de l’art, mais elle est aussi porteuse de mémoire. La richesse culturelle d’une ville est avant tout constituée par l’accumulation des mémoires » (page 197)
Il semble que depuis peu, dans tous les domaines, en dépit des « dérapages » et malgré les traumatismes profonds, on se rapproche, en France comme en Algérie, d’une mémoire authentique et apaisée : l’actualité le démontre. Et l’optimisme le soutient.
Joëlle Deluz-Labruyère
Géographe
« MAROC: LES LANGUES DE LA DISCORDE », sous la direction de Touriya Fili-Tullon, UGA éditions (Université Grenoble-Alpes), 2019
Ce livre est la version revue et augmentée d’un autre paru en 2018 à Casablanca sous le titre : Maroc : la guerre des langues. Dans les deux cas, l’accent a été mis d’emblée sur le caractère très conflictuel de la situation linguistique au Maroc, en sorte qu’on est plutôt (agréablement) surpris de ne pas trouver l’expression de tensions violentes dans les dix-huit articles qui composent ce recueil. On constate évidemment que la situation est fort complexe et comporte des aspects paradoxaux (pour en prendre un parmi d’autres, les Marocains n’écrivent pas la langue qu’ils parlent) mais pour autant on n’a pas le sentiment 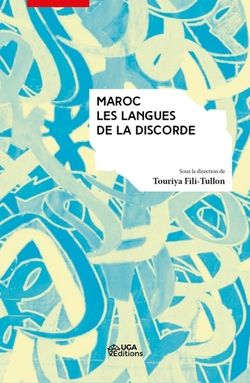 d’un blocage préjudiciable à la communication ni à la création littéraire. A cet égard tout semble judicieusement exprimé dès le premier article, celui d’Abdou Filali-Ansary, philosophe de formation et expert en sciences humaines. Comme plusieurs des auteurs regroupés dans ce recueil, il est soucieux de démentir une croyance aussi fausse qu’angoissante, selon laquelle les langues utilisées dans un même pays ou par un même individu ne pourraient que s’exclure voire se détruire les unes les autres. De toute façon, la situation vécue au Maroc oppose un déni à cette idée puisque de fait on y dénombre au moins quatre langues qui coexistent au quotidien, l’arabe populaire ou darija, l’amazighe, l’arabe écrit ou arabe standard et le français ; sans parler de diverses variantes dialectales !
d’un blocage préjudiciable à la communication ni à la création littéraire. A cet égard tout semble judicieusement exprimé dès le premier article, celui d’Abdou Filali-Ansary, philosophe de formation et expert en sciences humaines. Comme plusieurs des auteurs regroupés dans ce recueil, il est soucieux de démentir une croyance aussi fausse qu’angoissante, selon laquelle les langues utilisées dans un même pays ou par un même individu ne pourraient que s’exclure voire se détruire les unes les autres. De toute façon, la situation vécue au Maroc oppose un déni à cette idée puisque de fait on y dénombre au moins quatre langues qui coexistent au quotidien, l’arabe populaire ou darija, l’amazighe, l’arabe écrit ou arabe standard et le français ; sans parler de diverses variantes dialectales !
Cette situation linguistique, qui correspond à la réalité du Maroc d’aujourd’hui, est la preuve que le parti nationaliste, qui avait des chances de s’imposer immédiatement après l’indépendance, n’y est pas parvenu. Son injonction d’établir dans le pays une seule langue, correspondant à un seul pays et une seule nation, s’est heurtée à une réalité autre et comme c’était une décision purement idéologique, à terme, elle ne pouvait qu’échouer.
Le risque était que cet échec profite à une autre idéologie, faisant de l’arabe coranique ou du moins littéral et classique la langue qu’il convenait d’imposer au pays, dans une perspective religieuse et réactionnaire d’attachement aux valeurs de l’islam (à maintenir ou à rétablir) ; ce parti pris s’oppose ou s’opposerait à toute velléité de faire évoluer la langue arabe dans le sens de la modernité. Pourtant plusieurs articles montrent que cette évolution est bel et bien en cours, et que l’arabe écrit de nos jours au Maroc ne cesse de travailler à son propre renouvellement. A ce propos, « Les langues de la discorde » nous appelle à en finir avec plusieurs stéréotypes, que les écrivains francophones du Maghreb ont contribué à répandre. Pour justifier leur choix du français comme langue d’écriture, ils ou elles ont expliqué que l’arabe avait plus ou moins consciemment pour eux un rapport avec le sacré, du fait qu’il est originellement la langue du Coran, et que pour cette raison ils ne pouvaient aborder dans cette langue certains sujets tel que le rapport au corps sexué, à l’érotisme etc. Plusieurs auteurs du recueil démentent preuve à l’appui que la langue arabe éviterait effectivement de tels sujets.
Le lecteur comprend que non seulement on peut faire de nombreuses propositions pour changer certaines caractéristiques traditionnelles de la langue arabe mais qu’en fait cet important travail est déjà en cours et a dépassé le stade du projet. La modernité au Maroc n’est pas et ne doit pas être l’apanage de la langue française, en fait un clivage de cette sorte entre les deux langues écrites, arabe et français, en recouvre un autre qui semble très évident et forcément déplaisant, de type social celui-là : l’usage du français, à l’exclusion ou presque des autres langues employées au Maroc, est assez largement le fait d’une élite peut-être partiellement intellectuelle mais qui surtout dispose de la richesse économique et n’a que très peu en commun sinon rien avec les couches populaires. D’une manière générale, on a l’impression que si le mot sociolinguistique et la science à laquelle il correspond n’existaient pas, le Maroc obligerait à les inventer, prolongeant ce que la simple observation révèle d’ailleurs assez bien. Mais dans chacune des trois parties du livres, études, témoignages et entretiens, on voit bien que les auteurs, souvent sollicités pour parler de ce genre de sujet (comme le fait remarquer Abdellatif Laâbi avec un brin d’agacement), essaient de renouveler leur propos au profit d’idées plus originales.
D’une manière générale, on a l’impression que si le mot sociolinguistique et la science à laquelle il correspond n’existaient pas, le Maroc obligerait à les inventer, prolongeant ce que la simple observation révèle d’ailleurs assez bien. Mais dans chacune des trois parties du livres, études, témoignages et entretiens, on voit bien que les auteurs, souvent sollicités pour parler de ce genre de sujet (comme le fait remarquer Abdellatif Laâbi avec un brin d’agacement), essaient de renouveler leur propos au profit d’idées plus originales.
L’une d’entre elles concerne l’arabe dialectal et populaire appelé darija qui pour le moment n’est qu’une langue parlée et non écrite. Employer à ce propos l’expression ne…que qui est restrictive est le signe qu’on se réfère à un préjugé commun, mais c’est ici avec la volonté de le dénoncer car plusieurs auteurs s’emploient à souligner la richesse et la créativité de cette langue. Ils expliquent qu’elle n’est nullement un sous-produit dérivé de l’arabe écrit par simplification et appauvrissement, comme le veut une idée répandue mais inexacte, qui risque d’entraîner des effets négatifs. La darija mérite qu’on s’intéresse à elle pour découvrir et développer ses possibilités linguistiques, et certains semblent même penser que dans cette perspective d’un travail inventif, elle pourrait acquérir le statut de langue écrite. En tout cas c’est encore un vaste champ ouvert sur l’avenir et dès lors qu’il s’agit de langage, on voit bien comment cette ouverture peut stimuler les écrivain.e.s.
Concernant l’amazighe, ou langue berbère, le livre apporte aussi de précieuses informations, notamment sur les travaux dont elle a été l’objet depuis quelques décennies. Il est évidemment impossible dans ce cas de ne pas voir à quel point les options linguistiques sont liées à des questions politiques, ce qui fait partie de la complexité qui nous paraissait la caractéristique principale de la situation évoquée par ce livre. La complexité est une richesse, c’est l’aspect positif qu’on en retient. Du côté négatif, il y a le fait que les Marocains lisent peu et s’imaginent avoir lu alors qu’il n’en est rien. Mais le problème de la lecture engage toute une réflexion sur notre époque, et dépasse largement le cadre du Maroc.
Denise Brahimi
« UN PALAIS POUR DEUX LANGUES » , récit par Mohammed El Amraoui, éditions La Passe du vent 2019
La Passe du vent est une maison d’édition créée il y a dix ans à Vénissieux et on ne peut que s’en féliciter parce qu’elle prend en charge des livres qui ont parfois du mal à trouver leur place, notamment aux confins de la création poétique, ou de plusieurs domaines à la fois. Ce qui est un peu le cas de ce « Palais pour deux langues », qui comporte, comme dit son auteur, une autobiographie linguistique, et des Notes sur la traduction de la poésie (notamment de la poésie arabe).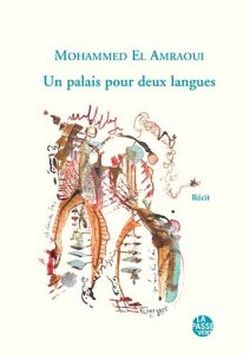 On croit comprendre que ce livre doit beaucoup aussi à une compagnie de théâtre, Les ArTpenteurs qui pour un spectacle multilingue, Le café des langues, a fait appel à Mohammed El Amraoui. Poète et traducteur, il se devait d’être choisi en raison de son propre cheminement et de créations antérieures toutes en rapport avec le multilinguisme. Ce spectacle est assurément d’une conception originale, conforme aux engagements de la compagnie depuis sa fondation en 1992 et dans l’esprit de divers projets réalisés dans le quartier de La Duchère à Lyon (connu pour sa très grande diversité ethnique et linguistique).
On croit comprendre que ce livre doit beaucoup aussi à une compagnie de théâtre, Les ArTpenteurs qui pour un spectacle multilingue, Le café des langues, a fait appel à Mohammed El Amraoui. Poète et traducteur, il se devait d’être choisi en raison de son propre cheminement et de créations antérieures toutes en rapport avec le multilinguisme. Ce spectacle est assurément d’une conception originale, conforme aux engagements de la compagnie depuis sa fondation en 1992 et dans l’esprit de divers projets réalisés dans le quartier de La Duchère à Lyon (connu pour sa très grande diversité ethnique et linguistique).
Mohammed El Amraoui, d’origine marocaine, s’appuie principalement sur sa propre expérience qui l’a amené à découvrir la langue française après avoir pu explorer, dans un premier temps, la diversité des langues parlées et écrites au Maroc. Ce premier socle de réflexion et d’observations lui a évidemment été très utile pour aborder le second, qui s’est imposé à lui à partir de son exil en France. La qualité de ses propos vient de ce qu’ils sont toujours issus d’une expérience personnelle concrète, complétant de manière opportune d’excellents travaux universitaires comme celui dont nous avons déjà parlé dans cette chronique, Maroc : les langues de la discorde (Université Grenoble-Alpes, 2019).
Il est vrai que l’exemple marocain est particulièrement fécond lorsqu’il s’agit d’explorer les effets du multilinguisme. En Algérie la situation a souvent été présentée de manière binaire, comme le fait par exemple l’écrivaine Leïla Sebbar : d’un côté ceux qui parlent arabe et de l‘autre ceux qui parlent français. Une autre écrivaine Assia Djebar (morte en 2015) a d’ailleurs montré qu’en fait les choses étaient plus complexes et qu’une Algérienne comme elle avait eu à se débattre entre deux langues écrites et deux langues parlées.
L’intérêt du livre de Mohammed El Amraoui est de montrer toutes les possibilités qui s’ouvrent pour qui a vécu comme lui entre plusieurs langues marocaines et comment la navigation possible entre elles permet d‘exprimer soi-même ou de ressentir dans le langage des autres nombre de nuances qui font évidemment le bonheur de tout être amoureux des langues, et du poète en particulier.
Ce qu’il nous dit dans un deuxième temps, et dans un ensemble de notes consacrées à la traduction, est qu’il faut aussi savoir accepter la perte, car tout ce qui se dit dans une langue se peut pas à coup sûr se retrouver dans une autre, et il n’est même pas certain qu’on puisse trouver des équivalents : parfois, tout simplement, il n’y en a pas. On comprend par là à quel point le génie poétique d’un peuple est tributaire des caractéristiques linguistiques de sa langue. Le langage théorique donne l’impression qu’il s’agit d’observations savantes, mais en fait, ces Notes sur la traduction évoquent parfois des faits très simples, comme on peut le montrer ici à partir d’un exemple : « Un poème en arabe adressé à un arbre avec des traits féminins se repose sur le signifié « sajara » qui est un substantif féminin. La traduction en français bute contre cette limite faite par la langue puisqu’aucun arbre en français n’est au féminin. »
Le livre de Mohammed El Amraoui évoque un certain nombre de constats de cette sorte et fait comprendre qu’il serait aussi vain qu’absurde de s’en désoler. Le multilinguisme n’est pas l’espoir d’une langue universelle ni un plaidoyer en sa faveur. Qu’on le déplore ou non, on sait depuis longtemps que l’espéranto est ou a été une utopie non viable, et ce que nous explique Mohammed Amraoui n’en est que plus intéressant. La diversité des langues existe, il faut donc vivre avec elle, alors même qu’on ne l’a pas choisie mais parce qu’elle est une donnée de base dans le monde d’aujourd’hui. On croit comprendre, d’après ce qu’il annonce comme une « petite autobiographie linguistique ordinaire », que les principaux intercesseurs entre lui et la diversité fascinante des langues ont été des écrivains —ceux qu’il a eu la chance de rencontrer d’abord en traduction, dans une langue qui était sienne et qu’il pouvait comprendre, avant qu’il ne les rencontre dans leur propre langue, découvrant grâce à eux un élargissement toujours en cours de son multilinguisme. Pour prendre un exemple qui se passe au moment de son arrivée en France, c’est-à-dire en terre d’exil, il raconte son arrivée à Nantes, où son frère Driss l’accueille et lui sert de guide, en se référant constamment à des écrivains ou à des poètes comme si c’était à travers eux qu’il arrive à percevoir la réalité. En tout cas une réalité ou peut-être faudrait-il dire une surréalité car c’est à l’aide du surréalisme et avec les mots d’André Breton que se fait cette initiation au monde où il va vivre désormais.
On croit comprendre, d’après ce qu’il annonce comme une « petite autobiographie linguistique ordinaire », que les principaux intercesseurs entre lui et la diversité fascinante des langues ont été des écrivains —ceux qu’il a eu la chance de rencontrer d’abord en traduction, dans une langue qui était sienne et qu’il pouvait comprendre, avant qu’il ne les rencontre dans leur propre langue, découvrant grâce à eux un élargissement toujours en cours de son multilinguisme. Pour prendre un exemple qui se passe au moment de son arrivée en France, c’est-à-dire en terre d’exil, il raconte son arrivée à Nantes, où son frère Driss l’accueille et lui sert de guide, en se référant constamment à des écrivains ou à des poètes comme si c’était à travers eux qu’il arrive à percevoir la réalité. En tout cas une réalité ou peut-être faudrait-il dire une surréalité car c’est à l’aide du surréalisme et avec les mots d’André Breton que se fait cette initiation au monde où il va vivre désormais.
Ce passage par la poésie surréaliste pour prendre peu à peu pied dans le réel est certainement la découverte la plus étonnante et la plus poétique au sens fort du mot que nous livre Mohammed El Amraoui à travers ses souvenirs. La poésie serait cette multilangue qui donne le plus sûr accès au multilinguisme, sa force vient de ce qu’elle dépasse ce qui est strictement linguistique et permet de se comprendre contre tout espoir—mais le récit nous le prouve par plusieurs exemples.
Denise Brahimi

« LE CHOIX D’ALI » film d’Amor Hakkar, 2019
Ce film qui sort sur les écrans à la fin de l’année 2019 correspond à un projet que le réalisateur portait de longue date car à sa manière modeste, il cherche à faire un cinéma utile, qui évite de graves malaises dont il a vu l’exemple dans la société autour de lui. Il s’agit de la société française du fait qu’il vit en France à Besançon, mais il situe son film dans ce qu’il connaît le mieux, c’est-à-dire le milieu musulman qui vit dans les quartiers pauvres comme il l’a fait lui-même, ayant d’abord connu le bidonville. 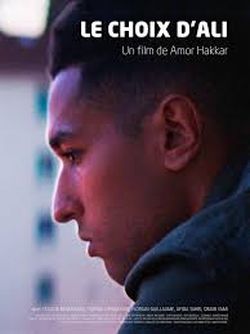 Le problème dont il veut parler est celui de la violente réprobation voire de l’exclusion que subissent les homosexuels dans ce genre de quartier plus encore qu’ailleurs, l’homophobie sévissant un peu partout et pas seulement là. Mais Amor Hakkar veut montrer que d’une part l’islam, en tout cas les groupes sociaux musulmans, sont particulièrement violents contre les homosexuels qui essaient de vivre dans leur famille et et dans leur milieu d’origine ; et que d’autre part la pression religieuse se fait de plus en plus ressentir aujourd’hui, alors que lui-même, par exemple, a connu une époque où les « musulmans » pouvaient y échapper. Cette montée en puissance de l’interdit religieux aboutit à des situations tragiques dont le film donne l’exemple, de manière d’autant plus probante que le réalisateur est discret, nullement polémique, et évite sauf exception de montrer la violence sur l’écran. Ali le jeune héros homosexuel du film ne se fait ni tuer ni chasser par les gens du quartier où vit sa famille et où il retourne pour voir sa mère malade après cinq ans d’absence. Cette absence était une fuite, et elle lui a permis en effet de vivre à son goût, avec un compagnon homosexuel comme lui, Eric, ignorant à tous égards du milieu maghrébin et provincial qui est celui d’Ali. Eric veut accompagner Ali lorsque celui-ci retourne à Besançon voir sa mère, c’est une erreur et la tentative se termine fort mal car Ali ne peut pas assumer sa liaison ni dans sa famille ni dans l’entourage du quartier ; le film montre de façon très convaincante qu’il est obligé d’abandonner Eric (provisoirement croit-il) à la violence hargneuse d’une agression à laquelle il assiste sans intervenir. C’est une lâcheté qui ne peut que le culpabiliser et l’humilier gravement et qui entraîne évidemment leur rupture.
Le problème dont il veut parler est celui de la violente réprobation voire de l’exclusion que subissent les homosexuels dans ce genre de quartier plus encore qu’ailleurs, l’homophobie sévissant un peu partout et pas seulement là. Mais Amor Hakkar veut montrer que d’une part l’islam, en tout cas les groupes sociaux musulmans, sont particulièrement violents contre les homosexuels qui essaient de vivre dans leur famille et et dans leur milieu d’origine ; et que d’autre part la pression religieuse se fait de plus en plus ressentir aujourd’hui, alors que lui-même, par exemple, a connu une époque où les « musulmans » pouvaient y échapper. Cette montée en puissance de l’interdit religieux aboutit à des situations tragiques dont le film donne l’exemple, de manière d’autant plus probante que le réalisateur est discret, nullement polémique, et évite sauf exception de montrer la violence sur l’écran. Ali le jeune héros homosexuel du film ne se fait ni tuer ni chasser par les gens du quartier où vit sa famille et où il retourne pour voir sa mère malade après cinq ans d’absence. Cette absence était une fuite, et elle lui a permis en effet de vivre à son goût, avec un compagnon homosexuel comme lui, Eric, ignorant à tous égards du milieu maghrébin et provincial qui est celui d’Ali. Eric veut accompagner Ali lorsque celui-ci retourne à Besançon voir sa mère, c’est une erreur et la tentative se termine fort mal car Ali ne peut pas assumer sa liaison ni dans sa famille ni dans l’entourage du quartier ; le film montre de façon très convaincante qu’il est obligé d’abandonner Eric (provisoirement croit-il) à la violence hargneuse d’une agression à laquelle il assiste sans intervenir. C’est une lâcheté qui ne peut que le culpabiliser et l’humilier gravement et qui entraîne évidemment leur rupture.
Mais cette rupture n’est qu’un aspect de la situation complexe et douloureuse vécue par Ali, et c’est dans celle-ci que réside la beauté tragique du film qui consiste principalement à montrer son impossible choix. Ali ne peut pas ne pas ressentir l’immense appel de ses parents, père, mère, sœur et jeune frère qui sous des formes différentes voudraient tant qu’il réintègre le foyer familial, ce qui implique sans aucun doute dans leur esprit une progressive normalisation : une vie quotidienne dans la maison familiale où l’attendent sa chambre et les traces de son passé, un travail à l’image de celui du père et dans son entourage immédiat, et à terme bien sûr un mariage fêté traditionnellement comme celui auquel il assiste à la fin du film.
C’est d’ailleurs cette dernière perspective qui entraîne son rejet final sous une forme qu’on ne révélera pas. Mais en fait ce rejet n’a jamais cessé d’être en lui et senti comme inévitable par le spectateur, alors même qu’à un certain niveau d’apparence et de volonté consciente, Ali s’applique à envisager un retour à la maison. Le réalisateur suit de manière convaincante les hésitations de son personnage ; dans le récit dramatique qu’il nous donne à suivre, les décisions successives et contradictoires d’Ali jouent comme un leurre, ce n’est pas qu’il triche ni qu’il mente mais il n’y a rien qui soit véritablement possible et sa mère qui éprouve par empathie tout ce que vit Ali a l’intuition de ces impossibilités qui caractérisent la tragédie : alors même qu’il vit à la maison et tente plus ou moins de s’y réintégrer, elle voit parfaitement que, comme elle dit, il « tourne en rond »—sans pouvoir sortir du cercle.
Ce n’est donc pas par une série de dénonciations ni de prises de position explicites que le réalisateur s’engage et nous engage dans la lutte contre le préjugé homophobe, qui d’ailleurs n’est jamais nommé comme tel. Pour parler de la manière qui lui est propre, mieux vaut éviter de dire qu’il s’attaque à un problème de société pour montrer à quel  point il est grave et mortifère. Amor Hakkar est évidemment convaincu qu’il en est ainsi, mais sa manière ne consiste pas en un militantisme flamboyant. Qu’il soit engagé est tout à fait certain, ce qui ne veut pas dire qu’il s’exprime comme on le fait dans un combat car les affirmations théoriques ne peuvent sans doute pas grand chose contre l’état de lieux qu’il décrit. Son choix à lui est de toucher la sensibilité, de faire partager des souffrances tellement inutiles qu’on ne peut manquer d’être consterné par leur inutilité. Ali est un garçon de bonne foi, qui ne fait de mal à personne jusqu’au moment où il est condamné à la lâcheté dont on a déjà parlé et qui lui fait perdre, en même temps que l’amour d’Eric, l’estime de lui-même sans laquelle il ne peut pas vivre. On comprend qu’il était très jeune lorsqu’il a fui vers Paris, comme on fuit d’une prison ou d’un piège. Maintenant qu’il est plus âgé de quelques années et qu’il mesure la douleur passée et présente des siens, il ne peut assumer ce rôle de bourreau, le fait que ceux qu’il aime le plus au monde soient à ce point malheureux à cause de lui.
point il est grave et mortifère. Amor Hakkar est évidemment convaincu qu’il en est ainsi, mais sa manière ne consiste pas en un militantisme flamboyant. Qu’il soit engagé est tout à fait certain, ce qui ne veut pas dire qu’il s’exprime comme on le fait dans un combat car les affirmations théoriques ne peuvent sans doute pas grand chose contre l’état de lieux qu’il décrit. Son choix à lui est de toucher la sensibilité, de faire partager des souffrances tellement inutiles qu’on ne peut manquer d’être consterné par leur inutilité. Ali est un garçon de bonne foi, qui ne fait de mal à personne jusqu’au moment où il est condamné à la lâcheté dont on a déjà parlé et qui lui fait perdre, en même temps que l’amour d’Eric, l’estime de lui-même sans laquelle il ne peut pas vivre. On comprend qu’il était très jeune lorsqu’il a fui vers Paris, comme on fuit d’une prison ou d’un piège. Maintenant qu’il est plus âgé de quelques années et qu’il mesure la douleur passée et présente des siens, il ne peut assumer ce rôle de bourreau, le fait que ceux qu’il aime le plus au monde soient à ce point malheureux à cause de lui.
De tous côtés il est piégé, coïncé, ce qu’on ressent physiquement en le regardant et qui prouve évidemment la qualité de l’acteur Yassine Benkhadda, qui sait souffrir sans avoir l’air de jouer dans un mélo. Amor Hakkar, qui n’en est pas à son premier film, a été apprécié dès La Maison jaune, sorti en 2008, pour la qualité de ce qu’on a appelé son « combat humaniste ». Combat sans violence, humanisme sans exclusion sont si rares qu’on les salue ici avec émotion.
Denise Brahimi
« TERMINAL SUD » film de Rabah Ameur-Zaimeche 2019 Rabah Ameur-Zaimeche a un parcours cinématographique personnel, un artisanat dans la Seine-Saint-Denis, et le goût de mettre en valeur des personnages hors du commun. Après des films sur sa banlieue (Wesh Wesh Qu’est ce qu’il se passe 2002), sur un retour au pays (Bled Number One 2006), et aussi des films historiques en costumes (Les chants de Mandrin 2012, Histoire de Judas 2015), le réalisateur a souhaité aborder la thématique, très inspirée de la décennie noire algérienne, d’une société que la violence terroriste omniprésente fait se déliter.
Rabah Ameur-Zaimeche a un parcours cinématographique personnel, un artisanat dans la Seine-Saint-Denis, et le goût de mettre en valeur des personnages hors du commun. Après des films sur sa banlieue (Wesh Wesh Qu’est ce qu’il se passe 2002), sur un retour au pays (Bled Number One 2006), et aussi des films historiques en costumes (Les chants de Mandrin 2012, Histoire de Judas 2015), le réalisateur a souhaité aborder la thématique, très inspirée de la décennie noire algérienne, d’une société que la violence terroriste omniprésente fait se déliter.
Le personnage principal est incarné (et le terme est particulièrement adapté en l’occurence) par l’excellent Ramzy Bedia qui laisse de côté ses habituelles bouffonneries (dans lesquelles on l’aime aussi!). Il est un médecin hospitalier qui poursuit sa mission vaille que vaille alors que le monde s’effondre autour de lui. Chaque jour il doit passer un contrôle de police minutieux en arrivant à l’hôpital, qui donne l’impression qu’on contrôle plus les « bons » que ne seraient arrêtés les « méchants » s’ils se manifestaient.
Le début du film montre un petit bus dont les passagers peuvent tous passer pour algériens arrêté à un barrage militaire, les passagers dépouillés de leurs valeurs par ces militaires. Les mots échangés mélangent arabe et français. Le paysage de maquis est méditerranéen. Un jeune se faisant connaître comme militaire en permission est emmené par les « militaires ». Le chauffeur se rend ensuite dans ce qui s’avère une petite salle de rédaction d’un journal (on découvre plus tard la plaque à l’entrée du petit bâtiment où est gravé « Le dernier maquis », le titre d’un précédent film du réalisateur. Une des journalistes est incarnée par la sociologue Nacira Guenif-Souilamas. Les échanges entre les journalistes décrivent une situation d’attentats, d’assassinats pour lesquels la police ne fait rien. Malheureusement la suite du film leur donne raison, deux femmes journalistes se faisant enlever par des hommes en tenue de policiers cagoulés, le rédacteur en chef, qu’on découvre être le frère de la compagne du docteur se fait assassiner d’une balle dans le dos, et le docteur ne parvient pas à le sauver… Cela donne lieu à de très belles scènes où les hommes creusent la tombe, puis les femmes chantent une mélopée, suivie étonnamment par le beau « Je crois entendre encore… », des Pêcheurs de perles de Bizet.
 Cela illustre la surprise du film : on ne réalise que progressivement que la situation ne se passe pas en Algérie, alors qu’il y est fait constamment référence, le choix étant fait de situer l’action dans des paysages peu à peu reconnaissables de Nîmes et de la Camargue. Cela donne à l’oeuvre un caractère en partie irréel, la volonté de rendre universelle une situation que, après l’Algérie, plusieurs pays ayant vécu ces supposés « printemps arabes » ont vécue voire vivent toujours. La critique a plutôt bien accueilli Terminal Sud, voyant dans ce paradoxe spatio-temporel une façon de nous questionner en forme de « et si ça se passait chez nous? ». L’auteur de cette chronique a plutôt adhéré au propos, acceptant de se faire surprendre par la découverte progressive que nous n’étions pas que dans une nouvelle illustration du drame algérien, mais dans une réflexion plus profonde sur la fragilité de nos sociétés en apparence tranquilles.
Cela illustre la surprise du film : on ne réalise que progressivement que la situation ne se passe pas en Algérie, alors qu’il y est fait constamment référence, le choix étant fait de situer l’action dans des paysages peu à peu reconnaissables de Nîmes et de la Camargue. Cela donne à l’oeuvre un caractère en partie irréel, la volonté de rendre universelle une situation que, après l’Algérie, plusieurs pays ayant vécu ces supposés « printemps arabes » ont vécue voire vivent toujours. La critique a plutôt bien accueilli Terminal Sud, voyant dans ce paradoxe spatio-temporel une façon de nous questionner en forme de « et si ça se passait chez nous? ». L’auteur de cette chronique a plutôt adhéré au propos, acceptant de se faire surprendre par la découverte progressive que nous n’étions pas que dans une nouvelle illustration du drame algérien, mais dans une réflexion plus profonde sur la fragilité de nos sociétés en apparence tranquilles.
Mais certains critiques n’ont pas apprécié, et les programmateurs pas trop non plus ce qui fait que le film a été assez peu diffusé.
Pourtant ce film reste dans dans la manière de réalisateur, qui joue avec l’histoire, en créant des ponts et des tensions entre le passé et le présent. Et qui investit sur la personnalité de son personnage principal, un doux généreux entraîné peu à peu à se défendre coûte que coûte.
Cette faible diffusion est regrettable : le personnage du Docteur joué par Ramzi est en effet impressionnant de présence, traversant les situations de plus en plus invivables qu’il rencontre en perdant peu à peu intégrité physique et certitudes morales. Pas de grands discours, un vécu au quotidien, d’une impasse qui n’a qu’un débouché, le départ en bateau, à ce fameux terminal Sud qui donne son titre au film, et qui en est un peu le message subliminal et paradoxal…
Michel Wilson

- Mercredi 5 février à 19h, à la Médiathèque de Vaise (Lyon 5ème), projection du film « Du jardin partagé à la solidarité paysanne en Algérie », réalisé par Acte Public Compagnie en partenariat avec Coup de Soleil AuRA suivis d’échanges et de débats avec notamment des membres de l’association algérienne TORBA
- Jeudi 6 février 2020 à 19h: à la Médiathèque de Vaise projection du film « Un retour à la terre pour se construire au Maroc », d’Acte Public Compagnie et Coup de Soleil AuRA, suivi d’échanges et de débats autour des actions de l’association DARNA de Tanger
- Vendredi 7 février 2020 à 16h puis 17h30: à la Médiathèque Lucie Aubrac de Vénissieux projection du film réalisé par des jeunes Vénissians de l’association Humanity in Action sur des associations de Tanger, puis du film sur Torba (Algérie), suivi d’un débat.
- Du vendredi 7 février au dimanche 9 février 2020 Maghreb-Orient des Livres organisé à l’Hôtel de Ville de Paris par les association Coup de Soleil et IREMMO.
- Mardi 11 février 2020 au Mémorial de la résistance et de la déportation de Saint Etienne, participation de notre association à la Journée d’étude « Les mémoires de la Guerre d’Algérie ».
- Du 13 février au 18 février 2020: Les rendez-vous des cinémas d’Afrique à Mon Ciné, Saint-Martin d’Hères (38). Coup de Soleil AuRA est partenaire de cette manifestation avec plusieurs autres associations. Nous animerons notamment la première soirée le 13 février autour du film algérien « Jusqu’à la fin des temps ».
- Jeudi 27 février 2020: au Centre Charlie Chaplin de Vaulx en Velin participation à un séminaire « Histoires singulières pour une mémoire commune »

