Lettre culturelle franco-maghrébine # 42
ÉDITO
Bonjour.
Nous avions tout d’abord pensé que nos lectrices et lecteurs, si fidèles soient ils/elles, auraient d’autres préoccupations que nos modestes invitations à découvrir la richesse de la production culturelle maghrébine.
Nous avons finalement conclu qu’offrir la possibilité d’un divertissement, au sens fort du mot, en donnant accès à des films vus ou à voir, ou à des lectures d’autant plus passionnantes qu’inhabituelles, cela fait sens en ces temps d’inquiétude et d’isolement.
Nous venons de transformer les modalités de diffusion notre lettre, qui, nous l’espérons la rendront plus attrayante, tout en nous facilitant la tâche.
C’est l’occasion de vous demander si vous souhaitez continuer à la recevoir. Dans le cas contraire, vous pourrez chaque mois demander votre désabonnement.
Bonne lecture.
Denise Brahimi et Michel Wilson

« UN DIVAN A TUNIS », film tunisien de Manele Labidi, 2020 C’est toujours une heureuse surprise lorsqu’un film concernant le Maghreb ne se présente pas comme un inventaire dramatique des problèmes de société qui s’y posent. Et c’est en effet avec beaucoup de plaisir que le public reçoit « Un divan à Tunis » annoncé haut et fort comme une comédie. Cependant tout le monde sait qu’une comédie de mœurs comme on dit ne fait pas rire sans égratigner ici ou là et qu’elle comporte une part plus ou moins grande de satire, ce qui se disait jadis en latin et notamment à l’époque de Molière : « castigat ridendo mores » (la comédie) corrige les mœurs en riant. L’idée de correction est d’autant  plus justifiée dans le cas de ce film « Un divan à Tunis » que le personnage principal, rôle magnifiquement incarné par l’actrice Golshifteh Farahani, est psychanalyste, et que sa clientèle (très vite nombreuse !) vient la trouver pour qu’elle « corrige » ce qui ne va chez eux. Son rôle n’est évidemment pas de corriger ce qui ne va pas dans l’ensemble de la société tunisienne ou tunisoise, et comme elle applique rigoureusement les règles du métier, elle ne travaille que sur des cas individuels, d’ailleurs aussi variés que possible. Cependant, le mot Tunis figurant dans le titre du film, tous les patients ont au moins un point commun qui est cette ville et la manière dont on y vit, à un niveau social moyen, celui des gens qui sans être riches ne sont pas pauvres non plus. D’ailleurs la comédie suppose une sorte d’image-type de ce qu’elle veut décrire, non seulement elle ne refuse pas le cliché mais elle a tendance à le grossir par commodité et pour mieux faire rire. Les films sur la psychanalyse (et l’on pense par exemple à celui de Chantal Akerman qui s’intitule «Un divan à New York », dans l’inventaire qu’ils font de certaines névroses, visent aussi à les utiliser comme révélatrices d’une société voire d’une civilisation. Le film de Labede Labidi est non seulement situé dans un espace précis, il l’est aussi dans le temps. C’est un film d’après le printemps de 2011, et elle tire d’ailleurs un effet comique du fait que le grand-père de la psychanalyste (des plus âgés il est vrai) ne s’est pas encore aperçu du départ de Ben Ali, dont il dit être un grand ami. Allusion sans doute au film Good Bye Lenin de 2003 où l’on voit une Berlinoise maintenue pas sa famille dans l’ignorance de la chute du Mur. A dire vrai, Un divan à Tunis ne semble pas considérer que la chute de Ben Ali a changé quoi que ce soit. Mais l’évaluation de la société politique n’est pas son propos, du moins il ne semble pas, et le problème n’est pas de savoir depuis quand la ou les situations évoquées par le film se sont mises en place. On prend les choses telles qu’elles sont, à un moment qui est à peu près le moment présent. La question qui sert de fil conducteur au film et qui lui donne sa tension dramatique interne est de savoir si l’intrépide Selma va réussir à s’imposer comme psychanalyste à Tunis, du fait qu’elle cumule les handicaps pour ce faire : elle est jeune, belle et célibataire, elle vit seule et s’habille à peu près comme un garçon, elle a quitté la Tunisie quand elle était très jeune et n’a gardé aucun contact avec le peu de famille qui lui reste dans ce pays. Nous ne serions pas dans une comédie si le dénouement n’était pas résolument optimiste : oui, elle réussit…mais in extremis et on a eu tout le temps de se dire, avec de très évidentes raisons, que décidément elle n’y arriverait pas ! Non pas que ses services soient inutiles à la population dans laquelle se recrutent ses patients, bien au contraire. On ne cesse de se dire, et c’est d’ailleurs l’idée qui la soutient elle-même dans son entreprise, qu’il y a dans ce pays un besoin extraordinaire de parler, que les gens sont très conscients leurs difficultés psychiques et très désireux d’y voir clair en eux-mêmes, par exemple grâce à l’analyse de leurs rêves. Pour des gens qui n’ont jamais entendu parler de Freud, cette situation n’en est pas moins extrêmement favorable à la psychanalyse ! Mais les obstacles viennent d’ailleurs et ils ne manquent pas. Le principal est d’ordre administratif et bureaucratique car il manque à Selma, pour pouvoir exercer son métier un certain papier, ou une lettre de recommandation, ce qui la plonge dans des démarches kafkaïennes et la conduit aux limites du découragement. Il arrive qu’on entende des propos pessimistes mais la réalisatrice, comme son héroïne, se refusent à n’entendre ou à n’ s’exprimer qu’une seule voix. On rit, on pleure (en tout cas Selma mais une fois seulement) et au bout du compte (conte) on suspend son jugement. Que de drôles d’histoires, et quelles histoires drôles !
plus justifiée dans le cas de ce film « Un divan à Tunis » que le personnage principal, rôle magnifiquement incarné par l’actrice Golshifteh Farahani, est psychanalyste, et que sa clientèle (très vite nombreuse !) vient la trouver pour qu’elle « corrige » ce qui ne va chez eux. Son rôle n’est évidemment pas de corriger ce qui ne va pas dans l’ensemble de la société tunisienne ou tunisoise, et comme elle applique rigoureusement les règles du métier, elle ne travaille que sur des cas individuels, d’ailleurs aussi variés que possible. Cependant, le mot Tunis figurant dans le titre du film, tous les patients ont au moins un point commun qui est cette ville et la manière dont on y vit, à un niveau social moyen, celui des gens qui sans être riches ne sont pas pauvres non plus. D’ailleurs la comédie suppose une sorte d’image-type de ce qu’elle veut décrire, non seulement elle ne refuse pas le cliché mais elle a tendance à le grossir par commodité et pour mieux faire rire. Les films sur la psychanalyse (et l’on pense par exemple à celui de Chantal Akerman qui s’intitule «Un divan à New York », dans l’inventaire qu’ils font de certaines névroses, visent aussi à les utiliser comme révélatrices d’une société voire d’une civilisation. Le film de Labede Labidi est non seulement situé dans un espace précis, il l’est aussi dans le temps. C’est un film d’après le printemps de 2011, et elle tire d’ailleurs un effet comique du fait que le grand-père de la psychanalyste (des plus âgés il est vrai) ne s’est pas encore aperçu du départ de Ben Ali, dont il dit être un grand ami. Allusion sans doute au film Good Bye Lenin de 2003 où l’on voit une Berlinoise maintenue pas sa famille dans l’ignorance de la chute du Mur. A dire vrai, Un divan à Tunis ne semble pas considérer que la chute de Ben Ali a changé quoi que ce soit. Mais l’évaluation de la société politique n’est pas son propos, du moins il ne semble pas, et le problème n’est pas de savoir depuis quand la ou les situations évoquées par le film se sont mises en place. On prend les choses telles qu’elles sont, à un moment qui est à peu près le moment présent. La question qui sert de fil conducteur au film et qui lui donne sa tension dramatique interne est de savoir si l’intrépide Selma va réussir à s’imposer comme psychanalyste à Tunis, du fait qu’elle cumule les handicaps pour ce faire : elle est jeune, belle et célibataire, elle vit seule et s’habille à peu près comme un garçon, elle a quitté la Tunisie quand elle était très jeune et n’a gardé aucun contact avec le peu de famille qui lui reste dans ce pays. Nous ne serions pas dans une comédie si le dénouement n’était pas résolument optimiste : oui, elle réussit…mais in extremis et on a eu tout le temps de se dire, avec de très évidentes raisons, que décidément elle n’y arriverait pas ! Non pas que ses services soient inutiles à la population dans laquelle se recrutent ses patients, bien au contraire. On ne cesse de se dire, et c’est d’ailleurs l’idée qui la soutient elle-même dans son entreprise, qu’il y a dans ce pays un besoin extraordinaire de parler, que les gens sont très conscients leurs difficultés psychiques et très désireux d’y voir clair en eux-mêmes, par exemple grâce à l’analyse de leurs rêves. Pour des gens qui n’ont jamais entendu parler de Freud, cette situation n’en est pas moins extrêmement favorable à la psychanalyse ! Mais les obstacles viennent d’ailleurs et ils ne manquent pas. Le principal est d’ordre administratif et bureaucratique car il manque à Selma, pour pouvoir exercer son métier un certain papier, ou une lettre de recommandation, ce qui la plonge dans des démarches kafkaïennes et la conduit aux limites du découragement. Il arrive qu’on entende des propos pessimistes mais la réalisatrice, comme son héroïne, se refusent à n’entendre ou à n’ s’exprimer qu’une seule voix. On rit, on pleure (en tout cas Selma mais une fois seulement) et au bout du compte (conte) on suspend son jugement. Que de drôles d’histoires, et quelles histoires drôles !
Denise Brahimi
 Premier long métrage d’une cinéaste franco tunisienne, qui a quitté pour notre bonheur la finance pour le cinéma, Un divan à Tunis reçoit un excellent accueil de la critique, et espérons-le du public. On sort en effet de la projection de ce film réjoui par tant de finesse, de richesse et de nuances dans le propos. Cette comédie fait percevoir de façon bienveillante et non dogmatique les incohérences vécues par toutes sortes de Tunisiennes et Tunisiens. Cela passe par de nombreuses scènes très cocasses, qui illustrent la richesse de l’écriture de la réalisatrice, une galerie de portraits digne de la comédie italienne d’antan (référence confirmée par une partie des musiques du film), traités avec beaucoup de tendresse. Mention spéciale pour l’imam sans barbe qui porte de lunettes lui donnant l’allure lunaire de Woody Allen (parions que ce n’est pas un hasard), ou la copine coiffeuse vraiment too much, les deux policiers assez catastrophiques, le boulanger qui va assumer sa transsexualité… Autre mention spéciale pour le flic ambigu joué tout en nuances par l’excellent Madj Mastoura que nous avons tant aimé dans Hedi, naguère chroniqué dans notre lettre. Même la voiture qu’on lui vend comme l’affaire du siècle a un rôle non négligeable. Et Monsieur Freud ne manque pas de faire quelques apparitions, soit en effigie coiffé d’un tarbouche, soit en sauveteur nocturne sur une route déserte qui par son silence sévère amène notre héroïne (fantastique Golshifteh Farahani) à une profonde émotion. Au passage, sans avoir l’air d’y toucher, c’est un petit bilan de la Tunisie d’aujourd’hui qui se dégage de façon impressionniste, un joyeux désordre, mais considéré avec affection. Un vrai moment de bonheur cinématographique.
Premier long métrage d’une cinéaste franco tunisienne, qui a quitté pour notre bonheur la finance pour le cinéma, Un divan à Tunis reçoit un excellent accueil de la critique, et espérons-le du public. On sort en effet de la projection de ce film réjoui par tant de finesse, de richesse et de nuances dans le propos. Cette comédie fait percevoir de façon bienveillante et non dogmatique les incohérences vécues par toutes sortes de Tunisiennes et Tunisiens. Cela passe par de nombreuses scènes très cocasses, qui illustrent la richesse de l’écriture de la réalisatrice, une galerie de portraits digne de la comédie italienne d’antan (référence confirmée par une partie des musiques du film), traités avec beaucoup de tendresse. Mention spéciale pour l’imam sans barbe qui porte de lunettes lui donnant l’allure lunaire de Woody Allen (parions que ce n’est pas un hasard), ou la copine coiffeuse vraiment too much, les deux policiers assez catastrophiques, le boulanger qui va assumer sa transsexualité… Autre mention spéciale pour le flic ambigu joué tout en nuances par l’excellent Madj Mastoura que nous avons tant aimé dans Hedi, naguère chroniqué dans notre lettre. Même la voiture qu’on lui vend comme l’affaire du siècle a un rôle non négligeable. Et Monsieur Freud ne manque pas de faire quelques apparitions, soit en effigie coiffé d’un tarbouche, soit en sauveteur nocturne sur une route déserte qui par son silence sévère amène notre héroïne (fantastique Golshifteh Farahani) à une profonde émotion. Au passage, sans avoir l’air d’y toucher, c’est un petit bilan de la Tunisie d’aujourd’hui qui se dégage de façon impressionniste, un joyeux désordre, mais considéré avec affection. Un vrai moment de bonheur cinématographique.
Michel Wilson
« ADAM » film marocain de Maryam Touzani 2019
Ce film est à la fois un film marocain et un film de femme, ce qui peut expliquer ses caractéristiques. Il est entièrement fondé sur la volonté de montrer (mieux vaudrait dire : de rendre sensible) un problème de société, qui sans doute doit une part de ce qu’il est à la tradition arabo-berbère et à l’islam mais qui semble particulièrement accentué au Maroc. On y retrouve d’autant mieux l’influence et la pratique dominante des films de Nabil Ayouch (Ali Zaoua prince de la rue, Much Loved) que celui-ci a été présent de plusieurs manières dans le film qui a été réalisé par son épouse.
 Si l’on peut parler d’un film de femmes, ce n’est pas seulement parce que les deux personnages principaux sont des femmes (dont l’une, Abla, est jouée par l’actrice belgo-marocaine bien connue Lubna Azabal) ; en fait on peut même parler d’une troisième, Warda fille d’Abla, qui à sept ou huit ans est une merveille d’intelligence, de vivacité et d’espièglerie. C’est aussi parce que le problème qui est posé concerne l’instinct maternel, incarné par la très jeune Samia, à la grossesse et à l’accouchement de laquelle on assiste dans le film de Maryam Touzani. La revendication en faveur de ce jeune et beau corps épanoui, qui émerveille l’âme d’enfant de Warda, est en elle-même une sorte de plaidoyer féministe, contre la perception machiste et étriqué de l’érotisme lié au corps féminin. D’autant que la féminité de Samia est ou plutôt pourrait être encore plus évidente et multiforme après la naissance de son enfant, montré comme une sorte de prolongement évident de son propre corps.
Si l’on peut parler d’un film de femmes, ce n’est pas seulement parce que les deux personnages principaux sont des femmes (dont l’une, Abla, est jouée par l’actrice belgo-marocaine bien connue Lubna Azabal) ; en fait on peut même parler d’une troisième, Warda fille d’Abla, qui à sept ou huit ans est une merveille d’intelligence, de vivacité et d’espièglerie. C’est aussi parce que le problème qui est posé concerne l’instinct maternel, incarné par la très jeune Samia, à la grossesse et à l’accouchement de laquelle on assiste dans le film de Maryam Touzani. La revendication en faveur de ce jeune et beau corps épanoui, qui émerveille l’âme d’enfant de Warda, est en elle-même une sorte de plaidoyer féministe, contre la perception machiste et étriqué de l’érotisme lié au corps féminin. D’autant que la féminité de Samia est ou plutôt pourrait être encore plus évidente et multiforme après la naissance de son enfant, montré comme une sorte de prolongement évident de son propre corps.
Mais c’est ici qu’apparaît l’idée centrale du film et la tragédie qu’il exprime. En dépit de la force physique incroyable et instinctive de ce qu’elle ressent, Samia sait qu’elle ne doit pas se laisser aller à son amour pour cet enfant, parce qu’elle ne peut pas et ne veut pas le garder avec elle, dans l’intérêt même de ce petit garçon qu’elle ne veut pas condamner au statut infamant de bâtard, implacablement chargé de mépris dans la société marocaine. C’est ici que se rejoignent les deux aspects du film, le sociétal et le féministe. Samia crève véritablement du désir qu’elle a de garder son enfant avec elle mais elle n’a pas le droit de se laisser aller à ce qui serait un pur égoïsme de sa part. L’intérêt de l’enfant est de toute évidence qu’elle le confie à un organisme qui se chargera de son adoption. Et c’est ainsi qu’il deviendra le fils d’une famille honorable, de ceux dont aucune tare ne vient d’emblée appesantir le destin.
Il est clair que pour un public français par exemple, c’est un renversement complet de ce qui serait considéré comme l’égoïsme d’une mère à l’égard de son enfant. Même Abla, qui sans doute comprend la situation dans laquelle se trouve Samia, a du mal à accepter cet abandon, dont elle sait pourtant la nécessité. Il est difficile de dire si pour les besoins de sa thèse, Maryam Touzani a exagéré l’importance du préjugé contre les bâtards qui sévit dans la société marocaine. Ce que nous savons très bien est qu’il a sévi aussi pendant des siècles dans d’autres sociétés. Des représentations littéraires en ont été données, mais c’était toujours du point de vue du bâtard lui-même c’est-à-dire de son éventuelle marginalité ou infériorisation dans le corps social. Il ne semble pas que la question ait jamais été posée du point de vue de la mère de cet enfant et c’est en cela que le féminisme contemporain montre sa justesse et son efficacité.
L’autre personnage du film, Abla, pose aussi des problèmes concernant la condition des femmes et les difficultés à vivre qui leur sont propres. Abla est veuve, elle a perdu son mari dans un accident et depuis lors, elle a renoncé à toute gaîté, à tout plaisir de vivre. Les années ayant passé, cette austérité revêche dont elle fait preuve à tous égards ne lui est sans doute imposée que par elle-même et non par l’environnement social, mais on comprend assez vite qu’elle n’en souffre pas moins et qu’elle s’est enfermée dans une sorte de glaciation inhumaine. Samia, malgré ses propres malheurs, l’aidera à en sortir, tant elle incarne la puissance de la vie, de la vie malgré tout et plus forte que tout.
 C’est ainsi que la réalisatrice évite elle aussi de s’enfermer dans la représentation d’un problème unique et trop particulier. Les vies de femmes dont elle s’inspire sont traitées par elle de manière nuancée, en tout cas sans qu’on ait le sentiment d’une dénonciation polémique et ciblée. Evidemment on peut en conclure que les femmes sont victimes, mais pas toujours de la même façon ni pour les mêmes raisons. La façon dont Maryam Touzani réalise son film ne relève pas du misérabilisme, même si Samia a du mal à errer dans les rues pauvres de Casablanca avec son gros ventre de femme enceinte, à la recherche d’un travail qu’elle se voit mainte fois refuser. Les liens qui s’établissent entre elle et Abla ne sont certainement pas ceux de maîtresse à esclave, et dans l’appréciation du besoin que chacune a de l’autre, il y a beaucoup d’ambiguïté. Les situations se renversent, ce que tous les personnages comprennent sans qu’il soit besoin d’expliquer. Il y a à la fois les lois du monde, telles qu’on les subit dans une société donnée, et les êtres de chair et de sang, pourvus d’une conscience morale qui existe et s’entrecroise avec les lois. Apprécier cet entrecroisement ne saurait donner lieu à une œuvre purement polémique.
C’est ainsi que la réalisatrice évite elle aussi de s’enfermer dans la représentation d’un problème unique et trop particulier. Les vies de femmes dont elle s’inspire sont traitées par elle de manière nuancée, en tout cas sans qu’on ait le sentiment d’une dénonciation polémique et ciblée. Evidemment on peut en conclure que les femmes sont victimes, mais pas toujours de la même façon ni pour les mêmes raisons. La façon dont Maryam Touzani réalise son film ne relève pas du misérabilisme, même si Samia a du mal à errer dans les rues pauvres de Casablanca avec son gros ventre de femme enceinte, à la recherche d’un travail qu’elle se voit mainte fois refuser. Les liens qui s’établissent entre elle et Abla ne sont certainement pas ceux de maîtresse à esclave, et dans l’appréciation du besoin que chacune a de l’autre, il y a beaucoup d’ambiguïté. Les situations se renversent, ce que tous les personnages comprennent sans qu’il soit besoin d’expliquer. Il y a à la fois les lois du monde, telles qu’on les subit dans une société donnée, et les êtres de chair et de sang, pourvus d’une conscience morale qui existe et s’entrecroise avec les lois. Apprécier cet entrecroisement ne saurait donner lieu à une œuvre purement polémique.
A aucun moment la réalisatrice ne paraît poser les problèmes de manière théorique ou abstraite. De même que son héroïne Samia va donner chair à l’enfant dont elle est porteuse, de même Maryam Touzani doit donner chair aux personnages de son histoire, ou plutôt à l’histoire elle-même. La pâte des gâteaux que les deux femmes préparent à pleines mains, la musique et la danse que Samia réussit à imposer aux refus de sa comparse Abla, font partie de cette chair du film, au même titre que la poignante douleur de Samia qui doit renoncer à sa maternité.
Denise Brahimi
« ABOU LEILA »film de Amine Sidi-Boumediène 2019
Comme le titre ne l’indique pas, ce film est une variation sur les événements de la tristement célèbre décennie noire qu’ont vécue les Algériens à la fin du siècle dernier. Il est même précisément daté de l’année 1994 qui a été particulièrement meurtrière et d’ailleurs il commence par la représentation d’un meurtre commis en pleine rue d’Alger sur la personne d’un avocat au moment où il sort de son domicile et monte dans sa voiture, malgré les sinistres pressentiments de son épouse qui essaie de l’en empêcher. La police arrive et il s‘ensuit un grand nombre de coups de feu, après quoi cette séquence, qui a été traitée de manière tout à fait réaliste, s’interrompt brutalement et l’on pourrait dire qu’à partir de là commence le film qui lui sera beaucoup moins explicite et plus mystérieux.
 Ce qu’on voit d’abord pourrait être une scène d’un road movie dans le sud algérien, dont le paysage est aisément reconnaissable. Les personnages en sont deux jeunes hommes ou hommes encore jeunes, Lotfi en lequel on reconnaît l’acteur bien connu Lyès Salem et avec lui un autre, qui paraît bien mal en point, joué excellemment par l’acteur Slimane Benouari et qui ne semble jamais désigné dans le film autrement que comme S. Ce dernier semble avoir des problèmes physiques qui le gênent pour marcher (a-t-il été blessé dans une opération antiterroriste ?) mais surtout un grand trouble psychique pour lequel il s’avérera peu de temps après qu’en effet il a été traité en psychiatrie. Lotfi prend la direction des opérations, avec beaucoup d’inquiétude pour l’état de son compagnon dont on voit en effet qu’il est sujet à des crises d’angoisse ou de délire pendant lesquelles il perd toute conscience et tout contrôle de lui-même.
Ce qu’on voit d’abord pourrait être une scène d’un road movie dans le sud algérien, dont le paysage est aisément reconnaissable. Les personnages en sont deux jeunes hommes ou hommes encore jeunes, Lotfi en lequel on reconnaît l’acteur bien connu Lyès Salem et avec lui un autre, qui paraît bien mal en point, joué excellemment par l’acteur Slimane Benouari et qui ne semble jamais désigné dans le film autrement que comme S. Ce dernier semble avoir des problèmes physiques qui le gênent pour marcher (a-t-il été blessé dans une opération antiterroriste ?) mais surtout un grand trouble psychique pour lequel il s’avérera peu de temps après qu’en effet il a été traité en psychiatrie. Lotfi prend la direction des opérations, avec beaucoup d’inquiétude pour l’état de son compagnon dont on voit en effet qu’il est sujet à des crises d’angoisse ou de délire pendant lesquelles il perd toute conscience et tout contrôle de lui-même.
De toute manière on comprend que les deux hommes se sont engagés clandestinement dans une quête aux contours incertains et qu’ils ne sont pas couverts par leur hiérarchie : un ami de Lotfi lui reproche violemment par téléphone d’être parti sans autorisation avec un fou avéré —une aventure dont il ne peut certainement résulter rien de bon. On comprend tant bien que mal que s’ils se sont embarqués de cette manière en effet risquée et aventureuse, c’est pour rechercher un dangereux terroriste connu sous le nom de Abou Leïla, probablement celui qu’on a vu dans la première séquence du film et qui a réussi à échapper à la police. S. déclare qu’il veut le retrouver pour le tuer, ce qui paraît problématique dans l’état où il est et surtout en raison des maigres renseignements dont il dispose pour traquer un adversaire aussi redoutable. Il ne sait guère que le nom du lieu dans lequel Abou Leïla semble s’être réfugié et même sur ce point Lotfi a des doutes, d’autant qu’à cette époque le grand Sud saharien n’a pas encore été touché par le terrorisme.
Le film est ainsi fait, et de manière fort habile, qu’on oscille constamment entre des faits bien réels et d’autres qui n’existent peut-être que dans les délires du pauvre S. littéralement terrorisé. A cet égard, le film nous fait comprendre que le terrorisme mérite bien son nom car il agit à la fois comme une cruelle réalité —ce qu’on a vu dans la première séquence—et comme une emprise sur les esprits, surtout évidemment les plus fragiles, comme celui de S. périodiquement envahi par des hallucinations. Telle est la double nature du terrorisme que nous montre le réalisateur, évidemment très intéressé par ce mélange du vrai et du faux, qu’il emprunte à de grands maîtres de ce genre cinématographique tels que David Lynch, ou Stanley Kubrick le réalisateur de Shining (1980) auquel Abou Leila fait plusieurs fois penser.
 Il y a notamment dans Abou Leïla une scène d’horreur très remarquable, jouant sur la folie du personnage qui provoque certains faits mais surtout les amplifie démesurément, entraînant avec lui le spectateur livré à lui-même et à son éventuelle capacité de jugement pour démêler le vrai du faux. Amine Sidi-Boumediène, jeune réalisateur, rejoint ici une tradition forcément impressionnante de représentation de la folie, qui dans le monde occidental remonte à la tragédie grecque, celle de Sophocle dans Ajax (450 avant J.C) ou celle d’Euripide dans Les Bacchantes (405 avant J.C). Dans la première de ces deux tragédies, on voit Ajax faire un massacre de moutons qu’il prend pour ses ennemis. Et dans la seconde, la folie ou confusion mentale entraîne un meurtre non moins horrible et sanglant.
Il y a notamment dans Abou Leïla une scène d’horreur très remarquable, jouant sur la folie du personnage qui provoque certains faits mais surtout les amplifie démesurément, entraînant avec lui le spectateur livré à lui-même et à son éventuelle capacité de jugement pour démêler le vrai du faux. Amine Sidi-Boumediène, jeune réalisateur, rejoint ici une tradition forcément impressionnante de représentation de la folie, qui dans le monde occidental remonte à la tragédie grecque, celle de Sophocle dans Ajax (450 avant J.C) ou celle d’Euripide dans Les Bacchantes (405 avant J.C). Dans la première de ces deux tragédies, on voit Ajax faire un massacre de moutons qu’il prend pour ses ennemis. Et dans la seconde, la folie ou confusion mentale entraîne un meurtre non moins horrible et sanglant.
Dans Abou Leïla, au cours d’une nuit de panique et d’angoisse, S. se met lui aussi à massacrer des moutons, ce qui fait qu’il est couvert de sang (réellement semble-t-il) ; mais surtout, il se voit pataugeant dans des chairs sanguinolentes qu’il manie à pleines mains, les arrachant à une énorme carcasse d’un rouge violâtre—vision de cauchemar évidemment —cependant il est vrai que pendant la décennie noire, des récits abominables ont circulé sur les horreurs commises par les terroristes, sans doute pas sans raison, mais pas non plus sans que s’y mêlent les pires fantasmes. Les guerres civiles, comme l’ont été les guerres de religion en France au 16e siècle, font réapparaître des hantises archaïques, telles que celles du cannibalisme qu’on voit en effet apparaître dans une des scènes du film.
On a donc le sentiment que le réalisateur, loin de se livrer à des démonstrations gratuites d’horreur, s’empare de souvenirs encore récents, qui sont à la fois les siens propres et ceux de la mémoire algérienne collective. Né en 1982, il était entre l’enfance et l’adolescence quand les événements que son film évoque (son premier long métrage) se sont produits. De ce matériau très extraordinaire (et heureusement !) il tire un travail personnel nourri de sa connaissance de la littérature et du cinéma et aussi d’une conscience qui semble très juste du délabrement psychique de nombreux Algériens. Le tableau qu’il en fait, en la personne de S., est pathétique, parce qu’on sent qu’il aime son personnage, et ne peut rien pour lui. Lotfi a essayé de faire ce qu’il pouvait, on ne peut lui jeter la pierre s’il n’a pas réussi. Les Touaregs, ou autres Sahariens, ont essayé eux aussi, et s’ils n’ont pu le sauver, du moins ont-ils évité qu’il se détruise lui-même. Ce film parle certes d’un horrible bain de sang, et pourtant il est loin d’être sans amour.
Denise Brahimi
« LES MISERABLES » film de Ladj Ly, 2019
Le titre emprunté au célèbre roman de Victor Hugo s’explique d’abord par le fait que le film se passe à Montfermeil en Seine-Saint-Denis (banlieue située au nord-est de Paris) , où le réalisateur a passé son enfance et vit encore actuellement. Il a d’ailleurs été grand lecteur du roman de Hugo dont une partie se passe à Montfermeil, chez les tristement célèbres Thénardier, parents de l’enfant héros-enfant victime appelé Gavroche. Naturellement une raison plus profonde va au-delà de ce qui pourrait être une simple coïncidence, et l’on n’a pas de peine à comprendre que les habitants de l’actuel Montfermeil sont les misérables de notre époque, dont les conditions de vie matérielle justifient pleinement cette appellation. Ils sont français (ou le sont devenus), a fortiori leurs enfants nés en France, et dès le début du film le réalisateur prend soin de montrer  qu’à ce titre ils partagent tous un même sentiment national. On ne saurait dire que, pour prendre un exemple attendu, les policiers sont plus français ou plus blancs que les autres, puisque justement Ladj Ly prend soin de mettre un jeune homme d’origine africaine parmi les trois « flics » de la Bac ou Brigade anticriminalité dont on suit l’histoire au cours des événements racontés par le film. Comme beaucoup des personnages d’origine africaine qu’on y voit, il est sans doute malien mais peu importe, ce n’est pas le problème, et s’il s’agissait de s’intéresser à l’origine des gens, c’est plutôt de leur diversité qu’il faudrait parler.
qu’à ce titre ils partagent tous un même sentiment national. On ne saurait dire que, pour prendre un exemple attendu, les policiers sont plus français ou plus blancs que les autres, puisque justement Ladj Ly prend soin de mettre un jeune homme d’origine africaine parmi les trois « flics » de la Bac ou Brigade anticriminalité dont on suit l’histoire au cours des événements racontés par le film. Comme beaucoup des personnages d’origine africaine qu’on y voit, il est sans doute malien mais peu importe, ce n’est pas le problème, et s’il s’agissait de s’intéresser à l’origine des gens, c’est plutôt de leur diversité qu’il faudrait parler.
Cette diversité va d’ailleurs bien au-delà des types physiques dans lesquels elle est incarnée ; ce à quoi nous invite le contrôle mobile exercé par les trois hommes de la BAC dans la zone qui dépend d’eux est une découverte de la complexité des confrontations entre groupes et individus, s’agissant de rapports d’influence ou de rapports de force qui ne sont pas clairement ou explicitement définis — le pouvoir des uns et des autres étant d’ailleurs souvent auto-proclamé mais susceptible d’être remis en question. Celui qui appartient officiellement aux flics n’en est pas moins menacé s’ils commettent des erreurs ; ce qui explique pourquoi Chris, le flic principal de la bande des trois, est à la fois très fier d’avoir réussi à s’imposer dans un endroit traditionnellement difficile à gérer, et en même temps condamné à une vigilance maintenue par un mélange de force et de diplomatie. Il lui faut négocier dans toute la mesure du possible avec les autres formes de pouvoir qui s’exercent à leur manière dans ces mêmes lieux, sans qu’on puisse savoir clairement quelle alliance sera la plus efficace et la plus souhaitable. Les flics disposent évidemment d’indics mais qui sont loin d’être dociles et soumis. Les positions changent : un ancien voyou, gravement délinquant, peut se reconvertir en une sorte de chef moral et spirituel, la religion aidant. Ladj Ly montre le rôle des prédicateurs religieux que les jeunes écoutent volontiers, mais il est loin de les incriminer et de les dénoncer comme le font généralement les médias français ; en fait ils représentent un minimum d’encadrement face à des jeunes livrés à eux-mêmes et sans point de repère. Les mères jouent un rôle affectif important mais à la fois insuffisant et inconditionnel, ce qui minimise leur influence—et de toute façon, bien minces sont leurs moyens d’action.
D’autre part les enfants et même les adultes subissent la terreur que leur inspirent certains groupes très caractérisés, agissant par leur force physique difficilement contestable : c’est le cas des gitans, propriétaires d’un cirque installé localement, et ignorants de tout scrupule voire de tout sentiment ; lorsque l’un d’eux menace un gamin de le jeter dans la cage d’un lion énorme et rugissant, et presque dans les mâchoire de celui-ci, tout le monde a peur, sans parler de l’enfant. Même si cette partie de l’histoire est inventée, on a l’impression que le réalisateur est encore sous le coup de terreurs enfantines difficiles à exorciser.
Le moindre événement peut changer la donne, qui reste constamment instable. Or les  événements ne manquent pas dans cette histoire et tout l’art de Ladj Ly (mais il dit aussi à quel point il lui a fallu travailler) consistent à les enchaîner de manière à la fois plausible et imprévisible, donnant le sentiment d’une extrême difficulté à les contrôler. L’un des gamins trouve moyen de voler aux Gitans un petit lionceau adorable comme une peluche, provoquant la fureur (terrifiante) de ses propriétaires qui font entendre leur volonté de le récupérer. La recherche est sur le point d’aboutir lorsqu’une malheureuse bavure défigure le gamin et le laisse pour presque mort ; les flics émergent à peine de l’angoisse et de la panique qui s’est emparée d’eux lorsqu’ils découvrent une nouvelle raison de s’angoisser sur leur propre sort, du fait que tout l’épisode de la bavure a été filmé par un drone et qu’il y a une urgence absolue à récupérer ce film révélateur. Un nouvel arrangement est trouvé, prouvant au passage que les négociations pour dénouer ces entrelacs sont certes difficiles mais pas impossibles. Cependant tout va déraper à nouveau, lorsque le gamin victime de la bavure et de la féroce plaisanterie du gitan décide de se venger. La bande des gamins s’en prend aux trois flics, et l’on assiste à une émeute collective au cours de laquelle Chris est gravement blessé. Le plus « humaniste » des trois flics comprend alors que sa position, juste dans l’idéal est dans les faits difficile à tenir.
événements ne manquent pas dans cette histoire et tout l’art de Ladj Ly (mais il dit aussi à quel point il lui a fallu travailler) consistent à les enchaîner de manière à la fois plausible et imprévisible, donnant le sentiment d’une extrême difficulté à les contrôler. L’un des gamins trouve moyen de voler aux Gitans un petit lionceau adorable comme une peluche, provoquant la fureur (terrifiante) de ses propriétaires qui font entendre leur volonté de le récupérer. La recherche est sur le point d’aboutir lorsqu’une malheureuse bavure défigure le gamin et le laisse pour presque mort ; les flics émergent à peine de l’angoisse et de la panique qui s’est emparée d’eux lorsqu’ils découvrent une nouvelle raison de s’angoisser sur leur propre sort, du fait que tout l’épisode de la bavure a été filmé par un drone et qu’il y a une urgence absolue à récupérer ce film révélateur. Un nouvel arrangement est trouvé, prouvant au passage que les négociations pour dénouer ces entrelacs sont certes difficiles mais pas impossibles. Cependant tout va déraper à nouveau, lorsque le gamin victime de la bavure et de la féroce plaisanterie du gitan décide de se venger. La bande des gamins s’en prend aux trois flics, et l’on assiste à une émeute collective au cours de laquelle Chris est gravement blessé. Le plus « humaniste » des trois flics comprend alors que sa position, juste dans l’idéal est dans les faits difficile à tenir.
Cet humanisme est celui de Ladj Ly, qui cependant se garde bien de discours sentimentaux ou moralisateurs. Il ne veut ni terroriser par un étalage de violence ni minimiser la gravité de celle-ci. Il faut à la fois analyser les mécanismes par lesquels elle s’impose et garder à l’esprit que la menace est permanente parce que des situations, comme celles qu’on voit dans le film, ne peuvent être entièrement contrôlées. Le réalisateur ne cède pas à la facilité du film de dénonciation qui consiste à désigner un bouc émissaire et à le charger de tous les maux. Pas non plus à celle de la noirceur absolue et du désespoir, contrairement à certaines interprétations du film trop peu attentives à cet « humanisme » qui y est pourtant très présent jusqu’au bout.
Denise Brahimi

« ECORCES », roman par Hajar Bali, éditions Barzakh 2019
Ce premier roman donne d’abord l’impression d’une grande originalité, sans rapport avec la production franco-algérienne habituelle, ou la plus fréquente. Cependant à la réflexion on ne peut manquer de lui découvrir une paternité qui n’est pas des moindres, puisqu’il s’agit du livre-ancêtre par excellence (néanmoins toujours jeune), qui est Nedjma de Kateb Yacine. Rapprochement dont il est facile de se justifier : y a-t-il dans la littérature algérienne (ou maghrébine) un autre roman qui tourne autour du risque d’inceste, à la manière faulknérienne puisqu’on sait que le grand auteur américain était la référence favorite de Kateb ?
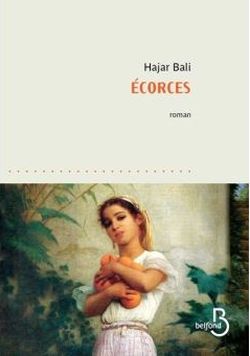 Que veut dire ici la manière faulknérienne ? Cela veut dire pour commencer que certains désordres s’expliquent par un contexte de guerre, et d’une guerre qui a ou qui va modifier l’essentiel, c’est-à-dire toute la structure fondamentale d’une société—ce qui vaut aussi bien pour la guerre de Sécession que pour la guerre d’Algérie. L’adjectif faulklnérien pourrait aider à définir aussi un moment dans l’évolution sociologique qui est celui où les structures tribales et archaïques se sont défaites sous des poussées diverses, donnant naissance à des individualités mais à un moment où celles-ci sont encore très encadrées par un ensemble de relations familiales omniprésentes et déterminantes. Il se pourrait que ce soit à ce stade intermédiaire que le risque ou la tentation de l’inceste prend un sens particulier, dont le roman d’Hajar Bali fait sentir l’ambiguité.
Que veut dire ici la manière faulknérienne ? Cela veut dire pour commencer que certains désordres s’expliquent par un contexte de guerre, et d’une guerre qui a ou qui va modifier l’essentiel, c’est-à-dire toute la structure fondamentale d’une société—ce qui vaut aussi bien pour la guerre de Sécession que pour la guerre d’Algérie. L’adjectif faulklnérien pourrait aider à définir aussi un moment dans l’évolution sociologique qui est celui où les structures tribales et archaïques se sont défaites sous des poussées diverses, donnant naissance à des individualités mais à un moment où celles-ci sont encore très encadrées par un ensemble de relations familiales omniprésentes et déterminantes. Il se pourrait que ce soit à ce stade intermédiaire que le risque ou la tentation de l’inceste prend un sens particulier, dont le roman d’Hajar Bali fait sentir l’ambiguité.
Il faut pourtant dire pour commencer que ce qui paraît de loin le plus important dans Ecorces se situe selon un axe vertical, celui des générations successives au sein d’une même famille, et ici il n’y en a pas moins de quatre, partagées à nombre égal entre des hommes et des femmes. L’histoire commence en pleine période coloniale et va jusqu’à la mort, un siècle plus tard, de Baya, qui est vraiment le tronc dont tous les autres personnages ne sont que des écorces, pour reprendre l’image suggérée par le titre. Encore faut-il s’empresser d’ajouter qu’il ne s’agit pas pour autant de ce qu’on a coutume d’appeler l’histoire d’une famille, suivie selon l’ordre chronologique et historique. La composition d’Ecorces est très complexe mais le petit miracle du livre est qu’on la trouve cependant toute naturelle, et les personnages sont suffisamment individualisés pour qu’il n’y ait aucune confusion possible entre eux, quel que soit le moment où ils refont surface dans le récit. On est assez pris dans la trame de ce dernier pour la sentir à la fois comme solide et souple, riche de déterminations mais pourtant ouverte sur l’incertitude. De Nour et Mouna qui sont les deux personnages les plus jeunes au moment où le récit s’achève (il a 23 ans), on ne sait vraiment pas ce que l’avenir leur réserve. La seule chose qu’on sache est qu’arrivés à ce point ils ont compris l’un et l’autre qu’ils se sont enfermés dans une impasse —une impasse qui a pour nom inceste, puisqu’ils sont frère et sœur ; ce qu’on peut dire sans rien gâcher pour le lecteur, puisque il a toujours été tenu au courant. Le malheureux Nour sera le dernier à comprendre, ce qui d’ailleurs pose le problème de la place des hommes dans ce roman, et sans doute bien au-delà du roman si l’on comprend ce que veut nous dire la romancière.
La succession des femmes qu’elle nous montre, Baya, Fatima, Meriem, Mouna  composent un monde féminin omniprésent et constant, puisqu’il leur est donné de coexister en dépit de leur différence d’âge ; et ce monde est sans commune mesure avec celui des hommes, en ce sens que ce sont constamment elles qui détiennent le pouvoir et la parole, qui prennent les décisions, qui gèrent la vie et qui à dire vrai manipulent les hommes sans leur arracher la moindre protestation, ni la moindre violence. Pour des raisons diverses d’ailleurs ils meurent bien avant elles, étant plus exposés aux risques de l’histoire, combats armés, prison, et surtout semble-t-il beaucoup moins pourvus du désir de vivre. Plusieurs d’entre eux aspirent au silence, à une vie calme et retirée, désir que leurs épouses ne les laissent pas satisfaire. Ils sont fragiles à la fois physiquement et psychiquement, ce qui ne veut pas dire que le récit d’Hajar Bali ne manifeste pas de sympathie à leur égard, avec une préférence pour le dernier, Nour, qui est un garçon très attachant. On dirait que l’amour maternel est une force en soi, qui accomplit des miracles ou presque. Pendant huit ans, c’est-à-dire tout le temps de la guerre d’Algérie et au-delà, Baya attend le retour de son fils Haroun qui a disparu, et contre toute probabilité elle avait raison puisqu’elle le retrouve vivant. On est suffoqué par la force de ces femmes d’autant qu’elle va contre tous les propos répandus sur le patriarcat et sur la soumission ancestrale des femmes tant par la coutume que par la religion. Il faudrait s’interroger sur ces clichés, qui sans doute s’appuient sur quelques réalités, passées et même présentes mais sont aussi démentis par tant d’autres.
composent un monde féminin omniprésent et constant, puisqu’il leur est donné de coexister en dépit de leur différence d’âge ; et ce monde est sans commune mesure avec celui des hommes, en ce sens que ce sont constamment elles qui détiennent le pouvoir et la parole, qui prennent les décisions, qui gèrent la vie et qui à dire vrai manipulent les hommes sans leur arracher la moindre protestation, ni la moindre violence. Pour des raisons diverses d’ailleurs ils meurent bien avant elles, étant plus exposés aux risques de l’histoire, combats armés, prison, et surtout semble-t-il beaucoup moins pourvus du désir de vivre. Plusieurs d’entre eux aspirent au silence, à une vie calme et retirée, désir que leurs épouses ne les laissent pas satisfaire. Ils sont fragiles à la fois physiquement et psychiquement, ce qui ne veut pas dire que le récit d’Hajar Bali ne manifeste pas de sympathie à leur égard, avec une préférence pour le dernier, Nour, qui est un garçon très attachant. On dirait que l’amour maternel est une force en soi, qui accomplit des miracles ou presque. Pendant huit ans, c’est-à-dire tout le temps de la guerre d’Algérie et au-delà, Baya attend le retour de son fils Haroun qui a disparu, et contre toute probabilité elle avait raison puisqu’elle le retrouve vivant. On est suffoqué par la force de ces femmes d’autant qu’elle va contre tous les propos répandus sur le patriarcat et sur la soumission ancestrale des femmes tant par la coutume que par la religion. Il faudrait s’interroger sur ces clichés, qui sans doute s’appuient sur quelques réalités, passées et même présentes mais sont aussi démentis par tant d’autres.
Le lien entre mères et fils est bien sûr une explication du potentiel inépuisable dans lequel les premières puisent sans réserve, et tout se passe comme si de ce fait elles vidaient les seconds d’une bonne part de leur énergie. Dans la société contemporaine, ce pourrait être par l’amour qu’ils retrouvent une vision équilibrée, pour eux positive, de ce que le monde féminin peut leur apporter. Mais ce que nous dit le roman d’Hajar Bali c’est que selon cet axe, horizontal celui-là puisqu’il s’agit de l’amour entre frère et sœur (il y en a un autre exemple dans le livre que celui de Nour et Mouna), le débouché hors de l’enfermement familial n’est pas non plus garanti et pourrait être un leurre. Comme s’il y avait inconsciemment chez les hommes le besoin de retrouver du semblable au lieu de partir à la recherche du nouveau et du différent. La romancière nous renvoie aux forces obscures qui guident beaucoup de comportements supposés librement choisis : « Sommes-nous choisis pour répéter inlassablement les mêmes gestes, que nous croyons être de notre propre volonté ?» Grâce à la qualité de l’écriture, qui mêle délicatesse et fermeté, le récit peut prendre le risque de telles questions.
Denise Brahimi
« LES AILES DE DAOUYA » par Rabia Djelti , éditions Barzakh Alger 2019, traduit de l’arabe.
Ce roman est à la fois débordant de fantaisie imaginative et plongeant non pas dans une mais dans plusieurs réalités. Il donne un grand sentiment d’invention et de liberté, ce qui fait son charme, mais il a aussi un ou plusieurs propos qu’il ne perd pas de vue au long de son déroulement. Malgré certaines apparences il n’est pas l’œuvre d’une débutante puisque son auteure, universitaire, poétesse et traductrice, écrit assidûment depuis au moins deux décennies sinon plus.
Ce qui peut donner le sentiment qu’on a affaire à une œuvre de jeunesse est que ce livre,  avec toutes ses inventions et ses originalités, n’en appartient pas moins à la catégorie qu’on pourrait appeler « roman de formation » : on y voit comment une enfant puis une jeune fille à l’heure des études et une jeune femme à l’âge des amours parcourt ces différentes étapes et nous les fait partager.
avec toutes ses inventions et ses originalités, n’en appartient pas moins à la catégorie qu’on pourrait appeler « roman de formation » : on y voit comment une enfant puis une jeune fille à l’heure des études et une jeune femme à l’âge des amours parcourt ces différentes étapes et nous les fait partager.
L’héroïne du livre s’appelle Daouya et son histoire commence en Algérie, principalement dans la ville d’Oran. Elle grandit dans l’affection et sous l’influence d’une merveilleuse grand-mère qu’elle ne cessera de regretter après sa disparition. Par cette grand-mère Hanna Nouha, l’histoire plonge dans la légende mais plutôt pour le plaisir et sans insistance sur ce qu’on appelle les origines. La deuxième étape géographique du parcours conduit Daouya à Damas pour ses études supérieures et c’est un moment qu’elle vit avec bonheur tant elle ressent d’affinités entre la vie qu’elle mène à Damas et son appartenance algérienne. Mais la guerre qui se déclare en Syrie l’oblige à partir comme beaucoup en exil pour Paris.
Le trait remarquable de ce que Daouya évoque de sa vie et de ses sentiments est qu’on ne ressent jamais d’aigreur ni d’amertume, de reproche ni de regret. Concernant par exemple le fait qu’elle est une femme, ce qu’elle en dit n’a rien à voir avec le misérabilisme qui apparaît si souvent dès qu’il s’agit de la condition féminine au Maghreb ou dans le Proche-Orient arabe. Pas non plus la moindre dénonciation de préjugés culturels qui pourraient relever du racisme ou du moins créer tel ou tel sentiment d’infériorité. Et c’est à cet égard que Les Ailes de Daouya est un livre particulièrement original et plaisant à lire. S’il y a bien un sentiment qui s’en dégage, c’est au contraire que la jeune femme se meut, et de plus en plus, dans un monde non cloisonné culturellement, où l’on passe en toute mobilité d’un registre à l’autre, de l’art à la littérature, de la musique ou à la science, avec la grâce des oiseaux dans leur envol : c’est ici évidemment que les « ailes » de Daouya prennent toute leur signification.
Les premières fois où il en est question, de façon un peu mystérieuse, on se dit que c’est une différence dont il va forcément lui falloir payer le prix, ne serait-ce que par la gêne physique de devoir supporter et dissimuler dans son dos des paquets de plumes qui à un moment ou l’autre cherchent à se déployer. Mais on comprend vite à quel point cette faculté d’envol est un privilège inouï, dont elle va profiter pleinement, dès le moment à où elle comprend qu’elle accède par là à un monde de savoir et de beauté que les êtres non-ailés ne soupçonnent même pas. Tel était le vœu que sa grand-mère avait formé pour elle et il a fallu attendre jusqu’au milieu du livre pour qu’elle accède à ce bonheur inouï d’être reçue dans le monde des oiseaux. On comprend peu à peu et de mieux en mieux le symbolisme des ailes, et du même coup le sens de l’expression française, plus banale il est vrai : « se sentir pousser des ailes »(une soudaine envie d’entreprendre et de se surpasser ).
 Un très beau moment du livre évoque la joie que ressent son héroïne lorsqu’il lui est donné de participer à une certaine « conférence des oiseaux », pour laquelle l’auteure n’a pas à reprendre explicitement ce titre célèbre du poète persan Farid al-Din Attar puisque dans l’Orient spirituel et mystique il est connu de tous les esprits. L’expérience merveilleuse dont elle parle a sans doute à voir avec le soufisme, mais Rabia Djelti ne veut pas la refermer sur un type trop défini de spiritualité. Elle s’amuse à moderniser et à diversifier le monde des participants à la conférence, ce qui permet à son héroïne de rencontrer aussi bien le musicien arabo-andalou Ziryab, homme du 9e siècle, qu’Oum Kalthoum, Martin Luther King et l’écrivain Alphonse Daudet. Une fantaisie délicieusement loufoque mais qui signifie en clair qu’aucune frontière ne peut empêcher le monde des Ailés de communiquer entre eux. Les ailes qui soulèvent Daouya elle-même avec une parfaite aisance lui ouvrent « l’égalité totale dans le partage de la vie, de la folie, de la joie, de la création et de l’ivresse spirituelle entre tous les Ailés ! »
Un très beau moment du livre évoque la joie que ressent son héroïne lorsqu’il lui est donné de participer à une certaine « conférence des oiseaux », pour laquelle l’auteure n’a pas à reprendre explicitement ce titre célèbre du poète persan Farid al-Din Attar puisque dans l’Orient spirituel et mystique il est connu de tous les esprits. L’expérience merveilleuse dont elle parle a sans doute à voir avec le soufisme, mais Rabia Djelti ne veut pas la refermer sur un type trop défini de spiritualité. Elle s’amuse à moderniser et à diversifier le monde des participants à la conférence, ce qui permet à son héroïne de rencontrer aussi bien le musicien arabo-andalou Ziryab, homme du 9e siècle, qu’Oum Kalthoum, Martin Luther King et l’écrivain Alphonse Daudet. Une fantaisie délicieusement loufoque mais qui signifie en clair qu’aucune frontière ne peut empêcher le monde des Ailés de communiquer entre eux. Les ailes qui soulèvent Daouya elle-même avec une parfaite aisance lui ouvrent « l’égalité totale dans le partage de la vie, de la folie, de la joie, de la création et de l’ivresse spirituelle entre tous les Ailés ! »
Pour autant et pendant le même temps, Daouya n’oublie pas le monde des non-Ailés dans lequel de toute façon elle se trouve immergée. Ce monde-là nourrit la partie anecdotique de son livre de plusieurs façons. Pendant ses années de jeunesse entre Oran et Damas, elle découvre l’existence du « trabendo », commerce de contrebande entre les deux pays, en la personne d’une trabendiste qui devient son amie et qui donne lieu à un portrait aussi intéressant qu’amusant—on pourrait dire picaresque par référence à ce type de romans qui a fleuri en Espagne, riche en marginaux de toute espèce, plus ou moins voyous et sympathiques néanmoins. A Paris elle fait ainsi la connaissance d’une prostituée qui elle aussi ouvre le roman sur la diversité et l’espace social sans entrer pour autant dans la revendication.
Grâce à ce roman traduit de l’arabe on a l’impression de retrouver, alors qu’il se situe en pleine actualité, une sorte de liberté et de plaisir du conte qui passe pour appartenir à la tradition orientale plus qu’à la pratique occidentale du roman. Mais justement Rabia Djelti nous incite à ne pas nous enfermer dans ces catégories un peu misérables de l’histoire littéraire et à prendre plutôt notre envol vers un mythique et désirable sixième continent. Pour l’évoquer, elle recourt allégrement à une sorte de science fiction qui pour une fois n’est pas dystopique (comme on le dit des contre-utopies qui virent au cauchemar), alors qu’elle l’est souvent devenue dans la littérature d’aujourd’hui. Oui, le cauchemar existe dans nos sociétés et même la menace d’une apocalypse imminente mais il y a un refuge, nous dit l’auteure, qui est de rejoindre à tire-d’aile le monde des oiseaux.
Denise Brahimi

- Comme l’ensemble de nos concitoyen.ne.s, nous restons chez nous, avons annulé tous nos rendez-vous, mais travaillons à ce qui peut se faire à distance, en particulier cette lettre. Prenez soin de vous, faites signe à vos relations, et jouissez plus lentement du temps qui passe.


Pingback: Projection-débat de « Un divan à Tunis » de Manele Labidi à l’université Jean Moulin Lyon 3 le 12 décembre 2022 | Coup de Soleil