Lettre culturelle franco-maghrébine # 43
ÉDITO
Une fois n’est pas coutume. Cette Lettre est consacrée à un seul des pays du Maghreb, le Maroc, alors que nous essayons en général de n’en privilégier aucun ! Mais il se trouve que ce regroupement s’est proposé de lui-même et qu’il comporte une forme de diversité puisque les livres qui s’y trouvent appartiennent à différents genres : des essais et notamment autour d’une défense de la laïcité, des romans dont le dernier écrit par Leïla Slimani, et enfin un film, qui prend le parti du comique dans une production le plus souvent grave voire alarmiste.
Globalement cette Lettre rejoint celles que nous publions habituellement. Le moment exceptionnel que nous vivons nous a incités à en insérer une d’un modèle différent entre la précédente et celle-ci : continuité et changement, c’est tout un programme ! Nous avons reçu deux poèmes que nous publions dans cette lettre. Nous poursuivrons cette publication de courts extraits si vous continuez à nous en envoyer.
Bonne lecture.
Denise Brahimi et Michel Wilson
Et merci une fois encore à Linnéa Johansson, notre stagiaire, qui a composé cette lettre.

« LE MIRACLE DU SAINT INCONNU », FILM MAROCAIN PAR ALAA EDDINE ALJEM, 2019
Il a fallu attendre quelques mois pour comprendre le bon accueil reçu par ce premier film au Festival de Cannes 2019, qui en salles aussi, semble très apprécié du public. Ce qu’on peut expliquer assez facilement. Qui dit film marocain ou maghrébin en général annonce le plus souvent un drame intensément chargé de problèmes politiques et sociaux, qui se renouvellent au fil des années et parfois s’aggravent, ne laissant guère aux cinéastes d’autre attitude possible que leur dénonciation. Ce n’est pas le choix du jeune Alaa Eddine Aljem qui puise à une tout autre veine du génie maghrébin : la veine comique, bien sûr fondée sur la satire de divers comportements et échappant à toute position partisane y compris dans le domaine religieux devenu le plus sensible qui soit voire intouchable !
 On est incité à parler de religion et même de miracle (qui est une sorte de comble de la croyance et de la foi) par le titre du film ; mais à dire vrai ce titre agit presque comme un leurre même s’il est en effet question, dans cette fiction inventive, d’un saint et de son mausolée. L’histoire a déjà été beaucoup racontée parce qu’elle comporte une surprise amusante. Un voleur ayant enterré le fruit de son larcin dans un endroit désertique du sud marocain est tout étonné lorsqu’il vient le rechercher quelques années plus tard à sa sortie de prison : la modeste tombe qu’il avait simulée à l’endroit de l’enfouissement est devenue l’objet d’un culte, celui du saint inconnu (et pour cause !) auquel les villageois voisins ont construit un mausolée. Il s’est même établi tout à côté un nouveau village aux dépens de l’ancien qui de toute façon dépérissait pour cause de sécheresse. Les pèlerins et les touristes sont une source de revenus certes modestes mais c’est tout de même mieux que rien, et le gardien du mausolée, aidé de son chien fidèle, semble vivre assez bien des aumônes qu’il reçoit au nom du saint, tout anonyme qu’il soit.
On est incité à parler de religion et même de miracle (qui est une sorte de comble de la croyance et de la foi) par le titre du film ; mais à dire vrai ce titre agit presque comme un leurre même s’il est en effet question, dans cette fiction inventive, d’un saint et de son mausolée. L’histoire a déjà été beaucoup racontée parce qu’elle comporte une surprise amusante. Un voleur ayant enterré le fruit de son larcin dans un endroit désertique du sud marocain est tout étonné lorsqu’il vient le rechercher quelques années plus tard à sa sortie de prison : la modeste tombe qu’il avait simulée à l’endroit de l’enfouissement est devenue l’objet d’un culte, celui du saint inconnu (et pour cause !) auquel les villageois voisins ont construit un mausolée. Il s’est même établi tout à côté un nouveau village aux dépens de l’ancien qui de toute façon dépérissait pour cause de sécheresse. Les pèlerins et les touristes sont une source de revenus certes modestes mais c’est tout de même mieux que rien, et le gardien du mausolée, aidé de son chien fidèle, semble vivre assez bien des aumônes qu’il reçoit au nom du saint, tout anonyme qu’il soit.
Il en vit si bien qu’il veille attentivement sur ce poste lucratif, assis en permanence à la porte du mausolée qui de ce fait reste inaccessible à l’ex-voleur fort dépité de ne pouvoir récupérer son bien : un bien volé certes dont il ne se sent pas moins injustement spolié ! Bien décidé à ne pas lâcher le morceau, il multiplie les approches mais aussi les échecs, en partie par la faute d’un acolyte auto-baptisé « le cerveau » —un surnom manifestement à contre-emploi. Cette série d’échecs sur lesquels on ne saurait s’attendrir (mais presque) est une des bases du comique au même titre que peut l’être une succession de chutes dans les classiques du cinéma burlesque.
Cependant c’est une certaine manière de peindre une galerie de personnages locaux qui fait toute la saveur du film. On pourrait en conclure qu’il sera sans doute plus apprécié au Maroc même qu’à l’extérieur ; mais la force du comique est d’atteindre assez vite la généralité, c’est-à-dire un dépassement des frontières. Lorsque le gardien du Mausolée fait mettre des dents en or a à son chien qui a perdu les siennes (alors qu’il prive son fils de nourriture), on comprend certes que cet usage est à la fois un signe de richesse dans le village et une pratique bien connue du barbier local, mais le résultat est propre à faire rire tout public !
 On a droit ainsi à un ensemble de représentations satiriques, dans un esprit populaire qui est celui des très petites communautés où tout le monde sait à quoi s’en tenir sur tout le monde et où le plus grand des problèmes est de lutter contre l’ennui—ce qu’on comprend à travers le personnage, d’ailleurs très réussi, d’un jeune médecin récemment nommé ! Il compose avec l’infirmier, qui lui semble avoir toujours été là, un de ces couples comme on en trouve dans le western américain à la John Ford, preuve entre autres qu’Alaa Eddine Aljem ne manque pas de références cinématographiques.
On a droit ainsi à un ensemble de représentations satiriques, dans un esprit populaire qui est celui des très petites communautés où tout le monde sait à quoi s’en tenir sur tout le monde et où le plus grand des problèmes est de lutter contre l’ennui—ce qu’on comprend à travers le personnage, d’ailleurs très réussi, d’un jeune médecin récemment nommé ! Il compose avec l’infirmier, qui lui semble avoir toujours été là, un de ces couples comme on en trouve dans le western américain à la John Ford, preuve entre autres qu’Alaa Eddine Aljem ne manque pas de références cinématographiques.
La satire n’est pas anodine ni bêtifiante, elle n’est pas non plus méchante et l’on voit bien que le réalisateur a parfois beaucoup de tendresse pour ces âmes simples qui n’ont d’autre recours que quelques superstitions. Il en est ainsi pour le vieil homme qui attend la pluie depuis dix ans et qui s’en prend au mausolée parce que celui-ci attire à lui les derniers survivants du village ancien ; il y reste lui-même jusqu’à ce que mort s’en suive, et tandis qu’on l’enterre à la manière traditionnelle, on se dit que ce pourrait bien être lui le véritable saint inconnu : comme tant d’autres sans doute qui vivent et meurent dans des villages de cette sorte, sans que quiconque se préoccupe de leur sort.
On s’interroge sur les prochaines réalisations de Alaa Eddine Aljem car ce début, fort intéressant, est aussi une sorte de prudence face la diversité des voies dans lesquelles il pourrait s’engager. La tradition satirique qui est très présente au Maghreb car elle y est d’origine populaire, comme souvent dans les sociétés paysannes a d’abord été orale mais on constate qu’elle passe très bien par ce merveilleux media qu’est le cinéma. La critique peut s’y loger sans agressivité apparente mais non sans efficacité. C’est une ressource à ne pas négliger d’autant qu’elle s’use moins que les formes violentes d’expression.
Denise Brahimi

« PLAIDOIRIE POUR UN MAROC LAÏQUE » PAR ABDERRAHIM BERRADA, TARIK EDITIONS, 2019
L’on ne s’étonnera pas de trouver au titre de ce livre le mot « plaidoirie », l’auteur étant avocat de profession. Né en 1938, il a défendu nombre de militants politiques dans les 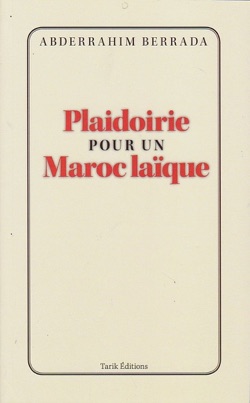 années 70 et l’on reconnaît son habitude de plaider à son style en effet très oratoire —même s’il reste tout à fait clair et sait se mettre à la portée d’un vaste public. Il met son talent et sa force de persuasion au service de ce qui est dans ce livre sa cause unique, celle de la laïcité. La première partie du livre consiste à en cerner la définition et les implications pratiques. La seconde partie est consacrée aux aspects que prennent l’une et les autres dans le contexte marocain, tant il est vrai qu’un livre comme le sien ne peut avoir d’effet que s’il est précis et concret. Or c’est l’efficacité qu’il cherche avant tout, considérant que la cause de la laïcité est loin d’être gagnée dans son pays, partant même de l’évidence contraire, ce qui l’amène à inventorier les préventions et les préjugés dus à l’ignorance et à la peur, en raison desquels l’idée même de laïcité est fortement stigmatisée.
années 70 et l’on reconnaît son habitude de plaider à son style en effet très oratoire —même s’il reste tout à fait clair et sait se mettre à la portée d’un vaste public. Il met son talent et sa force de persuasion au service de ce qui est dans ce livre sa cause unique, celle de la laïcité. La première partie du livre consiste à en cerner la définition et les implications pratiques. La seconde partie est consacrée aux aspects que prennent l’une et les autres dans le contexte marocain, tant il est vrai qu’un livre comme le sien ne peut avoir d’effet que s’il est précis et concret. Or c’est l’efficacité qu’il cherche avant tout, considérant que la cause de la laïcité est loin d’être gagnée dans son pays, partant même de l’évidence contraire, ce qui l’amène à inventorier les préventions et les préjugés dus à l’ignorance et à la peur, en raison desquels l’idée même de laïcité est fortement stigmatisée.
Avant même d’en venir à la complexité des problèmes que soulève cette situation, l’auteur s’attache à montrer à quel point la définition de la laïcité est univoque, claire et simple : la laïcité c’est la séparation de l’Etat et de la religion, formule dont on ne mesure peut-être pas d’emblée le caractère radical et subversif mais il est certain que les lecteurs marocains de Berrada, comme le souligne sa préfacière Hinde Taarji (journaliste et essayiste, auteur des Voilées de l’islam ), ne peuvent manquer de ressentir l’audace inhérente à ce « brûlot ».
Connaissant la situation marocaine mieux que quiconque (il y a des années qu’il travaille à ce livre enfin publié en 2019), l’auteur en vient très vite à ce qu’on pourrait appeler l’envers de sa définition, c’est-à-dire l’inventaire et l’analyse de tout ce que n’est pas la laïcité, contrairement à ce qu’on croit ou à ce qu’on prétend de façon mensongère, pour mieux en éloigner la masse des Marocains—qui pourtant ne sont nullement des fanatiques. Les fanatiques existent, désignés par l’auteur comme « fanatiques totalitaires » mais ce sont surtout des manipulateurs, qui s’emploient à répandre des contrevérités. Chaque fois qu’il s’agit de dénoncer ces dernières, Abderrahim Berrada est d’une très grande fermeté et n’hésite pas à se montrer polémique. Non, la laïcité ne vise pas à faire régner un « athéisme d’Etat » puisque justement son grand principe est de ne pas intervenir dans les affaires de l’Etat et dans la politique en général ; pour la même raison, la laïcité n’a pas davantage à s’opposer à l’islam, son seul but est d’assurer à chacun sa liberté de conscience, perfidement assimilée par certains à la liberté des mœurs, c’est-à-dire à la permissivité, décrite comme la négation de toute morale. De toute manière, à l’égard de la laïcité le but n’est pas de se montrer tolérant mais de l’affirmer comme un droit, l’un de ces imprescriptibles droits humains comme on dit aujourd’hui pour récuser la référence au genre masculin que pourrait impliquer l’expression « les droits de l’Homme ».
Dans la seconde partie qui traite de « la problématique marocaine de la laïcité », l’auteur montre comment les lois marocaines peuvent entrer en conflit avec la liberté de conscience —autre manière de dire la laïcité ; et comment traiter ce type de situation : tout le problème est là évidemment ! Abderrahim Berrada a repris à son compte une formule qui vient du Canada et qui consiste à dire qu’il faut trouver des « accommodements raisonnables ». Il en propose un certain nombre, prouvant son expertise en matière de solutions juridiques et donnant aussi l’impression qu’on finit toujours par en trouver si on se donne vraiment la peine de les chercher.
 D’où le sentiment qu’en effet il est pensable, faisable (en plus du fait qu’il est éminemment souhaitable) de transformer le Maroc en un pays laïque. Reste à le faire, cependant. Pour le moment, les problèmes au quotidien sont innombrables dans cet État au moins partiellement théocratique qu’est le Maroc. Mais alors n’est-ce pas justement la meilleure des raisons pour que les Marocains souhaitent cette simplification que serait le passage à la laïcité ? A mesure qu’on lit le livre d’Abderrahim Berrada on éprouve paradoxalement le double sentiment que d’une part on tourne en rond mais qu’en même temps sans doute on avance, peut-être parce qu’on y voit plus clair, ce qui est déjà beaucoup.
D’où le sentiment qu’en effet il est pensable, faisable (en plus du fait qu’il est éminemment souhaitable) de transformer le Maroc en un pays laïque. Reste à le faire, cependant. Pour le moment, les problèmes au quotidien sont innombrables dans cet État au moins partiellement théocratique qu’est le Maroc. Mais alors n’est-ce pas justement la meilleure des raisons pour que les Marocains souhaitent cette simplification que serait le passage à la laïcité ? A mesure qu’on lit le livre d’Abderrahim Berrada on éprouve paradoxalement le double sentiment que d’une part on tourne en rond mais qu’en même temps sans doute on avance, peut-être parce qu’on y voit plus clair, ce qui est déjà beaucoup.
A dire vrai le livre tourne par instants à un procès des archaïsmes de l’islam, des injustices dont il est cause et des impasses auxquelles il conduit. Et l’analyse de certaines « vociférations criminelles » des salafistes (appelant par exemple à punir de mort ceux qui osent dire que la femme musulmane doit être reconnue égale de l’homme) amène finalement à dénoncer la démission de l’Etat qui garde le silence, et de la Justice qui ne fait rien, en dépit de la loi.
Il est d’autant plus remarquable que l’auteur soit capable d’aller contre ses convictions et goûts personnels dans certains cas où il s’agit d’abord et uniquement de respecter le principe de laïcité. Par exemple pour ce qui concerne le port du foulard ou hijab, auquel on n’a aucune raison de s’opposer, car il ne va pas contre ce principe : c’est un choix personnel des intéressées qui n’agresse personne—à la différence de la burqa, « sinistre accoutrement » qui pose un problème grave de sécurité. En réalité il s’agit d’établir avec souplesse et bon sens les règles du vivre ensemble, mais les obstacles viennent de l’ordre moral qui va grandissant au Maroc et qui est selon l’auteur une forme de fascisme né dans les années 70, lorsque Hassan a appuyé son pouvoir sur l’islam politique. C’est à cette dérive qu’il faut opposer la séparation du religieux et du politique, principe de base de la laïcité.
Denise Brahimi
« LE COMBAT D’UN HOMME DE GAUCHE » PAR ABDELLAH ZAÂZAÂ, KALIMATE ÉDITIONS, MAROC
Ce témoignage vient compléter, de manière personnelle et sensible, un certain nombre des propos tenus par Abderrahim Berrada dans le livre dont on vient de parler. On a vu que celui-ci, centré sur la notion de laïcité, répertorie bien plus largement toutes les tares qui pèsent sur la société marocaine du fait qu’elle est soumise aux pressions de l’islam politique, instrumentalisé par Hassan II dès les années 70 du siècle dernier.
 Abdellah Zaâzaâ n’est pas un intellectuel ni un homme de loi ni un penseur politique, il est essentiellement un militant, qui très jeune a travaillé dans la clandestinité avec de jeunes communistes, assumant pour eux sans rechigner un grand nombre de tâches pratiques. Ce qui n’a pas manqué de lui valoir (en 1975) arrestation et emprisonnement, dans des conditions qu’il décrit et qui sont abominables. Il a été tellement torturé qu’il n’a pu s’en sortir, semble-t-il, que grâce à une exceptionnelle résistance après laquelle il lui a fallu une très longue endurance puisqu’il n’a été libéré qu’en 1989. Plusieurs années de sa vie au cachot ont été consacrées à une éventuelle évasion, grâce au creusement d’un tunnel qui au dernier moment s’avérera inutile du fait que lui-même et un certain nombre de ses compagnons seront graciés.
Abdellah Zaâzaâ n’est pas un intellectuel ni un homme de loi ni un penseur politique, il est essentiellement un militant, qui très jeune a travaillé dans la clandestinité avec de jeunes communistes, assumant pour eux sans rechigner un grand nombre de tâches pratiques. Ce qui n’a pas manqué de lui valoir (en 1975) arrestation et emprisonnement, dans des conditions qu’il décrit et qui sont abominables. Il a été tellement torturé qu’il n’a pu s’en sortir, semble-t-il, que grâce à une exceptionnelle résistance après laquelle il lui a fallu une très longue endurance puisqu’il n’a été libéré qu’en 1989. Plusieurs années de sa vie au cachot ont été consacrées à une éventuelle évasion, grâce au creusement d’un tunnel qui au dernier moment s’avérera inutile du fait que lui-même et un certain nombre de ses compagnons seront graciés.
En 1988 il écrit avec beaucoup d’audace une lettre à Hassan II (dont il reproduit le texte dans son livre) expliquant au Roi tout puissant les raisons qu’il y a de lutter pour la démocratie !
 Cette lutte continue d’ailleurs après sa libération y compris dans un cadre légal, puisque Abdellah Zaâzaâ se présente à des élections communales pour lesquelles ses principaux thèmes de revendication sont la laïcité et l’égalité entre les hommes et les femmes. Une partie de son argumentation est parfois très proche de celle que Abderrahim Berrada développe dans son livre. Il continue à se confronter, bien malgré lui, à des fonctionnaires d’état et à des policiers, ce qui donne lieu à deux ou trois dialogues aussi comiques qu’inquiétants au cours desquels on voit bien qu’il joue avec le danger. Ce ne sont d’ailleurs pas des dialogues comme ses interlocuteurs prétendent qu’ils les voudraient, car il se refuse absolument à discuter avec eux et lorsque le livre s’achève, on constate qu’il a appris à ne rien céder. Dans un texte publié en 2002, il dit avoir pressenti depuis quelques années « qu’il y avait dans notre société de formidables ressorts prêts à jouer en faveur de la démocratie ». Il affirme en effet avoir la preuve que contrairement à l’opinion de leurs adversaires les gauchistes ne sont pas isolés.
Cette lutte continue d’ailleurs après sa libération y compris dans un cadre légal, puisque Abdellah Zaâzaâ se présente à des élections communales pour lesquelles ses principaux thèmes de revendication sont la laïcité et l’égalité entre les hommes et les femmes. Une partie de son argumentation est parfois très proche de celle que Abderrahim Berrada développe dans son livre. Il continue à se confronter, bien malgré lui, à des fonctionnaires d’état et à des policiers, ce qui donne lieu à deux ou trois dialogues aussi comiques qu’inquiétants au cours desquels on voit bien qu’il joue avec le danger. Ce ne sont d’ailleurs pas des dialogues comme ses interlocuteurs prétendent qu’ils les voudraient, car il se refuse absolument à discuter avec eux et lorsque le livre s’achève, on constate qu’il a appris à ne rien céder. Dans un texte publié en 2002, il dit avoir pressenti depuis quelques années « qu’il y avait dans notre société de formidables ressorts prêts à jouer en faveur de la démocratie ». Il affirme en effet avoir la preuve que contrairement à l’opinion de leurs adversaires les gauchistes ne sont pas isolés.
Denise Brahimi
« MIGRATIONS AU MAROC : L’IMPASSE ? » COLLECTIF, COLLECTION ENQUÊTES, MAROC, 2019
Ce livre est un recueil d’articles écrits par une dizaine d’écrivains, journalistes, chercheurs, dont le point commun est de s’intéresser avec précision à un phénomène devenu visible,  préoccupant voire problématique dans la société marocaine actuelle. Cependant le mot « impasse » qui figure dans le titre ne correspond pas tout à fait ou pas forcément à l’impression que donne la lecture de ces différents articles.
préoccupant voire problématique dans la société marocaine actuelle. Cependant le mot « impasse » qui figure dans le titre ne correspond pas tout à fait ou pas forcément à l’impression que donne la lecture de ces différents articles.
La migration qui est de loin privilégiée dans ce recueil est celle des Subsahariens, pour lesquels le Maroc apparaît d’abord comme une étape vers l’Europe qui est l’eldorado de leurs rêves, mais une étape qui se transforme souvent en terminus tant il est vrai que la suite du parcours qui devrait nécessairement se faire par voie de mer est ou serait encore plus difficile, plus dangereuse et plus onéreuse que tout ce qui a précédé.
L’aspect le plus désastreux des situations générées par cette migration est celui des enfants ou adolescents mineurs non accompagnés, évidemment en situation irrégulière puisque sans papiers et au sujet desquels l’auteure de l’article intitulé Les petits combattants écrit : « Pour survivre, ils errent dans les rues et les gares en essayant de tenir comme ils peuvent. Certain.e.s en mendiant, d’autres en lavant des voitures, en portant les courses dans les marchés ou en ayant recours à la prostitution. » La raison la plus fréquente qui les a poussés à quitter leur pays est la misère, qui leur a paru sans espoir. Ceux dont parle l’article, qui ont échoué à Casablanca, viennent souvent de Guinée Conakry, mais d’autres sont originaires de Côte d’Ivoire, de République Démocratique du Congo et du Libéria et beaucoup sont entrés au Maroc clandestinement depuis l’Algérie et ont pris la route pour Oujda via Maghnia. Le mot précarité paraît bien faible pour évoquer leur mode de vie.
Cependant, il serait faux de dire que personne ne se soucie de cette situation. Depuis 2013, le Maroc a une politique migratoire et il y a un nombre relativement important d’ONG, même si beaucoup sont à peu près sans moyens. L’auteure d’un autre article a recueilli les paroles de plusieurs réfugiés, et elles sont accablantes. Le statut de réfugié est très important parce qu’il entraîne le versement d’une petite somme mensuelle, l’étape suivante étant la carte de séjour et pour ceux qui veulent devenir étudiants (ils sont assez nombreux semble-t-il), la possibilité d’une bourse.
Sujet très intéressant aussi, parce que décrit concrètement, la cohabitation des Subsahariens et des Marocains dans les mêmes lieux, pour exercer les mêmes métiers. On imagine bien que cela ne va pas sans problèmes mais il serait exagéré de dire qu’avec le temps, il n’y a pas eu de progrès. La pratique du vivre-ensemble demande un long apprentissage. L’État revendique une politique migratoire d’accueil, mais les comportements racistes existent partout et sont flagrants.
Le livre aborde aussi la question religieuse, inévitable du fait que nombre de migrants subsahariens sont d’obédience chrétienne. Mais c’est évidemment le problème économique, disons tout simplement celui de la survie, qui est de loin le plus important. Car les migrants sont tentés de partir vers les pays riches, ou obligés de le faire, et par là se mettent en danger de mort. Le dernier article du livre s’intitule : « Au royaume des enfants disparus en mer ».
Denise Brahimi
« RAMADAN(S) » ROMAN PAR MEHDI AZZAR, ÉDITIONS LIGNE DE VIE, 2019
Ce livre est le récit autobiographique d’un franco-Marocain né en 1975. Il vit avec sa famille en Normandie où le père travaille dans une fonderie, jusqu’au moment où ils déménagent à Paris, en 1998. A cette date Ali le narrateur a 23 ans, et il y a déjà quelques années qu’il ne fait plus le Ramadan, ce mois de l’année si important pour les 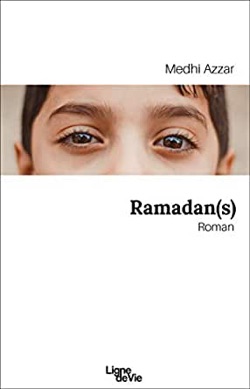 Musulmans, car il fait partie des cinq commandements de l’islam, et apparaît comme le signe nécessaire et indispensable d’appartenance à la communauté, qui d’ailleurs est loin d’être seulement religieuse. Le livre se présente comme une évocation successive des mois de Ramadan entre l’année 1983 et l’année 1991. A la première de ces deux dates Ali n’a encore que 8 ans et il est encore trop jeune pour être soumis à l’obligation de jeûner comme le font les adultes dont ses parents. Mais il tient absolument à le faire, pour mériter la considération générale et n’y parvient à dire vrai que plus ou moins. En tout cas c’est un moyen de se distinguer de son petit frère Lotfi, un peu plus jeune que lui et évidemment très jaloux de cette supériorité.
Musulmans, car il fait partie des cinq commandements de l’islam, et apparaît comme le signe nécessaire et indispensable d’appartenance à la communauté, qui d’ailleurs est loin d’être seulement religieuse. Le livre se présente comme une évocation successive des mois de Ramadan entre l’année 1983 et l’année 1991. A la première de ces deux dates Ali n’a encore que 8 ans et il est encore trop jeune pour être soumis à l’obligation de jeûner comme le font les adultes dont ses parents. Mais il tient absolument à le faire, pour mériter la considération générale et n’y parvient à dire vrai que plus ou moins. En tout cas c’est un moyen de se distinguer de son petit frère Lotfi, un peu plus jeune que lui et évidemment très jaloux de cette supériorité.
Ce à quoi nous fait assister le récit chronologique de Mehdi Azzar est une dégradation, à dire vrai assez rapide, de l’enthousiasme des débuts, qui fait que le jeune Ali supporte de moins en moins bien ce mois très particulier que son père et sa mère continuent à respecter d’une manière qu’il juge exaspérante, suscitant en lui une révolte qui va grandissant chaque année. En fait ce n’est pas tellement la religion qu’il met en cause car dans sa famille on est très peu dévot. Mais le mois de ramadan qui impose de jeûner toute la journée et ne permet de manger et de boire que la nuit, selon des horaires très stricts et fixés de manière communautaire, lui paraît très frustrant, injustifiable et totalement archaïque.
On ne peut dire que le livre soit une attaque contre l’islam car il ne se situe jamais à ce niveau qui serait celui d’une critique idéologique et argumentée. Certes la critique est bien présente mais on pourrait dire qu’elle est spontanée, et se développe comme une réaction individuelle du même type que d’autres révoltes adolescentes contre un mode de vie familial senti comme rigide et contraignant. L’aboutissement de cette évolution est assez attendu, les deux garçons quittent la maison dès la fin de leur adolescence, ils font des études supérieures avec un très grand succès pour Lotfi plus que pour Ali, et ils vivent avec des compagnes françaises, ce qui semble ne leur poser aucun problème bien au contraire, sinon qu’ils sont de plus en plus éloignés du milieu familial. On constate à l’occasion d’un ultime ramadan qu’Ali n’arrive plus à supporter cet ensemble de pratiques rituelles ne serait-ce que pour quelques heures.
 La rupture entre les deux générations est tout à fait claire. Les parents restent des Marocains vivant en France, sans problème d’intégration notable mais cantonnés à l’intérieur de leur petite communauté dite musulmane ; ils n’arrivent pas toujours mais souvent à partir au Maroc pour leurs vacances annuelles. Les enfants devenus adultes sont complétement francisés, ce qui veut dire entre autres sans appartenance religieuse et sans le moindre désir d’en avoir une. Publiant ce livre en 2019, Mehdi Azzar veut sans doute dire ou donner à entendre qu’il n’a strictement rien de commun avec les tristement célèbres islamo-terroristes, qui sont absents de son récit.
La rupture entre les deux générations est tout à fait claire. Les parents restent des Marocains vivant en France, sans problème d’intégration notable mais cantonnés à l’intérieur de leur petite communauté dite musulmane ; ils n’arrivent pas toujours mais souvent à partir au Maroc pour leurs vacances annuelles. Les enfants devenus adultes sont complétement francisés, ce qui veut dire entre autres sans appartenance religieuse et sans le moindre désir d’en avoir une. Publiant ce livre en 2019, Mehdi Azzar veut sans doute dire ou donner à entendre qu’il n’a strictement rien de commun avec les tristement célèbres islamo-terroristes, qui sont absents de son récit.
En ce sens ce livre appelé roman mais où l’on ne sent guère la part de la fiction est une peinture assez minutieuse de ce qu’intégration veut dire. Il rejette sans même avoir à les dénoncer beaucoup de clichés en cours, sans doute à des fins de récupération politique. Dans ce premier livre, Mehdi Azzar ne parle qu’au passé de lui-même en tant qu’enfant d’une famille franco-marocaine. Au présent il est artiste parisien et vit à Paris. Point.
Denise Brahimi
« LE DERNIER MANUSCRIT », ROMAN DE MAMOUN LAHBABI, ÉDITIONS MARSAM, RABAT 2019
Le personnage dont ce livre pourrait être l’autobiographie, ou presque, est une jeune femme de vingt-six ans, prénommée Chirine, qui est née au nord du Maroc, dans la ville de Sefrou; ville sans doute un peu écrasée par le voisinage de Fès et de Meknès, en sorte que malgré ses soixante mille habitants, elle reste assez peu connue. Chirine n’y a passé que les quatre premières années de sa vie avant de venir avec sa mère habiter Rabat. Mais l’auteur s’intéresse beaucoup à ce qui précède cette migration et donc à la mère de Chirine, dont l’histoire en effet vaut la peine d’être contée.
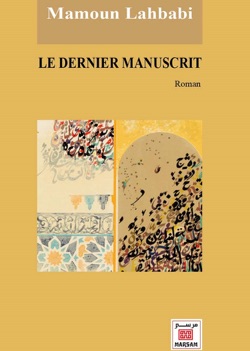 Chirine parle de sa mère ou plutôt de ceux qu’elle appelle les hommes de sa mère, en les désignant comme ceux que celle-ci « recevait sans quitter le lit » ; et Chirine dit de ces hommes qu’elle les a détestés dès l’enfance. Cependant la mère et la fille se sont aimées sans mélange et avec une infinie tendresse. C’est en partie pour retrouver cette mère désormais perdue que Chirine, à l’âge de vingt-six ans, se prépare à raconter son histoire, ou leur histoire. S’il y a une certitude et un fil directeur qui l’accompagne, comme on va le voir, c’est bien la très haute idée qu’elle a de l’écriture et de ses pouvoirs.
Chirine parle de sa mère ou plutôt de ceux qu’elle appelle les hommes de sa mère, en les désignant comme ceux que celle-ci « recevait sans quitter le lit » ; et Chirine dit de ces hommes qu’elle les a détestés dès l’enfance. Cependant la mère et la fille se sont aimées sans mélange et avec une infinie tendresse. C’est en partie pour retrouver cette mère désormais perdue que Chirine, à l’âge de vingt-six ans, se prépare à raconter son histoire, ou leur histoire. S’il y a une certitude et un fil directeur qui l’accompagne, comme on va le voir, c’est bien la très haute idée qu’elle a de l’écriture et de ses pouvoirs.
La mère de Chirine était une belle femme blonde, pourvue d’une « charge érotique » qui envoûtait tous les hommes ; la légende et l’imagination de sa fille font d’elle une descendante de Vikings, mais à part cela on n’a jamais rien su de son géniteur, et c’est une mère adoptive, Méma, qui la garda jusqu’à l‘âge de quinze ans. Méma était une jeune veuve malheureusement stérile, qui fut trop heureuse d’adopter cette petite fille et la prénomma Mahjouba. Passant sur un certain nombre d’années, on arrive au moment où l’enfant trouvée est en âge de se marier. On lui fait alors épouser un certain Miloud, qui sera le père de Chirine. Mariage traditionnel, sans bonheur et sans joie, qui donne une piètre idée de certains comportements masculins odieux à l’égard des femmes mais qui n’en aboutit pas moins à la naissance de Chirine. Après quoi, Miloud se remarie, la mère de Chirine est chassée de la maison et décide alors de partir à Rabat avec sa fille de quatre ans. Elle-même n’a pas encore atteint une vingtaine d’années.
On comprend à cette occasion la technique romanesque de Mamoun Lahbabi, qui consiste à faire dériver des récits secondaires du récit principal, à la manière des Mille et un nuits. De ce fait on est peut-être habitué dans le monde arabe plus qu’ailleurs à ce procédé narratif. En tout cas on peut voir ici comment il permet que le roman s’enrichisse progressivement de nouveaux personnages, tels qu’Aïcha, qui héberge un certain temps Chirine et sa mère, et qui étant féministe, encourage cette dernière à se prendre en main.
Pour parler du mode de vie qu’adopte alors sa mère, Chirine évoque le roman de Zola intitulé Nana (1880), appartenant à sa série des Rougon-Macquart : Nana a été une courtisane très recherchée en son temps, dont Zola fait la représentante quasi mythique d’une forme de pouvoir féminin.
C’est d’ailleurs le second procédé caractéristique du Dernier Manuscrit que ce recours à un grand nombre de textes littéraires connus pour développer et magnifier son propos : les livres sont au cœur de ce livre, ce qui n’a rien d’étonnant du fait que Mamoun Lahbabi est un universitaire, qui d’ailleurs a écrit lui-même une bonne quinzaine de livres avant celui-là. Il décrit son héroïne Chirine comme une grande lectrice qui lorsqu’elle entre à  l’Université choisit des études de lettres, et entretient bientôt des rapports privilégiés avec madame Azari, sa professeure de littérature. Celle-ci devient à son tour un des principaux personnages du livre du fait qu’elle confie à Chirine, pour qu’elle le fasse publier, un manuscrit dans lequel elle raconte l’histoire de sa propre vie. C’est un nouvel exemple d’histoire secondaire (mais non moins passionnante) venant se greffer sur le récit principal. Historiquement, le manuscrit de Madame Azari renvoie à l’époque du protectorat de la France sur le Maroc et c’est encore un aspect de la diversité qui caractérise le ou les récits de Mamoun Lahbabi. De plus cette évocation lui permet d’introduire dans son livre certains passages assez remarquables de littérature érotique.
l’Université choisit des études de lettres, et entretient bientôt des rapports privilégiés avec madame Azari, sa professeure de littérature. Celle-ci devient à son tour un des principaux personnages du livre du fait qu’elle confie à Chirine, pour qu’elle le fasse publier, un manuscrit dans lequel elle raconte l’histoire de sa propre vie. C’est un nouvel exemple d’histoire secondaire (mais non moins passionnante) venant se greffer sur le récit principal. Historiquement, le manuscrit de Madame Azari renvoie à l’époque du protectorat de la France sur le Maroc et c’est encore un aspect de la diversité qui caractérise le ou les récits de Mamoun Lahbabi. De plus cette évocation lui permet d’introduire dans son livre certains passages assez remarquables de littérature érotique.
En tout cas, Madame Azari, en lui faisant don de son manuscrit, fait entrer Chirine dans le monde des éditeurs et des écrivains, ce qui ne peut manquer d’inciter la jeune femme à s’y faire une place personnellement. On devine qu’elle deviendra elle-même écrivaine et on en a la preuve puisque le livre qu’on est en train de lire, Le dernier Manuscrit, est écrit par elle à la première personne. En ce sens, elle est à la fois elle-même en tant que personnage du livre et figure de l’écrivain Mamoun Lahbabi, entretenant avec lui les liens très particuliers qui sont ceux de tout auteur avec son narrateur ou sa narratrice.
Le dernier Manuscrit propose au lecteur un système de relais, autour de l’écriture comme transmission—là est le véritable sujet de ce livre d’où ressort un amour de la littérature très émouvant.
Denise Brahimi
« LE PAYS DES AUTRES », PAR LEÏLA SLIMANI, ROMAN, GALLIMARD, 2020
Ce roman très récent a suscité l’intérêt sitôt sa parution, du fait que l’auteure, jeune femme marocaine qui n’a pas encore quarante ans, est très connue depuis qu’elle a obtenu le Prix Goncourt en 2016 pour son roman précédent Chanson douce et déploie par ailleurs beaucoup d’énergie pour attirer l’attention sur les aspects souvent déplorables de La Vie sexuelle au Maroc, c’est le titre d’un essai qu’elle a publié en 2017.
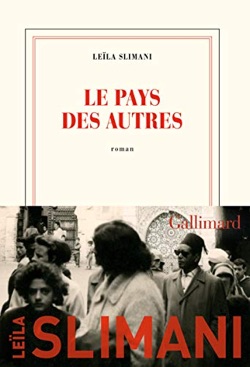 Le roman qu’elle vient de publier ne s’inscrit dans la ligne d’aucun de ses livres précédents, en revanche son auteure l’a annoncé comme le premier d’une trilogie appartenant au genre du roman historique, ne remontant pas plus loin que le milieu du siècle dernier. Il en recouvre une dizaine d’années, de 1946 à 1956, c’est-à-dire de la fin de la deuxième guerre mondiale à l’indépendance du Maroc. Ces dates ont un sens bien précis pour l’action et les personnages du roman. Le héros masculin de cette première génération, Amine Belhadj, a fait partie des troupes marocaines intégrées à l’armée française, et c’est ainsi qu’il s’est trouvé en Alsace, un des derniers bastions de l’armée allemande dans son repli hors de France à la Libération. Mathilde, jeune Alsacienne, s’étant éprise de lui, ils se marient avant de partir s’installer au Maroc dans la région de Meknès. On ne sait au juste ce que signifiait pour Mathilde le fait que le Maroc était à l’époque un protectorat français. Et pas davantage semble-t-il ni elle ni son mari Amine, tout occupés à l’exploitation de leur domaine, ne comprennent que le développement du nationalisme marocain, clandestin mais d’autant plus violent, va aboutir à l’indépendance du pays.
Le roman qu’elle vient de publier ne s’inscrit dans la ligne d’aucun de ses livres précédents, en revanche son auteure l’a annoncé comme le premier d’une trilogie appartenant au genre du roman historique, ne remontant pas plus loin que le milieu du siècle dernier. Il en recouvre une dizaine d’années, de 1946 à 1956, c’est-à-dire de la fin de la deuxième guerre mondiale à l’indépendance du Maroc. Ces dates ont un sens bien précis pour l’action et les personnages du roman. Le héros masculin de cette première génération, Amine Belhadj, a fait partie des troupes marocaines intégrées à l’armée française, et c’est ainsi qu’il s’est trouvé en Alsace, un des derniers bastions de l’armée allemande dans son repli hors de France à la Libération. Mathilde, jeune Alsacienne, s’étant éprise de lui, ils se marient avant de partir s’installer au Maroc dans la région de Meknès. On ne sait au juste ce que signifiait pour Mathilde le fait que le Maroc était à l’époque un protectorat français. Et pas davantage semble-t-il ni elle ni son mari Amine, tout occupés à l’exploitation de leur domaine, ne comprennent que le développement du nationalisme marocain, clandestin mais d’autant plus violent, va aboutir à l’indépendance du pays.
On ne saurait donc dire que le roman de Leïla Slimani soit un retour suivi et documenté sur les événements politiques de ces dix années, que d’ailleurs l’auteure elle-même n’a évidemment pas connus puisqu’elle est née en 1981. Parmi les personnages du roman il y a une petite fille, Aïcha, la première des deux enfants de Mathilde et d’Amine, qui a sept ans au début des années 50 et qui donc ne peut représenter ni peu ni prou Leïla Slimani elle-même. De toute façon, ce n’est pas le but qu’elle dit s’être donné, en tout cas pas dans ce premier livre, que de reproduire sous une forme romanesque et donc plus ou moins arrangée, l’itinéraire de ses proches, de sa famille ou d’elle-même. Etant donné que le livre est dédié, entre autres « à ma mère adorée », on se dit que Mathilde doit certainement quelque chose à cette mère et que l’envie de parler d’elle, de la retrouver à travers le souvenir ou à travers les mots, est sans doute à l’origine du livre. Mais il ne serait pas juste de parler d’hommage, en ce sens que ce n’est pas le ton choisi par la romancière —et c’est précisément ce ton qui est difficile à définir, sans doute parce que ce n’est pas celui qu’on attendait.
Plutôt que d’utiliser son talent d’écriture pour rendre hommage aux siens, Leïla Slimani semble désireuse de s’en tenir à une position objective, qui évite soigneusement de procéder par empathie et d’entrer comme on dit dans la peau de ses personnages, au risque de prendre parti davantage pour l’un ou pour l’autre. C’est un refus assez clair de sa part, notamment sur le plan politique. Les colons français au Maroc, dans leur grande majorité, ne sont certes pas présentés sous un jour sympathique, et le roman souligne en particulier leur aversion pour toute espèce de métissage, comme celui que représente le couple formé par Amine et Mathide. Pour autant, les nationalistes ne le sont pas davantage, et les seules déclarations anticolonialistes qu’on entende sortent de leurs bouches, toutes empreintes d’un fanatisme haineux ; ils sont cruels, inhumains, et particulièrement brutaux vis à vis des femmes, qu’ils maltraitent sans vergogne. On ne peut certes pas dire que le roman de Leïla Slimani s’apparente à une production politiquement correcte de la vulgate post coloniale, mais évidemment ce n’est pas le contraire non plus : on voit bien que la romancière a surtout pour projet de ne pas s’enfermer dans les antithèses binaires des pour et des contre, ni de désigner clairement un adversaire ciblé.
 Le titre qu’elle a choisi, le « pays des autres » ne peut suggérer dans ce contexte qu’un refus d’assignation : on est toujours l’autre de quelqu’un et renvoyé sans cesse à une altérité marquée négativement : pour les femmes de colons, Mathilde n’est pas une Française comme elles, elle est autre ; ou bien, pour le dire encore autrement, il n’y a que des autres, dès le moment où quelqu’un trouve avantage à stigmatiser ce qu’il dénonce comme altérité. D’ailleurs on est toujours à la fois dénonciateur et dénoncé : Amine dénonce l’altérité de Mathilde qui n’est pas comme les femmes marocaines mais la sienne est dénoncée par son frère le nationaliste Omar. La position stratégique adoptée par la romancière lui permet d’ explorer tous les angles de vue adoptés sur une situation donnée, celle que son livre évoque mais en prenant bien soin de ne jamais grossir le trait ni en exagérer la complexité. Le réel est fait de facettes multiples, non unifiables sans doute, mais le problème, ou le drame, ou la tragédie, commencent justement quand on prétend les unifier.
Le titre qu’elle a choisi, le « pays des autres » ne peut suggérer dans ce contexte qu’un refus d’assignation : on est toujours l’autre de quelqu’un et renvoyé sans cesse à une altérité marquée négativement : pour les femmes de colons, Mathilde n’est pas une Française comme elles, elle est autre ; ou bien, pour le dire encore autrement, il n’y a que des autres, dès le moment où quelqu’un trouve avantage à stigmatiser ce qu’il dénonce comme altérité. D’ailleurs on est toujours à la fois dénonciateur et dénoncé : Amine dénonce l’altérité de Mathilde qui n’est pas comme les femmes marocaines mais la sienne est dénoncée par son frère le nationaliste Omar. La position stratégique adoptée par la romancière lui permet d’ explorer tous les angles de vue adoptés sur une situation donnée, celle que son livre évoque mais en prenant bien soin de ne jamais grossir le trait ni en exagérer la complexité. Le réel est fait de facettes multiples, non unifiables sans doute, mais le problème, ou le drame, ou la tragédie, commencent justement quand on prétend les unifier.
La qualité du pays des autres est d’être un livre qui ne cherche ni à escamoter ni à dénoncer. Dans ce que Leïla Slimani ne peut ni ne veut escamoter, il y la soumission imposée aux femmes qui vivent en régime marocain, et elle n’est évidemment pas prête à minimiser la violence qu’elles subissent— on sait d’emblée qu’elle ne le fera sous aucun prétexte. La confiance qu’elle inspire à cet égard ne relève pas que de la position féministe qu’on lui connaît par ailleurs, elle vient de l’attitude qu’on lui a vue précédemment, c’est-à-dire son refus d’une idéologie de principe (différence culturelle, respect de la tradition)qui permettrait de tout justifier. L’indépendance acquise, on a hâte de découvrir l’histoire racontée dans les livres suivants, annoncés et promis par l’auteure, et de savoir si ces « autres » que sont les femmes, culturellement, traditionnellement victimes, ont eu quelque chance d’en bénéficier.
Denise Brahimi
 L’accueil fait à la Lettre 42 bis nous donne à penser que vous aimeriez continuer cette publication de « textes choisis » par vous, en rapport avec le Maghreb (auteurs, sujets…).
L’accueil fait à la Lettre 42 bis nous donne à penser que vous aimeriez continuer cette publication de « textes choisis » par vous, en rapport avec le Maghreb (auteurs, sujets…).
« L’ÉLOGE DU SAHARA » PAR L’ÉMIR ABDELKADER. TEXTE CHOISI PAR MOUNIRA CHERRABEN
Ô toi qui prends la défense des habitants de la ville
Et qui condamne l’amour bédouin
Pour ses horizons sans limites,
Est-ce la légèreté que tu reproches à nos tentes ?
N’as-tu d’éloges que pour des maisons de pierre et de boue ?
Si tu avais les secrets du désert
Si tu t’étais éveillé au milieu du Sahara
Si tes pieds avaient foulé ce tapis de sable
Parsemé de fleurs semblables à des perles,
Tu aurais admiré nos plantes,
L’étrange variété de leurs teintes,
Leur grâce, leur parfum délicieux.
Tu aurais respiré ce souffle embaumé
Qui double la vie,
Car il n’a point passé sur
l’impureté des villes…
« LE FLEUVE DU BONHEUR » PAR TOURIA IKBAL. TEXTE CHOISI PAR ODILE TESTE
Il prend sa source
dans les profondeurs sacrées
Il s’écoule impétueusement
dans les veines de la volupté
Il s’engouffre
dans les jointures de la raison
il se heurte
au récif de la déception
Il s’enlise
dans les falaises des tourments
Il passe
dans le filtre des alchimies secrètes
et
revient à sa source primaire


Pingback: Leila Slimani, roman historique marocain – Coup de Soleil Sud
Pingback: Leila Slimani Le pays des autres, Gallimard, 2020 | Coup de Soleil