Lettre culturelle franco-maghrébine #44
-La période accumule malheureusement les disparitions des gens que nous aimions, et celle, toute récente de Guy Bedos, un des soutiens initiaux et permanents de Coup de Soleil nous attriste tout particulièrement.
GUY BEDOS : COUP DE SOLEIL EN DEUIL
Immense chagrin ce 29 mai, pour Coup de soleil dont il était l’un des parrains les plus fidèles, depuis plus de 30 ans : Guy Bedos vient de mourir… Comment oublier, en particulier, ce « Coup de soleil à l’Olympia », en février 1991 ? En pleine guerre du Golfe, au moment où de graves tensions montaient au sein de la société française, nous avions pu réunir trois amis : lui, le Pied noir d’Alger, Michel Boujenah, le Tunisien et Smaïn, le Constantinois. Ils avaient plaidé tous les trois pendant plus de deux heures, navigant entre le rire et les larmes, martelant que la France devait rester unie et fraternelle, malgré le drame du Proche-Orient ! Retransmise en direct sur les télévisions de France et du Maghreb, cette soirée inoubliable avait marqué les esprits ! J’ai eu la chance de faire ensuite avec Guy deux trop brefs séjours, à Alger pour un Salon du livre et à Casablanca où notre amie « la » libraire Marie-Louise Belarbi m’ avait invité pour deux journées mémorables avec deux autres Algériens : Guy Bedos et le dessinateur Slim… et puis (« quand même, avait dit Guy à la presse, il faut bien un Gaulois dans le décor! ») Jean Plantu
– Avant même de vous présenter notre sélection pour le mois à venir, nous voudrions partager avec vous quelques pensées inspirées par l’écrivain, philosophe et penseur Albert Memmi, disparu ce 22 mai 2020 (alors qu’il était presque centenaire, en dépit d’une apparente fragilité).
Pour parler de Memmi nous avons recours à l’universitaire Guy Dugas, qui fut très proche de lui, et s’employa à le faire connaître. Nous lui empruntons quelques lignes qui montrent à quel point Memmi est représentif des complexités maghrébines :
Ici et maintenant je voudrais seulement souligner la richesse et la logique d’une pensée philosophique et morale (j’allais ajouter « politique »… mais il se méfiait trop de la politique pour l’associer à la morale) que les réseaux sociaux ont par trop tendance à schématiser, à présent qu’il n’est plus là. C’était un être complexe, à la fois rigoureux et contradictoire, plus dans la critique (et l’autocritique) que dans la louange, d’un détachement apparent et pourtant incroyablement attaché aux siens, à son pays, à son passé – et c’est précisément ce qui le rendait fascinant à mes yeux et si représentatif d’un Maghreb, autre, pluriel et partagé, qui n’est, il ne le savait que trop, qu’un rêve(..)
Et si nous retenons plus particulièrement le passage suivant de ce qu’écrit par Guy Dugas, c’est qu’il introduit parfaitement le texte que la Lettre vous propose ce mois-ci, à lire dans dans la rubrique « Notre choix » :
Que l’on me permette seulement de souligner un autre aspect de cette personnalité hors norme, à la lecture des posts à son sujet : Albert Memmi était résolument laïque, laïque et humaniste. Il croyait moins en Dieu que dans les hommes et pour lui les religions n’étaient que « de la littérature devenue folle »
La conclusion judicieuse de Guy Dugas est évidemment qu’il faut lire Albert Memmi.
Et retrouvons aussi cette conversation dans un entretien au Québec.
ÉDITO
Les circonstances récentes et encore actuelles ont été néfastes à certains films, comme celui dont nous vous parlons aujourd’hui. Sa sortie en salle laissait espérer un beau succès mais elle a été interrompue par le confinement. Nous espérons que le moment est proche où on pourra le retrouver sur les écrans !
Pour le reste, nous sommes revenus à la diversité qui nous est chère, celle des genres, qu’il s’agisse d’un essai ou de récits et romans ; ou de celle des pays, d’où une double présence de la Mauritanie dans le choix de ce mois.
Denise Brahimi

« UN FILS », film franco-tunisien de Mehdi M.Barsaoui, 2020
Ce film est l’œuvre d’un jeune réalisateur qui n’en travaille pas moins à ce projet depuis plusieurs années. L’action du film se passe entièrement en Tunisie, plus précisément à Tataouine dans le sud du pays, à plus de 500km de Tunis et, de manière encore plus localisée, dans l’hôpital de cette ville où un pauvre enfant de dix ans, Aziz, se débat entre la vie et la mort. Il a été grièvement blessé par une balle perdue au moment où la voiture de ses parents Farès et Meriem, s’est trouvé prise dans un attentat meurtrier, lié plus ou moins clairement aux événements qu’on appelle le printemps tunisien, en cours depuis quelques mois puisque l’action du film se passe en septembre 2011, sept mois après la chute de Benali. Cependant cette région qui se trouve au sud-est de la Tunisie semble plus gravement perturbée par les troubles qui ont lieu dans le pays voisin la Libye.
 Le but du réalisateur n’est d’ailleurs pas d’évoquer avec précision la situation politique qui sert de cadre à son film. Une des raisons pour lesquelles il l’a situé à Tataouine est sans doute, justement, de ne pas voir à raconter les événements qui se passent à Tunis et dans le nord du pays. La grande distance à laquelle il s’en tient lui permet de centrer son film autrement. Ce dernier mot comporte principalement deux aspects : le premier est une critique sociale de la Tunisie bien avant 2011 (et sans doute encore près), le second est un drame psychologique qui surgit inopinément au sein du couple formé par Farès et Mériem.
Le but du réalisateur n’est d’ailleurs pas d’évoquer avec précision la situation politique qui sert de cadre à son film. Une des raisons pour lesquelles il l’a situé à Tataouine est sans doute, justement, de ne pas voir à raconter les événements qui se passent à Tunis et dans le nord du pays. La grande distance à laquelle il s’en tient lui permet de centrer son film autrement. Ce dernier mot comporte principalement deux aspects : le premier est une critique sociale de la Tunisie bien avant 2011 (et sans doute encore près), le second est un drame psychologique qui surgit inopinément au sein du couple formé par Farès et Mériem.
S’agissant du premier il ne s’agit pas d’une dénonciation virulente ni d’un état des lieux détaillé. Cet hôpital de Tataouine que l’on a l’occasion de voir de très près n’est nullement présenté de façon défavorable bien au contraire, les lieux sont très décents même si certaines possibilités sont limitées, et le personnel fait très bien son travail, en particulier le médecin –chirurgien qui se bat pour essayer de sauver Aziz et qui fait preuve d’une humanité remarquable. Reste que la situation est ce qu’elle est, que le don d’organe est encore une pratique rare voire très rare en Tunisie et que la bureaucratie implique des lenteurs très dommageables. Dans le cas particulier évoqué par le film, une difficulté supplémentaire et grave vient de ce qu’on ne peut évoquer l’adultère sans exposer ceux ou celles qui l’ont commis (ici il s’agit de Meriem, dix ans auparavant) sans les exposer à une peine qui peut aller jusqu’à cinq ans de prison ferme.
Mais s’agissant d’adultère, la difficulté est double puisqu’on touche par là au drame psychologique du couple qui est le deuxième sujet principal du film, d’autant mieux traité que le réalisateur a su s’entourer d’acteurs remarquables qui se sont investis pleinement dans leurs personnages. Sami Bouajila, dans le rôle de Farès, fait preuve des qualités qu’on lui connaissait déjà et qui lui ont valu ici une reconnaissance officielle bien méritée. Le réalisateur apporte tout son soin à suggérer une évolution qui ne se révèle qu’à la fin du film et qui concerne aussi bien l’homme que la femme, Meriem jouée par Najia Ben Abdallah.
En fait cette évolution est assez classique et psychologiquement vraisemblable. Le père est  d’abord dans une fureur indicible quand il apprend que sa femme a commis l’adultère et qu’il n’est pas le père biologique de son fils. Si grand est son amour pour cet enfant qu’on est saisi d’effroi à l’idée de ce que sera sa réaction quand il saura, ce qui pour des raisons médicales liées à la transplantation d’organe, est inévitable. Sans parler du fait qu’au début du film, on le voit très amoureux de sa femme, et visiblement convaincu que la réciproque est vraie (le spectateur l’est aussi). Pour ce qui est de la mère, la honte qu’elle éprouve dépasse elle aussi ce qu’on peut imaginer, d’autant qu’elle se sent coupable non seulement vis à vis de son mari mais aussi vis à vis de l’enfant. Les événements s’avèrent très cruels à son égard car elle ne pouvait sûrement pas prévoir que sa brève relation clandestine, à laquelle elle a très vite mis fin, devrait un jour refaire surface.
d’abord dans une fureur indicible quand il apprend que sa femme a commis l’adultère et qu’il n’est pas le père biologique de son fils. Si grand est son amour pour cet enfant qu’on est saisi d’effroi à l’idée de ce que sera sa réaction quand il saura, ce qui pour des raisons médicales liées à la transplantation d’organe, est inévitable. Sans parler du fait qu’au début du film, on le voit très amoureux de sa femme, et visiblement convaincu que la réciproque est vraie (le spectateur l’est aussi). Pour ce qui est de la mère, la honte qu’elle éprouve dépasse elle aussi ce qu’on peut imaginer, d’autant qu’elle se sent coupable non seulement vis à vis de son mari mais aussi vis à vis de l’enfant. Les événements s’avèrent très cruels à son égard car elle ne pouvait sûrement pas prévoir que sa brève relation clandestine, à laquelle elle a très vite mis fin, devrait un jour refaire surface.
Le drame est dû à une série de malchances (le mot est faible !) imprévisibles qui se succèdent à un rythme rapide et accablant. On est tenté de parler de tragique ou de tragédie, du fait des révélations comparables à celles qui détruisent Jocaste et Œdipe roi dans la pièce de Sophocle qui porte son nom. Mais ici nous sommes dans un drame moderne, ce qui laisse la possibilité d’un tout autre dénouement, que l’auteur se garde de traiter, laissant ouverte la fin du film. Les deux personnages ont évolué, comme le prouvent les regards silencieux mais significatifs qu’ils échangent à ce dernier moment. L’extraordinaire énergie déployée par Meriem pour retrouver le père biologique de son fils est un rachat de la faute qu’elle a commise. Farès de son côté commet des erreurs, comme celle de croire qu’il pourra tout résoudre avec son argent (autre point sur lequel la critique sociale rejoint le drame psychologique). La leçon que lui impose l’échec de son plan a pour effet de le rendre moins dur à l’égard de Meriem. On a parlé à propos de leur évolution d’une émancipation aussi bien masculine que féminine, ce qui veut dire en effet qu’ils arrivent à dépasser les normes en vigueur dans leur société, et ce à quoi on assiste dans la deuxième partie du film est l’extrême difficulté de ce dépassement. La diversité des événements et leur accumulation en un temps très restreint fait que le spectateur n’a pas vraiment le temps d’en prendre la mesure et de vivre ses émotions profondément. On peut penser que le réalisateur voulait éviter toute forme de pathos de même qu’il évite toute une série de scènes trop brutales ou trop crues (par exemple la révélation à Farès de l’existence d’un autre père ou père biologique). On a le sentiment que le film va très vite ou veut aller très vite, du fait que c’est aussi un film à suspens et une course contre la montre pour sauver la vie d’Aziz. Comme au printemps 2011 pour la Tunisie tout entière, on assiste à une crise, mais pour qu’elle prenne tout son sens, chacun sait qu’il y faudra du temps.
Denise Brahimi

« LA CASA DEL MOURADIA » par Mohamed Benchikou, Maisonneuve et Larose et Hémisphères, 2020
Ce livre n’est pas un roman même s’il s’en donne un peu les apparences pour ne pas rebuter d’emblée son lecteur. C’est à la fois un hommage au Hirak comme l’indique son  sous-titre : Février 2019 …Et l’Algérie se réveilla ! et plus encore une analyse politique du régime qui a précédé, cette analyse étant en fait une violente dénonciation, argumentée par Mohamed Benchicou, journaliste qui se situe résolument dans l’opposition au régime algérien, notamment dans le journal Le Matin qu’il a fondé en 1991. Opposition pour laquelle il a payé le prix fort puisqu’il a été emprisonné pendant deux ans, également en tant qu’écrivain et particulièrement pour un livre au titre explicite paru en 2004 : Bouteflika, une imposture algérienne. Bouteflika apparaît d’ailleurs dans plusieurs de ses titres, comme sa cible de prédilection. Cependant ce n’est pas le cas dans ce dernier livre qui est de 2020, l’état général de l’ex-Président rendant difficile de l’accabler plus qu’il ne l’est, en vertu du principe louable : on ne tire pas sur une ambulance.
sous-titre : Février 2019 …Et l’Algérie se réveilla ! et plus encore une analyse politique du régime qui a précédé, cette analyse étant en fait une violente dénonciation, argumentée par Mohamed Benchicou, journaliste qui se situe résolument dans l’opposition au régime algérien, notamment dans le journal Le Matin qu’il a fondé en 1991. Opposition pour laquelle il a payé le prix fort puisqu’il a été emprisonné pendant deux ans, également en tant qu’écrivain et particulièrement pour un livre au titre explicite paru en 2004 : Bouteflika, une imposture algérienne. Bouteflika apparaît d’ailleurs dans plusieurs de ses titres, comme sa cible de prédilection. Cependant ce n’est pas le cas dans ce dernier livre qui est de 2020, l’état général de l’ex-Président rendant difficile de l’accabler plus qu’il ne l’est, en vertu du principe louable : on ne tire pas sur une ambulance.
Mohamed Benchicou est un journaliste bien informé, qui pratique son métier de manière très personnelle et qui bénéficie de sources rares. Aussi peut-il nous raconter avec minutie un certain nombre d’événements et de démarches multiples de la part des détenteurs du pouvoir, au moment où ils prétendent soutenir, contre toute évidence et de la manière la plus insensée qui soit, une cinquième candidature de Bouteflika à la présidence de l’Algérie. Les gens qui ont suivi de près les péripéties politiques de l’année 2019 en Algérie reconnaîtront sans doute un certain nombre de faits, pour lesquels le livre apporte des éclaircissements. La plupart des lecteurs y trouveront des informations sur des agissements tellement rocambolesques qu’on s’interroge sur la folie perverse que provoque la volonté démente de garder (ou d’acquérir) le pouvoir.
Mohamed Benchicou oublie lui-même la tentative de fiction par laquelle il encadre son analyse. En dehors de l’idée, sans doute bonne, de se situer soixante ans plus tard, en 2079, lorsqu’une jeune étudiante et chercheuse découvre le récit écrit par son grand-père, le journalisme politique est contrebalancé non vraiment par la fiction mais plutôt par le lyrisme et l’enthousiasme que le Hirak suscite chez l’auteur, au point qu’il déborde largement les manifestations de ce mouvement pendant l’année 2019. On sait que celles- ci sont actuellement c’est-dire un an plus tard à l’arrêt du fait de l’épidémie ravageuse qui bloque toute action. Mais Mohamed Benchicou ne croit nullement que le Hirak puisse s’arrêter et rester fixé à un moment précis de l’histoire contemporaine de l’Algérie. Il en parle comme de l’aspiration irrépressible des peuples à se révolter contre l’oppression et tire sa confiance de nombre d’événements qui ont marqué l’histoire récente de l’Algérie. Ce en quoi il illustre l’aspiration que Kamel Daoud exprime pour son peuple dans son discours inaugural au dernier Maghreb des livres (février 2020) : de la mémoire certes, à condition qu’elle laisse de la place à l’action présente et ne la bloque pas dans l’inactivité d’une perpétuelle commémoration. Mohamed Benchicou se met délibérément dans le personnage du grand-père qui grâce au Hirak a retrouvé une confiance dans l’avenir depuis longtemps perdue et piétinée par des décennies de régime mortifère. C’est ainsi que, par la bouche de Djeddou Messaoud c’est-à-dire lui-même, il dit à sa petite-fille Lilya (celle qui sera étudiante en 2079) : « Ma petite Lilya, J’ai vu ressusciter un peuple que Dieu et les hommes semblaient avoir oublié dans ce lointain caveau où gisent les dépouilles de quelques anciennes espérances … »
ci sont actuellement c’est-dire un an plus tard à l’arrêt du fait de l’épidémie ravageuse qui bloque toute action. Mais Mohamed Benchicou ne croit nullement que le Hirak puisse s’arrêter et rester fixé à un moment précis de l’histoire contemporaine de l’Algérie. Il en parle comme de l’aspiration irrépressible des peuples à se révolter contre l’oppression et tire sa confiance de nombre d’événements qui ont marqué l’histoire récente de l’Algérie. Ce en quoi il illustre l’aspiration que Kamel Daoud exprime pour son peuple dans son discours inaugural au dernier Maghreb des livres (février 2020) : de la mémoire certes, à condition qu’elle laisse de la place à l’action présente et ne la bloque pas dans l’inactivité d’une perpétuelle commémoration. Mohamed Benchicou se met délibérément dans le personnage du grand-père qui grâce au Hirak a retrouvé une confiance dans l’avenir depuis longtemps perdue et piétinée par des décennies de régime mortifère. C’est ainsi que, par la bouche de Djeddou Messaoud c’est-à-dire lui-même, il dit à sa petite-fille Lilya (celle qui sera étudiante en 2079) : « Ma petite Lilya, J’ai vu ressusciter un peuple que Dieu et les hommes semblaient avoir oublié dans ce lointain caveau où gisent les dépouilles de quelques anciennes espérances … »
Denise Brahimi
Beyrouk (Mauritanie) Éd. Elyzad, Tunis
« LE TAMBOUR DES LARMES » 2015
« JE SUIS SEUL » 2018
Une fois n’est pas coutume : c’est de la Mauritanie qu’il sera question dans cette double analyse, à travers deux œuvres du journaliste et écrivain Mbarek ould Beyrouk connu sous le nom de Beyrouk. Et nous remonterons un peu en arrière, jusqu’à la publication du Tambour des larmes en 2015 pour situer son autre livre plus récent, Je suis seul.
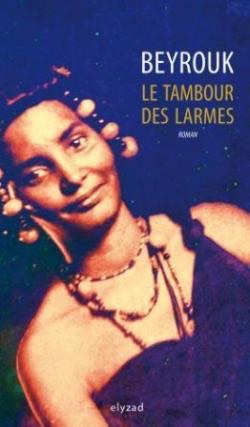 Bien qu’on ne puisse parler de roman historique à propos de ces deux-là, il sont pour les lecteurs que nous sommes, souvent mal informés sur la Mauritanie, un excellent moyen pour comprendre les étapes récentes qui composent l’histoire moderne et contemporaine de ce pays. La position de Beyrouk est d’ailleurs intéressante parce qu’il n’est ni un représentant de la tradition tribale (bien qu’il en soit issu et imprégné) ni un moderne à l’occidentale au sens où le sont plusieurs des personnages qu’il évoque dans ses romans, et notamment quand il est question de la capitale Nouakchott, ville qu’il représente comme en rupture complète avec le passé.
Bien qu’on ne puisse parler de roman historique à propos de ces deux-là, il sont pour les lecteurs que nous sommes, souvent mal informés sur la Mauritanie, un excellent moyen pour comprendre les étapes récentes qui composent l’histoire moderne et contemporaine de ce pays. La position de Beyrouk est d’ailleurs intéressante parce qu’il n’est ni un représentant de la tradition tribale (bien qu’il en soit issu et imprégné) ni un moderne à l’occidentale au sens où le sont plusieurs des personnages qu’il évoque dans ses romans, et notamment quand il est question de la capitale Nouakchott, ville qu’il représente comme en rupture complète avec le passé.
Dans Je suis seul, il est beaucoup question de l’ancêtre du narrateur, Nacereddine , qui pourrait sans doute être aussi bien l’ancêtre de Beyrouk lui-même et qui était en tant qu’imam une sorte de saint faiseur de miracles, parlant aux étoiles et à l’invisible. Le narrateur s’interroge pour savoir s’il y a continuité entre cet ancêtre et les prédicateurs islamistes qui sont en train de le persécuter et font peser sur lui une menace de mort. La réponse est négative : entre les saints ascétiques d’autrefois et les tueurs d’aujourd’hui, il y a eu une terrible distorsion, et c’est en cela que l’œuvre de Beyrouk, à travers une passionnante mise en forme romanesque, est une réflexion sur l’histoire de son pays.
Cette réflexion est d’ailleurs complexe et c’est en cela qu’elle est passionnante car si elle comporte une terrible dénonciation de la période actuelle, elle ne fait pas pour autant 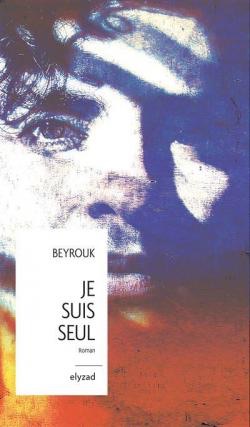 l’apologie passéiste de la période antérieure, représentée dans le premier des deux livres dont nous parlons, Le Tambour des larmes (qui n’est nullement le premier livre de Beyrouk : il en a écrit deux ou trois autres auparavant).
l’apologie passéiste de la période antérieure, représentée dans le premier des deux livres dont nous parlons, Le Tambour des larmes (qui n’est nullement le premier livre de Beyrouk : il en a écrit deux ou trois autres auparavant).
Le tambour des larmes est d’abord un vrai tambour avant d’être un symbole. C’est un tambour sacré, objet rituel vénéré par toute la tribu à laquelle appartient la jeune fille ou jeune femme qui est l’héroïne du livre, Rayhana. Elle est à la fois victime de la tribu principalement incarnée par sa propre mère, et animée à son égard d’un terrible désir de vengeance qui la pousse à voler le tambour et à fuir en l’emportant avec elle. Il est vrai que ce vol est la seule réplique qu’elle a trouvée, à la hauteur d’un autre qu’elle a subi elle-même : on lui a volé pour le faire disparaître l’enfant qu’elle a mis au monde clandestinement à la suite d’un viol.
Cette terrible histoire de vengeance, qui reste inaboutie à la fin du livre, illustre et résume tout ce qu’il y a d’inacceptable pour la sensibilité moderne dans la société tribale, à savoir tout ce qui nous apparaît comme une cruauté féroce voire inhumaine et dont le rejet de l’enfant né hors mariage n’est d’ailleurs qu’un aspect. On assiste à un même rejet de l’homosexualité (masculine, on n’en voit pas d’autre) mais surtout, de la part de Beyrouk, à une dénonciation de ce qui est certainement la tare la plus grave de cette société archaïque, à savoir l’esclavage. Rayhana a aimé tendrement dans son enfance une petite esclave Mbarka qui certes n’est pas maltraitée dans la famille mais qui pourtant s’enfuit ne pouvant supporter cette sorte de non existence à laquelle la voue le statut d’esclave. Lorsque Rayhana est en fuite à son tour, elle la cherche et finit par la retrouver à la ville, où elle a le statut d’affranchie et vit de prostitution. On comprend que la société mauritanienne n’a pas encore réglé cette énorme problème, mais lorsqu’on la retrouve évoquée dans le livre suivant, c’est-à-dire dans Je suis seul, il n’en est plus question.

Un autre problème en revanche se pose avec acuité, c’est la violence imposée par les islamistes au reste de la population. Beyrouk ne juge pas nécessaire d’en faire une description détaillée car c’est la même que dans les autres pays musulmans tombés sous leur coupe, en revanche dans ce dernier rman, il consacre beaucoup de soin à faire comprendre comment on a pu en arriver là et pourquoi personne n’est prêt à se battre pour défendre le régime politique en place. De ce dernier on apprend d’autant mieux ce qu’il y a à savoir que le narrateur en est ou en a été un parfait représentant —par « parfait » il faut entendre affligé de toutes les tares des régimes dits modernes qui se sont mis en place après les indépendances des pays maghrébins et africains.
Celles-ci comportent une ambition absolument sans vergogne, réussir signifiant posséder le plus possible d’argent et pour cela pratiquer la corruption à grande échelle. Aucun sentiment ne résiste à cette pulsion, c’est le règne de l’égoïsme total, d’un monde sans amour et si toutefois ce dernier avait des velléités d’apparaître, il serait aussitôt bafoué.
On ne saurait dire que le narrateur de Je suis seul éprouve véritablement du remords d’avoir été ce genre d’homme, dont on avait déjà vu apparaître un ou deux exemples dans Le tambour des larmes (dont le sinistre séducteur qui a abandonné Rayhana sans un adieu après l’avoir violée). A dire vrai il ne sait sans doute plus bien où il en est et c’est sans doute le plus intéressant dans ce portrait d’homme « nouveau », ayant rompu tout lien avec la tradition tribale mais évidemment incapable d’avoir aucun ancrage dans une Mauritanie supposée urbaine et occidentalisée. On ne peut s’empêcher de penser que lui et ses semblables ont bien mérité ce qui leur arrive, ce djihad mené par des combattants sinistres aux mains desquels la ville est tombée. Médiocres et bornés, ils n’ont en effet que des apparences en commun avec les hommes du passé de la trempe de Nacereddine. Ils n’en sont que la parodie, confirmant ce qu’on sait sur l’histoire, à savoir qu’on ne peut la forcer à revenir en arrière. Le constat sur l’époque contemporaine est d’une totale sévérité.
Denise Brahimi
« ULTIME PREUVE D’AMOUR » De Canesi Et Rahmani Editions Anne Carrière 2020
Ce septième ouvrage du duo Michel Canesi et Jamil Rahmani est aussi prenant que les précédents. Une fois de plus, nous apprécions un beau portrait de femme comme ces deux auteurs savent nous en offrir. Et nous nous laissons prendre à cette double et envoûtante histoire d’amour qui traverse le temps et l’espace.
 Entre Algérie et France, entre fin de la période coloniale et décennie noire, ce livre fait une passerelle entre deux moments de l’histoire, entre un pied noir et une Algérienne, entre deux hommes amoureux de la même femme.
Entre Algérie et France, entre fin de la période coloniale et décennie noire, ce livre fait une passerelle entre deux moments de l’histoire, entre un pied noir et une Algérienne, entre deux hommes amoureux de la même femme.
Le procédé d’écriture nous fait vivre l’histoire tour à tour dans la peau des trois principaux personnages, et à quelques reprise dans celle du témoin de toute cette histoire qui s’étend sur 34 ans, avec un point fixe, l’hôtel Aletti à Alger, devenu Es Safir. Ce témoin est Mohand, le liftier de l’antique ascenseur Otis Pifre de l’hôtel, personnage de théâtre antique, qui voit et interprète les faits, qui en donne les clés à l’un des personnages, suscitant sans le savoir l’acte central de l’intrigue du livre. Et ce personnage, en apparence secondaire, est aussi le « témoin » au sens de signal, de l’histoire de l’Algérie contemporaine, vue par le petit peuple. Si un jour ce livre est porté à l’écran quel magnifique second rôle pour un comédien !
Pour l’auteur de ces lignes, ce roman, comme déjà Alger sans Mozart, lui fait revoir des  lieux familiers, revivre charnellement quelques épisodes de l’année 1962. Ayant connu Jamil Rahmani au Lycée Victor Hugo, ex-Gauthier, juste après l’indépendance, il a le même âge, et ces évocations sont d’une grande évidence, qui lui fait lire ce livre comme s’il en avait vécu une partie des péripéties. L’immeuble du Telemly, la salle Pierre Borde… Mais il admire la capacité de son ex condisciple à restituer ces moments dans des tableaux vivants, colorés, sonores, et même odorants… Retenons en particulier cette vision poétique de la façade d’Alger, vue de la mer, comparée à la rue de Rivoli, qui ferait face à la Méditerranée au lieu des Tuileries.
lieux familiers, revivre charnellement quelques épisodes de l’année 1962. Ayant connu Jamil Rahmani au Lycée Victor Hugo, ex-Gauthier, juste après l’indépendance, il a le même âge, et ces évocations sont d’une grande évidence, qui lui fait lire ce livre comme s’il en avait vécu une partie des péripéties. L’immeuble du Telemly, la salle Pierre Borde… Mais il admire la capacité de son ex condisciple à restituer ces moments dans des tableaux vivants, colorés, sonores, et même odorants… Retenons en particulier cette vision poétique de la façade d’Alger, vue de la mer, comparée à la rue de Rivoli, qui ferait face à la Méditerranée au lieu des Tuileries.
Les trajectoires de vie d’Inès, Pierre et Rachid sont riches, incarnées. Les personnages prennent vie sous nos yeux, et même dans le cas de Rachid nous font partager leur marche vers la mort. Les auteurs, comme dans leurs livres précédents qui leur valent un lectorat fidèle et nombreux savent nous attacher à leurs personnages, nous faire voir les lieux où ils évoluent, vivre charnellement ce que les héros vivent et ressentent.
L’ultime preuve d’amour de Rachid pour sa femme Inès nous fait partager la plus belle des humanités, la plus grande des générosités. Il n’est pas question de « divulgâcher » l’intrigue de ce beau roman. On peut cependant souligner que, grâce à lui, Pierre, le pied-noir, se réconcilie avec lui-même et avec l’Algérie.
L’histoire ne passe pas, dit ce livre, on ne peut indéfiniment lui tourner le dos.
Michel Wilson
« LES BASKETS ET LE COSTUME » par Abdelilah Laloui, Éditions Jclattès, 2020
Il y a beaucoup de plaisir à lire ce petit livre qui se présente de manière très simple et qui cependant est peut-être un peu plus complexe qu’il n’y paraît d’abord.
Le titre donne à penser qu’il s’agit d’une opposition binaire entre deux mondes ou deux modes de vie, symbolisés par les vêtements qu’on y porte et les apparences extérieures qu’on y revêt. Les baskets appartiennent au monde des pauvres, d’autant plus que celles dont il est d’abord question dans le livre sont très usées et d’aspect misérable, tandis que le costume est celui que porte Abdelilah à la fin du récit, dans quelques circonstances où il est de rigueur et signifie l’appartenance à une position officielle, ici celle des élites républicaines qui siègent à l’Assemblée nationale. Il est tout à fait clair que le jeune héros de cette histoire, à la fois auteur et narrateur, va passer en une petite vingtaine d’années des premières au second, bel exemple d’ascension sociale, à partir d’un milieu défavorisé, celui des banlieues parisiennes, dont l’une des caractéristiques essentielles est de ne pas avoir accès au minimum de culture que possèdent plus ou moins, mais visiblement, les autres catégories sociales.

C’est d’ailleurs un aspect intéressant du livre que d’insister particulièrement sur ce trait négatif, l’absence de culture, finalement beaucoup plus déterminant que le niveau de vie matériel dans la société française d’aujourd’hui. Les parents d’Abdelilah ne sont pas riches, mais le père a un métier qui lui permet de faire vivre sa famille au quotidien, il est d’ailleurs de nationalité française et fait partie de ces gens qu’on dit bien intégrés, sans aucun des signes extérieurs d’exclusion qui parfois stigmatisent les enfants plus encore que leurs parents. La mère, d’origine kabyle, est étonnante parce qu’elle est à la fois très liée (notamment par le fil du téléphone !) au monde d’où elle vient, et très avertie sur la manière dont il convient de vivre pour prendre sa place dans la société française. En cela elle est très représentative de ce que dit le livre tout entier, regard porté par Abdelilah sur lui-même et sur les siens, mais aussi sur la société française contemporaine, la vie lui ayant permis d’en connaître des aspects très différents.
La complexité du livre vient de ce qu’Abdelilah se trouve placé entre deux mondes (puisqu’on ne dit plus « classes » depuis que la terminologie marxiste, à tort ou à raison, a été remplacée par d’autres). Ce qui est intéressant est que cette évolution s’est faite sans qu’il l’ait vraiment voulue et sans qu’il en soit d’emblée conscient. Celui qu’il vaut mieux appeler le narrateur que l’auteur, puisqu’il reconnaît avoir intégré à son histoire certains traits de fiction, n’est pas un ambitieux hanté par le désir de la réussite sociale, il est bien vrai que dans sa modeste famille on est ébloui par son succès et qu’on essaie d’y contribuer dans la mesure du possible, comme le fait une tante du garçon qui en fait joue un rôle précurseur dans son ascension. Mais de façon assez remarquable on ne vit plus dans une société comme celle dont parlent par exemple les romans de Balzac, décrivant la société française au début du 19e siècle. Le processus démocratique en cours depuis des décennies fait son œuvre et crée des modèles très différents de réussite sociale. Abdelilah Lalaoui, si jeune qu’il soit, est capable de présenter la sienne avec suffisamment de distance critique pour qu’on en apprécie les aspects positifs incontestables sans pour autant crier cocorico.
Le fait précis qui est en cause et dont il a été beaucoup question en son temps pas si lointain est l’ouverture d’une école prestigieuse, Sciences Po, à des candidats différents de ceux qui semblaient y être tout naturellement ( ?) destinés. L ‘accès à cette école par laquelle sont passés de nombreux futurs cadres de la nation ne pouvait s’ouvrir à des catégories socialement défavorisées que par la création d’un concours spécial, dont la préparation comporte ce qu’on pourrait appeler un rattrapage culturel indispensable. On retrouve donc ici encore, dans ce fait précis, le même constat sur la nature du fossé, très difficile à franchir, qui existe dans une société comme la nôtre : il vient de ce que certaines catégories de citoyens n’ont aucun accès à un patrimoine culturel (peut-être plus symbolique que réel) que d’autres reçoivent comme acquis, sans effort de leur part.
 Ce qui est remarquable et éminemment sympathique dans le bref itinéraire déjà parcouru par Abdelilah Lalaoui est qu’il ne se contente pas de faire ce constat à partir de sa propre expérience. Constat d’ailleurs très mitigé parce qu’il s’avère que le « rattrapage » reste d’une efficacité très limitée et que le concours spécial à l’usage des défavorisés a plutôt pour effet de les situer d’emblée dans une catégorie définitivement inférieure. Il est difficile de dire si le jeune auteur a bénéficié d’une série de circonstances favorables ou s’il doit tout à son propre mérite, mais on voit bien que de toute façon il lui a fallu passer par des moments extrêmement difficiles. Il a beaucoup pleuré dans sa courte vie, ce qui vaut certainement mieux que de s’enfermer dans la haine des autres ou de soi. Mais surtout ce qui fait son originalité est qu’à partir de ce constat, il a immédiatement voulu changer les choses, et de ce fait a créé une association, « Tous curieux » pour lutter contre le sentiment d’infériorité ressenti par les exclus de l’héritage culturel.
Ce qui est remarquable et éminemment sympathique dans le bref itinéraire déjà parcouru par Abdelilah Lalaoui est qu’il ne se contente pas de faire ce constat à partir de sa propre expérience. Constat d’ailleurs très mitigé parce qu’il s’avère que le « rattrapage » reste d’une efficacité très limitée et que le concours spécial à l’usage des défavorisés a plutôt pour effet de les situer d’emblée dans une catégorie définitivement inférieure. Il est difficile de dire si le jeune auteur a bénéficié d’une série de circonstances favorables ou s’il doit tout à son propre mérite, mais on voit bien que de toute façon il lui a fallu passer par des moments extrêmement difficiles. Il a beaucoup pleuré dans sa courte vie, ce qui vaut certainement mieux que de s’enfermer dans la haine des autres ou de soi. Mais surtout ce qui fait son originalité est qu’à partir de ce constat, il a immédiatement voulu changer les choses, et de ce fait a créé une association, « Tous curieux » pour lutter contre le sentiment d’infériorité ressenti par les exclus de l’héritage culturel.
Les baskets et le costume n’est pas un livre destiné à présenter précisément cette association mais en tout cas, il attire l’attention sur le fait qu’elle existe, et on se rend compte, à lire le récit de l’auteur, que cette bonne nouvelle trouve un écho au sein de la société française qui paraît la mieux établie. On ne soupçonne pas toujours les combats que certains de ses membres ont dû mener pour arriver là où ils sont ! Finalement, la leçon est qu’il ne faut pas se laisser enfermer par des déterminismes même évidents mais être au contraire convaincu que chacun porte en soi la liberté nécessaire ( suffisante ?) pour les déjouer.
Denise Brahimi
« FEMMES BERBÈRES DE PART ET D’AUTRE DE LA MÉDITERRANÉE » par Tassadit Yacine, Éditions Du Croquant, 2018
L’auteure de ce livre, chercheuse et enseignante en anthropologie sociale, est spécialiste du monde berbère, sur lequel elle a publié de nombreux ouvrages, auquel ce dernier livre ne pouvait manquer de faire référence. Il propose un plan en deux parties. La première concerne la domination masculine en Algérie et principalement en Kabylie, qui en est la principale région (mais pas la seule) de culture berbère. La seconde comporte des entretiens avec d’autres chercheurs (Mohammed Arkoun, Mouloud Mammeri) et des études de cas appelés « Parcours de femmes » au nombre desquelles figure l’auteure elle-même, fournissant d’intéressants détails biographiques. Elle s’est d’ailleurs laissé une certaine liberté de présentation, dans une étude qui globalement dénonce les souffrances des femmes (il y a aussi un article sur les homosexualités) dues à la domination masculine, quelles que soient les exceptions.
 La première partie passe de données anthropologiques assez générales, au sein desquelles le cas de l’Algérie fait figure d’exemple, à des analyses portant sur des personnages particuliers, tels que l’écrivaine d’origine kabyle Taos Amrouche, dont les romans autobiographiques sont une source très importante. La deuxième partie comporte le même mélange, la figure connue (mais aussi « méconnue » selon Tassadit Yacine) étant ici celle de Germaine Tillion. Cependant, à travers la diversité des articles qui nous sont donnés à lire, et celle des figures féminines qu’on y voit apparaître, on comprend aisément—et Tassadit Yacine ne s’en cache pas—que sa préoccupation principale est ce phénomène de domination qu’on pourrait dire omniprésent dans le monde qu’elle a eu à connaître, y compris le monde intellectuel que son métier l’a amenée à fréquenter. D’origine berbère, elle appartient évidemment à la catégorie des femmes émancipées et encore le mot est faible, en sorte qu’on pourrait l’imaginer comme figurant dans un nombre petit (ou très petit) d’exceptions, mais ce n’est pas ce qu’elle dit, même si elle ne dit pas explicitement le contraire, dans ce livre qui n’est pas autobiographique à l’exception d’un article déjà évoqué : « L ’art d’être une femme et demie ou De la parole à la lettre : Plantée comme un garçon dans l’Algérie coloniale ». Cet article était à l’origine un entretien paru en 2013 dans la revue L’Homme et la société. Lorsqu’il s’agit d’un cas particulier, il s’agit donc toujours, pour la chercheuse qu’elle est, de passer à des conclusions plus générales, ou en tout cas d’en donner la possibilité.
La première partie passe de données anthropologiques assez générales, au sein desquelles le cas de l’Algérie fait figure d’exemple, à des analyses portant sur des personnages particuliers, tels que l’écrivaine d’origine kabyle Taos Amrouche, dont les romans autobiographiques sont une source très importante. La deuxième partie comporte le même mélange, la figure connue (mais aussi « méconnue » selon Tassadit Yacine) étant ici celle de Germaine Tillion. Cependant, à travers la diversité des articles qui nous sont donnés à lire, et celle des figures féminines qu’on y voit apparaître, on comprend aisément—et Tassadit Yacine ne s’en cache pas—que sa préoccupation principale est ce phénomène de domination qu’on pourrait dire omniprésent dans le monde qu’elle a eu à connaître, y compris le monde intellectuel que son métier l’a amenée à fréquenter. D’origine berbère, elle appartient évidemment à la catégorie des femmes émancipées et encore le mot est faible, en sorte qu’on pourrait l’imaginer comme figurant dans un nombre petit (ou très petit) d’exceptions, mais ce n’est pas ce qu’elle dit, même si elle ne dit pas explicitement le contraire, dans ce livre qui n’est pas autobiographique à l’exception d’un article déjà évoqué : « L ’art d’être une femme et demie ou De la parole à la lettre : Plantée comme un garçon dans l’Algérie coloniale ». Cet article était à l’origine un entretien paru en 2013 dans la revue L’Homme et la société. Lorsqu’il s’agit d’un cas particulier, il s’agit donc toujours, pour la chercheuse qu’elle est, de passer à des conclusions plus générales, ou en tout cas d’en donner la possibilité.
Cette intention est dite explicitement dans l’article intitulé : « Nouara ou les affres de l’exil ». Nouara est une femme immigrée qui tente de dire sa souffrance à travers la poésie. Tassadit Yacine explique qu’en recueillant les paroles de Nouara, elle veut « analyser aussi les structures d’une société » et que « à travers la vie de Nouara, marquée par les difficultés, la douleur, la souffrance, il faut surtout lire celle de beaucoup de femmes. »
Le mélange des cas particuliers et des observations de l’anthropologue (y compris sur elle-même ou à partir d’elle-même) est la caractéristique de ce livre et permet d’en apprécier l’intéressante méthode dont on jugera peut-être qu’elle est une marque de la recherche au féminin. Pourtant les grandes voire très grandes références de l’auteure en matière de recherche sont deux hommes dont la fréquentation et le travail l’ont beaucoup marquée. Il s’agit de l’Algérien originaire de Kabylie Mouloud Mammeri (mort en 1989) et du Français originaire du Béarn Pierre Bourdieu(mort en 2002).
 Tous les spécialistes du monde berbère, culture, langue etc. connaissent au moins le nom du premier (qui était aussi écrivain et romancier).Tassadit Yacine est d’autant plus autorisée à parler de lui qu’elle a repris la direction de la revue Awal qu’il avait fondée, assurant ainsi la continuité des « études berbères » à partir de Paris. Elle rappelle que Mouloud Mammeri, dès l’âge de 19 ans, avait déjà proclamé la nécessaire reconnaissance de la langue et de la culture berbères ; mais aussi que cette rude tâche est devenue particulièrement difficile à poursuivre à partir de 1965 lorsque la politique algérienne officielle a été de valoriser l’arabité. Pour Tassadit Yacine elle-même le moment difficile a suivi la mort de Mammeri, lorsqu’il lui a fallu de se faire reconnaître comme sa disciple.
Tous les spécialistes du monde berbère, culture, langue etc. connaissent au moins le nom du premier (qui était aussi écrivain et romancier).Tassadit Yacine est d’autant plus autorisée à parler de lui qu’elle a repris la direction de la revue Awal qu’il avait fondée, assurant ainsi la continuité des « études berbères » à partir de Paris. Elle rappelle que Mouloud Mammeri, dès l’âge de 19 ans, avait déjà proclamé la nécessaire reconnaissance de la langue et de la culture berbères ; mais aussi que cette rude tâche est devenue particulièrement difficile à poursuivre à partir de 1965 lorsque la politique algérienne officielle a été de valoriser l’arabité. Pour Tassadit Yacine elle-même le moment difficile a suivi la mort de Mammeri, lorsqu’il lui a fallu de se faire reconnaître comme sa disciple.
S’agissant de Pierre Bourdieu, auquel elle rend plusieurs fois hommage, l’auteure de ce livre montre qu’à l’origine de ses travaux, il pourrait bien y avoir un certain comparatisme, son origine béarnaise et ses souvenirs de cette époque (il est né dans les Pyrénées-Atlantiques en 1930) étant forts présents en lui lorsqu’il étudie par exemple, comme il l’a fait, la Kabylie. Une partie de l’étude que le livre consacre à Bourdieu et à ses travaux sur la domination masculine s’intitule « L’expérience béarnaise ». En 1962, Pierre Bourdieu a publié dans Les Temps modernes un article intitulé : « Les relations entre les sexes dans la société paysanne », résultat de recherches menées dans un village du Béarn. Il est aisé d’en conclure, comme le fait Tassadit Yacine, que « les indigènes de tous lieux d (d’Europe et d’ailleurs) peuvent être soumis aux mêmes analyseurs. »
Reste que la berbérité n’a cessé d’être le terreau de ses propres recherches, que ce soit comme le dit son titre, en Algérie ou en France, sur l’une ou l’autre des deux rives de la Méditerranée. Son livre est celui d’une berbère et d’une femme, double cause de domination.
Denise Brahimi

« INTÉGRISMES ET LAICITE » (Monde Diplomatique de mars 1989) :
Extrait de l’article d‘Albert Memmi
« TROIS AFFAIRES RÉVÉLATRICES »
L’intégrisme correspond à une conception complète de l’existence,
émotionnelle et systématique. Considérons les trois événements, plus
ou moins récents, qui ont agité nos diverses communautés : les
revendications des intégristes juifs en Israël, les remous provoqués
par le film de Scorsese, la Dernière Tentation du Christ, la
condamnation à mort de l’écrivain anglo-indien Salman Rushdie. Il
est remarquable que l’on trouve des traits communs dans les trois
affaires, même s’ils sont paroxystiques chez les Iraniens. Mgr
Ducourtray ne s’y est pas trompé : la cause des musulmans est
identique à celle des chrétiens. De même le grand rabbin de France
avait affirmé sa solidarité avec l’évêché.
Lorsque les intégristes juifs de Jérusalem veulent imposer leur
définition exclusive du juif, ils tendent à exclure de la communauté
juive la majorité des juifs contemporains, les époux non juifs de
toutes les unions mixtes, même convertis par un rabbin libéral, leurs
enfants ignominieusement qualifiés de bâtards. Ainsi, l’intégrisme
exclut même les autres fidèles de la même confession, avec autant de
 rigueur que pour les hérétiques. Le résultat de cet anathème est la
rigueur que pour les hérétiques. Le résultat de cet anathème est la
suppression symbolique, sinon la suppression physique. Si les
intégristes devaient triompher en Israël, les non- intégristes
devraient se convertir à nouveau, c’est-à-dire devenir des intégristes.
L’intégrisme est bien la mort, symbolique au moins, de l’autre, en
attendant mieux.
Le film de Scorcese a réveillé des tentations chez certains chrétiens.
Nous le savions déjà grâce aux manifestations des adeptes de Mgr
Lefebvre, qui, rappelons-le, ont souvent partie liée avec ceux de M. Le
Pen : cette fois, la violence physique n’est pas loin de la
condamnation doctrinale. Mais, là encore, Mgr Lefebvre n’est que le
paroxysme d’une tendance endémique. Si l’Eglise officielle s’était
contentée de condamner ce film, il n’y aurait rien à dire. Ce n’est pas
nous, laïcs et libéraux, qui le lui aurions reproché : notre philosophie
à nous, précisément, nous conduit à respecter l’opinion de chacun,
même si les croyants, eux, ne respectent pas la nôtre. Lorsque l’abbé
Laurentin, dans un récent article du Figaro, se plaint des reproches
faits à l’Eglise à propos de ses prises de position sur le sida, il a
raison. Mais il ne s’en est pas tenu là : il a demandé des mesures
concrètes. Sur l’affaire Scorsese, les activistes chrétiens ne se sont pas
contentés d’exprimer une opinion ; ils sont passés aux actes. Un
cinéma a été incendié à Paris, il y a eu un mort, indirect il est vrai.
Dans de nombreuses villes de France et d’Europe, les projections ont
été interrompues malgré la loi, sous la menace physique. Ces
violences ont-elles été condamnées par l’Eglise ? Non, simplement
déplorées : voilà ce qui arrive, a osé dire un évêque, si l’on heurte les
sentiments des chrétiens.
Avec l’incitation au meurtre de Salman Rushdie, les choses
deviennent tout à fait claires : quiconque porte atteinte à l’islam
encourt la peine de mort. L’atteinte, notons-le bien, est simplement
verbale, une opinion contraire. L’énormité de la récompense vient en
quelque sorte donner la mesure de la condamnation. Il faut que
Rushdie soit détruit, et pas seulement symboliquement.
(Choisi par La lettre de Coup de soleil RA )
« DOSSIER SUR LES PIEDS NOIRS: LEUR SECONDE VIE » Historia, mai 2020
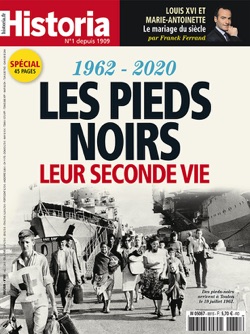


Pingback: Beyrouk nomadise en France, octobre 2021 | Coup de Soleil Sud
Pingback: Beyrouk nomadise en France, octobre 2021 – Coup de Soleil Sud
Pingback: Beyrouk nomadise en France, octobre 2021 | Coup de Soleil