Lettre culturelle franco-maghrébine #52
ÉDITO
Ce que nous vous proposons dans cette Lettre 52 a le mérite de la diversité, non seulement celle des sujets abordés (comme toujours dans La Lettre) mais pour commencer, celle des genres auxquels ils appartiennent.
C’est ainsi que pour la première fois, La Lettre s’intéresse à des articles de presse concernant quelques sujets d’actualité : l’aide de journalistes spécialisés n’est pas de trop pour tenter de les élucider.
Pour une fois et parce que, par les temps qui courent, cela mérite d’être signalé, nous vous parlons d’un film, El Hasla . Qui plus est et pour redoubler le plaisir que vous aurez j’espère à entendre parler de cinéma, nous vous annonçons qu’il sera question d’un autre film dans La Lettre du mois prochain. Pas question d’oublier le grand écran !
Cette Lettre 52 prend la suite de la précédente, dans laquelle nous avions reproduit une présentation prometteuse par son éditeur du Journal d’Albert Memmi.Celui-ci est à nouveau présent cette fois-ci sous le titre Les Hypothèses infinies, même s‘il est clair que nous ne pouvions prétendre surmonter dans un bref article cet énorme massif d’où sortent de toute part les plus immenses questions !
Encore un autre genre littéraire, le théâtre, abordé à travers le travail d’adaptation de Dominique Lurcel, mettant en scène un texte du sociologue Stéphane Beaud. Là aussi , nous espérons bien qu’il y aura une suite, dans une autre et prochaine Lettre !
Et naturellement comme certains l’espèrent, il sera aussi question de BD, à propos d’histoires de chats, mais n’en disons pas plus… A vous de lire…
Denise Brahimi

« LES HYPOTHESES INFINIES, Journal 1936-1962 » d’Albert Memmi édité par Guy Dugas, CNRS Editions, 2021
De ce Journal nous avons vu dans la Lettre précédente (51) la présentation alerte et brève par Guy Dugas qui en est l’éditeur, en tant que spécialiste de longue date de l’écrivain et philosophe Albert Memmi, mort l’an dernier (2020) alors qu’il allait atteindre sa centième année. A l’image de cette si longue vie, ce Journal, qui n’en couvre que 26 années de 16 à 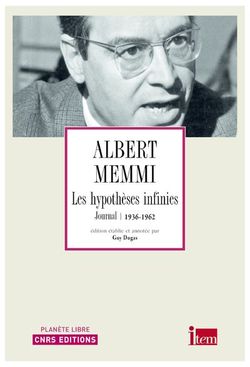 42 ans, se présente comme un énorme monument dans lequel on aurait sans doute beaucoup de ma là se déplacer si l’on n’était guidé par une main experte. Viendra sans doute, en son temps, la seconde partie de ces innombrables et précieux fragments, qui justifient le terme d’infini employé dans le titre car à aucun moment ils ne donnent l’impression de se situer dans un espace clos et organisé à l’intérieur de ses propres limites. On a plutôt l’impression d’avoir à comprendre et à interpréter ce qui émerge un peu au hasard de la pensée de l’auteur, sans qu’il ait jamais cherché à lui assurer à une cohérence, de forme ni de fond, ni même une parfaite lisibilité. Mais tel qu’il est, il apporte déjà beaucoup, en complément des œuvres publiées qui, elles, donnent au contraire l’impression d’être parfaitement abouties à l’intérieur d’un genre littéraire donné, qu’il s’agisse du genre romanesque auquel appartiennent La statue de sel (1953)et Agar (1955), du moins pour cette première période, ou d’un autre genre original et plus difficile à définir, auquel il donne le nom de portraits, Portrait du colonisateur, Portrait du colonisé (1957), Portrait d’un juif (1962), relevant de la psychologie collective et de la sociologie. Ces différentes œuvres sont évidemment évoquées dans le Journal, de façon toujours fragmentaire, mais qui permet au moins de se rendre compte qu’elle sont toutes très travaillées, longuement nourries par l’information, la réflexion, et aussi par le mélange intéressant entre une incontestable confiance que Memmi se fait à lui-même et à son talent et d’autre part l’insatisfaction, le doute, la difficulté d’être et d’écrire qui sont souvent le propre de l’écrivain. Memmi a su très vite qu’il voulait faire partie de cette corporation et que rien d’autre ne l’intéressait vraiment mais encore fallait-il vivre c’et-à-dire gagner sa vie, ce qui dans les trois ou quatre décennies auxquelles nous assistons dans cette partie du Journal ne lui a jamais été facile et parfois même très difficile, jusqu’à ce que son talent commence à être reconnu lorsqu’il atteint à peu près une trentaine d’années. Albert Memmi est d’origine pauvre voire très pauvre et il lui a pratiquement toujours fallu se prendre en charge lui-même,
42 ans, se présente comme un énorme monument dans lequel on aurait sans doute beaucoup de ma là se déplacer si l’on n’était guidé par une main experte. Viendra sans doute, en son temps, la seconde partie de ces innombrables et précieux fragments, qui justifient le terme d’infini employé dans le titre car à aucun moment ils ne donnent l’impression de se situer dans un espace clos et organisé à l’intérieur de ses propres limites. On a plutôt l’impression d’avoir à comprendre et à interpréter ce qui émerge un peu au hasard de la pensée de l’auteur, sans qu’il ait jamais cherché à lui assurer à une cohérence, de forme ni de fond, ni même une parfaite lisibilité. Mais tel qu’il est, il apporte déjà beaucoup, en complément des œuvres publiées qui, elles, donnent au contraire l’impression d’être parfaitement abouties à l’intérieur d’un genre littéraire donné, qu’il s’agisse du genre romanesque auquel appartiennent La statue de sel (1953)et Agar (1955), du moins pour cette première période, ou d’un autre genre original et plus difficile à définir, auquel il donne le nom de portraits, Portrait du colonisateur, Portrait du colonisé (1957), Portrait d’un juif (1962), relevant de la psychologie collective et de la sociologie. Ces différentes œuvres sont évidemment évoquées dans le Journal, de façon toujours fragmentaire, mais qui permet au moins de se rendre compte qu’elle sont toutes très travaillées, longuement nourries par l’information, la réflexion, et aussi par le mélange intéressant entre une incontestable confiance que Memmi se fait à lui-même et à son talent et d’autre part l’insatisfaction, le doute, la difficulté d’être et d’écrire qui sont souvent le propre de l’écrivain. Memmi a su très vite qu’il voulait faire partie de cette corporation et que rien d’autre ne l’intéressait vraiment mais encore fallait-il vivre c’et-à-dire gagner sa vie, ce qui dans les trois ou quatre décennies auxquelles nous assistons dans cette partie du Journal ne lui a jamais été facile et parfois même très difficile, jusqu’à ce que son talent commence à être reconnu lorsqu’il atteint à peu près une trentaine d’années. Albert Memmi est d’origine pauvre voire très pauvre et il lui a pratiquement toujours fallu se prendre en charge lui-même,
Ce dont d’ailleurs il ne se plaint pas et il répète de manière visiblement sincère qu’il ne s’intéresse pas à l’argent, disant avec la même sincérité que son seul moteur est l‘ambition, c’est-à-dire le désir de se faire reconnaître dans le monde intellectuel et littéraire, d’y avoir un nom parmi les plus grands. Cette ambition ne prend vraiment son sens et Memmi ne connaît ce genre de satisfaction qu’après avoir quitté la Tunisie pour venir à Paris, peu après la fin de la deuxième guerre mondiale. Peu à peu et jusqu’au moment où nous le quittons à la fin de ce premier volume, lorsqu’il a atteint la quarantaine, il se construit en effet une position, au sein de ce qu’on pourrait appeler l’intelligentzia de gauche, qui dans toutes ces années-là occupe le haut du pavé, si l’on ose dire familièrement, qu’il s’agisse du communisme, de l’existentialisme , de  l’anticolonialisme etc. Cependant Memmi n’est pas snob ni mondain, il cherche à définir sa propre pensée et la trouve de ce côté-là ; mais on peut ajouter qu’il a beaucoup de mal à la définir et à se définir par rapport à ses supposés semblables, et que c’est pendant des années (ou même pendant toute sa vie ?) un travail à temps presque complet que la recherche de cette définition. Non que Memmi aurait l’esprit particulièrement compliqué, hésitant ou confus, loin de là, mais il faut avouer que sa position, si position il y a, est objectivement d’une grande complexité et qu’aucun choix ne s’avère pour lui sans contradiction, du moins aux yeux de ceux pour qui les choses ont la chance d’être claires.
l’anticolonialisme etc. Cependant Memmi n’est pas snob ni mondain, il cherche à définir sa propre pensée et la trouve de ce côté-là ; mais on peut ajouter qu’il a beaucoup de mal à la définir et à se définir par rapport à ses supposés semblables, et que c’est pendant des années (ou même pendant toute sa vie ?) un travail à temps presque complet que la recherche de cette définition. Non que Memmi aurait l’esprit particulièrement compliqué, hésitant ou confus, loin de là, mais il faut avouer que sa position, si position il y a, est objectivement d’une grande complexité et qu’aucun choix ne s’avère pour lui sans contradiction, du moins aux yeux de ceux pour qui les choses ont la chance d’être claires.
Il fait souvent et lucidement dans le Journal le point sur les éléments qui composent sa complexité. Memmi est né et a vécu jusqu’à l’âge adulte dans le milieu juif et populaire de Tunis, un milieu où on ne parle qu’une sorte de patois mais pas le français (ni l’arabe, car on est encore jusqu’en 1956-1957 en pleine période coloniale ) ; et d’ailleurs la lecture du Journal permet de se rendre compte que jusqu’au milieu de sa vie en tout cas, Memmi continue à avoir quelques petites difficultés pour s’exprimer en français. On peut supposer qu’il a beaucoup travaillé pour parvenir à la langue de ses œuvres publiées, qui donne l’impression d’être parfaitement châtiée. Mais en même temps et par voie de conséquence, toute la culture de Memmi est française, il revendique ce fait, il en est heureux et fier et elle crée pour lui une appartenance que l’on peut dire sans mélange.
Cependant, ce qui lui reste de son passé juif et tunisien est important, c’est la base de ce qu’il appelle sa juiverie (il trouvera par la suite de meilleurs mots pour le dire, fort heureusement, car celui-ci comme on sait est chargé de connotations péjoratives ) et elle restera pour lui pendant toute sa vie un très grand sujet de réflexion, théorique sans doute mais vraiment existentielle et d’autant plus sans doute que cette partie de lui-même reste partiellement énigmatique à ses propres yeux. Memmi n’est certainement pas l‘homme des reniements, il veut comprendre, et il n’est sans doute guère aidé par ce que lui a apporté le sionisme qui a été sa seule ressource pendant toute son adolescence, quand il ne trouvait nulle part ailleurs de réponse à l’antisémitisme régnant au temps de la deuxième guerre mondiale. Mais lorsqu’il entre par la suite à Paris dans la catégorie des « intellectuels de gauche », il ne peut manquer d’être mis en difficulté (par les autres plus que par lui-même) du fait de l’antisionisme virulent pour lequel ils militent. En difficulté également lorsque la Tunisie devient indépendante, car s’il est pleinement d’accord et de longue date pour le rejet de la colonisation, il est pourtant et inévitablement mis dans la catégorie des Occidentaux qui ne peuvent manquer d’être stigmatisés dans cette nouvelle Tunisie revendiquant son arabité.
Tels sont les tiraillements—c’est le moins qu’on puisse dire—avec lesquels Memmi a dû vivre, on voit mal comment il aurait pu échapper à une angoisse directement liée à l’Histoire et à son Histoire.
Denise Brahimi
« PASSEPORT POUR LA LIBERTE » : Samira Belhoumi et Stéphane Beaud, entretiens. Adaptation théâtrale par Dominique Lurcel, éditions Anamnèse, 2021.
Avant de parler du travail de Dominique Lurcel et de l’actrice qui est sa complice dans cette pièce, Nadia Larbiouène, rappelons ce qui en est le point de départ, c’est-à-dire l’enquête que le livre désormais bien connu du sociologue Stéphane Beaud rapporte minutieusement sous le titre : La France des Belhoumi. Portraits de famille (1977-2017), éditio ns La Découverte, 2018.
ns La Découverte, 2018.
Stéphane Beaud a conduit cette enquête pendant plusieurs années auprès des Belhoumi, famille d’immigrés algériens de huit enfants, cinq filles et trois garçons. L’aînée des filles, Samira, a maintenant une cinquantaine d’années, puisque née en 1970. Le père est arrivé en France un an plus tard et la mère, avec les trois aînés de leurs enfants, l’a suivi en 1977. Les enfants de Samira représentent la troisième génération de la famille Belhoumi.
De cette famille, l’homme de théâtre et metteur en scène Dominique Lurcel, qui dirige la compagnie « Passeurs de mémoires », a retenu comme représentante bénévole la seule Samira, dont on peut dire que d’un point de vue social elle incarne la réussite et peut être prise comme exemple d’une intégration réussie : elle a la nationalité française et occupe un poste de cadre dans le secteur de la santé publique. A titre personnel, elle-même a très vite ressenti le désir de décrire le devenir familial dans sa diversité, et aussi la place particulière qu’elle y tient. Stéphane Beaud lui a donné la possibilité d’en parler à sa guise au cours de nombreux entretiens inédits, et c’est justement le matériau utilisé par  Dominique Lurcel, qui en a repris plusieurs éléments pour écrire sa pièce. Homme de théâtre, il souhaite initier par ce moyen une réflexion, principalement dans le milieu scolaire, de façon non dogmatique, en s’appuyant sur l’expérience vécue. Une des idées qu’il exprime, et qu’il rend très convaincante à propos du personnage de Samira Belhoumi, est liée à ce constat : elle est certes l’exemple d’une réussite mais d’une réussite douloureuse, qui amène à se poser la question : à quel prix ?
Dominique Lurcel, qui en a repris plusieurs éléments pour écrire sa pièce. Homme de théâtre, il souhaite initier par ce moyen une réflexion, principalement dans le milieu scolaire, de façon non dogmatique, en s’appuyant sur l’expérience vécue. Une des idées qu’il exprime, et qu’il rend très convaincante à propos du personnage de Samira Belhoumi, est liée à ce constat : elle est certes l’exemple d’une réussite mais d’une réussite douloureuse, qui amène à se poser la question : à quel prix ?
Nadia Larbiouène est l’actrice qui est chargée d’incarner ce personnage sur la scène, il lui faut donc représenter à la fois ce qu’il en est de cette réussite et de cette douleur, de ses séquelles et de ses traces.
La pièce a été conçue principalement pour être jouée dans des lieux d’enseignement, collèges et lycées, et ce projet a déjà connu quelques réalisations, qui se sont révélées très encourageantes. D’après son expérience et les quelques représentations de la pièce qui ont déjà eu lieu, Dominique Lurcel pense que l’implication des élèves dans le débat qui suit la pièce est un élément essentiel de tout ce dispositif. Parmi les spectateurs de la piè ce, il est vraisemblable que ce sont les spectatrices qui seront le plus amenées à s’identifier au personnage de Samira ; mais peut-être faut-il s’attendre aussi à des formes de rejet, et plus encore de la part des garçons, d’autant que dans le livre de Stéphane Beaud, dont la totalité transparaît forcément un peu à l’arrière-plan, on voit s’imposer une distinction de genre, les filles étant beaucoup plus prêtes que les garçons à profiter du système scolaire que l’école française met à leur disposition et le faisant avec plus de succès.
ce, il est vraisemblable que ce sont les spectatrices qui seront le plus amenées à s’identifier au personnage de Samira ; mais peut-être faut-il s’attendre aussi à des formes de rejet, et plus encore de la part des garçons, d’autant que dans le livre de Stéphane Beaud, dont la totalité transparaît forcément un peu à l’arrière-plan, on voit s’imposer une distinction de genre, les filles étant beaucoup plus prêtes que les garçons à profiter du système scolaire que l’école française met à leur disposition et le faisant avec plus de succès.
Il devrait y avoir bientôt des occasions de confirmer ou de vérifier tout cela, grâce à une dizaine de représentations entre la fin mars et le début avril (lycées et facultés d’Ile de France et des Hauts de France). Deux autres sont prévues les 11 et 12 juin à la Maison des Passages à Lyon…si le lieu ouvre de nouveau ses portes à ce moment-là… Nous espérons que ce sera l’occasion de transcrire dans La Lettre des entretiens déjà prévus avec l’actrice et l’acteur metteur en scène, à propos de ces stimulants « passeports pour la liberté ».
Denise Brahimi
Présentation de quelques articles lus dans le quotidien Le Monde
I/ « Printemps arabes », la Révolution inachevée, cahier joint au journal Le Monde des 17-18 Janvier
Ce cahier joint d’une dizaine de pages regroupe des articles de plusieurs auteurs sur les différents pays arabes qui ont suivi l’impulsion donnée par la Tunisie dès le début de l’année 2011. C’est d’ailleurs à l’occasion de cet anniversaire que le journal se livre à ce tour d’horizon, incluant aussi bien le Yemen, la Lybie, la Syrie, l’Irak et l’Egypte que les trois pays du Maghreb. Nous nous en tiendrons à ceux-là, compte tenu des domaines géographiques que recouvre l’Association Coup de soleil.
 Trois articles sont consacrés à la Tunisie, dont le premier aborde un problème douloureux, très difficile à aborder avec beaucoup de familles directement concernées. Il s’agit des Tunisiens qui sont partis faire le djihad en Irak et en Syrie, emmenant souvent avec eux femme et enfants, et qui maintenant peinent pour revenir dans leur pays. Certains sont encore détenus par les Kurdes. On constate que « la Tunisie rapatrie de façon ponctuelle quelques orphelins ». La question des revenants étant sensible sur le plan politique, on évite de l’évoquer.
Trois articles sont consacrés à la Tunisie, dont le premier aborde un problème douloureux, très difficile à aborder avec beaucoup de familles directement concernées. Il s’agit des Tunisiens qui sont partis faire le djihad en Irak et en Syrie, emmenant souvent avec eux femme et enfants, et qui maintenant peinent pour revenir dans leur pays. Certains sont encore détenus par les Kurdes. On constate que « la Tunisie rapatrie de façon ponctuelle quelques orphelins ». La question des revenants étant sensible sur le plan politique, on évite de l’évoquer.
Un deuxième article sur ce même pays essaie de faire le point sur les quelques avancées dans la conquête des droits des personnes LGBT. Mais l’homosexualité est toujours considérée comme une tare et condamnée par la loi, comme l’a prouvé, très récemment, en juin 2020, la condamnation de deux hommes de 26 ans à deux ans de prison.
Plus réconfortant est le troisième article, intitulé « Le renouveau des espaces culturels tunisiens »—celui-ci étant une des conséquences positives de la révolution de 2011. L’auteure de l’article n’hésite pas à parler d’une « movida tunisienne » et les exemples qui en sont donnés sont convaincants : collectif d’artistes issus du hip-hop, rap contestataire, galerie associative d’art contemporain. Mais la crise sanitaire ne peut manquer d’accroître le problème financier.
L’ article consacré au Maroc est illustré par une photo extrêmement parlante sur le thème des inégalités sociales effarantes qui caractérisent ce pays. On y voit la juxtaposition d’un quartier très délabré voir misérable de Casablanca et de la marina luxueuse qui vient d’être construite juste à côté. On sait que dans les quartiers défavorisés, des maisons s’effondrent en écrasant leurs habitants, parce qu’ils les ont construites eux-mêmes, sans autorisation. En 2016 a commencé dans le Rif un mouvement de contestation populaire qui s’est étendu ensuite vers le sud, mais il a été écrasé par une violente répression.
article consacré au Maroc est illustré par une photo extrêmement parlante sur le thème des inégalités sociales effarantes qui caractérisent ce pays. On y voit la juxtaposition d’un quartier très délabré voir misérable de Casablanca et de la marina luxueuse qui vient d’être construite juste à côté. On sait que dans les quartiers défavorisés, des maisons s’effondrent en écrasant leurs habitants, parce qu’ils les ont construites eux-mêmes, sans autorisation. En 2016 a commencé dans le Rif un mouvement de contestation populaire qui s’est étendu ensuite vers le sud, mais il a été écrasé par une violente répression.
En Algérie on sait que le mouvement est plus récent puisqu’il date du début de l’année 2019 et son évolution complexe, incertaine, fait que les Algériens se concentrent principalement sur la situation politique, alors qu’évidemment elle n’est la  seule à poser des problèmes ! L’article du Monde insiste sur l’incapacité de la classe politique à se renouveler. Le sentiment général est que ni le pouvoir ni l’opposition n’arrivent à s’organiser. Toutefois et quoi qu’il advienne, nul ne saurait dire que le Hirak n’est pas et n’a pas été un mouvement important.
seule à poser des problèmes ! L’article du Monde insiste sur l’incapacité de la classe politique à se renouveler. Le sentiment général est que ni le pouvoir ni l’opposition n’arrivent à s’organiser. Toutefois et quoi qu’il advienne, nul ne saurait dire que le Hirak n’est pas et n’a pas été un mouvement important.
D’après l’article synthétique qui termine le cahier, cette appréciation valable pour le Hirak l’est aussi pour l’ensemble des révolutions arabes. Le désir de révolte est encore vif, certes insatisfait. Mais la possibilité est apparue de créer sur place des contre-systèmes qui réagissent face à des situations bloquées.
II/ Tribune de Hichem Benaïssa dans Le Monde du 15 février 2021
Réduire la laïcité à son seul principe de neutralité, volonté contenue dans le projet de loi « confortant le respect des principes de la République », a pour but de rendre invisible la diversité, notamment religieuse, de la population, explique le sociologue Hicham Benaissa dans une tribune au « Monde » du 15 février 2021.
 Ce sociologue attaché au CNRS réfléchit au changement profond de la société française qui se trouve mis en cause dans la proposition de loi « contre le séparatisme », au nom de la laïcité et en usant des principes qu’on associe à ce mot. Il ne le fait pas de manière polémique mais d’abord historique, avant de poser une question fondamentale pour tous les citoyens que nous sommes. Dans les années 70 du siècle dernier, la diversité représentée par les travailleurs musulmans n’était pas sentie comme dangereuse, ni par les entreprises ni par l’Etat, parce qu’ils étaient là pour travailler, et à titre provisoire pensait-on. On sait clairement maintenant qu’il n’en est rien et que leur présence est devenue constitutive de la population française. La question qui se pose alors est la suivante : la République peut-elle se penser comme ne produisant que du même ? Son but peut-il être de rendre invisible la diversité croissante de la population française y compris religieuse.
Ce sociologue attaché au CNRS réfléchit au changement profond de la société française qui se trouve mis en cause dans la proposition de loi « contre le séparatisme », au nom de la laïcité et en usant des principes qu’on associe à ce mot. Il ne le fait pas de manière polémique mais d’abord historique, avant de poser une question fondamentale pour tous les citoyens que nous sommes. Dans les années 70 du siècle dernier, la diversité représentée par les travailleurs musulmans n’était pas sentie comme dangereuse, ni par les entreprises ni par l’Etat, parce qu’ils étaient là pour travailler, et à titre provisoire pensait-on. On sait clairement maintenant qu’il n’en est rien et que leur présence est devenue constitutive de la population française. La question qui se pose alors est la suivante : la République peut-elle se penser comme ne produisant que du même ? Son but peut-il être de rendre invisible la diversité croissante de la population française y compris religieuse.
Denise Brahimi
« LE CHAT DU RABBIN 10: RENTREZ CHEZ VOUS! » DE Joann Sfar, éditions Poisson Pilote
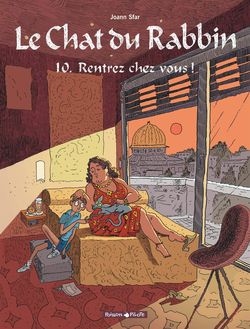 Le 10ème opus de la saga féline de Joann Sfar est peut-être un des plus réjouissants. Il nous fait voyager dans l’espace, entre Alger, l’Égypte, Israël (dans ses différentes appellations et définitions entre 1870, 1925,et 1973) et Nice. Et dans le temps, depuis la date du décret Crémieux, et un siècle plus tard en pleine guerre du Kippour. Le chat accompagne sa maîtresse Zlabya dans sa jeunesse vagabonde qui l’amène aux côtés d’un violoniste trotskyste juif dans ce qui n’était pas encore Israël mais le « foyer national » créé par la déclaration Balfour. Il est toujours avec elle, son mari, ses enfants et petits enfants quand ils visitent Israël en 1973. Le longévité de ce chat est phénoménale. Phénoménale aussi sa capacité à parler, français, très mal hébreu, et surtout à être un narrateur narquois, et un persifleur interrupteur des conversations des humains. Ce chat est tour à tour courageux et lâche, sentencieux et goguenard. Un phénomène ! Et le révélateur de la causticité de Sfar sur toutes les innombrables contradictions qu’il pointe dans les multiples façons d’être juif. Quand le rabbin père de Zlabya, sa fille, son gendre et leurs pittoresques amis sont au bord d’une plage algéroise pour y faire le « tashlin » annue
Le 10ème opus de la saga féline de Joann Sfar est peut-être un des plus réjouissants. Il nous fait voyager dans l’espace, entre Alger, l’Égypte, Israël (dans ses différentes appellations et définitions entre 1870, 1925,et 1973) et Nice. Et dans le temps, depuis la date du décret Crémieux, et un siècle plus tard en pleine guerre du Kippour. Le chat accompagne sa maîtresse Zlabya dans sa jeunesse vagabonde qui l’amène aux côtés d’un violoniste trotskyste juif dans ce qui n’était pas encore Israël mais le « foyer national » créé par la déclaration Balfour. Il est toujours avec elle, son mari, ses enfants et petits enfants quand ils visitent Israël en 1973. Le longévité de ce chat est phénoménale. Phénoménale aussi sa capacité à parler, français, très mal hébreu, et surtout à être un narrateur narquois, et un persifleur interrupteur des conversations des humains. Ce chat est tour à tour courageux et lâche, sentencieux et goguenard. Un phénomène ! Et le révélateur de la causticité de Sfar sur toutes les innombrables contradictions qu’il pointe dans les multiples façons d’être juif. Quand le rabbin père de Zlabya, sa fille, son gendre et leurs pittoresques amis sont au bord d’une plage algéroise pour y faire le « tashlin » annue l, le chat persifle « croire en Dieu, c’est accepter de faire des trucs ridicules en son nom », son maître le rabbin l’approuve « Pour une fois mon chat a raison. C’est ridicule. Et Dieu le sait. Une fois pour toutes Dieu est un type bien. Et un marrant…. ». La cérémonie consiste à agiter les franges de son vêtement devant la mer pour se débarrasser de ses péchés. Cela déclenche une splendide bagarre avec les Algérois pas encore appelés pieds noirs qui les insultent et leur crient « retournez chez vous » (où se trouve ce « chez vous?).
l, le chat persifle « croire en Dieu, c’est accepter de faire des trucs ridicules en son nom », son maître le rabbin l’approuve « Pour une fois mon chat a raison. C’est ridicule. Et Dieu le sait. Une fois pour toutes Dieu est un type bien. Et un marrant…. ». La cérémonie consiste à agiter les franges de son vêtement devant la mer pour se débarrasser de ses péchés. Cela déclenche une splendide bagarre avec les Algérois pas encore appelés pieds noirs qui les insultent et leur crient « retournez chez vous » (où se trouve ce « chez vous?).
Autre morceau de bravoure, le « rabbin du rabbin », vieil aveugle bourré de principe, et moqué par le chat, raconte la réaction des juifs d ‘Algérie et de sa mère le 24 octobre 1870, date du décret Crémieux. Elle comme quantité d’autres juifs sont allés consulter le psychiatre à l’hôpital psychiatrique d’Alger pour essayer de résoudre les contradictions dans lesquelles le fait de devenir français les faisait entrer… Après quoi elle part s’acheter une robe « française » pour remplacer sa tenue autochtone.
 Cet album fourmille de cocasses anecdotes sur la judaïté sous toutes ses formes, et aussi sur les liens paradoxaux qui se nouent entre juifs et non juifs, même antisémites, entre Hava, la cheffe de la brigade Hashomer qui mène bataille pour le camp juif, costumée en Bédouins, et un bande de vrais bédouins dont le chef est amoureux de Hava… « Cet après midi j’ai envoyé ma mère et ma sœur se faire soigner au Kibboutz. Les juifs sont nos ennemis, mais ils ont de bons médecins ».
Cet album fourmille de cocasses anecdotes sur la judaïté sous toutes ses formes, et aussi sur les liens paradoxaux qui se nouent entre juifs et non juifs, même antisémites, entre Hava, la cheffe de la brigade Hashomer qui mène bataille pour le camp juif, costumée en Bédouins, et un bande de vrais bédouins dont le chef est amoureux de Hava… « Cet après midi j’ai envoyé ma mère et ma sœur se faire soigner au Kibboutz. Les juifs sont nos ennemis, mais ils ont de bons médecins ».
C’est aussi un concentré d’analyse philosophique et géostratégique (si, si!). Le rabbin déclare« L’Angleterre, quand elle doit gérer un territoire avec des juifs et des arabes, elle promet un pays à chacun des deux, pis elle les laisse se débrouiller ». « Et la France, c’est le Décret Crémieux ; elle a dit aux juifs : dorénavant vous êtes français, et elle a dit aux arabes : vous non ! … C’est kif-kif : dans les deux cas à la fin, tout le monde se déteste ! ». Et que répond le chat ? « Du jour au lendemain, l’Angleterre peut annuler ta déclaration Balfour et la France peut, si ça lui chante, abroger ton décret Crémieux ». Et comme les deux rabbins sont sceptiques : « Vous les prêtres, vous êtes trop croyants ».
 Pour finir, le mari de Zlabya, lui aussi rabbin ne s’installera pas en Israël où il voulait protéger sa famille contre les insultes et les menaces aux « sales juifs », mais à Nice. Et quand la famille va visiter Israël en pleine guerre de Kippour il finit par s’y faire traiter de « sale arabe » et le vieille Zlabya ne supporte pas la climatisation.
Pour finir, le mari de Zlabya, lui aussi rabbin ne s’installera pas en Israël où il voulait protéger sa famille contre les insultes et les menaces aux « sales juifs », mais à Nice. Et quand la famille va visiter Israël en pleine guerre de Kippour il finit par s’y faire traiter de « sale arabe » et le vieille Zlabya ne supporte pas la climatisation.
Ce délicieux vagabondage dans le temps et l’espace, et dans les paradoxes d’appartenances multiples est un excellent exutoire à ces temps de semi confinement, et d’invectives contre les identités hors normes…
Michel Wilson
« WILLIS FROM TUNIS : 10 ANS ET TOUJOURS VIVANT! », de Nadia Khiari, Editions Elyzad 2020
 Encore un chat, encore marqué du chiffre 10, un chat tunisien, celui-là. Nadia Khiari a créé son célèbre Willis from Tunis (le nom de son vrai chat), le 13 janvier 2011, en écoutant ce qui allait être le dernier discours de Ben Ali. Celui-ci promettait entre autre la liberté sur internet. Chiche ! Le premier dessin sortait sur Facebook : un chat guettant, tout sourire, les souris, se félicitant de la baisse du prix du fromage… Le personnage était parti pour une belle carrière, qui allait valoir à sa créatrice de nombreux prix internationaux, dont le prix « couilles au cul » du off du festival d’Angoulême. Il faut dire que Nadia Khiari ne manque pas de courage dans sa mise en cause, via le chat Willis de toutes les perversions de la vie politique tunisienne, avec quelques incursions hors frontières, surtout quand il s’agit de pourfendre l’islamisme. Et pour rester dans le caractère supposé célébré par le prix en question, la dessinatrice ne se prive pas de références explicitement sexuelles, un chat n’ayant pas de tabous, comme chacun sait.
Encore un chat, encore marqué du chiffre 10, un chat tunisien, celui-là. Nadia Khiari a créé son célèbre Willis from Tunis (le nom de son vrai chat), le 13 janvier 2011, en écoutant ce qui allait être le dernier discours de Ben Ali. Celui-ci promettait entre autre la liberté sur internet. Chiche ! Le premier dessin sortait sur Facebook : un chat guettant, tout sourire, les souris, se félicitant de la baisse du prix du fromage… Le personnage était parti pour une belle carrière, qui allait valoir à sa créatrice de nombreux prix internationaux, dont le prix « couilles au cul » du off du festival d’Angoulême. Il faut dire que Nadia Khiari ne manque pas de courage dans sa mise en cause, via le chat Willis de toutes les perversions de la vie politique tunisienne, avec quelques incursions hors frontières, surtout quand il s’agit de pourfendre l’islamisme. Et pour rester dans le caractère supposé célébré par le prix en question, la dessinatrice ne se prive pas de références explicitement sexuelles, un chat n’ayant pas de tabous, comme chacun sait.
 Les éditions Elyzad dont nous aimons célébrer le travail, ont accueilli dans un beau livre épais et joliment édité un échantillon de 10 années de dessins satiriques (chatiriques?), qui ont ponctué les péripéties du difficile parcours de la Tunisie vers la démocratie. Ces dessins ont été publiés dans Siné Mensuel et dans Le Courrier international. Des extraits d’articles publiés par Nadia Khiari dans Siné Mensuel ouvre chaque chapitre annuel du livre. Une préface de Plantu salue l’oeuvre et le punch de la dessinatrice. Plus loin le chat de Sine fraternise avec Willis, et son créateur dit également toute l’admiration qu’il voue à Nadia.
Les éditions Elyzad dont nous aimons célébrer le travail, ont accueilli dans un beau livre épais et joliment édité un échantillon de 10 années de dessins satiriques (chatiriques?), qui ont ponctué les péripéties du difficile parcours de la Tunisie vers la démocratie. Ces dessins ont été publiés dans Siné Mensuel et dans Le Courrier international. Des extraits d’articles publiés par Nadia Khiari dans Siné Mensuel ouvre chaque chapitre annuel du livre. Une préface de Plantu salue l’oeuvre et le punch de la dessinatrice. Plus loin le chat de Sine fraternise avec Willis, et son créateur dit également toute l’admiration qu’il voue à Nadia.
L’ensemble donne une sorte de film de ces dix années en Tunisie, un film du style Marx Brothers, aux personnages connus ou inconnus, et aux sketches le plus souvent drôles, réussis et plutôt rentre dedans.  Nadia Khiari enseigne les arts plastiques dans un lycée, à côté de son activité de dessinatrice satirique, malheureusement ne nourrit pas suffisamment… sa femme. Son dessin est simple, presque schématique, mais efficace. Tous les personnages sont des chats, à l’humour forcément mordant. Les dessins sont soit sur fond blanc, soit mis en couleurs avec un vraie réussite visuelle.
Nadia Khiari enseigne les arts plastiques dans un lycée, à côté de son activité de dessinatrice satirique, malheureusement ne nourrit pas suffisamment… sa femme. Son dessin est simple, presque schématique, mais efficace. Tous les personnages sont des chats, à l’humour forcément mordant. Les dessins sont soit sur fond blanc, soit mis en couleurs avec un vraie réussite visuelle.
Au fil des années, le langage satirique s’affirme, les cibles se diversifient, les traits font mouche. Au passage une impression de désespoir finit par se dégager, du reste le livre s’achève sur un dessin qui cite la formule bien connue « l’humour est la politesse du désespoir ». L’humour de Willis n’est pas toujours poli, désespéré pour partie, mais d’une belle vigueur. Quelques vignettes suivront, pour s’en convaincre.
Michel Wilson





« EL HASLA », film marocain de Sonia Terrab, 2020 / 1h / Documentaire
Ce film documentaire est un exemple, encore un, de la grande efficacité de ce genre cinématographique pour parler du Maghreb d’aujourd’hui ; et il est fréquemment choisi par de jeunes ou moins jeunes réalisateurs de ces pays, visiblement convaincus et à juste titre que dans les cas qui leur tiennent à cœur, la réalité comme on dit dépasse la fiction. Elle la dépasse par une émotion forcément plus forte parce que la question de la crédibilité ne se pose pas, tout est forcément vrai et d’une vérité criante, c’est souvent le cas de le dire, en tout cas dans un document comme celui-ci où la réalisatrice a donné la parole principalement à des jeunes gens, malheureux garçons totalement conscients d’être dans une situation désespérée.
 Ils habitent un quartier populaire de Casablanca, Hay Mohammedi et le titre du film est aussi celui d’une chanson, El Hasla, qui signifie l’impasse, mot dont la signification symbolique ne peut échapper à personne : voie sans issue, aucune perspective, aucun espoir. Pourtant la chanson renvoie à une période où ce quartier était le lieu d’une vraie culture populaire, dans les années 70 du siècle dernier, c’est-à-dire il y a une cinquantaine d’années. De quoi était-elle faite et pourquoi a-t-elle aujourd’hui disparu ? Telles sont les questions que le documentaire incite à se poser, sans forcément y répondre directement lui-même car il ne s’agit pas d’échafauder des hypothèses et de les traduire en discours mais de donner à voir et à entendre, quitte à ce que le spectateur du film prolonge hors champ ses propres réflexions.
Ils habitent un quartier populaire de Casablanca, Hay Mohammedi et le titre du film est aussi celui d’une chanson, El Hasla, qui signifie l’impasse, mot dont la signification symbolique ne peut échapper à personne : voie sans issue, aucune perspective, aucun espoir. Pourtant la chanson renvoie à une période où ce quartier était le lieu d’une vraie culture populaire, dans les années 70 du siècle dernier, c’est-à-dire il y a une cinquantaine d’années. De quoi était-elle faite et pourquoi a-t-elle aujourd’hui disparu ? Telles sont les questions que le documentaire incite à se poser, sans forcément y répondre directement lui-même car il ne s’agit pas d’échafauder des hypothèses et de les traduire en discours mais de donner à voir et à entendre, quitte à ce que le spectateur du film prolonge hors champ ses propres réflexions.
De quoi était faite cette culture populaire, alors partagée par nombre d’artistes, écrivains et sportifs ? Comme le rappelle la chanson évoquée dans le titre, elle a été portée par un groupe de musiciens, Lemchaheb dont le succès a été un temps foudroyant : fondé en 1974, il disparaît dans les années 1980. A quoi s’ajoutait—et sans doute les supporters étaient-ils les mêmes—la gloire du club de football TAS ou Tihad Athletic Sport, de plus longue durée.
Pour comprendre ce qu’il en est aujourd’hui de ce quartier et de sa jeunesse, le mieux est d’utiliser le travail de la réalisatrice, dont on ne peut qu’admirer le talent avec lequel elle a  su recueillir des témoignages, hélas trop clairs et sans appel. La plupart des garçons qu’elle a enregistrés ont entre 15 et 25 ans semble-t-il, ils sont généralement en bande de cinq ou six, mais quand, exceptionnellement, on voit une fille, elle est seule face à la caméra ou plutôt avec sa mère qui parle pour elle. Donc la différence des sexes reste considérable et les relations entre garçons et filles semblent rarissimes. Cependant les premiers en parlent et les plus âgés disent qu‘ils aspirent au mariage, mais que celui-ci est impossible faute d’argent. Lorsqu’ils font allusion à l’amour, c’est de façon étonnamment enfantine et qu’on pourrait dire inconsistante, tant il est vrai que cela ne correspond pour eux à aucune réalité. Pourtant le désir d’enfant existe, un des garçons parmi les plus âgés explique que sa famille a été amenée à adopter un petit garçon abandonné par sa mère et que sa propre vie en a été changée : il se sent désormais responsable.
su recueillir des témoignages, hélas trop clairs et sans appel. La plupart des garçons qu’elle a enregistrés ont entre 15 et 25 ans semble-t-il, ils sont généralement en bande de cinq ou six, mais quand, exceptionnellement, on voit une fille, elle est seule face à la caméra ou plutôt avec sa mère qui parle pour elle. Donc la différence des sexes reste considérable et les relations entre garçons et filles semblent rarissimes. Cependant les premiers en parlent et les plus âgés disent qu‘ils aspirent au mariage, mais que celui-ci est impossible faute d’argent. Lorsqu’ils font allusion à l’amour, c’est de façon étonnamment enfantine et qu’on pourrait dire inconsistante, tant il est vrai que cela ne correspond pour eux à aucune réalité. Pourtant le désir d’enfant existe, un des garçons parmi les plus âgés explique que sa famille a été amenée à adopter un petit garçon abandonné par sa mère et que sa propre vie en a été changée : il se sent désormais responsable.
Comme chaque fois qu’il est question de la vie familiale au Maghreb, c’est l’image de la mère qui concentre toute l’affectivité ; un des garçons raconte comment la sienne travaille dur tous les jours car elle a quatre bouches à nourrir et c’est pour lui une motivation très forte qui le pousse à vouloir réussir : pour commencer, il réussit à passer le bac, première étape mais qui le conduit vers quoi ? Pourra-t-il échapper au sort de ses deux fidèles camarades, dont on apprend qu’ils sont l’un et l’autre en prison. Beaucoup de ceux que l’on voit et dont on entend parler sont d’ailleurs passés par cette case et leur jugement sur le rôle social de la prison est loin d’être négatif, comme si c’était finalement le seul lieu où ils sont assurés d’être nourris , encadrés, et délivrés de leurs addictions.
La place prise par la drogue dans le quartier est considérable, on est même tenté de penser qu’elle est la cause principale du déclin connu par celui-ci. Non seulement, comme certains le reconnaissent, la drogue les transforme en zombies, mais encore elle les amène à voler même leurs plus proches voisin(e)s alors que pendant longtemps on vivait dans le  quartier comme dans une sorte de grande famille, de manière presque communautaire. Le trafic de drogue est comme partout aux mains de dealers qu’on ne voit pas dans le film mais dont le rôle néfaste est connu de tout le monde ; il semble probable que les emprisonnements pour cause de deals concernent de petits revendeurs ou des consommateurs modestes néanmoins devenus délinquants.
quartier comme dans une sorte de grande famille, de manière presque communautaire. Le trafic de drogue est comme partout aux mains de dealers qu’on ne voit pas dans le film mais dont le rôle néfaste est connu de tout le monde ; il semble probable que les emprisonnements pour cause de deals concernent de petits revendeurs ou des consommateurs modestes néanmoins devenus délinquants.
Concernant ce que furent les deux piliers de la grandeur passée du Hay Mohammedi (et dont les plus âgés sont seuls à parler, déplorant l’ignorance des jeunes), il faut distinguer entre le football et la musique. Le premier reste très important pour les garçons, exutoire à leur trop plein d’énergie, et véritable raison de vivre ; cependant ils sont très divisés entre plusieurs clubs plus ou moins rivaux, qui de ce fait semblent n’avoir qu’une modeste importance. La musique est désormais réduite à bien peu de chose, principalement des  chants de supporters semble-t-il : ainsi va la vie des groupes musicaux, qui disparaissent comme ils étaient venus ; et c’est à peine si l’on voit dans le film quelques bribes d’activité musicale complétement sclérosée. L’un des garçons explique à la réalisatrice (sans doute pour refuser sa demande) qu’ils n’ont pas la moindre envie de chanter. Pourtant il leur arrive d’improviser sur le mode humoristique des petits couplets chargés d’auto-dérision.
chants de supporters semble-t-il : ainsi va la vie des groupes musicaux, qui disparaissent comme ils étaient venus ; et c’est à peine si l’on voit dans le film quelques bribes d’activité musicale complétement sclérosée. L’un des garçons explique à la réalisatrice (sans doute pour refuser sa demande) qu’ils n’ont pas la moindre envie de chanter. Pourtant il leur arrive d’improviser sur le mode humoristique des petits couplets chargés d’auto-dérision.
Le thème de l’impasse, plusieurs fois rappelé pendant le documentaire, y trouve sa pleine signification. On se dit que c’est déjà beaucoup de l’avoir montré dans un film—faute de savoir si celui-ci aura quelque effet sur la réalité.
Denise Brahimi

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.
Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris, chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002.

La recrudescence de la pandémie a une fois de plus mis à mal nos projets qui étaient nombreux en cette fin d’année. Nous les reporterons pour l’essentiel à des temps où la rencontre sera possible sans en craindre des conséquences sanitaires. D’autres beaux projets sont à l’étude, notamment grâce aux moyens du « à distance ». Patience! Et prenez soin de vous.
Ne vous privez pas en cette période de repli, de lire tous les beaux livres que nous commentons pour vous.
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

