Lettre culturelle franco-maghrébine #53
ÉDITO
Ce mois-ci est sous le signe de la variété des pays et des genres, au point que le roman qui est en général le mieux représenté dans cette chronique culturelle est ici minoritaire.
Nous en avons pourtant un qui est tout à fait représentatif du genre, il est l’œuvre d’une Marocaine et porte en bonne part sur le problème des migrants dans le sud du Maroc. Et nous avons aussi un exemple d’une catégorie voisine, celle des souvenirs d’enfance pendant la guerre d’Algérie.
Une étude universitaire sous la forme d’un recueil d’articles porte sur le thème « Art et résistance » et comporte des analyses précieuses parce qu’elles éclairent un certain nombre d’œuvres avec beaucoup de précision.
Mais ce ne sont sans doute pas des analyses qui conviendraient au peintre marocain Gharbaoui, qui nous est présenté par un de ses successeurs œuvrant dans le Maroc d’aujourd’hui. Nous le remercions d’avoir envoyé son article à La Lettre.
Les journalistes fournissent parfois un travail sans équivalent dans d’autres publications. C’est le cas d’un article paru récemment dans « Le Monde diplomatique » sur les Kabyles vivant de longue date dans le quartier de Ménilmontant à Paris.
Nous avons la chance, car ce n’est pas fréquent, de pouvoir vous présenter cette fois un livre pour la jeunesse, « Krimo, mon frère » qui semble enchanter ses lecteurs.
Et comme nous vous l’avions promis dans La Lettre du mois dernier, cette sélection mensuelle comporte aussi un film, « Les Femmes du pavillon J », un vrai bonheur dont on n’ose rêver par les temps qui courent !
Denise Brahimi

« SABLES » par Anissa M. Bouziane, éditions du Mauconduit, Paris, 2018, traduit de l’américain 2019
Bien que ce roman soit le premier de son auteure, il ne donne certainement pas l’impression d’être l’œuvre d’une débutante. D’abord parce qu’il témoigne d’une très belle écriture, alors même que les francophones le lisent en traduction. Ensuite parce qu’il est composé avec beaucoup de soin et maîtrise une grande diversité d’événements, choisissant d’ailleurs d’évoquer leur répercussion sur les sentiments et les comportements des personnages, plutôt que d’en faire l’objet d’une narration.
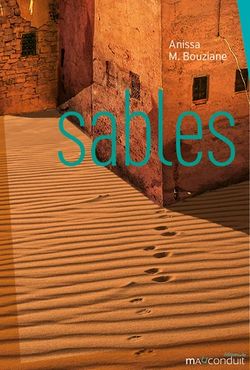 La diversité prend la forme d’une sorte de grand écart entre ce qui s’est passé à New York le 11 septembre 2001 et ce que vit plus tard dans le sud du Maroc la jeune Américano-Marocaine Jeehan qui a décidé de rentrer dans son pays d’origine, le Maroc où vivent ses parents, après la destruction des tours du World Trade Center. Pendant la plus grande partie du livre, on passe de l’un à l’autre lieu au moyen de courts chapitres en alternance, non sans que ce récit suive un déplacement dans l’espace et une mutation dans le temps : Jehan vit d’abord et de très près la destruction des tours de New York tout près desquelles elle travaille puis elle plonge de plus en plus dans l’expérience du Sahara marocain qui est pour elle une découverte multiple, géographique et existentielle. Dans ce deuxième lieu elle est désignée comme « l’Américaine » même s’il est évident qu’elle n’aurait jamais pu vivre cette aventure si elle n’était Marocaine en même temps et reconnue comme telle. Chronologiquement, la partie marocaine de son histoire fait suite à la partie américaine. Lorsque venant de New York elle débarque à Casablanca, et part aussitôt pour le Sahara en taxi, on comprend vite qu’il s’agit d’une rupture à tous égards et d’une découverte d’elle-même autant que de certains lieux et faits, qui finalement ne sont pas moins violents que ceux du 11septembre à New York.
La diversité prend la forme d’une sorte de grand écart entre ce qui s’est passé à New York le 11 septembre 2001 et ce que vit plus tard dans le sud du Maroc la jeune Américano-Marocaine Jeehan qui a décidé de rentrer dans son pays d’origine, le Maroc où vivent ses parents, après la destruction des tours du World Trade Center. Pendant la plus grande partie du livre, on passe de l’un à l’autre lieu au moyen de courts chapitres en alternance, non sans que ce récit suive un déplacement dans l’espace et une mutation dans le temps : Jehan vit d’abord et de très près la destruction des tours de New York tout près desquelles elle travaille puis elle plonge de plus en plus dans l’expérience du Sahara marocain qui est pour elle une découverte multiple, géographique et existentielle. Dans ce deuxième lieu elle est désignée comme « l’Américaine » même s’il est évident qu’elle n’aurait jamais pu vivre cette aventure si elle n’était Marocaine en même temps et reconnue comme telle. Chronologiquement, la partie marocaine de son histoire fait suite à la partie américaine. Lorsque venant de New York elle débarque à Casablanca, et part aussitôt pour le Sahara en taxi, on comprend vite qu’il s’agit d’une rupture à tous égards et d’une découverte d’elle-même autant que de certains lieux et faits, qui finalement ne sont pas moins violents que ceux du 11septembre à New York.
Pour autant, on ne peut dire facilement quel est le lien entre ces deux moments et ces deux aspects de sa vie, et le livre est beaucoup trop subtil pour se résumer à une sorte de retour aux sources et à l’authenticité perdue durant sa confrontation avec le monde occidental. Ce qu’elle vit pendant son séjour au Sahara, bref quoique plus long que prévu, est limité dans le temps et se termine par un retour à Casablanca, dans une famille avec laquelle ses liens sont très forts et indestructibles. Cette famille explique la complexité de Jeehan : Père marocain mais travaillant de longue date dans une école américaine et nourri par la littérature de plusieurs pays, mère française qui n’imaginerait pas de laisser ses filles dériver dans une sorte de néant culturel par renoncement à la civilisation.
Même s’il y quelques moments où l’on sent poindre chez Jeehan la tentation de cette dérive, ce n’est décidément pas la bonne piste à suivre pour comprendre son aventure. Elle n’en ignore pas la possibilité, ou le risque, comme on peut le voir au fait qu’elle évoque un roman assez connu, fondé sur ce thème et dont le titre américain, traduit en français, devient Un thé au Sahara (1980).L’auteur Paul Bowles y raconte comment une Américaine venue vivre au Maroc se laisse subjuguer et entraîner, très loin de sa culture d’origine, par une arabité sensuelle à l’opposé de ce qu’était son intellectualité auparavant. Or il y a plus d’une différence entre cette histoire et celle de Jeehan et l’on peut en retenir les deux principales, qui sont tout à fait claires dans le livre et aussi tout à fait inscrites dans la réalité historique, socio-politiques etc. en sorte qu’on ne saurait les rabattre sur les états d’âme de l’héroïne.
La première est la réaction anti-arabe des Américains lorsqu’ont lieu à New York les événements du 11 septembre 2001. Jeehan ne cesse de se faire interpeller en tant que représentante du monde arabe comme si elle était forcément coupable en tant qu’arabe(alors même que personne ne semble savoir ce que ça veut dire !) de ce qu’ont fait les terroristes ; d’ailleurs, les conséquences pratiques ne manquent pas, et elle se fait rapidement renvoyer de son travail. On croit comprendre qu’il lui est difficile de ne pas endosser à un niveau sans doute inconscient cette énorme culpabilité dont elle sait pourtant à quel point elle est absurde et injuste. Le roman fait parfaitement comprendre pourquoi cette situation devient insoutenable et pourquoi Jeehan doit partir.
 Ce qui est tout à fait intéressant aussi est la raison qu’elle se donne pour le faire et qui est relative à un autre aspect, non moins éprouvant, de l’actualité mondiale. Jeehan qui est au moins partiellement journaliste voudrait enquêter, avec son ami Ali qui l’est également, sur le trafic odieux et clandestin auquel se livrent des passeurs dans le sud du Maroc. Contre des sommes astronomiques et dans des conditions inhumaines, ils acheminent vers le nord et l’Espagne des cargaisons de candidats subsahariens à l’émigration. Jeehan va en effet être témoin de la mort horrible d’un certains nombre d’entre eux qu’on a laissé enfermés sans air et sans eau dans la remorque d’un camion. La complexité du roman vient du fait que sa volonté de dénoncer un tel crime va de pair avec l’expérience existentielle qu’elle est amenée à vivre et qui entre dans la trame de son histoire personnelle. Elle n’avait pas prévu, en tout cas pas consciemment, qu’elle aurait à s’y confronter en même temps qu’à se battre contre les autres obstacles plus attendus dus à la rapacité des passeurs.
Ce qui est tout à fait intéressant aussi est la raison qu’elle se donne pour le faire et qui est relative à un autre aspect, non moins éprouvant, de l’actualité mondiale. Jeehan qui est au moins partiellement journaliste voudrait enquêter, avec son ami Ali qui l’est également, sur le trafic odieux et clandestin auquel se livrent des passeurs dans le sud du Maroc. Contre des sommes astronomiques et dans des conditions inhumaines, ils acheminent vers le nord et l’Espagne des cargaisons de candidats subsahariens à l’émigration. Jeehan va en effet être témoin de la mort horrible d’un certains nombre d’entre eux qu’on a laissé enfermés sans air et sans eau dans la remorque d’un camion. La complexité du roman vient du fait que sa volonté de dénoncer un tel crime va de pair avec l’expérience existentielle qu’elle est amenée à vivre et qui entre dans la trame de son histoire personnelle. Elle n’avait pas prévu, en tout cas pas consciemment, qu’elle aurait à s’y confronter en même temps qu’à se battre contre les autres obstacles plus attendus dus à la rapacité des passeurs.
On voit par là que le roman mêle plusieurs aspects et n’exclut pas ceux d’un roman policier ou thriller. Tout le monde autour d’elle et Jehan elle-même savent qu’elle se met en danger, et c’est finalement grâce à la chance sans doute et grâce à l’amour de sa famille que Jehann va se tirer d’affaire. Les divers événements qu’elle côtoie sont d’une gravité extrême et pourtant le récit refuse de se déployer sur le mode mélodramatique ou tragique, Jehann reçoit des coups, elle tombe, se blesse, souffre physiquement et finalement elle s’en sort, sans que le livre nous dise jusqu’à quand. Le grand atout de l’auteur est son art d’écrire, grâce auquel elle évite le risque de s’enliser dans un récit réaliste, en poétisant le sien.
Denise Brahimi
« SOUVENIRS D’ENFANCE DE LA GUERRE D’ALGERIE: UNE ENTREE DOULOUREUSE DANS LA MODERNITE », par Mohammed Matmati , éditions Campus ouvert, 2021
L’auteur de ce livre est né dans l’est de l’Algérie en 1946, c’est dire que la période de la guerre d’indépendance correspond à son enfance et à son adolescence, qui sont souvent des années, et c’est son cas, où les souvenirs s’inscrivent dans la mémoire avec une grande fraîcheur et efficacité, leur permettant de perdurer toute une vie. La période de la guerre et les lieux où Mohammed Matmati l’a vécue, forment un massif central au cœur du livre, qui cependant ne se borne pas à les évoquer.
 Il commence son livre par une longue évocation de type historique consacrée à la « petite Kabylie » qui est sa région et qu’il replace aussi bien dans la géographie que dans le temps. Il s’agit d’un retour sur les sources bien connues en la matière, notamment les livres de ces grands historiens qu’ont été Charles-André Julien et Charles-Robert Ageron. C’est d’ailleurs un trait remarquable de l’auteur que de ne jamais hésiter à être pédagogique sans doute parce que, comme il l’écrit souvent, il a le sentiment de devoir beaucoup sinon tout à l’école qui certes était celle de l’époque coloniale, mais à laquelle un très grand nombre d’Algériens ont rendu hommage. D’ailleurs un homme à la fois traditionnel et éclairé comme l’était le père de Mohammed en savait toute l’importance pour l’avenir de ses enfants, et il a fait les plus grands sacrifices pour qu’ils bénéficient de cet enseignement. On voit aussi comment, en cette matière, le père pouvait être relayé par les fils aînés, qui n’hésitaient pas à prendre en charge les plus jeunes s’il le fallait.
Il commence son livre par une longue évocation de type historique consacrée à la « petite Kabylie » qui est sa région et qu’il replace aussi bien dans la géographie que dans le temps. Il s’agit d’un retour sur les sources bien connues en la matière, notamment les livres de ces grands historiens qu’ont été Charles-André Julien et Charles-Robert Ageron. C’est d’ailleurs un trait remarquable de l’auteur que de ne jamais hésiter à être pédagogique sans doute parce que, comme il l’écrit souvent, il a le sentiment de devoir beaucoup sinon tout à l’école qui certes était celle de l’époque coloniale, mais à laquelle un très grand nombre d’Algériens ont rendu hommage. D’ailleurs un homme à la fois traditionnel et éclairé comme l’était le père de Mohammed en savait toute l’importance pour l’avenir de ses enfants, et il a fait les plus grands sacrifices pour qu’ils bénéficient de cet enseignement. On voit aussi comment, en cette matière, le père pouvait être relayé par les fils aînés, qui n’hésitaient pas à prendre en charge les plus jeunes s’il le fallait.
Mohammed Matmati a vécu ces années-là dans les deux grandes villes de l’Est algérien, Constantine et Bône-Annaba, villes sur lesquelles il ne manque pas d’apporter un grand nombre de renseignements, et l’on pourrait presque dire quartier par quartier. C’est l’avantage du récit autobiographique sur toute espèce de livre d’histoire, si détaillé soit-il. Celui-ci–ci est d’une grande fraîcheur parce que l’auteur réussit à restituer ce qu’était son regard naïf d’enfant curieux et intelligent —évitant le plus souvent d’y mêler des jugements rétrospectifs, sauf lorsqu’il s’agit d’introduire dans son récit de véritables petites monographies pour l’instruction du lecteur, comme par exemple celle qu’il consacre aux Juifs de Constantine, dans le sous-chapitre intitulé « La ville de Constantine et les Juifs ». L’auteur ne sous-estime pas l’importance de son apport personnel, d’autant qu’il a manifestement un grand plaisir à revenir sur ses souvenirs, mais il a aussi pour méthode de les utiliser comme supports ou points de départ pour élargir les connaissances dont il fait part généreusement.
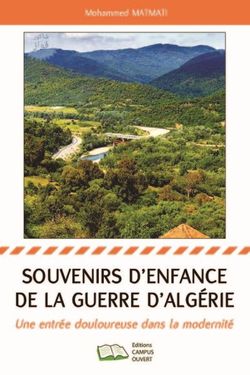 Entre 1957 et 1962, plus les années passent et plus grandit dans ses souvenirs la place tenue par la guerre. D’une manière qu’il faut saluer, il est à la fois totalement engagé pour la cause du FLN et de l’indépendance, mais jamais violent dans l’invective et la dénonciation, alors même que son récit fait apparaître les exactions révoltantes de l’armée française. Sur les méfaits de l’OAS il n’est pas moins clair et détaillé, sans doute parce qu’en 1961-62, il est déjà un grand adolescent, étant né, rappelons-le, en 1946. D’ailleurs, tout le chapitre consacré à ces années-là s’intitule « La maturité dans la guerre ». Aussi a-t-il pu vivre pleinement et en toute conscience la joie de l’indépendance en juillet 1962.
Entre 1957 et 1962, plus les années passent et plus grandit dans ses souvenirs la place tenue par la guerre. D’une manière qu’il faut saluer, il est à la fois totalement engagé pour la cause du FLN et de l’indépendance, mais jamais violent dans l’invective et la dénonciation, alors même que son récit fait apparaître les exactions révoltantes de l’armée française. Sur les méfaits de l’OAS il n’est pas moins clair et détaillé, sans doute parce qu’en 1961-62, il est déjà un grand adolescent, étant né, rappelons-le, en 1946. D’ailleurs, tout le chapitre consacré à ces années-là s’intitule « La maturité dans la guerre ». Aussi a-t-il pu vivre pleinement et en toute conscience la joie de l’indépendance en juillet 1962.
Mohammed Matmati est un homme foncièrement honnête, qui n’essaie pas de tricher. Raison pour laquelle il ajoute encore après cela un chapitre au titre clair : « L‘indépendance, les premières déceptions ». Il ne va pas au-delà des premières années de la nouvelle nation, mais c’est assez pour qu’il ait au moins trois raisons d’être déçu : « la crise politique de l’été 1962, la guerre des frontières entre l’Algérie et le Maroc et le coup d’état militaire de 1965 ». Il ne s’y étend pas outre-mesure, n’étant comme on a déjà vu ni dans la violence ni dans la déploration, mais il a le grand mérite de ne pas esquiver cette dernière partie du parcours sur lequel il a décidé de revenir, pour l’usage de ses lecteurs.
Les quelques réflexions qu’il présente en guise de conclusion ne sont pas moins claires et dignes d’intérêt. Ayant constaté à la suite du récit précédent à quel point tout son passage à l’âge adulte se trouve imbriqué dans les années de guerre, il s’autorise à remonter dans les périodes antérieures et s’interroge sur les erreurs regrettables commises par la colonisation. Il en ressort qu’il ne peut se résoudre à condamner ni la France ni la République sans autre forme de procès. D’ailleurs il apporte lui-même, évidemment brièvement, des réponses à ses questions, et l’on ne peut qu’apprécier le mélange dont il fait preuve de fermeté et de modération.
Denise Brahimi
« ART ET RESISTANCE AU MAGHREB ET AU MOYEN-ORIENT DE 1945 A 2011 », coordonné par Anissa Bouayed et Chantal Chanson-Jabeur , L’Harmattan, 2021
Ce livre est un recueil d’une douzaine d’articles, écrits par des universitaires de disciplines différentes et regroupés en trois ensembles. Le premier traite de l’importance historique de l’art pour résister à l’oubli, le deuxième étudie la place de l’art dans les conflits du Moyen-Orient, relation israélo-palestinienne et guerre du Liban, le troisième analyse la position des artistes du Maghreb et la manière dont ils subvertissent le rôle dont on veut les investir officiellement. On trouve aussi dans le volume un cahier de reproductions indispensables pour la lecture des articles.
 Faute de pouvoir citer les auteurs (même s’il y en a d’aussi éminents que Benjamin Stora ou Omar Carlier), ou résumer leurs articles, même très sommairement, on se contentera ici, à regret, de les évoquer pour y renvoyer les lecteurs, en abordant successivement les trois parties du recueil.
Faute de pouvoir citer les auteurs (même s’il y en a d’aussi éminents que Benjamin Stora ou Omar Carlier), ou résumer leurs articles, même très sommairement, on se contentera ici, à regret, de les évoquer pour y renvoyer les lecteurs, en abordant successivement les trois parties du recueil.
—Dans la première on voit comment l’art est un moyen de résister à la désinformation, une arme malheureusement très efficace aux mains de ceux qui savent l’utiliser. Pour occulter les violences et les horreurs des massacres, une pratique fréquente consiste à leur substituer d’autres images, qui les déréalisent. C’est à cela que s’opposent certaines productions artistiques remarquables, photographiques, vidéographiques ou cinématographiques. L’auteure de l’article recourt aux grands maîtres de l’esthétique contemporaine pour nous faire comprendre les caractéristiques de ces images particulières, qui ne sont « ni une reproduction du réel ni un pur irréel », complexité qui ne retire rien à leur simplicité apparente.
Suit un article qui prend appui sur des événements tristement célèbres, les massacres qui ont eu lieu à Sétif en mai 1945. Quelle mémoire visuelle en a-t-on gardé en France et en Algérie, et comment s’est faite la construction de ces deux imaginaires, évidemment bien différents. Il faut travailler sur un exemple très précis comme celui-ci pour comprendre les différentes étapes de leur construction à travers le temps.
 On voit ensuite comment l’image est apparue tardivement, après les archives écrites et les témoignages, comme source possible voir nécessaire à l’écriture de l’histoire. Cette troisième source est d’un volume considérable, puisque alimentée par les chaînes de télévision et par internet. Si l’on prend l’exemple de la guerre d’Algérie, les écrans offrent en grand nombre à son propos des documentaires et des films de fiction, et la difficulté est d’ailleurs de faire la part des choses entre les uns et les autres, lorsqu’il s’agit de savoir où se trouve la plus forte authenticité. Il est certain que beaucoup de films sur ces événements souffrent d’un manque de profondeur historique et cèdent à la fascination de la violence. Mais ils nourrissent les mémoires qui ont besoin d’être portées par un souffle épique et une puissante affectivité.
On voit ensuite comment l’image est apparue tardivement, après les archives écrites et les témoignages, comme source possible voir nécessaire à l’écriture de l’histoire. Cette troisième source est d’un volume considérable, puisque alimentée par les chaînes de télévision et par internet. Si l’on prend l’exemple de la guerre d’Algérie, les écrans offrent en grand nombre à son propos des documentaires et des films de fiction, et la difficulté est d’ailleurs de faire la part des choses entre les uns et les autres, lorsqu’il s’agit de savoir où se trouve la plus forte authenticité. Il est certain que beaucoup de films sur ces événements souffrent d’un manque de profondeur historique et cèdent à la fascination de la violence. Mais ils nourrissent les mémoires qui ont besoin d’être portées par un souffle épique et une puissante affectivité.
Le dernier article de cette première partie se situe à Paris et à Rabat, et évoque deux expositions consacrées à la disparition de Mehdi Ben Barka. On apprend à ce sujet que l’Institut Mehdi Ben Barka comporte un comité chargé de cette sorte d’expositions, créé pour le 40e anniversaire de l’enlèvement du leader politique en 1965. Il est question dans l’article de trois expositions : deux d’entre elles ont eu lieu à Paris, l’une en 2005, où le peintre et graphiste Fabien Jomaron présentait une série de portraits et l’autre en 2007 où figuraient des œuvres variées de 41 artistes ; la troisième, à laquelle participaient 23  artistes, a eu lieu à Rabat en 2008. Ce qui s’y trouve mis en exergue est une fonction de l’art qui ne peut être de représenter la réalité puisqu’il s’agit ici d’une disparition et d’un disparu : « ce qui est présent, c’est la vertigineuse absence ». Pour chacun des artistes, l’acte qu’il accomplit est un engagement, une volonté de faire apparaître ce qui est dissimulé et qui est la vérité. Les œuvres présentées sont de véritables manifestes, elles sont le meilleur moyen de transmettre une mémoire dont on constate par ailleurs qu’elle est inévitablement altérée par le temps.
artistes, a eu lieu à Rabat en 2008. Ce qui s’y trouve mis en exergue est une fonction de l’art qui ne peut être de représenter la réalité puisqu’il s’agit ici d’une disparition et d’un disparu : « ce qui est présent, c’est la vertigineuse absence ». Pour chacun des artistes, l’acte qu’il accomplit est un engagement, une volonté de faire apparaître ce qui est dissimulé et qui est la vérité. Les œuvres présentées sont de véritables manifestes, elles sont le meilleur moyen de transmettre une mémoire dont on constate par ailleurs qu’elle est inévitablement altérée par le temps.
—Les habitués de Coup de soleil savent que cette association se consacre et donc se limite aux pays du Maghreb. Il est pourtant évident qu’Israël, la Palestine et le Liban offrent une sorte de miroir grossissant sur la relation entre art et résistance. Tant il est vrai que ce qu’on appelle la question palestienne implique forcément et d’emblée celle de la résistance et de ses moyens, ou encore d’une subversion possible de l’oppression. Même la cartographie, qui implique la délimitation des frontières, ne saurait être neutre et il arrive qu’elle devienne grâce aux artistes un moyen de revendication. Symboliquement, le mur de séparation construit entre les deux pays est un cas exemplaire du renversement par l’art d’une situation imposée, lorsque il est utilisé pour nier la volonté de séparation et pour dire qu’elle n’existe pas ! La substantielle étude consacrée au grand peintre libanais Shafic Abboud montre de façon convaincante ce qu’il en est d’un art « concerné » par la guerre (mot qui dénote une pratique volontaire de l’en-deçà !) et qui pourtant se refuse au reportage de type réaliste, en évitant la figuration.
—La troisième partie du livre prend ses exemples en Algérie et en Tunisie.
S’agissant de mémoire l’Algérie est au premier rang des pays qui ont pris en charge d’en donner une version officielle, chargé d’un rôle très important : devenir le mythe fondateur d’une nouvelle nation. Cependant sa politique muséale a été mise en place un peu tardivement, non par la génération de l’indépendance mais par celle qui a suivi. Il fallait le temps de créer des sites mémoriels dignes de leur enjeu, en l’occurrence non pas un mais deux musées dans l’espace public, celui du Moudjahid ouvert en 1984 et un an plus tard celui de l’Armée, l’un et l’autre relevant « de la théâtralité du pouvoir, de l’Etat spectacle, de sa mise en scène ». En suivant de près l’article qui leur est consacré, on constate la présence constante et délibérée des intentions qui ont présidé à cette mise en place. Quelle que soit la distance qu’on veut garder à l’égard d’une idéologie aussi prégnante, du point de vue de ses concepteurs, c’est, comme on dit banalement, du beau travail ! Et certainement, pour qui s’intéresse au rôle des images et de l’imagerie, un vaste sujet de réflexion…
L’article suivant, consacré à la résistance des artistes algériens contemporains, est une sorte de répondant au précédent, opposant la force de la fragilité à la matérialité d’une affirmation imposante. On se doute que ce jeu d’opposition a son origine dans la période coloniale. A l’époque actuelle la résistance des jeunes artistes consiste à faire émerger une différence, qui s’oppose à l’uniformisation culturelle et artistique. Il s’agit pour eux de créer des images qui comportent une fonction critique par rapport au déversement de toutes celles aujourd’hui imposées.
En Tunisie, il semble qu’une fonction éventuellement subversive de l’art ait eu (et qu’elle ait encore) beaucoup de mal à émerger. Dans le titre de l’article consacré à cette éventualité et aux obstacles qu’elle rencontre, figure la formule « art de la cour », constat sévèrement critique à l’égard des artistes institutionnels, officiellement reconnus et soutenus. Seules quelques galeries présentent semble-t-il une autre sorte de travail de type collectif, ou individuel. Le lecteur fera connaissance avec deux artistes qui se trouvent être des femmes. Elles sont la preuve suffisante qu’un art politique existe en Tunisie, inventif et novateur.
Il existe aussi dans la BD et le dessin de presse de ce même pays, domaines favoris de l’humour et de la dérision, mais soumis pour cette raison même à différentes formes de contrôle voire de censure. La partie n’est jamais gagnée !
Denise Brahimi
EL GHARBAOUI : l’envol des racines
Le peintre le plus emblématique de la peinture Marocaine est aussi le plus mystérieux.
Sa croix, un long chemin vie…
Une enfance douloureuse, une jeunesse tourmentée, une fin aussi prématurée que tragique.
 Il y a 50 ans le 8 avril 1971 Jilali El Gharbaoui disparaissait.
Il y a 50 ans le 8 avril 1971 Jilali El Gharbaoui disparaissait.
La beauté de ses tableaux semble répondre à ce qu’il était intérieurement.
Regardez ses gestes de couleur, ses gestes de lumière de vie, regardez cette gestualité très franche très forte qui exprime son désir de liberté.
Pourquoi Gharbaoui ? Parce- que Jilali est celui qui a fait entrer la peinture Marocaine dans la modernité.
Père de l’abstraction lyrique au Maroc, Gharbaoui est surtout celui qui a ôté toute Marocanité dans sa peinture. Sa peinture, c’était sa terre.
Elle reflète aussi parfaitement ses états intérieurs. Sa peinture c’était son destin.
Dans son parcours, Gharbaoui croisera deux personnalités qui comprendront son art : le poète Henri Michaux, rencontré à Paris au début des années 1950, à la démarche artistique identique et aux mêmes addictions ; et surtout le critique Pierre Restany, sensible aux signes tracés fiévreusement par le Marocain.
 Malgré le soutien de ses amis et la reconnaissance d’un public tout acquis, l’artiste, toujours en proie à ses tourments, finira ses jours à Paris dans la plus grande solitude.
Malgré le soutien de ses amis et la reconnaissance d’un public tout acquis, l’artiste, toujours en proie à ses tourments, finira ses jours à Paris dans la plus grande solitude.
Il est retrouvé mort sur un banc . André Malraux fera rapatrier son corps au Maroc, à Fès, dans un avion aux couleurs du royaume Chérifien.
Il sera inhumé dans la plus grande indifférence.
«La quête de la lumière est pour moi capitale. Elle ne trompe jamais. Elle nous lave les yeux. »
Jilali Gharbaoui.
Mehdi Salhi





« AVEC LES KABYLES DE MENILMONTANT », Le Monde Diplomatique, mars 2021, par Arezki Metref
Ce gros article d’une douzaine de pages est l’œuvre d’un journaliste qui est aussi écrivain, et qui prend pour point de départ ce qu’il peut voir au quotidien dans le 20e arrondissement de Paris—visibilité d’autant plus grande que la fermeture des cafés pour cause de pandémie a dispersé vers l’extérieur de leurs repaires habituels les vieux Kabyles familièrement appelés Chibanis. Cette situation inattendue appelle l’attention sur leur histoire, qui remonte aux origines ou presque de la communauté kabyle de Paris, évidemment devenue différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a une cinquantaine d’années.

L’intérieur de l’hôtel bar restaurant Des Deux Gares à Paris dans le 17ème arrondissement depuis une fenêtre de l’extérieur. Ce lieu est surnommé Le Club des Chibanis par ses habitués.
Le retour sur l’histoire montre à quel point la structure communautaire de leur groupe a aidé les Kabyles à s’intégrer dans le monde du travail en France, alors que pendant plusieurs décennies, ils y sont arrivés sans la moindre connaissance de la langue française et tout juste arrachés au groupe familial voir tribal où ils vivaient dans leurs montagnes. Il est clair que sans l’aide très efficace du groupe d’accueil qui les prenait en main à leur arrivée, on voit mal comment leur venue et leur intégration professionnelle auraient été possibles. Et on admire l’intelligence de la prise en charge dont ils ont bénéficié. Arezki Metref cite à ce propos l’une de ses sources qui explique concrètement comment les choses se passaient : «Les nouveaux arrivants, pour la plupart analphabètes, étaient totalement pris en charge par la communauté. Ils étaient logés et nourris. On leur donnait de l’argent, on leur apprenait à circuler dans Paris. On les accompagnait à leur travail jusqu’à ce qu’ils connaissent le chemin. Ils ne pouvaient pas apprendre le français, car ils continuaient à vivre dans leur communauté – d’une certaine façon, dans leur village.»
L’origine de cette migration est à la fois politique et économique : en 1871, un des derniers massacres commis par la colonisation a consisté en l’écrasement de toute la partie de la Kabylie qui était restée productive et vivante. Privés de leurs terres, les habitants ont dû se retirer sur d’autres terres, souvent trop pauvres pour être exploitées, en sorte qu’il leur devenait impossible d’y vivre et de faire vivre leur famille. C’est ainsi que des flots importants d’immigrés kabyles sont venus travailler en France.

Cependant les Kabyles de Ménilmontant semblent avoir fui dès qu’ils le pouvaient la condition d’ouvriers, encore une fois grâce à l’aide qu’ils trouvaient dans leur communauté, à l’origine villageoise et tribale et maintenue après l’installation dans un quartier de Paris. Leur choix s’est porté massivement sur la restauration et l’hôtellerie. Un moment est venu où les Auvergnats de Paris longtemps connus sous le nom de bougnats, ont trouvé grâce à ceux qu’on appelait les Algériens l’occasion de vendre leur café et de rentrer dans leur province pour une retraite sans doute bien méritée. Et c’est ainsi qu’ont fleuri dans certains quartiers de Paris comme Ménilmontant, les cafés dits algériens, bien que kabyles en réalité. Mais d’un point de vue français, cette distinction n’était pas sentie comme significative, alors que comme on sait, elle est devenue de plus en plus marquée voire revendiquée depuis quelques décennies, notamment pour des raisons linguistiques, la langue kabyle ou tamazight n’ayant rien à voir avec l’arabe (considérée à l’indépendance comme l’unique langue officielle de l’Algérie). L’article rappelle utilement que « être algérien ne signifie pas forcément être arabe, puisque les Kabyles sont berbères. Ce dernier terme désigne un vieux peuple autochtone d’Afrique du Nord dont la présence est attestée au moins depuis Hérodote. Il a la singularité de posséder une langue, le tamazight, transmise oralement, et qui survit depuis plus de deux mille ans ».
 Arezki Metref mélange des informations de ce type, assez générales, avec des entretiens actuels et localisés sur le bastion kabyle de Ménilmontant. On apprend à le lire que le hirak y est présent avec des revendications variées qui sont en pointe de la contestation algérienne aujourd’hui. C’est une preuve s’il en fallait que la population d’origine kabyle n’est plus ce qu’elle était socialement et sociologiquement, de moins en moins populaire sans doute et comportant un grand nombre de professions dont celles dites libérales qui sont une composante de la bourgeoisie. Diversification, « gentrification » sont des phénomènes très présents à Ménilmontant comme dans d’autres quartiers qui furent populaires. Les Kabyles qui y restent nombreux, mais les chibanis ne sont plus que des traces d’un passé qui tombera bientôt dans l’oubli. Les Français d’époque coloniale ont vanté la capacité d’adaptation des Kabyles, qu’ils jugeaient supérieure à celle des Arabes. Actuellement l’adaptation à la société française ne fait plus problème, et si problème il y a, ce serait plutôt celui de la place des Kabyles dans la société algérienne : malgré tout ce qui s’est passé depuis l’indépendance (dont la récente officialisation du tamazight), beaucoup d’entre eux jugent que cette place est encore minorisée de manière inacceptable.
Arezki Metref mélange des informations de ce type, assez générales, avec des entretiens actuels et localisés sur le bastion kabyle de Ménilmontant. On apprend à le lire que le hirak y est présent avec des revendications variées qui sont en pointe de la contestation algérienne aujourd’hui. C’est une preuve s’il en fallait que la population d’origine kabyle n’est plus ce qu’elle était socialement et sociologiquement, de moins en moins populaire sans doute et comportant un grand nombre de professions dont celles dites libérales qui sont une composante de la bourgeoisie. Diversification, « gentrification » sont des phénomènes très présents à Ménilmontant comme dans d’autres quartiers qui furent populaires. Les Kabyles qui y restent nombreux, mais les chibanis ne sont plus que des traces d’un passé qui tombera bientôt dans l’oubli. Les Français d’époque coloniale ont vanté la capacité d’adaptation des Kabyles, qu’ils jugeaient supérieure à celle des Arabes. Actuellement l’adaptation à la société française ne fait plus problème, et si problème il y a, ce serait plutôt celui de la place des Kabyles dans la société algérienne : malgré tout ce qui s’est passé depuis l’indépendance (dont la récente officialisation du tamazight), beaucoup d’entre eux jugent que cette place est encore minorisée de manière inacceptable.
Denise Brahimi
« KRIMO MON FRERE » de Mabrouk Rachedi (Edition L’Ecole des loisirs 2019)
Après plusieurs romans qui ont connu un certain succès, Mabrouk Rachedi oriente depuis quelques années son activité littéraire vers le public adolescent. Il n’est pas besoin d’insister sur l’importance de ce genre littéraire : nous avons tous fait nos premiers pas de lecteurs ou de lectrices en nous régalant d’aventures de héros auxquels nous pouvions nous identifier, et qui restent en nous bien des années après. Il semble particulièrement  important que dans ce genre littéraires figurent des livres donnant vie à des personnages pour qui l’origine étrangère de leurs parents ou grands parents peut amener à connaître des problèmes particuliers. Nous l’avions perçu dans un précédent livre de l’auteur, « Toutes les couleurs de mon drapeau », commenté dans cette lettre.
important que dans ce genre littéraires figurent des livres donnant vie à des personnages pour qui l’origine étrangère de leurs parents ou grands parents peut amener à connaître des problèmes particuliers. Nous l’avions perçu dans un précédent livre de l’auteur, « Toutes les couleurs de mon drapeau », commenté dans cette lettre.
Le personnage central de ce récit est une toute jeune fille, Lila, qui habite Grigny dans l’Essonne, et qui part au Japon pour tenir une dernière promesse faite à son petit frère Krimo (Abdelkrim), qui vient de décéder des suites d’un accident. Le roman est jalonné de découvertes successives. C’est d’abord le Japon bien sûr, avec les contrastes entre Tokyo et Osaka, et la culture du manga que l’auteur semble bien connaître, qu’il fait découvrir au passage aux « vieux » lecteurs, mais qui n’a pas de secret pour le public auquel s’adresse ce livre. Lila va aussi découvrir progressivement la courte vie de ce petit frère qu’elle pensait perdu dans des histoires de trafics de drogue comme le frère aîné, emprisonné, au travers d’un journal intime progressivement dévoilé. Elle va se laisser apprivoiser à une relation d’amitié amoureuse avec le jeune « bourge » polytechnicien Adel, qui lui fait découvrir un peu de ce Japon étonnant, qu’en retour elle fait sortir du rôle de docile bon élève auquel le voue sa famille. Elle va surtout découvrir en elle-même une audace, une énergie, et dans le même temps une aptitude à l’écoute et à la compréhension de l’autre, ce qui donne à ce livre la valeur d’un roman initiatique, bien en phase avec le contenu éducatif qu’on peut attendre de ce genre littéraire.
Le jugement sévère qu’elle porte sur ses parents d’origine populaire qui blâment leur fils aîné pour ses trafics illégaux, mais qui acceptent son argent, se nuance à la fin du récit quand les souvenirs du petit frère perdu lui rappellent ceux de la petite ascension sociale qu’un patient labeur a permis à ses parents.
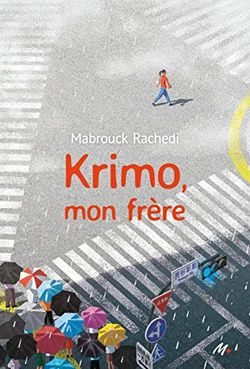 L’air de rien ce sont différents aspects de la vie de familles immigrées implantées dans une cité populaire que nous découvrons, la place qu’y prennent les trafics avec tous les drames qui en découlent, l’incompréhension qui s’installe entre les générations… Il y a même le flic au grand cœur qui s’investit dans la réussite de certains jeunes par la course de fond ou la réhabilitation de ceux qui on chuté.
L’air de rien ce sont différents aspects de la vie de familles immigrées implantées dans une cité populaire que nous découvrons, la place qu’y prennent les trafics avec tous les drames qui en découlent, l’incompréhension qui s’installe entre les générations… Il y a même le flic au grand cœur qui s’investit dans la réussite de certains jeunes par la course de fond ou la réhabilitation de ceux qui on chuté.
Plusieurs personnages attachants traversent cette histoire qui se déroule habilement entre un suspense bien tenu et un dévoilement progressif, des notations sociologiques éclairantes et des alternances de flashback permises par la lecture progressive du journal de Krimo. Le fait qu’une partie importante se passe au Japon que l’auteur fait découvrir au passage à ses lectrices et lecteurs est un ferment original pour une histoire de banlieusards. Il y a beaucoup d’habileté dans la manière de Mabrouck Rachedi de « ficeler » son récit, et le lecteur prend plaisir à se faire ainsi balader.
Il faut souhaiter que les jeunes seront nombreux à faire le voyage pour le marathon d’Osaka. Ils ne devraient pas le regretter.
Michel Wilson

« LES FEMMES DU PAVILLON J », film marocain de Mohamed Nadif, Les films des Deux Rives, Montpellier.
 Le réalisateur de ce film n’est pas encore des plus connus dans le monde du cinéma bien qu’il en ait déjà une pratique qui permet à ce film d’être bien conduit et bien maîtrisé. Ce pourrait être un film documentaire—genre actuellement très en vigueur dans les cinémas maghrébins— du fait qu’il se passe entièrement dans un hôpital psychiatrique dont on voit la vie quotidienne et le fonctionnement. Le pavillon J dont il est question dans le titre fait partie de cette institution, réservée à des patientes adultes encadrées par des femmes soignantes. Seul le médecin qui se trouve à la tête de ce pavillon appartient au genre masculin et par chance le film ne cède pas à la tentation féministe actuelle d’en faire une dénonciation caricaturale. Le réalisateur consacre son attention et la nôtre à quatre de ces femmes, constituant comme on dit un panel de cas bien distincts, échantillon représentatif sur lequel l’enquête psychiatrique va porter. Le choix de la fiction de préférence au documentaire a sans doute permis de mettre en place ce dispositif plus facilement et de rendre les situations parfaitement claires : les cas qui nous sont présentés sont presque des cas d’école, les patientes elles-mêmes expliquent à plusieurs reprises les raisons de leur pathologie et de leur internement, tout se passe comme s’il était plus facile d’être pédagogique à partir d’une certaine mise en forme relevant de la fiction qu’en s’immergeant dans la diversité et la complexité du monde réel comme le ferait un documentaire.
Le réalisateur de ce film n’est pas encore des plus connus dans le monde du cinéma bien qu’il en ait déjà une pratique qui permet à ce film d’être bien conduit et bien maîtrisé. Ce pourrait être un film documentaire—genre actuellement très en vigueur dans les cinémas maghrébins— du fait qu’il se passe entièrement dans un hôpital psychiatrique dont on voit la vie quotidienne et le fonctionnement. Le pavillon J dont il est question dans le titre fait partie de cette institution, réservée à des patientes adultes encadrées par des femmes soignantes. Seul le médecin qui se trouve à la tête de ce pavillon appartient au genre masculin et par chance le film ne cède pas à la tentation féministe actuelle d’en faire une dénonciation caricaturale. Le réalisateur consacre son attention et la nôtre à quatre de ces femmes, constituant comme on dit un panel de cas bien distincts, échantillon représentatif sur lequel l’enquête psychiatrique va porter. Le choix de la fiction de préférence au documentaire a sans doute permis de mettre en place ce dispositif plus facilement et de rendre les situations parfaitement claires : les cas qui nous sont présentés sont presque des cas d’école, les patientes elles-mêmes expliquent à plusieurs reprises les raisons de leur pathologie et de leur internement, tout se passe comme s’il était plus facile d’être pédagogique à partir d’une certaine mise en forme relevant de la fiction qu’en s’immergeant dans la diversité et la complexité du monde réel comme le ferait un documentaire.
 Une autre différence entre ce film et ceux qu’on voit beaucoup depuis quelques années dans le cinéma maghrébin est qu’on ne se trouve pas confronté ici avec la misère des plus pauvres, les abandonnés rejetés dans les marges du monde social, ces Olvidados ou Oubliés comme disait l’Espagnol Luis Bunuel dont le Marocain Nabil Ayouch a suivi les traces à cet égard. Les femmes qu’on voit dans le Pavillon J appartiennent sans doute à différentes sortes de moyenne bourgeoisie, parfois même à une classe plus aisée. De cette manière, le réalisateur a voulu semble-t-il éviter que leurs problèmes soient immédiatement explicables par la misère et par la difficulté de survivre si évidente pour les femmes les plus pauvres. Autres sont les problèmes féminins dont il voulait parler, sociétaux plutôt que sociaux. Le peu qu’on voit de la ville aux environs de l’hôpital psychiatrique a l’air relativement prospère, les voitures abondent et révèlent un niveau aisé ; les patientes qu’on voit vivre ne manquent pas d’argent (de poche), elles-mêmes et les familles qui viennent les voir sont plutôt bien habillées.
Une autre différence entre ce film et ceux qu’on voit beaucoup depuis quelques années dans le cinéma maghrébin est qu’on ne se trouve pas confronté ici avec la misère des plus pauvres, les abandonnés rejetés dans les marges du monde social, ces Olvidados ou Oubliés comme disait l’Espagnol Luis Bunuel dont le Marocain Nabil Ayouch a suivi les traces à cet égard. Les femmes qu’on voit dans le Pavillon J appartiennent sans doute à différentes sortes de moyenne bourgeoisie, parfois même à une classe plus aisée. De cette manière, le réalisateur a voulu semble-t-il éviter que leurs problèmes soient immédiatement explicables par la misère et par la difficulté de survivre si évidente pour les femmes les plus pauvres. Autres sont les problèmes féminins dont il voulait parler, sociétaux plutôt que sociaux. Le peu qu’on voit de la ville aux environs de l’hôpital psychiatrique a l’air relativement prospère, les voitures abondent et révèlent un niveau aisé ; les patientes qu’on voit vivre ne manquent pas d’argent (de poche), elles-mêmes et les familles qui viennent les voir sont plutôt bien habillées.
Quels sont donc les problèmes auxquels le réalisateur a préféré se consacrer ? Ils sont plus ou moins typiquement marocains, certains très peu et d’autres davantage. Parmi les premiers, on trouve ceux que les psychanalystes occidentaux, français par exemple, sont fréquemment amenés à soigner. Dans le film de Mohamed Nadif, on voit une femme d’âge moyen, Amal, ravagée par le douleur d’un deuil qu’elle n’arrive pas à faire après la mort tout à fait accidentelle de son bébé , dont elle se sent pourtant responsable et coupable. Le résultat en est qu’elle ne cesse de recourir au suicide, ce qu’elle ne peut manquer de se reprocher également. C’est une sorte de cycle infernal et sans fin, qui nous la donne à voir comme une femme torturée par la souffrance.
 S’agissant d’une jeune patiente appelée Rym et âgée de 18ans, âme révoltée dans un corps de garçonnet, on aurait pu être tenté, il y a quelque temps, de voir en elle la victime de mœurs trop répandues au Maroc et peut-être un peu plus qu’ailleurs. Mais il se trouve qu’un flux d’événements récents a révélé à quel point ces mœurs sont tout aussi répandues en France et sans doute dans bien d’autres pays : on aura compris qu’il s’agit de l’inceste, dans le film celui d’un père qui le pratique sur ses filles ; Rym qui n’y a pas échappé veut tout faire pour que sa petite sœur soit épargnée et n’en devienne pas à son tour la victime ; mais le premier obstacle vient de la mère, dont l’obsession principale est de maintenir la famille en son état traditionnel, c’est-à-dire soumise inconditionnellement à la toute-puissance du patriarcat. Le combat de Rym, heureusement, sera finalement victorieux, grâce à l’aide de ses amies devenues ses complices. Sans être tout à fait un « feel good movie » (film plein de bons sentiments, qui aide à se sentir bien), Les femmes du pavillon J racontent des histoires de drames sauvés par la solidarité féminine et le courage des femmes.
S’agissant d’une jeune patiente appelée Rym et âgée de 18ans, âme révoltée dans un corps de garçonnet, on aurait pu être tenté, il y a quelque temps, de voir en elle la victime de mœurs trop répandues au Maroc et peut-être un peu plus qu’ailleurs. Mais il se trouve qu’un flux d’événements récents a révélé à quel point ces mœurs sont tout aussi répandues en France et sans doute dans bien d’autres pays : on aura compris qu’il s’agit de l’inceste, dans le film celui d’un père qui le pratique sur ses filles ; Rym qui n’y a pas échappé veut tout faire pour que sa petite sœur soit épargnée et n’en devienne pas à son tour la victime ; mais le premier obstacle vient de la mère, dont l’obsession principale est de maintenir la famille en son état traditionnel, c’est-à-dire soumise inconditionnellement à la toute-puissance du patriarcat. Le combat de Rym, heureusement, sera finalement victorieux, grâce à l’aide de ses amies devenues ses complices. Sans être tout à fait un « feel good movie » (film plein de bons sentiments, qui aide à se sentir bien), Les femmes du pavillon J racontent des histoires de drames sauvés par la solidarité féminine et le courage des femmes.
Une autre des patientes de ce pavillon s’est trouvée prise dans un imbroglio ou piège matrimonial dont les éléments appartiennent à la société marocaine, mais qui sous des variantes diverses peuvent exister aussi bien ailleurs : il s’agit d’arrangements et d’échanges entre familles, où dans le but d’y trouver des avantages financiers, on sacrifie le bonheur et l’épanouissement d’une belle jeune femme, brisée lorsqu’elle découvre qu’on lui a fait épouser un homosexuel.
Les femmes du pavillon ne peuvent espérer se dégager de ce qui pèse sur elles qu’au prix de tentatives longues et difficiles, dont le film prouve avec un certain optimisme qu’elles peuvent finalement aboutir, que ce n’est en tout cas pas exclu. On comprend aussi par là pourquoi le film se devait d’être une fiction, plus facile que la réalité à conduire vers un heureux dénouement. Certains bons passages du film montrent des échappées temporaires, grâce auxquelles les patientes enfermées dans leurs traumatismes et dans la clôture de l’hôpital essaient de se donner un peu d’air. Ces brèves aventures se présentent sous un jour ambigu, elles comportent vraiment des moments de bonheur, mais on peut dire aussi qu’elles finissent mal et ne résolvent rien. Elles ont sans doute une vertu d’apprentissage et donnent aux femmes elles-mêmes la preuve qu’elles ne sont pas enlisées dans le désespoir.
Du film tout entier, on peut dire en effet qu’il n’est pas fondamentalement désespéré, mais qu’à certains moments, il semble pourtant bien près de l’être. La position du réalisateur était délicate à trouver, il s’en est sorti et son film est bon.
Denise Brahimi

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.
Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris, chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002.

- Le 31 mars, nous vous proposons en partenariat avec l’association Defkalyon une rencontre avec Camus en Grèce sous forme d’une Conférence débat animée par Virginie Lupo,
La recrudescence de la pandémie a une fois de plus mis à mal nos projets qui étaient nombreux en cette fin d’année. Nous les reporterons pour l’essentiel à des temps où la rencontre sera possible sans en craindre des conséquences sanitaires. D’autres beaux projets sont à l’étude, notamment grâce aux moyens du « à distance ».
Patience! Et prenez soin de vous.
Et cette information lyonnaise concernant nos ami.e.s de Grand Ensemble:
Dans la Newsletter de la Ville de Lyon du 19 mars 2021, on a pu lire l’annonce d’un prix qui n’est pas sans rapport avec les activités de Coup de soleil :
Prix « Coup de cœur du jury », doté de 1 000 €
Une guerre,récits d’une rive à l’autre
Par l’association Grand ensemble – atelier de cinéma populaire
Mise en ligne en 2016, cette plate-forme numérique est le fruit d’une longue démarche empirique pour explorer les mémoires
Ne vous privez pas en cette période de repli, de lire tous les beaux livres que nous commentons pour vous.
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

