Lettre culturelle franco-maghrébine #65
Édito
L’abondance des événements et des publications liés à l’anniversaire des accords d’Evian ne doit pas nous faire oublier qu’il existe aussi une vie quotidienne, plus modeste, mais dont pourtant le acteurs éprouvent un grand besoin de parler et de témoigner. Ce qui prend souvent la forme de romans, tant il est vrai que ce genre littéraire est vaste, souple et très inclusif. Le roman peut être inspiré par l‘autobiographie, ce qui est le cas de celui de Fawzia Zouari, « Par le fil je t’ai cousue » ; ou bien il prend la forme d’une fresque plus vaste, portant sur plusieurs individus et générations comme dans « Soleil amer » de Lilia Hassaïne. Il peut aussi, à partir d’un cas particulier, affirmer une tendance ethnographique, comme le fait « La Nuit de l’Amazone » de Bernard Zimmermann, ou une ambition historique comme on trouve dans le livre-enquête auquel a participé Tramor Quemeneur, «Mourir à Sakiet ».
Par ailleurs, nous continuerons à suivre le témoignage très personnel, littéraire et souvent poétique du Marocain AbdallahTaïa dans « Vivre à ta lumière ».
Enfin nous attirons avec force l’attention sur un film, «De nos frères blessés » par Hélier Cisterne, d’après le livre de Joseph Andras (2016) dont nous avons déjà parlé : L’acteur Vincent Lacoste y joue excellemment le rôle de Fernand Yveton, accusé de terrorisme et guillotiné par l’Etat colonial au début de la Guerre d’Algérie.
Denise Brahimi

« PAR LE FIL JE T’AI COUSUE » par Fawzia Zouari, éditions Plon, 2022

L’auteure, franco-tunisienne, est déjà connue pour quelques autres livres et pour ses activités en France, que ce soit à l’institut du Monde arabe ou au journal Jeune Afrique. Ce qu’elle nous donne à lire ici est un livre de souvenirs qui remontent à sa petite enfance et à sa première adolescence même si, comme il arrive souvent, un peu de fiction vient encadrer l’autobiographie. Le cadre géographico-historique permet de situer ces évocations de manière précise : toute l’action se passe dans le village où l’auteure est née, près du Kef à l’ouest de la Tunisie, c’est-à-dire fort loin de Tunis, et elle se présente à nous comme une petite villageoise coupée des réalités ; c’est d’ailleurs le thème dominant de tout le livre, elle s’effraie de constater qu’elle n’a rien su de ce qu’est le monde sans doute jusqu’à ce qu’elle quitte la Tunisie pour venir à Paris. Toute la première partie de sa vie a été enfermée dans une sorte d’enclave d’un archaïsme total, marquée par le refus de savoir et de connaître et surtout par la peur qui en est l’origine—peur qui sans doute caractérise principalement sa mère mais que celle-ci impose à ses enfants avec une intransigeance et une dureté inouïe. Et l’on peut ajouter d’emblée que cette peur inhérente à la mère, entraînant une totale fermeture au monde, concerne obsessionnellement toute intrusion de la sexualité dans la vie de ses filles, principalement les deux aînées, l’auteure du livre ayant droit, à partir du moment où elle a une dizaine d’années, à un statut particulier grâce à son père, un homme libéral et bon. L’enjeu ou en tout cas la forme que prennent la peur et l’enfermement porte sur le rapport à l’école : Bourguiba, premier président de la Tunisie indépendante (1956) a rendu l’école primaire obligatoire pour les filles comme pour les garçons, mais dans la famille Zouari les premières sont empêchées de poursuivre toute scolarité au-delà de ce premier stade, malgré les efforts d’une institutrice consciente des dons remarquables qui caractérisent au moins l’une des deux sœurs aînées. Elles végéteront dans l’inaction et dans l’attente d’un mariage évidemment imposé, contrariant en tout point leur désir d’amour et de sexualité, cette dernière étant forcément exacerbée par le refoulement qu’elle subit. Refoulement, le mot est faible, c’est un acharnement à la détruire et à faire disparaître la moindre de ses manifestations, sauf dans le cadre strictement étroit d’un mariage conforme aux normes que la mère une fois pour toute a décrétées. Dès la petite enfance c’est-à-dire dès le moment où la fillette qui raconte son histoire atteint l’âge de cinq ans, il faut exorciser le risque du surgissement de cette sexualité maléfique et pire que dangereuse par un rituel comme celui auquel le titre du livre fait allusion ; l’auteure commence par là et y revient encore plus tard, sans doute est-elle fascinée par cette magie qui caractérise la mentalité de sa mère et c’est d’ailleurs tout au long du livre un des aspects de son sentiment à l’égard de celle-ci. L’absence de révolte, même si son efficacité ne pouvait qu’être limitée ou nulle, est un point sur lequel on s’interroge, il amène à penser qu’un autre aspect de ce sentiment l’emporte auprès de la jeune enfant, qui est une immense frustration devant le constat déchirant que sa mère n’a pour elle aucune affection : l’absence totale de tendresse de la part de la mère entraîne une sorte de paralysie de la fille privée de toute réaction personnelle faute d’un terreau qui lui permettrait d’exister.

CC BY-SA 3.0 Emna Mizouni
On voit bien que Fawzia Zouari s’interroge beaucoup sur cet état dans lequel elle a vécu pendant une dizaine d’années, et il faudra encore bien plus longtemps semble-t-il pour qu’elle se délivre elle-même. Elle le sait si bien qu’elle est la première à souligner la vanité de son engagement lorsqu’elle commence à écrire le présent livre : elle voudrait, dit-elle, tâcher d’en exclure la figure maternelle du moins sous sa forme écrasante (d’autant qu’elle lui a déjà consacré un livre) mais de toute évidence elle n’y parvient pas. C’est donc plutôt aux séquelles de cet effrayant écrasement qu’elle continue à s’attacher, et peut-être de plus en plus. Et cela commence par une exploration de sa vie actuelle de mère et de femme mariée, non sans une remarquable ambiguïté. Car si une bonne partie de ses comportements maternels est commandée par la volonté d’exorciser le passé c’est-à-dire de prendre le contrepied de ce qu’elle a elle-même vécu, elle explique aussi à quel point sa mentalité est encore marquée par l’éducation qu’elle a reçue (on hésite un peu devant le mot « éducation » lorsqu’il ne s’agit que d’interdits) et que peut-être elle n’arrive pas à regretter complétement. Il est évident que pour tout ce qui se passe à un niveau profond du psychisme on ne peut établir un bilan clair séparant le négatif et le positif au sein de cette nébuleuse encore obscure et comme frappée d’irréalité que représente le monde de l’enfance. Il est pourtant manifeste qu’on ne fera pas dire à l’auteure des mots condamnant définitivement ce que fut la sienne. Enchantement et maléfice, son imaginaire a été trop nourri de contes traditionnels pour qu’elle puisse séparer ces deux aspects complémentaires ; et sans doute est-elle bien consciente de la difficulté qu’il y a pour elle à faire passer dans son livre cette double imprégnation mais on a envie de dire qu’elle ne renie rien et ce livre en est la preuve. A côté de moments presqu’insoutenables par l’évocation de la violence que la mère exerce— à quoi il faut ajouter celle du harcèlement sexuel subi de la part des hommes, à commencer ceux de la famille— on trouve aussi dans ces souvenirs des moments d’une grande poésie et la volonté de les restituer par la qualité du style. Le ton du livre n’est pas celui de la revendication mais plutôt celui plus intime d’une recherche personnelle qui est sans doute destinée à se poursuivre comme un cheminement et non à s’épuiser dans le cri d’une dénonciation univoque.
Denise Brahimi
« SOLEIL AMER » par Lilia Hassaine, éditions Gallimard, 2021
L’auteure, qui a déjà écrit un autre livre avant celui-là, est principalement une journaliste qui avant même d’avoir trente ans a déjà commencé une belle carrière dans les médias. Le succès lui sourit, elle a également été mannequin pour le couturier Jean-Paul Gaultier, ce qui laisse à penser qu’elle s’est peut-être inspirée d’elle-même pour le personnage de Nour, belle jeune fille indépendante voire révoltée qui quitte sa famille pour vivre librement sa vie dès qu’elle atteint sa majorité. Mais en dehors de cela, le livre ne semble pas d’inspiration autobiographique, à la différence d’un grand nombre de récits qu’on peut lire aujourd’hui et qui racontent souvent à la première personne l’enfance et l’adolescence de leur auteur(e) dans une famille franco-maghrébine immigrée en France après la deuxième guerre mondiale.

Librarie Mollat, CC BY 3.0
L’histoire évoquée par Lilia Hassaine s’étend sur plusieurs décennies et se passe entièrement dans la banlieue parisienne, si ce n’est un prologue et un épilogue fort courts précisément situés dans les Aurès en Algérie sur le site romain de Djemila, et qui enferment tout le livre entre deux dates, 1959 et 1997. En fait l’histoire s’achève vers la fin des années 80 quand l’un des principaux personnages meurt du sida et lorsque tous ceux et celles qu’on a connu(e)s enfants sont devenu(e)s adultes.
C’est dire que le roman préfère la longue durée à des gros plans sur une période restreinte. Cette deuxième manière donne souvent lieu à une écriture naturaliste, aux effets très soulignés. Dans la manière d’écrire de Lilia Hassaine, on remarque plutôt une certaine volonté de glisser à travers le temps, en suivant le cours d’allusions qui à un moment donné du livre deviennent claires alors qu’on ne s’y était pas attardé auparavant. La romancière fait défiler ses personnages sous une forme de silhouettes ou d’esquisses et l’on pourrait plutôt parler d’un tableau d’ensemble sans qu’aucun des principaux personnages, une dizaine environ, ne soit privilégié. Il s’agit d’une famille, deux couples de parents et les cinq enfants de l’un d’entre eux (mais le souvenir de ceux qui sont morts joue aussi un rôle par la place qu’il tient dans la mémoire des vivants). L’auteure semble surtout intéressée par la grande diversité qui les caractérise, hommes ou femmes, garçons ou filles, sur deux générations. En ce sens, on ne saurait dire que le livre s’appuie sur une sociologie ni sur la volonté d’organiser peu ou prou un ensemble de constats faits dans le milieu de l’immigration algérienne en France pendant les années 70 et 80 du siècle dernier. Assurément on reconnaîtra au passage ce que de nombreux livres nous ont déjà dit à ce propos, qu’il s’agisse d’essais, de documents ou de fictions. Mais la romancière n’en est sans doute pas encore à l’âge où le recul historique permet d’établir des bilans.
Il est vrai que dans les faits qu’elle montre clairement, il y a une évolution historique, par exemple dans les conditions de vie matérielle et dans les formes d’habitat. Mais on ne saurait dire que pour la deuxième génération, les choses se passent forcément mieux que pour la première. A l’époque où les hommes venaient pour travailler ils étaient certes vite usés par la dureté de conditions de vie et précocement vieillis, mais certains de leurs enfants connaissent le chômage, la tentation de la drogue et un sentiment d’échec, avec pour fond commun aux deux périodes le racisme ambiant de la part de ce qu’on ne saurait appeler sans scepticisme et dérision la société d’accueil.
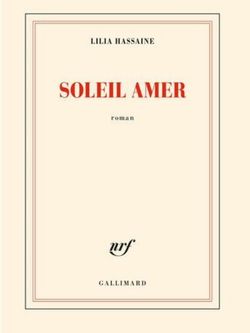 Cependant l’objet de la romancière n’est pas une analyse détaillée de ce qui est ou pourrait donner lieu (comme c’est le cas chez nombre d’autres écrivains) à une sociologie de l’immigration. La diversité de cas individuels et parfois leurs violents contrastes, semblent l’ intéresser davantage. Ce qui lui permet d’éviter certains clichés ou en tout cas des descriptions généralisantes. On voit par exemple un père ouvrier accepter la très grande liberté d’allure de sa dernière fille, Nour, et se plaire à la traiter comme s’il s’agissait d’un garçon, alors qu’il a brutalisé et brimé sa fille aînée d’une manière odieusement patriarcale. Evolution rapide des mœurs en moins d’une dizaine d’années ou variations imprévisibles et capricieuses chez un même individu dont on ne connaîtra de toute façon que certains aspects, parfois traditionnels parfois plus surprenants ?
Cependant l’objet de la romancière n’est pas une analyse détaillée de ce qui est ou pourrait donner lieu (comme c’est le cas chez nombre d’autres écrivains) à une sociologie de l’immigration. La diversité de cas individuels et parfois leurs violents contrastes, semblent l’ intéresser davantage. Ce qui lui permet d’éviter certains clichés ou en tout cas des descriptions généralisantes. On voit par exemple un père ouvrier accepter la très grande liberté d’allure de sa dernière fille, Nour, et se plaire à la traiter comme s’il s’agissait d’un garçon, alors qu’il a brutalisé et brimé sa fille aînée d’une manière odieusement patriarcale. Evolution rapide des mœurs en moins d’une dizaine d’années ou variations imprévisibles et capricieuses chez un même individu dont on ne connaîtra de toute façon que certains aspects, parfois traditionnels parfois plus surprenants ?
Finalement on pourrait dire de « Soleil amer » qu’il n’est pas si loin de la définition classique du roman, comme genre littéraire qui intègre le général et le particulier, l’évocation des cas individuels et la restitution du mouvement collectif entraînant les époques à travers le temps. Tout cela ne saurait être développé dans le très court livre de Lilia Hassaine, mais on devine une partie de ce qui pourrait l’être et s’y trouve esquissé.
Denise Brahimi
 Si l’on voulait absolument ranger dans une catégorie le livre qu’il nous propose à partir de cette découverte, on parlerait sans doute d’une monographie inspirée et élargie par la fréquentation des sciences humaines : on croit au départ que Magdalena va lui fournir une étude de cas pour un travail de type ethnographique ; en fait c’est plutôt de géographie humaine qu’il est soucieux car c’est là son domaine de recherche au sens universitaire, mais c’est aussi et forcément d’histoire qu’il s’agit, s’agissant d’une vieille dame qu’il interroge alors qu’elle a déjà 80 ans, quelques années avant sa mort. Née en 1893, elle plonge encore dans le 19e siècle, et le premier (en date) des documents sur lesquels s’appuie ce petit-fils chercheur est une photo de son mariage en 1910, alors qu’elle avait 17 ans, avec l’ouvrier agricole Francisco, pauvre comme elle et tous les siens.
Si l’on voulait absolument ranger dans une catégorie le livre qu’il nous propose à partir de cette découverte, on parlerait sans doute d’une monographie inspirée et élargie par la fréquentation des sciences humaines : on croit au départ que Magdalena va lui fournir une étude de cas pour un travail de type ethnographique ; en fait c’est plutôt de géographie humaine qu’il est soucieux car c’est là son domaine de recherche au sens universitaire, mais c’est aussi et forcément d’histoire qu’il s’agit, s’agissant d’une vieille dame qu’il interroge alors qu’elle a déjà 80 ans, quelques années avant sa mort. Née en 1893, elle plonge encore dans le 19e siècle, et le premier (en date) des documents sur lesquels s’appuie ce petit-fils chercheur est une photo de son mariage en 1910, alors qu’elle avait 17 ans, avec l’ouvrier agricole Francisco, pauvre comme elle et tous les siens. Parmi les raisons qui expliquent la considération de l’auteur pour Magdalena et autres qui ont connu plus ou moins le même destin, il y a l’absence totale de pleurnicherie : aucun attendrissement sur eux-mêmes chez ces pauvres voués à l’exil, et qui n’en restaient pas moins pauvres leur vie durant. Et ce alors même que Magdalena, pour s’en tenir à son exemple, était extrêmement consciente de l’inégalité sociale (tellement énorme qu’il faudrait un mot plus violent pour le dire) séparant radicalement pauvres et riches et ne laissant aux premiers aucune illusion, aucune lueur d’espoir d’un possible changement. Cette dureté qui s’exerce avant tout à l’égard de soi-même est évidemment impressionnante, incitant Bernard Zimmermann à réfléchir sur des attitudes dont il finit par comprendre qu’elles sont la plus frappante définition de la singularité de Magdalena—et en même temps que de Magdalena celle des autres femmes issues de cette même région des Alpujarras, qui assurément mérite bien une monographie.
Parmi les raisons qui expliquent la considération de l’auteur pour Magdalena et autres qui ont connu plus ou moins le même destin, il y a l’absence totale de pleurnicherie : aucun attendrissement sur eux-mêmes chez ces pauvres voués à l’exil, et qui n’en restaient pas moins pauvres leur vie durant. Et ce alors même que Magdalena, pour s’en tenir à son exemple, était extrêmement consciente de l’inégalité sociale (tellement énorme qu’il faudrait un mot plus violent pour le dire) séparant radicalement pauvres et riches et ne laissant aux premiers aucune illusion, aucune lueur d’espoir d’un possible changement. Cette dureté qui s’exerce avant tout à l’égard de soi-même est évidemment impressionnante, incitant Bernard Zimmermann à réfléchir sur des attitudes dont il finit par comprendre qu’elles sont la plus frappante définition de la singularité de Magdalena—et en même temps que de Magdalena celle des autres femmes issues de cette même région des Alpujarras, qui assurément mérite bien une monographie.« MOURIR À SAKIET, ENQUÊTE SUR UN APPELÉ DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE » par Véronique Gazeau-Goddet et Tramor Quemeneur, PUF, 2022
Ce livre est une bonne illustration du type de travail que font certains historiens actuels soucieux de diversifier le matériau sur lequel ils s’appuient, qu’il leur faut d’abord trouver et élaborer avant d’établir un certain nombre de faits et d’en tirer d’éventuelles conclusions. Le travail qui nous est donné à lire par ses deux auteurs est en effet une enquête, dans un milieu très difficile puisqu’il s’agit d’opérations militaires qu’on préférait peut-être, sans doute, garder partiellement secrètes pendant la guerre d’Algérie. Le fait principal dont il est question ici date du 11 janvier 1958 : ce jour-là mourut dans une embuscade un aspirant de l’armée française, Bernard Goddet, dont on aura remarqué que le nom est aussi celui d’une autrice du livre, qui en effet lui est apparentée. Mais ils furent au moins quatorze soldats français à mourir ce jour-là, parfois affreusement mutilés, tandis que quatre autres étaient faits prisonniers et gardés en otages.
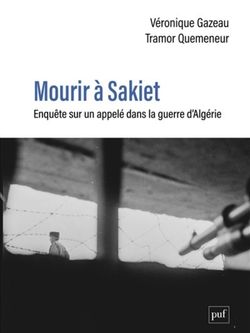 Bernard Goddet fait partie de ceux qu’on désigne comme les appelés de la Guerre d’Algérie, jeunes gens du contingent à une époque où le service militaire était encore obligatoire, ayant reçu dès leur incorporation à l’armée, à partir de 1954, une formation spéciale pour faire ce qu’on attendait d’eux. Il s’agissait d’aller se battre en Algérie contre ceux qu’on appelait les fellaghas ou combattants pour la cause de l’indépendance, et contre l’ALN ou armée de Libération nationale qui était la branche militaire du FLN.
Bernard Goddet fait partie de ceux qu’on désigne comme les appelés de la Guerre d’Algérie, jeunes gens du contingent à une époque où le service militaire était encore obligatoire, ayant reçu dès leur incorporation à l’armée, à partir de 1954, une formation spéciale pour faire ce qu’on attendait d’eux. Il s’agissait d’aller se battre en Algérie contre ceux qu’on appelait les fellaghas ou combattants pour la cause de l’indépendance, et contre l’ALN ou armée de Libération nationale qui était la branche militaire du FLN.
Le grand avantage du livre « Mourir à Sakiet » est qu’il s’appuie sur un exemple précis de ces appelés et le suis de très près depuis le début de sa formation par l’armée française jusqu’à sa mort ou même au-delà si l’on peut dire, puisque il a fallu, comme dit le titre, une véritable enquête pour tirer au clair les circonstances de sa mort. Elles posent encore quelques questions aujourd’hui et n’ont pas été complétement élucidées même par les deux auteurs du livre. Ils sont pourtant les mieux placés pour tenter de comprendre, l’une faisant partie de la famille de Bernard Goddet, qui a fait en sorte que ses proches puissent le suivre de près pendant son passage dans l’armée , tandis que l’autre des deux auteurs, Tramor Quemeneur, est connu comme historien spécialiste du comportement des soldats français pendant la Guerre d’Algérie, notamment pour tout ce qui concerne leurs actes d’ «insoumissions, refus d’obéissance et désertions », selon les termes qu’il a donnés pour titre à son travail universitaire sur la question (sous la direction de Benjamin Stora).
Avant donc d’en arriver à l’événement violent qu’est la mort brutale de Bernard Goddet à Sakiet, au nord de la frontière entre Algérie et Tunisie, le jeune homme nous est longuement présenté et principalement par l’intermédiaire de cette excellente source qu’est l’ensemble des lettres écrites à sa famille à partir de novembre 1956, jusqu’à la dernière qui est du 9 janvier 1958. Ces lettres, en apparence, ne contiennent rien de très remarquable, elles ne sont pas le fait d’un écrivain en puissance (pour autant qu’on puisse le dire) ni d’un intellectuel ou politologue, Bernard Goddet souligne volontiers lui-même la médiocrité de ses études, et dans la mesure où la plupart des lettres sont adressées à sa  mère et à sa grand-mère, elles concernent le plus souvent des faits modestes et intimes, excluant tout discours d’idées. Cependant il s’agit d’un garçon manifestement intelligent et cultivé, qui a l’esprit critique et réfléchit à ce qu’il voit. Il apparaît d’ailleurs que pour des raisons en partie familiales, il n’est pas prêt à suivre sans broncher les décisions que prend le gouvernement et qu’il est plus souvent dans une forme d’opposition assez marquée, qui n’est pourtant pas celle des anticolonialistes de gauche ou d’extrême gauche, comme il y en a un certain nombre au même moment dans l’armée. On trouve dans ses lettres des avis assez sévères sur la mauvaise qualité de la formation que reçoivent des gens comme lui, EOR (Elèves officiers de réserve ou destinés à l’être) alors que la plupart ne connaissent absolument rien à l’Algérie à aucun égard et que leur ignorance en tout domaine ne peut que s’avérer néfaste. D’ailleurs il semble bien que dans le malheureux accident du 11 janvier 1958, l’insuffisance d’information a été fatale au groupe de soldats français dont le chef n’a pas mesuré les risques qu’il prenait et leur faisait prendre, méconnaissant notamment la grande supériorité en nombre et en armements des HLL ou hors -la-loi qu’il croyait prendre en embuscade alors que c’est lui, semble-t-il qui fut victime de celle qu’on lui tendait. Bernard Goddet est d’ailleurs plus que réservé à d’autres égards, supportant très mal, comme beaucoup d’autres, l’usage de la torture que nul ne pouvait ignorer sur le champ des opérations. Cependant on ne peut évidemment voir là les causes même indirectes de sa mort : pour le dire très banalement ce qui s’est passé à Sakiet ce jour-là est l’histoire d’une tentative qui a très mal tourné et qui d’ailleurs a été analysée ensuite pour éviter à tout prix son renouvellement. « Mourir à Sakiet » explique fort bien aux lecteurs les difficultés et les dangers rencontrés par l’armée française sur cette frontière franco-tunisienne entre l’Algérie encore territoire français et la Tunisie devenue depuis peu indépendante, certes tenue à la neutralité entre les deux belligérants mais penchant évidemment du côté de l’ALN, y compris en la personne de son président Habib Bourguiba.
mère et à sa grand-mère, elles concernent le plus souvent des faits modestes et intimes, excluant tout discours d’idées. Cependant il s’agit d’un garçon manifestement intelligent et cultivé, qui a l’esprit critique et réfléchit à ce qu’il voit. Il apparaît d’ailleurs que pour des raisons en partie familiales, il n’est pas prêt à suivre sans broncher les décisions que prend le gouvernement et qu’il est plus souvent dans une forme d’opposition assez marquée, qui n’est pourtant pas celle des anticolonialistes de gauche ou d’extrême gauche, comme il y en a un certain nombre au même moment dans l’armée. On trouve dans ses lettres des avis assez sévères sur la mauvaise qualité de la formation que reçoivent des gens comme lui, EOR (Elèves officiers de réserve ou destinés à l’être) alors que la plupart ne connaissent absolument rien à l’Algérie à aucun égard et que leur ignorance en tout domaine ne peut que s’avérer néfaste. D’ailleurs il semble bien que dans le malheureux accident du 11 janvier 1958, l’insuffisance d’information a été fatale au groupe de soldats français dont le chef n’a pas mesuré les risques qu’il prenait et leur faisait prendre, méconnaissant notamment la grande supériorité en nombre et en armements des HLL ou hors -la-loi qu’il croyait prendre en embuscade alors que c’est lui, semble-t-il qui fut victime de celle qu’on lui tendait. Bernard Goddet est d’ailleurs plus que réservé à d’autres égards, supportant très mal, comme beaucoup d’autres, l’usage de la torture que nul ne pouvait ignorer sur le champ des opérations. Cependant on ne peut évidemment voir là les causes même indirectes de sa mort : pour le dire très banalement ce qui s’est passé à Sakiet ce jour-là est l’histoire d’une tentative qui a très mal tourné et qui d’ailleurs a été analysée ensuite pour éviter à tout prix son renouvellement. « Mourir à Sakiet » explique fort bien aux lecteurs les difficultés et les dangers rencontrés par l’armée française sur cette frontière franco-tunisienne entre l’Algérie encore territoire français et la Tunisie devenue depuis peu indépendante, certes tenue à la neutralité entre les deux belligérants mais penchant évidemment du côté de l’ALN, y compris en la personne de son président Habib Bourguiba.
 Le rappel du 11 janvier 1958 est des plus utiles pour comprendre certains aspects d’un autre événement auquel on pense plus souvent lorsque le nom de Sakiet est cité (ou Sakiet-Sidi-Youssef, pour le dire en entier) : il s’agit du bombardement de ce village par l’armée française, moins d’un mois plus tard, le 8 février 1958, causant un nombre de morts beaucoup plus élevé.
Le rappel du 11 janvier 1958 est des plus utiles pour comprendre certains aspects d’un autre événement auquel on pense plus souvent lorsque le nom de Sakiet est cité (ou Sakiet-Sidi-Youssef, pour le dire en entier) : il s’agit du bombardement de ce village par l’armée française, moins d’un mois plus tard, le 8 février 1958, causant un nombre de morts beaucoup plus élevé.
Sur le plan international , il provoqua une réprobation générale à l’égard de la France, et en Algérie même, il joua un rôle important dans ce qui se produisit en Mai 1958. La Guerre d’Algérie devait encore enchaîner catastrophe sur catastrophe quatre ans !
Denise Brahimi
« VIVRE À TA LUMIÈRE » par Abdallah Taïa, roman, éditions du Seuil, 2022
On ne peut avoir aucun doute sur la personne à laquelle l’auteur s’adresse dans son titre puisqu’il dédie le livre à sa mère « M’Barka Allali (1930-2010) » qui s’exprime dit-il par la voix de son héroïne Malika. De plus, en raison d’une idée reçue concernant le rapport des homosexuels à leur mère, on s’imagine que ce supposé roman sera en fait un hommage du fils à sa mère, objet d’un immense amour et unique personnage de femme qui puisse trouver place dans sa vie, aux dépens de toute autre qui tenterait d’y tenir la place d’épouse. Or ce n’est pas cela que décrit « Vivre à ta lumière », qui est un livre original et n’importe quelle est en lui la part d’autobiographie concernant les faits eux-mêmes, l’important étant les opinions qui s’y expriment de manière complexe, comportant à la fois les valeurs que font apparaître les comportements de Malika et leur critique par d’autres personnages, porte-paroles semble-t-il de l’auteur Abdallah Taïa.
De toute évidence le personnage principal du livre est Malika, vue à trois moments bien distincts de sa vie, qui se situent, dira-t-on pour simplifier, lorsqu’elle a 20, 40 et 60 ans, à quelques années près puisqu’en fait la chronologie que suit le livre s’inspire non d’une vie particulière mais des événements politiques qu’a traversés le Maroc, entre la fin du Protectorat français, la date choisie étant ici celle de 1954, et la mort du Roi Hassan II, 45 ans plus tard, en 1999.
 La première Malika est une jeune fille bientôt une jeune femme et bientôt veuve à l’âge de 20ans, lorsque meurt Allal le mari dont elle a été passionnèment amoureuse. C‘est elle qui l’a voulu et choisi et à ce propos on remarque que dans le roman d’Abdallah Taïa il n’y a pas de mariage forcé, imposé par les mœurs patriarcales et la violence physique au besoin, comme le décrivent de nombreux romans situés en milieu traditionnel maghrébin. Lorsque Malika se remarie faute de pouvoir survivre autrement, ce n’est certes pas un mariage d’amour mais la décision vient d’elle et elle ne s’en plaint jamais, non plus que des nombreux enfants dont elle devient mère, plutôt des filles que des garçons, et c’est d’ailleurs à l’une des six filles, Khadija, qu’elle s’attache particulièrement. En tout cas, lors de ce deuxième épisode, l’accent n’est mis d’aucune façon sur le rapport mère fils, dont on peut même dire qu’il est escamoté. C’est seulement dans le troisième épisode qu’il en sera question, mais plutôt sur un mode négatif si l’on peut dire puisque ici Malika s’entend durement reprocher de n’avoir pas veillé sur son plus jeune fils comme elle l’aurait dû. Jaâfar, le jeune homme (ex-détenu) qui lui parle au nom de son fils, d’une manière d’abord menaçante, lui reproche de n’avoir rien fait pour protéger ce garçon des agressions sexuelles qu’il a subies pendant son enfance et son adolescence et peut-être faut-il comprendre qu’elle est pour cette raison responsable de son homosexualité. Mais c’est encore une ambiguïté du texte que de présenter celle-ci à la fois comme une malédiction (à moins que le mot ne soit trop fort) et comme une bénédiction et une joie, car Jaâfar, parlant pour lui-même à propos de son récent séjour en prison, évoque la manière dont il y a trouvé l’amour, un amour si fort que son seul désir est d’être emprisonné à nouveau pour le retrouver. Il y a peut-être, sans doute, dans ces déclarations enflammées des souvenirs de Jean Genet, dont la présence est restée si forte au Maroc bien au-delà de sa mort. Quoi qu’il en soit, il ressort de toute cette fin de la troisième partie que le seul salut pour le fils était de fuir, en partant en France comme il l’a fait et en rompant tout lien avec sa mère. Malika elle-même le comprend et accepte cette rupture qu’elle sait définitive. Ce n’est pas une des moindres singularités de cette femme, parmi les plus démunies en apparence puisque née pauvre et restée pauvre parmi les pauvres, et portant restée tout au long de sa vie d’une force incroyable, ce qui est le sujet principal dont traite le livre du fils, ici Abdallah Taïa.
La première Malika est une jeune fille bientôt une jeune femme et bientôt veuve à l’âge de 20ans, lorsque meurt Allal le mari dont elle a été passionnèment amoureuse. C‘est elle qui l’a voulu et choisi et à ce propos on remarque que dans le roman d’Abdallah Taïa il n’y a pas de mariage forcé, imposé par les mœurs patriarcales et la violence physique au besoin, comme le décrivent de nombreux romans situés en milieu traditionnel maghrébin. Lorsque Malika se remarie faute de pouvoir survivre autrement, ce n’est certes pas un mariage d’amour mais la décision vient d’elle et elle ne s’en plaint jamais, non plus que des nombreux enfants dont elle devient mère, plutôt des filles que des garçons, et c’est d’ailleurs à l’une des six filles, Khadija, qu’elle s’attache particulièrement. En tout cas, lors de ce deuxième épisode, l’accent n’est mis d’aucune façon sur le rapport mère fils, dont on peut même dire qu’il est escamoté. C’est seulement dans le troisième épisode qu’il en sera question, mais plutôt sur un mode négatif si l’on peut dire puisque ici Malika s’entend durement reprocher de n’avoir pas veillé sur son plus jeune fils comme elle l’aurait dû. Jaâfar, le jeune homme (ex-détenu) qui lui parle au nom de son fils, d’une manière d’abord menaçante, lui reproche de n’avoir rien fait pour protéger ce garçon des agressions sexuelles qu’il a subies pendant son enfance et son adolescence et peut-être faut-il comprendre qu’elle est pour cette raison responsable de son homosexualité. Mais c’est encore une ambiguïté du texte que de présenter celle-ci à la fois comme une malédiction (à moins que le mot ne soit trop fort) et comme une bénédiction et une joie, car Jaâfar, parlant pour lui-même à propos de son récent séjour en prison, évoque la manière dont il y a trouvé l’amour, un amour si fort que son seul désir est d’être emprisonné à nouveau pour le retrouver. Il y a peut-être, sans doute, dans ces déclarations enflammées des souvenirs de Jean Genet, dont la présence est restée si forte au Maroc bien au-delà de sa mort. Quoi qu’il en soit, il ressort de toute cette fin de la troisième partie que le seul salut pour le fils était de fuir, en partant en France comme il l’a fait et en rompant tout lien avec sa mère. Malika elle-même le comprend et accepte cette rupture qu’elle sait définitive. Ce n’est pas une des moindres singularités de cette femme, parmi les plus démunies en apparence puisque née pauvre et restée pauvre parmi les pauvres, et portant restée tout au long de sa vie d’une force incroyable, ce qui est le sujet principal dont traite le livre du fils, ici Abdallah Taïa.
La première partie du livre est de loin la plus lumineuse et la plus émouvante. Non pas seulement parce qu’on y voit Malika en jeune femme amoureuse et bientôt privée par la mort d’Allal qu’elle aimait : il est tué pendant la Guerre d’Indochine où il s’est enrôlé au service de la France qui à cette époque (1954) exerce encore son protectorat sur le Maroc. Mais encore parce que rayonne sur tout ce premier épisode une remarquable innocence, que l’irruption du malheur et du mal viendra détruire finalement. Allal aime Malika et lui apporte beaucoup de tendresse mail il n’aime pas moins son ami Merzougue sans que la force de ce lien homosexuel ne gêne ou ne trouble qui que ce soit ni ne provoque chez Malika la moindre jalousie. Tel serait le bonheur si des raisons venues d’un autre monde (ici la recherche de l’argent) ne venait y mettre fin.
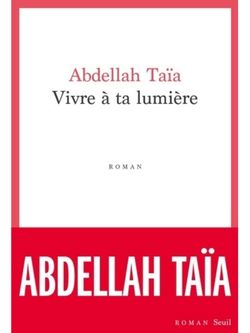 Malika lorsqu’on la revoit une vingtaine d’années plus tard n’est plus du tout la même ; c’est une femme dure qui a compris ce qu’on pourrait appeler le principe de réalité, c’est-à-dire principalement qu’il lui appartient à elle et à elle seule de se défendre contre tout ce qu’elle ressent comme une attaque contre son autonomie et son intégrité. Au risque de se tromper et de s’enfermer dans des refus hautains : elle refuse que sa fille Khadija aille travailler chez la Française Monique qui l’aime et qu’elle aime et qui voudrait en faire sa fille adoptive, mais c’est justement ce que Malika ne supporte pas : cette manière d’empiéter sur ce qu’elle revendique comme son domaine exclusif, où elle seule a le pouvoir de décision. Mère autoritaire, elle s’adjuge tous les attributs du père dans le système patriarcal, il est donc normal en un sens que les protestations plus ou moins exprimées par le fils (elle le sont en tout cas par la fuite) soient dirigées contre elle ; mais cette manière de décrire la société tradi tionnelle maghrébine reste très minoritaire et c’est en cela que le livre d’Abdallah Taïa est original alors qu’il existe une sorte de vulgate différente de ce qu’il nous dit, sans doute parce qu’elle satisfait davantage une certaine idée du patriarcat prédominante en Europe.
Malika lorsqu’on la revoit une vingtaine d’années plus tard n’est plus du tout la même ; c’est une femme dure qui a compris ce qu’on pourrait appeler le principe de réalité, c’est-à-dire principalement qu’il lui appartient à elle et à elle seule de se défendre contre tout ce qu’elle ressent comme une attaque contre son autonomie et son intégrité. Au risque de se tromper et de s’enfermer dans des refus hautains : elle refuse que sa fille Khadija aille travailler chez la Française Monique qui l’aime et qu’elle aime et qui voudrait en faire sa fille adoptive, mais c’est justement ce que Malika ne supporte pas : cette manière d’empiéter sur ce qu’elle revendique comme son domaine exclusif, où elle seule a le pouvoir de décision. Mère autoritaire, elle s’adjuge tous les attributs du père dans le système patriarcal, il est donc normal en un sens que les protestations plus ou moins exprimées par le fils (elle le sont en tout cas par la fuite) soient dirigées contre elle ; mais cette manière de décrire la société tradi tionnelle maghrébine reste très minoritaire et c’est en cela que le livre d’Abdallah Taïa est original alors qu’il existe une sorte de vulgate différente de ce qu’il nous dit, sans doute parce qu’elle satisfait davantage une certaine idée du patriarcat prédominante en Europe.
Cependant il semble que Malika, et c’est un tour de force, soit finalement capable de comprendre ses erreurs tout en restant fidèle à elle-même. Elle n’abdique pas son pouvoir de décision qu’elle veut sans mélange et s’en tient au choix d’une totale indépendance y compris affective, même s’il lui faut pour cela renoncer (volontairement)à des attitudes qui étaient les siennes antérieurement. Dans un langage sans doute trop superficiel et purement psychologique, on dirait d’elle que c’est une orgueilleuse mais son attitude va au-delà, elle est existentielle : ce qui la fait vivre est une certaine volonté de rester intraitable, et de ne pas céder. En cela elle en impose, y compris à son fils qui même éloigné d’elle reste irradié par son rayonnement.
Denise Brahimi

« DE NOS FRÈRES BLESSÉS », film de Hélier Cisterne, France-Belgique-Algérie 2020
La sortie de ce film tourné en 2019 n’a cessé d’être reportée pour cause de covid. Mais de toute façon le sujet en était connu puisque le film de Hélier Cisterne est inspiré du livre de Joseph Andras paru aux éditions Actes Sud en 2016 et en reprend le titre. On savait peut-être moins que le film était entièrement consacré au jeune militant communiste Fernand Yveton qui fut le seul Européen guillotiné pendant la Guerre d’Algérie et que de ce fait le choix de l’acteur chargé d’interpréter son rôle serait déterminant. Or on a grand plaisir à constater que l’interprétation qu’en donne Vincent Lacoste est absolument convaincante, ce qui ne minimise en rien le rôle de l’actrice, Vicky Krieps qui joue le rôle de sa femme Hélène. Les événements racontés se passent au tout début de la Guerre d’Algérie à partir de 1954, et Fernand Yveton fut guillotiné le 11 février 1957, à une époque où François
Mitterrand était Garde des sceaux, ce que le film tient manifestement à souligner, car il est certain qu’il aurait pu gracier le condamné et qu’il ne l’a pas fait.
 Pourtant la Guerre d’Algérie était encore loin de battre son plein et d’atteindre le degré de férocité qui sera le sien à partir des années 1958 à 1962. La condamnation de Fernand Yveton est particulièrement choquante parce que personne ne semble s’être soucié de prendre sa cause en main avec toute l’énergie nécessaire ; sa femme Hélène horrifiée et stupéfiée par la tournure tragique prise par les événements n’avait aucun moyen d’agir ; d’origine polonaise elle ignorait à peu près tout de l’Algérie et de la politique qui y était menée par la France jusqu’au moment où elle y avait mis les pieds pour suivre son mari et elle ne pouvait guère songer à prendre appui sur le parti communiste (Les Yveton père et fils appartenaient avec une conviction sans faille au parti communiste algérien) du fait qu’elle avait au contraire quitté la Pologne pour fuir le pouvoir qu’y exerçait celui-ci. En matière de politique, les idées d’Hélène se bornent à un violent rejet du communisme et de toute évidence c’est par pur amour qu’elle a suivi Fernand Yveton en Algérie mais certainement pas pour y mener un travail de militante ; au contraire, elle déplore plutôt celui auquel se consacre son mari car elle en mesure au moins partiellement le danger. Cependant aucun des deux époux ne semble l’avoir évalué à sa juste mesure en sorte que la condamnation de Fernand fait l’effet d’un coup de tonnerre qui les plonge brutalement en pleine catastrophe.
Pourtant la Guerre d’Algérie était encore loin de battre son plein et d’atteindre le degré de férocité qui sera le sien à partir des années 1958 à 1962. La condamnation de Fernand Yveton est particulièrement choquante parce que personne ne semble s’être soucié de prendre sa cause en main avec toute l’énergie nécessaire ; sa femme Hélène horrifiée et stupéfiée par la tournure tragique prise par les événements n’avait aucun moyen d’agir ; d’origine polonaise elle ignorait à peu près tout de l’Algérie et de la politique qui y était menée par la France jusqu’au moment où elle y avait mis les pieds pour suivre son mari et elle ne pouvait guère songer à prendre appui sur le parti communiste (Les Yveton père et fils appartenaient avec une conviction sans faille au parti communiste algérien) du fait qu’elle avait au contraire quitté la Pologne pour fuir le pouvoir qu’y exerçait celui-ci. En matière de politique, les idées d’Hélène se bornent à un violent rejet du communisme et de toute évidence c’est par pur amour qu’elle a suivi Fernand Yveton en Algérie mais certainement pas pour y mener un travail de militante ; au contraire, elle déplore plutôt celui auquel se consacre son mari car elle en mesure au moins partiellement le danger. Cependant aucun des deux époux ne semble l’avoir évalué à sa juste mesure en sorte que la condamnation de Fernand fait l’effet d’un coup de tonnerre qui les plonge brutalement en pleine catastrophe.
Lorsque celle-ci arrive, le film, habilement construit, fait mesurer la part d’inconscience qu’il y a probablement eu chez le jeune militant qui d’ailleurs, en la personne de Vincent Lacoste, paraît plus jeune qu’il ne l’était réellement, sorte d’adolescent intrépide et fougueux alors qu’il a déjà une trentaine d’années. Ce qui le meut plus que toute espèce d’idée à proprement parler politique, c’est l’indignation que provoque en lui la manière indigne voire scandaleuse et totalement injuste dont les Algériens dits musulmans sont traités en Algérie par le gouvernement colonial français, largement soutenu par la population d’origine européenne.
Fernand Yveton est ouvrier tourneur dans une usine d’Alger, il appartient à un monde ouvrier dans lequel les idées communistes (ce qui n’a rien à voir avec l’exercice du pouvoir soviétique voire stalinien) ont encore toute la force qu’elles ont eu pendant et après la deuxième guerre mondiale, une dizaine d’années auparavant, quand Fernand Yveton était un jeune homme d’une vingtaine d’années. Pour employer des mots en …isme, inévitables lorsqu’il s’agit d’idéologie, on peut déceler chez lui un idéalisme et un humanisme totalement incompatibles avec le cynisme de la politique coloniale : il est la victime toute désignée de cette dernière d’autant plus qu’il est une personne modeste, et semble susceptible d’être pris comme bouc émissaire sans soulever de protestation. En ce sens son cas illustre des observations politiques qu’on a pu faire en d’autres temps et en d’autres lieux, en sorte qu’il acquiert une sorte de généralité, alors même qu’il est tout à fait daté et situé dans l’histoire.
Il semble que le réalisateur, Hélier Cisterne, a voulu jouer sur ce double aspect car son film à certains égards peut passer pour historique, et en même temps exerce sur nous un effet immédiatement présent. La reconstitution de certains aspects de Paris mais surtout de l’Alger de l’époque fait que l’on pense aux films du premier Renoir, à l’époque du Front populaire, un Renoir humaniste animé par le goût des gens simples, « les « vraies gens », si ce n’est que les préoccupations sociales, dans le contexte qui est celui du film, prennent la forme de préoccupations anti-racistes, et que les « parties de campagne » y sont remplacées par les sorties à la plage, pêches aux oursins et autres joies simples qu’on a le temps d’apercevoir avant d’être précipités dans le drame. Fernand Yveton voulait défendre une sorte de droit naturel des gens à en profiter et à en profiter ensemble, Européens et Musulmans, alors même que l’intervention d’une police aux ordres du gouvernement s’emploie à rendre cette mixité raciale impossible. L’acte de sabotage organisé clandestinement par Fernand Yveton avait pour but d’attirer l’attention sur cet insoutenable état de fait, mais sans doute n’était-il pas facile à réussir et de fait il a échoué. Un échec qui justifie et montre la nécessité d’une organisation collective et très structurée qui est en train d’être mise en place par le FLN ; alors que Fernand Yveton agit seul et restera seul jusqu’à sa mort, en dépit des quelques sympathies qu’il s’est attiré. Hélène qui est un peu plus âgée que Fernand et qui a plus de maturité que lui entrevoit chez celui qu’elle aime une sorte de naïveté qui la terrifie et ne peut que renforcer son amour, faisant du film la très touchante histoire d’un couple d’amoureux fracassés par la violence qui sévit autour d’eux.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film,
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- Mardi 3 mai à 18h30 à la Mairie du 1er arrondissement à Lyon: Conférence « Des bidonvilles aux garnis » avec André Gachet et Olivier Chavanon
- Vendredi 6 mai à 19h à la Mairie du 1er arrondissement de Lyon projection du film de Mehdi Lallaoui « Sur les traces de Frantz Fanon » en présence du réalisateur, suivi d’un débat.
- Du 10 au 14 mai au Théâtre des Asphodèles à Lyon, Pièce de théâtre « Le contraire de l’ampour mise en scène par Dominique Lurcel, d’après le Journal de Mouloud Ferraoun
- Samedi 14 mai à la Bibliothèque Kateb Yacine de Grenoble Table ronde sur Kateb Yacine puis concert d’Amazigh Kateb autour de textes de son père.
- Du 13 au 15 mai, à l’Hôtel de Ville de paris Maghreb-Orient des Livres organisé par Coup de Soleil et l’IREMMO
- Lundi 16 mai intervention mémoires croisées de la Guerre d’Algérie au collège Les Champs à Saint-Eienne
- Mardi 17 mai intervention mémoires croisées de la Guerre d’Algérie au Lycée Albert Londres de Cusset (03)
- Mardi 24 mai à Clermont-Ferrand intervention mémoires croisées de la Guerre d’Algérie à l’Institution Saint Alyre.
- Lundi 30 mai intervention mémoires croisées de la Guerre d’Algérie au Collège de Dieulefit
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


Les analyses des livres rédigées par Denise Brahimi donnent envie de les lire.
Merci pour nous, futurs lecteurs