Lettre culturelle franco-maghrébine #66
Éditorial
La lettre du 1er juin n’est pas encore orientée vers les vacances, tant il y a de choses sérieuses à dire sur les questions qui nous sont chères. C’est ainsi qu’on y trouvera la présentation de trois essais portant sur des sujets de société. Dans le livre de Paul Max Morin, chercheur au CEVIPOF(Centre de recherches politiques et d’enquêtes) et enseignant à Sciences Po, il est question de la manière dont les jeunes d’aujourd’hui perçoivent la colonisation et la Guerre d’Algérie. L’ouvrage d’Amin Pérez, sociologue et universitaire au Québec, utilise les livres et les archives de Pierre Bourdieu et d’Abdelmalek Sayad, qui se sont connus à Alger en 1958, pour montrer comment chacun des deux a su mêler militantisme et savoir. Le travail universitaire d’Ali Guenoun, docteur en histoire, étudie, c’est son titre, « la question kabyle dans le nationalisme algérien, 1949-1962 » en privilégiant deux moments où le mouvement identitaire amazigh est intervenu dans le combat nationaliste de manière significative, éventuellement conflictuelle.
Dans cette Lettre 66, les arts n’en occupent pas moins une place importante, sous différentes formes. Il y est question de ce qu’on a appelé la « génération du môle », petit groupe de peintres comme Sauveur Galliéro mais aussi de poètes, penseurs, écrivains qui ont vécu à Alger avant et pendant la Guerre d’Algérie. Mais la peinture est aussi représentée sous sa forme la plus contemporaine en la personne du peintre Farid Chaachaoua, d’origine aurasienne néanmoins lyonnais. Et c’est de dessin qu’il s’agit dans le roman graphique analysé par Michel Wilson sous le titre « Falloujah »
Un très beau film cette fois ci, «Sur les traces de Frantz Fanon », réalisé par Mehdi Lallaoui, qui ne comporte aucune fiction mais n’en est pas moins émouvant.
Denise Brahimi

« LES JEUNES ET LA GUERRE D’ALGERIE » par Paul Max Morin, PUF, 2022
Ce travail, qui est très riche de témoignages et de ce fait très vivant, relève des enquêtes menées par le CEVIPOF , centre de recherches politiques de Sciences Po. On peut le considérer comme un sondage ou comme un ensemble de sondages mais c’est aussi un travail de grande ampleur et de grande ambition, en cela qu’il unit passé, présent et avenir et s’appuie sur 300 à 400 pages de recherches pour affirmer certaines conclusions sur la manière de sentir et de penser de la génération qui entre aujourd’hui dans l’âge adulte.  Peut-être faudrait-il mettre le mot « manière (s) » au pluriel car une des grandes qualités de cet ouvrage est le soin qu’il prend de rester nuancé ; de toute manière et on est heureux de le dire d’emblée, ce qui compte à propos de ces conclusions est qu’elles sont globalement plutôt optimistes, le fait étant assez rare pour mériter d’être signalé. Non, il n’y a pas lieu de s’affoler sur les attitudes politiques de la jeunesse actuelle et pour ce qui concerne l’héritage de la Guerre d’Algérie, on peut dire qu’il est plutôt positif en ceci qu’il amène plusieurs catégories de ces jeunes à réfléchir et à vouloir s’informer—sans a priori ou presque—alors que cette Guerre ainsi que l’histoire qui l’a précédée a entraîné pendant des décennies ce qu’on peut considérer comme une véritable crise de la pensée, à laquelle se sont substitués des affrontements sectaires, violents et apparemment sans issue.
Peut-être faudrait-il mettre le mot « manière (s) » au pluriel car une des grandes qualités de cet ouvrage est le soin qu’il prend de rester nuancé ; de toute manière et on est heureux de le dire d’emblée, ce qui compte à propos de ces conclusions est qu’elles sont globalement plutôt optimistes, le fait étant assez rare pour mériter d’être signalé. Non, il n’y a pas lieu de s’affoler sur les attitudes politiques de la jeunesse actuelle et pour ce qui concerne l’héritage de la Guerre d’Algérie, on peut dire qu’il est plutôt positif en ceci qu’il amène plusieurs catégories de ces jeunes à réfléchir et à vouloir s’informer—sans a priori ou presque—alors que cette Guerre ainsi que l’histoire qui l’a précédée a entraîné pendant des décennies ce qu’on peut considérer comme une véritable crise de la pensée, à laquelle se sont substitués des affrontements sectaires, violents et apparemment sans issue.
Ce qui est très intéressant dans ce livre, indépendamment de ses conclusions, est la méthode qu’il a mise au point pour parvenir à encadrer la masse considérable d’informations qu’il s’est donné pour but d’exploiter. Il s’agissait de distinguer et de classifier les catégories assez différentes des jeunes d’aujourd’hui qui ont une raison particulière de se sentir concernés par la Guerre d’Algérie (même ou justement quand ils en savent fort peu de choses). Ces catégories sont à peu près une demi-douzaine, que l’on retrouve dans chacun des cinq chapitres du livre. Il s’agit toujours des « descendants de », en fait, le plus souvent des petits-enfants de ceux qui ont participé en direct et en personne aux événements de la guerre, dont on sait bien en cette date anniversaire (1962-2022) qu’elle est terminée aujourd’hui depuis soixante ans. Ces jeunes d’aujourd’hui sont donc classés selon le rapport à la guerre qui a été celui de leur famille il y a environ deux générations. Ce qui veut dire qu’on y trouve des descendants de Français d’Algérie dits Pieds noirs, de Juifs algériens, de membres de l’OAS, de combattants du FLN, d’Algériens amenés à s’installer en France après la première guerre mondiale ou même avant, d’autres Algériens venus plus tard après 1962 et la fin de la guerre d’Algérie ; et naturellement des Harkis arrivés en France tant bien que mal après la fin de la lutte armée qu’ils avaient menée dans les rangs de l’armée française.
 La définition du mot « jeunes » est donnée explicitement par Paul Max Morin, il s’agit de ceux et de celles qui ont de 18 à 25 ans, mais on trouve aussi dans le livre des témoignages ou des fragments d’entretiens parfois assez longs recueillis auprès de gens sensiblement plus âgés, sans aller toutefois au-delà de 35 ans. Il semble qu’ils aient accepté de parler, ou voulu parler, suite au long cheminement qu’ils avaient accompli pour mesurer ce qui est précisément le sujet du livre, c’est-à-dire la place plus ou moins consciente occupée par les souvenirs de la guerre dans la vie de leur famille et dans l’héritage mental qu’ils en ont reçu.
La définition du mot « jeunes » est donnée explicitement par Paul Max Morin, il s’agit de ceux et de celles qui ont de 18 à 25 ans, mais on trouve aussi dans le livre des témoignages ou des fragments d’entretiens parfois assez longs recueillis auprès de gens sensiblement plus âgés, sans aller toutefois au-delà de 35 ans. Il semble qu’ils aient accepté de parler, ou voulu parler, suite au long cheminement qu’ils avaient accompli pour mesurer ce qui est précisément le sujet du livre, c’est-à-dire la place plus ou moins consciente occupée par les souvenirs de la guerre dans la vie de leur famille et dans l’héritage mental qu’ils en ont reçu.
Cette importance de la famille est considérable, aucun des jeunes concernés ne songe à la nier et surtout pas dans les cas à dire vrai rares où il y a eu rupture caractérisée avec l’idéologie familiale (par exemple chez certains descendants de membres de l’OAS, qui refusent d’assumer l’héritage familial—alors que d’autres au contraire le font de manière non moins marquée). Le rôle joué par la famille est d’ailleurs assez complexe, dans beaucoup de cas il n’est pas dû à des conversations franches et ouvertes entre les jeunes et leurs anciens, car c’est bien souvent le silence sur ces sujets qui a été de règle entre eux, mais ce silence, justement, est très souvent signalé comme un aspect important de la relation familiale. Et c’est beaucoup contre lui que beaucoup de jeunes disent avoir voulu s’informer par eux-mêmes à partir d’un certain moment.
L’autre source d’information et sans doute la plus importante est l’école, ce qu’il faut souligner à propos des jeunes d’aujourd’hui, parce qu’on a beaucoup dit, et sans doute à juste titre, à propos des décennies précédentes, que l’enseignement scolaire français a été très peu loquace, voire complétement défaillant sur tous les sujets concernant l’Algérie, la colonisation et la guerre. Mais tous disent aussi que ce n’est plus le cas aujourd’hui, les enseignants se donnent beaucoup de mal pour en parler à leurs élèves, dans certaines classes on fait venir des gens qui en ont été acteurs ou témoins ou qui en tout cas jugent important de transmettre ce qu’ils savent en milieu scolaire. Ce vaste effort collectif explique beaucoup des aspects que souligne le livre de Maul Max Morin, et de manière assez générale, l’accroissement considérable de l’intérêt porté par les jeunes à des questions qu’ils n’ont plus de gêne à aborder aujourd’hui , alors même que jusqu’à la génération de leurs parents, la formule le plus souvent employée était : « Il ne faut pas en parler, ce n’est pas tabou mais on n’en parle pas ». Il est vrai que ce silence était alors lié au souci d’intégration, qui ne fait plus partie, en tout cas pas sous la même forme, des préoccupations d’aujourd’hui. On sait en effet que ce qui est apparu à partir d’un certain moment est le souci de la « construction identitaire », qui reste fort aujourd’hui.
Denise Brahimi
« COMBATTRE EN SOCIOLOGUES, PIERRE BOURDIEU ET ABDELMALEK SAYAD DANS UNE GUERRE DE LIBERATION (ALGERIE 1958-1964) » par Amin Pérez, éditions Agone, 2022
Et
« FEMMES EN RUPTURE DE BAN, ENTRETIENS INEDITS AVEC DEUX ALGERIENNES » par Abdelmalek Sayad, éditions Raisons d’agir, 2021
On aura compris qu’il y a une bonne raison de regrouper ces deux livres, d’ailleurs tout à fait contemporains : ils sont unis par le nom du sociologue algérien Abdelmalek Sayad, très proche à tous égards de Pierre Bourdieu qui n’était que de 3 ans son aîné mais qui avait été son maître à Alger avant qu’ils ne deviennent collègues et amis. Dans les deux cas c’est de sociologie qu’il s’agit, principalement à propos de l’Algérie qui a été leur principal objet d’enquête pendant plusieurs années. Amin Pérez, auteur du premier livre, rapproche les deux auteurs dont il parle parce que, à partir d’origines différentes, les deux  hommes ont mis au point une sociologie souvent semblable, inspirée en tout cas par les mêmes principes, les mêmes intentions et le même désir d’agir. Les deux universitaires se sont refusés à un travail purement théorique, tout particulièrement au moment de la Guerre d’Algérie et de ses suites immédiates, qui les ont renforcés dans l’idée que leur travail se devait d’être un combat, comme le dit le titre du livre.
hommes ont mis au point une sociologie souvent semblable, inspirée en tout cas par les mêmes principes, les mêmes intentions et le même désir d’agir. Les deux universitaires se sont refusés à un travail purement théorique, tout particulièrement au moment de la Guerre d’Algérie et de ses suites immédiates, qui les ont renforcés dans l’idée que leur travail se devait d’être un combat, comme le dit le titre du livre.
Les origines familiales et sociales des deux chercheurs sont intéressantes en ceci qu’elles les ont rapprochés alors même qu’on aurait pu imaginer l’inverse. En fait, entre Bourdieu le Béarnais et Sayad le Kabyle, on constate qu’il y a eu une préparation assez semblable à ce qui deviendra l’exercice de leur métier, une même conscience révoltée de ce que sont les mécanismes d’exclusion et l‘affirmation qu’on dirait presque naturelle de supériorités acquises, parfaitement analysables dans la société française, même si la société coloniale  les exacerbe et les grossit. Or c’est encore celle-ci qui est en place et plus que jamais, si l’on peut dire, lorsque les deux hommes se rencontrent à l’Université d’Alger en 1958. Pour Sayad, il n’en a jamais connu d’autre, et il ne peut évidemment pas s’en accommoder, même s’il n’est pas d’emblée un indépendantiste dans la mouvance du FLN. Il ne se ralliera aux actions de ce parti que tardivement et l’on pourrait presque dire qu’il le fait contraint et forcé à partir du moment où cela devient le seul moyen de lutter contre les exactions de l’OAS. Mais en fait, pour l’essentiel, sa sensibilité et ses convictions le rapprochent de ceux qu’on appelle les Libéraux d’Alger : c’est par souci d’efficacité qu’il s’éloigne des extrêmes, d’autant que dans l’histoire de la Guerre d’Algérie, le moment vient où la politique à long ou à moyen terme, et par exemple celle du Général De Gaulle, reflète la conviction qu’aucun extrémisme n’a chance d’aboutir. Bourdieu, lui, a connu bien malgré lui, en tant qu’appelé, la position difficile de l’armée française, mais le moins qu’on puisse dire est qu’il n’a cessé de dénoncer ses actions et ses exactions. Il n’est certes pas un révolté, au sens que Camus par exemple a donné à ce terme, mais il sait très vite tout ce qu’il veut combattre, pour commencer la colonisation, et aussi le capitalisme, et toutes les formes arbitraires de domination. Le travail de sociologue qu’il entreprend et qu’il organise autour de lui est évidemment ressenti par lui comme un moyen, et peut-être même le moyen privilégié de la lutte révolutionnaire, celle qui doit aboutir à différentes formes de libération. Le livre d’Amin Pérez fait comprendre pourquoi la tournure politique que prend l’Algérie dans les années qui suivent l’indépendance n’est en aucun cas ce que ni Bourdieu ni Sayad ne voulaient pour ce pays. La date de 1962 et leur prochain retour en France ne signifie pas une rupture avec la sociologie de combat, même si leurs domaines respectifs se diversifient ; et l’on sait que pour ce qui est de Sayad son champ de recherche concernera beaucoup désormais l’immigration algérienne en France.
les exacerbe et les grossit. Or c’est encore celle-ci qui est en place et plus que jamais, si l’on peut dire, lorsque les deux hommes se rencontrent à l’Université d’Alger en 1958. Pour Sayad, il n’en a jamais connu d’autre, et il ne peut évidemment pas s’en accommoder, même s’il n’est pas d’emblée un indépendantiste dans la mouvance du FLN. Il ne se ralliera aux actions de ce parti que tardivement et l’on pourrait presque dire qu’il le fait contraint et forcé à partir du moment où cela devient le seul moyen de lutter contre les exactions de l’OAS. Mais en fait, pour l’essentiel, sa sensibilité et ses convictions le rapprochent de ceux qu’on appelle les Libéraux d’Alger : c’est par souci d’efficacité qu’il s’éloigne des extrêmes, d’autant que dans l’histoire de la Guerre d’Algérie, le moment vient où la politique à long ou à moyen terme, et par exemple celle du Général De Gaulle, reflète la conviction qu’aucun extrémisme n’a chance d’aboutir. Bourdieu, lui, a connu bien malgré lui, en tant qu’appelé, la position difficile de l’armée française, mais le moins qu’on puisse dire est qu’il n’a cessé de dénoncer ses actions et ses exactions. Il n’est certes pas un révolté, au sens que Camus par exemple a donné à ce terme, mais il sait très vite tout ce qu’il veut combattre, pour commencer la colonisation, et aussi le capitalisme, et toutes les formes arbitraires de domination. Le travail de sociologue qu’il entreprend et qu’il organise autour de lui est évidemment ressenti par lui comme un moyen, et peut-être même le moyen privilégié de la lutte révolutionnaire, celle qui doit aboutir à différentes formes de libération. Le livre d’Amin Pérez fait comprendre pourquoi la tournure politique que prend l’Algérie dans les années qui suivent l’indépendance n’est en aucun cas ce que ni Bourdieu ni Sayad ne voulaient pour ce pays. La date de 1962 et leur prochain retour en France ne signifie pas une rupture avec la sociologie de combat, même si leurs domaines respectifs se diversifient ; et l’on sait que pour ce qui est de Sayad son champ de recherche concernera beaucoup désormais l’immigration algérienne en France.
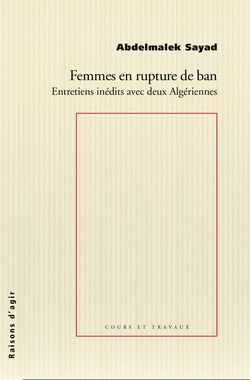 C’est d’ailleurs à ce champ qu’appartiennent les deux entretiens publiés aux éditions Raisons d’agir. Ils sont passionnants alors même que Sayad les avait mis à part de son vivant, confiant le plus long des deux à sa collègue Tassadit Yacine, en effet spécialiste des femmes maghrébines (ce que Sayad lui-même n’était pas, une affaire de génération !)L’entretien avec Ourida, titré « Moi je suis l’homme et la femme de la maison » constitue un portrait de femme étonnant, militante pour l’indépendance, toujours prête à batailler contre les patrons exploiteurs, quitte à inventer un syndicat pour défendre la cause des travailleuses, et par-dessus tout en bagarre permanente contre son mari dont elle ne parvient pas à divorcer. Ourida est une femme qui se bat d’un même mouvement sur tous les fronts et l’entretien qu’elle donne à Sayad est un véritable manifeste féministe, utilement commenté par Tassadit Yacine : pendant plus de dix ans le mari abusif d’Ourida a fait peser sur elle sans relâche la menace de lui reprendre sa fille et pour autant jamais elle n’a baissé les bras. Elle rappelle à certains égards la bouleversante Aïni mère de la narratrice dans « Histoire de ma vie » de Fadhma Aït Mansour Amrouche (mère de Jean et de Taos Amrouche). Cet entretien fait dans les années 70 à 80 du siècle dernier n’a été retrouvé dans les archives de Sayad qu’en 2018. Bonne occasion de rappeler le rôle important joué dans la révolution algérienne par beaucoup de femmes qui depuis lors n’ont jamais été reconnues à leur juste valeur.
C’est d’ailleurs à ce champ qu’appartiennent les deux entretiens publiés aux éditions Raisons d’agir. Ils sont passionnants alors même que Sayad les avait mis à part de son vivant, confiant le plus long des deux à sa collègue Tassadit Yacine, en effet spécialiste des femmes maghrébines (ce que Sayad lui-même n’était pas, une affaire de génération !)L’entretien avec Ourida, titré « Moi je suis l’homme et la femme de la maison » constitue un portrait de femme étonnant, militante pour l’indépendance, toujours prête à batailler contre les patrons exploiteurs, quitte à inventer un syndicat pour défendre la cause des travailleuses, et par-dessus tout en bagarre permanente contre son mari dont elle ne parvient pas à divorcer. Ourida est une femme qui se bat d’un même mouvement sur tous les fronts et l’entretien qu’elle donne à Sayad est un véritable manifeste féministe, utilement commenté par Tassadit Yacine : pendant plus de dix ans le mari abusif d’Ourida a fait peser sur elle sans relâche la menace de lui reprendre sa fille et pour autant jamais elle n’a baissé les bras. Elle rappelle à certains égards la bouleversante Aïni mère de la narratrice dans « Histoire de ma vie » de Fadhma Aït Mansour Amrouche (mère de Jean et de Taos Amrouche). Cet entretien fait dans les années 70 à 80 du siècle dernier n’a été retrouvé dans les archives de Sayad qu’en 2018. Bonne occasion de rappeler le rôle important joué dans la révolution algérienne par beaucoup de femmes qui depuis lors n’ont jamais été reconnues à leur juste valeur.
Soucieuse de jouer un rôle politique grâce au savoir qu’elle élabore et diffuse, la sociologie selon Bourdieu et Sayad prend sa source dans la situation coloniale mais prolonge bien au-delà l’analyse des rapports de domination, ce qui l’amène à y inclure les rapports de genre préfigurant par là l’apport récent du féminisme.
Denise Brahimi
 l’auteur fait preuve qu’on sait à quel point la question, parfaitement claire dès le titre de son livre, reste épineuse et peut-être même l’est plus que jamais aujourd’hui. C’est de la question identitaire amazigh que forcément il est traité ; le fait que la Kabylie soit particulièrement citée pourrait inciter à parler d’une histoire régionale mais nul n’ignore à quel point son rapport avec l’histoire nationale (et l’histoire du nationalisme) est un problème considérable qui met en cause toute la définition—inévitablement conflictuelle—de l’Algérie comme nation avant et après son indépendance.
l’auteur fait preuve qu’on sait à quel point la question, parfaitement claire dès le titre de son livre, reste épineuse et peut-être même l’est plus que jamais aujourd’hui. C’est de la question identitaire amazigh que forcément il est traité ; le fait que la Kabylie soit particulièrement citée pourrait inciter à parler d’une histoire régionale mais nul n’ignore à quel point son rapport avec l’histoire nationale (et l’histoire du nationalisme) est un problème considérable qui met en cause toute la définition—inévitablement conflictuelle—de l’Algérie comme nation avant et après son indépendance.Pour reprendre l’ordre chronologique suivi par le livre dans la succession de ses deux parties, on est amené à rappeler que, en 1949, c’est le Parti du Peuple algérien, ou PPA qui a en charge de promouvoir une définition de cette nation en cours de formation depuis longtemps déjà. Ali Guenoun propose une sociologie des « intellectuels militants » qui y travaillent, et fournit des informations du plus grand intérêt sur ce qu’étaient leurs lectures, « de Salluste à Renan, de Boulifa à Tawfik al-madani » : on est évidemment frappé par l’amplitude et la diversité de ces références mais aussi par l’absence d’objectif précis permettant d’organiser la recherche. On voit apparaître le mot « berbérisme » mais lorsqu’il s’agit d’analyser ce qu’il en est de cette idéologie, car c’en est une, des appréciations différentes se font jour, d’autant qu’en 1949, on est encore en pleine période coloniale : les berbéristes coloniaux portent la marque de traits propres à cette époque, qui tend à dévaloriser l’arabité et l’islam ; une tendance répandue à l’époque est d’accentuer la différence entre Kabyles et Arabes, en usant abondamment de définitions raciales. S’y opposent cependant les Oulamas qui mettent en valeur l’islam et la langue arabe.
Lorsque le MTLD ou mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques succède au PPA, on s’oriente vers ce qui est le sujet de la crise berbériste de 1949, c’est-à-dire une opposition entre d’une part les militants qui veulent se battre pour une Algérie plurielle, faisant toute leur place aux éléments berbères et d’autre part la direction du parti qui définit les objectifs du mouvement national comme la promotion d’une Algérie arabo-musulmane. Il est évident que cette opposition n’est pas réductible et qu’en revanche elle est propre à susciter des affrontements récurrents. Le livre d’Ali Guenoun fait comprendre qu’en effet cette crise est l’origine d’autres qui ne manqueront pas de se manifester brutalement lorsque les circonstances s’y prêteront : le dernier chapitre de cette première partie nous conduit jusqu’au « printemps berbère » de 1980 encore très présent dans les mémoires, au-delà du cadre historique que s’est fixé Ali Guenoun.
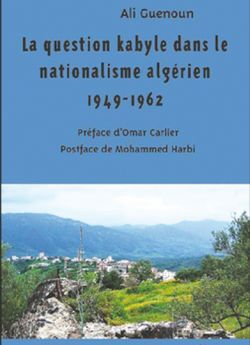 La deuxième partie à laquelle il se consacre porte elle aussi un titre fort clair, mais qui demande évidemment à être précisé : « Des usages de la référence « kabyle » dans la guerre d’indépendance ». Un rôle important y est joué par la zone définie comme Wilaya 3, dirigée par Belkacem Krim (lui-même originaire de Kabylie, région où il a organisé les premières formes de résistance clandestine à l’Etat colonial). Son pouvoir et son influence n’ont cessé d’augmenter pendant les premières années de la guerre dans les instances dirigeantes du FLN. Arrive le moment où comme le dit Ali Guenoun, « Belkacem Krim s’affirme comme leader national de la guerre ».Et c’est aussi le moment où à travers lui s’affirme la prééminence de la Kabylie dans la guerre. Mais le dernier chapitre du livre , qui concerne la période 1959-1962, montre comment la lutte des clans entraîne la perte de pouvoir de la Wilaya 3 et avec elle ce qu’on peut appeler l’échec de Belkacem Krim, rejeté dans l’opposition après l’indépendance ; on sait qu’il meurt finalement en 1970 assassiné par les services secrets algériens.
La deuxième partie à laquelle il se consacre porte elle aussi un titre fort clair, mais qui demande évidemment à être précisé : « Des usages de la référence « kabyle » dans la guerre d’indépendance ». Un rôle important y est joué par la zone définie comme Wilaya 3, dirigée par Belkacem Krim (lui-même originaire de Kabylie, région où il a organisé les premières formes de résistance clandestine à l’Etat colonial). Son pouvoir et son influence n’ont cessé d’augmenter pendant les premières années de la guerre dans les instances dirigeantes du FLN. Arrive le moment où comme le dit Ali Guenoun, « Belkacem Krim s’affirme comme leader national de la guerre ».Et c’est aussi le moment où à travers lui s’affirme la prééminence de la Kabylie dans la guerre. Mais le dernier chapitre du livre , qui concerne la période 1959-1962, montre comment la lutte des clans entraîne la perte de pouvoir de la Wilaya 3 et avec elle ce qu’on peut appeler l’échec de Belkacem Krim, rejeté dans l’opposition après l’indépendance ; on sait qu’il meurt finalement en 1970 assassiné par les services secrets algériens.Manifestement, Ali Guenoun est loin d’assimiler ce qui a été un moment la prééminence des Kabyles dans la lutte pour l’indépendance à une volonté de séparatisme s’appuyant sur une défense ou sur une exaltation du berbérisme. Son travail est très utilement commenté par une préface d’Omar Carlier et une postface de Mohammed Harbi, qui en soulignent la nouveauté autant que la nécessité. C’est en France qu’Ali Guenoun a soutenu la thèse dont ce livre est issu, tant il est vrai que ce qu’il aborde fait partie des « questions qui fâchent » à l‘Université d’Alger. On a pourtant le sentiment qu’il a parfaitement réussi dans son souci d’éviter les polémiques et les opinions a priori. Son livre fait naître l’espoir que le rapport entre nationalisme et démocratie pourrait être étudié en toute objectivité historique ; mais il nous avertit aussi, au fil de ses analyses minutieuses, que les contradictions entre les deux termes sont inévitables et difficiles.
Denise Brahimi
« LA GENERATION DU MÔLE D’ALGER » par Lydia Haddag, Casbah éditions, 2022
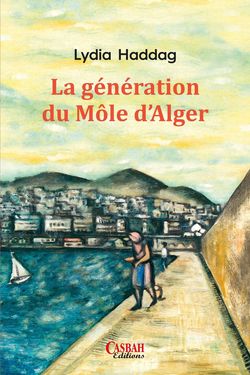 Il y a longtemps que les spécialistes d’histoire de l’art et de l’histoire tout court attendaient le livre que nous donne aujourd’hui une jeune universitaire algérienne, mettant à la disposition des lecteurs le résultat de ses recherches, agréablement illustré d’une quarantaine de reproductions mises en annexe . Son travail porte entre autres sur le peintre jusque là assez mal connu Sauveur Galliéro, né en 1914, dont on peut dire pour le situer sommairement qu’il est à peu près contemporain de son ami Albert Camus. Sauveur Galliéro est un peintre qui a toujours vécu dans la Casbah d’Alger ville où il est né et qu’il n’a guère quitté presque jusqu’à sa mort en 1963. Il est possible qu’il y ait une part de légende volontairement entretenue dans une certaine idée qu’on trouve ici ou là du personnage qu’il a été, sorte de hippie ou « clochard céleste » (selon la formule empruntée à l’écrivain américain Jack Kerouac).Ce qui veut dire qu’il vivait de la façon la plus modeste qui soit, entre sa maison de la Casbah qui avait toujours portes ouvertes en dépit de cette modestie, et le môle dont il est question dans ce livre dans la définition du groupe d’artistes, peintres ou écrivains. Le môle d’Alger fait partie du port de cette ville, c’est une jetée qui en facilite l’accès, permettant aussi la pêche et la baignade, dans un milieu très populaire que symbolise, parce que Camus en a parlé et que Galliéro l’a représenté, un établissement appelé les bains Padovani, sorte de cabanon ou ensemble de cabanes en planche, servant de dancing à la population pied-noire. On comprend par là ce que signifie ou plutôt connote une expression comme « le môle d’Alger » : elle renvoie à un mode de vie simple et sans le moindre apparat, trouvant sa raison d’être dans un rapport constant avec la nature, ici la mer, et dans une certaine sensualité, en rupture avec tout académisme et toute intellectualité.
Il y a longtemps que les spécialistes d’histoire de l’art et de l’histoire tout court attendaient le livre que nous donne aujourd’hui une jeune universitaire algérienne, mettant à la disposition des lecteurs le résultat de ses recherches, agréablement illustré d’une quarantaine de reproductions mises en annexe . Son travail porte entre autres sur le peintre jusque là assez mal connu Sauveur Galliéro, né en 1914, dont on peut dire pour le situer sommairement qu’il est à peu près contemporain de son ami Albert Camus. Sauveur Galliéro est un peintre qui a toujours vécu dans la Casbah d’Alger ville où il est né et qu’il n’a guère quitté presque jusqu’à sa mort en 1963. Il est possible qu’il y ait une part de légende volontairement entretenue dans une certaine idée qu’on trouve ici ou là du personnage qu’il a été, sorte de hippie ou « clochard céleste » (selon la formule empruntée à l’écrivain américain Jack Kerouac).Ce qui veut dire qu’il vivait de la façon la plus modeste qui soit, entre sa maison de la Casbah qui avait toujours portes ouvertes en dépit de cette modestie, et le môle dont il est question dans ce livre dans la définition du groupe d’artistes, peintres ou écrivains. Le môle d’Alger fait partie du port de cette ville, c’est une jetée qui en facilite l’accès, permettant aussi la pêche et la baignade, dans un milieu très populaire que symbolise, parce que Camus en a parlé et que Galliéro l’a représenté, un établissement appelé les bains Padovani, sorte de cabanon ou ensemble de cabanes en planche, servant de dancing à la population pied-noire. On comprend par là ce que signifie ou plutôt connote une expression comme « le môle d’Alger » : elle renvoie à un mode de vie simple et sans le moindre apparat, trouvant sa raison d’être dans un rapport constant avec la nature, ici la mer, et dans une certaine sensualité, en rupture avec tout académisme et toute intellectualité.
 Sitôt évoqué Sauveur Galliéro et sa peinture, il faut y ajouter un deuxième personnage et non des moindres, qui a été son ami très proche pendant des années : il s’agit de Jean Sénac, principalement poète et écrivain, très attaché lui aussi à son origine populaire (né en 1926 d’une mère espagnole et de père inconnu) et connu pour avoir survécu pour le meilleur et pour le pire à l’indépendance de l’Algérie puisque mort (assassiné) à Alger en 1973. Ce sont les deux figures principales de cette génération du Môle, autour desquelles on peut en citer une bonne dizaine d’autres, surtout des peintres, tous à peu près contemporains d’où l’emploi du mot « génération » pour les désigner.
Sitôt évoqué Sauveur Galliéro et sa peinture, il faut y ajouter un deuxième personnage et non des moindres, qui a été son ami très proche pendant des années : il s’agit de Jean Sénac, principalement poète et écrivain, très attaché lui aussi à son origine populaire (né en 1926 d’une mère espagnole et de père inconnu) et connu pour avoir survécu pour le meilleur et pour le pire à l’indépendance de l’Algérie puisque mort (assassiné) à Alger en 1973. Ce sont les deux figures principales de cette génération du Môle, autour desquelles on peut en citer une bonne dizaine d’autres, surtout des peintres, tous à peu près contemporains d’où l’emploi du mot « génération » pour les désigner.
Ce qui amène à préciser quelques dates, en tout cas un moment historique, d’autant qu’il n’est pas fréquemment étudié—d’où l’intérêt du livre de Lydia Haddag, où apparaît la volonté de remédier à cette insuffisance. On peut donner à cette période un sens large ou au contraire restreint. De toute manière elle est à situer entre la fin de la Deuxième guerre mondiale et l’accès de l’Algérie à l’indépendance en 1962. La date de 1945 étant aussi celle des funestes événements de Sétif, beaucoup d’historiens considèrent que les massacres alors commis sont le début de la Guerre d’Algérie , ce qui expliquerait que la génération du Môle est en rupture totale avec celle qui l’a précédée et qu’on pourrait appeler celle du Centenaire (1930 : Centenaire de la conquête de l’Algérie). C’en est bien fini de ce qui avait pu être l’exaltation d’une colonisation triomphante et puissamment installée, dont le corollaire en peinture était l’orientalisme, dans sa version académique, c’est-à-dire rapidement stéréotypée. A la génération du Môle, les positions politiques ou idéologiques sont plutôt évitées, sauf sous la forme poétique qui est celle que leur donne Jean Sénac. Pour ce qui est de Galliéro,  Lydia Haddad en parle comme d’une sorte de transition vivante, « intercesseur entre les communautés pied-noir et indigène», le lieu propre à cette conception de la vie qui s’exprime dans sa peinture étant sans doute la Méditerranée et le monde méditerranéen si chers au cœur du jeune Camus avant qu’il ne devienne le philosophe nobellisé.
Lydia Haddad en parle comme d’une sorte de transition vivante, « intercesseur entre les communautés pied-noir et indigène», le lieu propre à cette conception de la vie qui s’exprime dans sa peinture étant sans doute la Méditerranée et le monde méditerranéen si chers au cœur du jeune Camus avant qu’il ne devienne le philosophe nobellisé.
Il est vrai qu’à partir de la guerre d’indépendance et même de ses prémices immédiates, on entre dans la définition de cette période en un sens plus restreint, du début des années 50 jusqu’à l’indépendance de 62. On sait que Sénac a passé toutes les années de guerre à Paris , à se battre aux côtés du FLN, au risque de la rupture avec des appartenances anciennes comme celles qui le liaient à Camus tandis que d’autres comme Galliéro s’efforçaient de maintenir leur mode de vie et leur art le plus possible à l’écart de la lutte armée qui à terme ne pouvait signifier que leur disparition. Pour la période de la guerre, Lydia Haddag accorde une place très légitime au grand artiste ravagé et violent qu’était M’hamed Issiakhem, proche de l’écrivain Kateb Yacine, nettement plus jeune que Galliéro puisque né en 1928 et dont on peut de se demander si, représentant éminent d’une certaine peinture moderne en Algérie, on peut pour autant le joindre à la génération du Môle—en tout cas, ce ne serait pas dans sa définition la plus restreinte. Il est vrai que Lydia Haddag intitule la troisième et dernière partie de son livre : « D’une révolution picturale à une peinture révolutionnaire », ce qui ouvre le sujet de son étude vers de perspectives d’avenir. Il faut donc aborder assez souplement son livre et constater qu’il est à plusieurs entrées : une étude du peintre Sauveur Galliéro grâce aux archives ouvertes par son fils, un grand chapitre d’histoire culturelle algérienne à une époque encore coloniale mais précédant de peu le passage à l’Etat-nation, une analyse de l’impact d’un projet révolutionnaire (et d’abord au sens politique du mot) sur la création artistique … Face à un domaine de recherche aussi immense, l’autrice avait besoin de se centrer et d’abord au sens géographique du mot sur un objet petit et volontairement délimité voire cerné comme peut l’être le Môle d’Alger dans lequel Sauveur Galliéro a choisi d’inclure le monde qui était le sien. Il ne cherche pas à le magnifier, mais à le montrer, ce qui était en soi une chose rare à l’époque, et c’est cette apparente petitesse de l’objet qui fait la grandeur de son choix.
Denise Brahimi
« FALLOUJAH » de Feurat ALANI et Halim, chez Steinkis collection Témoins du monde
 Ce roman graphique ne porte pas sur le Maghreb, inspiration essentielle de notre Lettre, mais sur la ville irakienne de Falloudjah. Le dessinateur de cet album est certes d’origine algérienne, notre ami Halim Mahmoudi, qui signe Halim quand il pratique la bande dessinée, et de son nom complet dans le dessin de presse. Saluons d’entrée la qualité de son dessin encre noire sur fond blanc, justesse réaliste des attitudes et des expression, mais aussi puissance de certaines évocations subliminales que seule permet la BD, justifiant son qualificatif de 9ème Art. Halim a du reste obtenu de justes récompenses pour ses albums précédents, Arabico (2010), Un Monde libre (201) et Petite maman (2017).
Ce roman graphique ne porte pas sur le Maghreb, inspiration essentielle de notre Lettre, mais sur la ville irakienne de Falloudjah. Le dessinateur de cet album est certes d’origine algérienne, notre ami Halim Mahmoudi, qui signe Halim quand il pratique la bande dessinée, et de son nom complet dans le dessin de presse. Saluons d’entrée la qualité de son dessin encre noire sur fond blanc, justesse réaliste des attitudes et des expression, mais aussi puissance de certaines évocations subliminales que seule permet la BD, justifiant son qualificatif de 9ème Art. Halim a du reste obtenu de justes récompenses pour ses albums précédents, Arabico (2010), Un Monde libre (201) et Petite maman (2017).
Ce brio sert à merveille le récit de Feurat Alani, Journaliste, ancien correspondant de guerre, Prix Albert Londres pour sa websérie Le Parfum d’Irak. Son récit est en plusieurs épisodes portant tous sur sa ville d’enfance Falloujah, en Irak, devenue ville martyre sans que les Américains qui en portent la responsabilité, aient jamais accepté de l’assumer.
 C’est d’abord une « histoire de jumelles», les habitants protestant face à l’entrée dans leur intimité par les soldats américains observant les toits des habitation : cette protestation est noyée dans le sang, ce qui est l’entrée dans un long et sanglant siège comme notre époque récente en multiplie autour de nombreuses villes dans diverses parties du monde.
C’est d’abord une « histoire de jumelles», les habitants protestant face à l’entrée dans leur intimité par les soldats américains observant les toits des habitation : cette protestation est noyée dans le sang, ce qui est l’entrée dans un long et sanglant siège comme notre époque récente en multiplie autour de nombreuses villes dans diverses parties du monde.
Le récit rappelle l’enfance du narrateur qui passe des vacances un peu ennuyeuses dans cette ville située au bord de l’Euphrate (fleuve dont le nom irakien est homonyme du prénom du scénariste). Mais ses oncles le rendent fier, héros de la guerre contre l’Iran, salués à ce titre avec respect par tous les habitants. « Auprès d’eux je découvrais le sens de l’honneur et de la fierté ».
Mais en 2003, Georges Bush junior décide de faire payer à l’Irak de Saddam Hussein l’attentat d’Al Quaida contre les tours du World Trade Center. Les conséquences de cette guerre sont hallucinantes, et Falloujah et un des terrains où elle a été la plus terrible. Les Américains d’abord repoussés par des combattants irakiens chevronnés(opération « vigilant resolve ») reviennent en force en novembre 2004 avec 45000 hommes (!), rasent la ville (opération « Phantom fury » ! A croire que des scénaristes de blockbusters sont sollicités pour ces titres!) et la soumettent à un siège impitoyable, la population soumise à un contrôle absolu.
 Revenu dans sa ville d’enfance, le narrateur recueille des récits terribles de ses oncles, et le début d’indices sur l’usage d’armes interdites sur Falloujah, comme le phosphore blanc. Les conséquences ultérieurs sont abominables, marquées notamment par de multiples naissances d’enfants malformés. Le narrateur se lance alors dans une enquête difficile pour clarifier, et si possible dénoncer l’horreur de l’usage de telles armes sur des populations civiles.
Revenu dans sa ville d’enfance, le narrateur recueille des récits terribles de ses oncles, et le début d’indices sur l’usage d’armes interdites sur Falloujah, comme le phosphore blanc. Les conséquences ultérieurs sont abominables, marquées notamment par de multiples naissances d’enfants malformés. Le narrateur se lance alors dans une enquête difficile pour clarifier, et si possible dénoncer l’horreur de l’usage de telles armes sur des populations civiles.
Des témoins américains, un expert gallois lui font bientôt découvrir qu’à côté d’armes chimiques, des armes nucléaires à l’uranium appauvri et d’uranium enrichi. Mais que leurs enquêtes et démarches sont entravées, pour ne pas faire apparaître une vérité, qui pourtant frappe les générations ultérieures (comme du reste à Tchernobyl et à Fukushima). Revenu une autre fois en 2012 dans la ville, Feurat ne peut qu’informer sa famille du danger à rester dans ces lieux infestés… Sans qu’ils puissent envisager d’en partir.
Pour compléter notre compréhension de la situation actuelle de la ville, un récent reportage de TV5 Monde montre des touristes de Bagdad venant visiter une ville en cours de reconstruction et aux habitants exprimant un certain optimisme… Croyons-en l’augure !
Mais cet album est un témoignage à ne pas oublier.
Michel Wilson

« FRAGMENTS » exposition du peintre Farid Chaachoua, Galerie 41, Lyon, Mai 2022
 Farid Chaachoua est un peintre d’origine aurésienne bien connu des Lyonnais puisqu’il habite dans cette ville depuis 1998 et a déjà eu l’occasion d’y montrer sa production artistique, suffisamment nourrie pour qu’on puisse y reconnaître à la fois sa manière et son évolution.
Farid Chaachoua est un peintre d’origine aurésienne bien connu des Lyonnais puisqu’il habite dans cette ville depuis 1998 et a déjà eu l’occasion d’y montrer sa production artistique, suffisamment nourrie pour qu’on puisse y reconnaître à la fois sa manière et son évolution.
Pour ne parler que de ce que donne à voir son exposition actuelle (mai 2022), elle propose à la fois plusieurs formes de complexité et plusieurs raisons de séduire et de retenir l’attention.
Cela fait maintenant nombre de décennies que la peinture occidentale nous pose la même question : est-elle abstraite et figurative ? et dans le cas de Farid Chaachoua, on ne peut répondre que les deux à la fois, comme le prouvent notamment les titres qu’ils donnent ou ne donnent pas à ses tableaux, les uns n’évoquant rien d’autre que des questions purement techniques (« technique mixte sur papier », « acrylique sur papier »)parce qu’ils sont « sans titre », tandis que d’autres nous orientent vers des interprétations parfois chargées d’affectivité (« brisure », « mélancolie », « exils »). De toute façon, il serait difficile de trouver une vraie différence entre ces deux catégories, d’une part parce que la couleur et les lignes parlent d’elles-mêmes si l’on peut dire et impliquent une entière participation du peintre à ce qui est montré si « abstraitement » que ce soit, d’autre part parce qu’il est  rare qu’une ou des figures humaines ne se dégagent pas du tableau de manière à nous accrocher quitte à rester énigmatiques puisqu’on sait bien que dans un tableau tout ne s’explique pas et ne se réduit évidemment pas à un sens : lorsque figure il y a, le titre se réduit souvent au mot « portrait »—toutefois ne minimisons pas l’importance de cette mention, qui veut dire que nous regardons une personne, c’est-à-dire unique et à chaque fois distincte. Certains de ces portraits sont centrés sur l’humanité du personnage et suggèrent sa proximité avec nous, d’autres sont davantage une sorte de constat d’étrangeté et propres à nous perturber : « schizophrénie » nous dit le peintre, à moins que ce ne soit, présenté sur le mode humoristique, un autoportrait ? Les termes psychanalytiques font partie de son vocabulaire de référence, comme le prouvent deux tableaux de la récente série, qu’il intitule « forclos » : on sait que dans un certain langage, ce mot désigne ce qui est exclu du psychisme du sujet et donc voué à rester dans un hors champ inaccessible —on pourrait y voir une sorte de mise en garde du peintre lui-même qui nous prévient de ne pas chercher à surinterpréter ses tableaux ni même à les interpréter tout simplement, l’acte auquel nous sommes conviés étant d’abord et avant tout de les regarder tout simplement.
rare qu’une ou des figures humaines ne se dégagent pas du tableau de manière à nous accrocher quitte à rester énigmatiques puisqu’on sait bien que dans un tableau tout ne s’explique pas et ne se réduit évidemment pas à un sens : lorsque figure il y a, le titre se réduit souvent au mot « portrait »—toutefois ne minimisons pas l’importance de cette mention, qui veut dire que nous regardons une personne, c’est-à-dire unique et à chaque fois distincte. Certains de ces portraits sont centrés sur l’humanité du personnage et suggèrent sa proximité avec nous, d’autres sont davantage une sorte de constat d’étrangeté et propres à nous perturber : « schizophrénie » nous dit le peintre, à moins que ce ne soit, présenté sur le mode humoristique, un autoportrait ? Les termes psychanalytiques font partie de son vocabulaire de référence, comme le prouvent deux tableaux de la récente série, qu’il intitule « forclos » : on sait que dans un certain langage, ce mot désigne ce qui est exclu du psychisme du sujet et donc voué à rester dans un hors champ inaccessible —on pourrait y voir une sorte de mise en garde du peintre lui-même qui nous prévient de ne pas chercher à surinterpréter ses tableaux ni même à les interpréter tout simplement, l’acte auquel nous sommes conviés étant d’abord et avant tout de les regarder tout simplement.
Cette attitude implique-telle de notre part et de la part du peintre une certaine impassibilité ou neutralité, qui serait celle du regard « à l’état pur » si l’on peut dire, ? Il pourrait d’autant plus en être ainsi que les personnages des portraits, eux, ne nous regardent pas. Ils ont pourtant, souvent, des yeux immenses mais ne les tournent pas vers l’extérieur et font même plus précisément comme s’ils ne le voulaient pas. On pourrait alors parler d’un regard intérieur, sorte de fente ne laissant pas vraiment deviner ce qui se passe dans leurs énormes têtes, dans les cavernes profondes des lobes frontaux dont la taille semble démesurée, volontairement disproportionnée.
 Les personnages appartiennent à la matérialité de ce qui les entoure et qui est signifié surtout par les couleurs, distinctes et bien diversifiées, nullement simplificatrices, contribuant au contraire pleinement à la complexité du tableau. Celle-ci est tout autant prise en charge par le dessin, très délié mais nullement grêle pour autant, très affirmé et parfois même proliférant ; couleur et dessin sont aussi indispensables l’un que l’autre, étant entendu que la première renvoie plutôt à l’espace et à l’environnement et le second aux particularités individuelles, déterminées et aussi, pour jouer sur les mots, exprimant une détermination. Les créatures que fait surgir la peinture de Farid Chaachoua ne sont nullement des ectoplasmes, comme il arrive chez les peintres qui veulent montrer l’écrasement de l’humain dans le monde contemporain. Chez lui, les personnages sont schizophrènes peut-être ou menacés de le devenir, néanmoins têtus et quoi qu’il en soit des malheurs du temps (exils, errances, naufrages), à leur manière indestructibles.
Les personnages appartiennent à la matérialité de ce qui les entoure et qui est signifié surtout par les couleurs, distinctes et bien diversifiées, nullement simplificatrices, contribuant au contraire pleinement à la complexité du tableau. Celle-ci est tout autant prise en charge par le dessin, très délié mais nullement grêle pour autant, très affirmé et parfois même proliférant ; couleur et dessin sont aussi indispensables l’un que l’autre, étant entendu que la première renvoie plutôt à l’espace et à l’environnement et le second aux particularités individuelles, déterminées et aussi, pour jouer sur les mots, exprimant une détermination. Les créatures que fait surgir la peinture de Farid Chaachoua ne sont nullement des ectoplasmes, comme il arrive chez les peintres qui veulent montrer l’écrasement de l’humain dans le monde contemporain. Chez lui, les personnages sont schizophrènes peut-être ou menacés de le devenir, néanmoins têtus et quoi qu’il en soit des malheurs du temps (exils, errances, naufrages), à leur manière indestructibles.
 Les fils tracés par le dessin auraient pu les ligoter ou signifier leur annulation par un griffonnage. Ici pourtant le sentiment dominant n’est pas celui de la solitude individuelle, car le dessin sert aussi à relier, en sorte qu’assez étonnamment cette peinture ne signifie pas l’enfermement. Il y a de la mélancolie dans ce monde comme le disent certains titres et elle peut aller jusqu’à l’apathie, pour autant on ne parlera pas de désespoir, pas même d’une vision pessimiste de l’humanité . Vision dramatique plutôt et qui ne laisse aucun être en repos. Plusieurs tableaux parlent de « l’anima », alors pourquoi ne pas retenir de ce mot ce qu’il implique de vitalité : le peintre nous montre un monde animé, d’où les forces de mort sont rejetées vers l’extérieur par la volonté d’exister.
Les fils tracés par le dessin auraient pu les ligoter ou signifier leur annulation par un griffonnage. Ici pourtant le sentiment dominant n’est pas celui de la solitude individuelle, car le dessin sert aussi à relier, en sorte qu’assez étonnamment cette peinture ne signifie pas l’enfermement. Il y a de la mélancolie dans ce monde comme le disent certains titres et elle peut aller jusqu’à l’apathie, pour autant on ne parlera pas de désespoir, pas même d’une vision pessimiste de l’humanité . Vision dramatique plutôt et qui ne laisse aucun être en repos. Plusieurs tableaux parlent de « l’anima », alors pourquoi ne pas retenir de ce mot ce qu’il implique de vitalité : le peintre nous montre un monde animé, d’où les forces de mort sont rejetées vers l’extérieur par la volonté d’exister.
Denise Brahimi

« SUR LES TRACES DE FRANTZ FANON » film de Mehdi Lallaoui, 2021
Le titre de ce film n’est pas anodin. Il ne se donne pas pour un « biopic » ou film biographique racontant la vie d’un personnage par ailleurs connu pour son œuvre voir célèbre. Ce qu’il nous annonce est plutôt une sorte d’enquête, nécessairement partielle, visant à mettre en valeur quelques aspects d’une vie et/ou d’une œuvre suffisamment dignes d’intérêt pour qu’on ait envie d’en savoir plus à leur propos et qu’on parte à leur 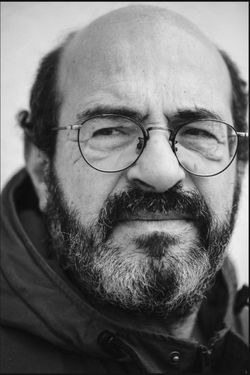 recherche. Mehdi Lallaoui le fait avec une évidente sympathie et une sorte de tendresse, même si le mot peut surprendre s’agissant de Fanon qui ne se pose jamais en séducteur, étant plutôt tragique et grave que souriant.
recherche. Mehdi Lallaoui le fait avec une évidente sympathie et une sorte de tendresse, même si le mot peut surprendre s’agissant de Fanon qui ne se pose jamais en séducteur, étant plutôt tragique et grave que souriant.
Du biopic le réalisateur n’a pas repris l’insistance sur la vie privée, son film veut manifestement éviter le registre de l’intime qui n’est pas son propos sans doute parce qu’il ne le juge pas approprié à son personnage, très peu bavard sur lui-même, comme on peut voir lorsqu’il annonce discrètement à une amie qu’il est atteint d’une leucémie, dont il mourra en effet à en décembre 1961 à l’âge de 36 ans (puisque né en 1925 en Martinique ) après avoir essayé en vain de la combattre. Fanon a voulu non pas se faire connaître mais faire connaître les idées qu’il exprime dans quelques grands livres dont le paradoxe remarquable est d’avoir été tirés d’une expérience immédiate mais de rester toujours aussi pertinents aujourd’hui. Il n’a pas pu défendre ses livres et les soutenir lui-même du fait de sa mort prématurée. Celle-ci peut paraître d’autant plus pathétique qu’elle précède de quelques mois l’accès de l’Algérie à l’indépendance, un événement évidemment crucial et pour lequel on peut dire que Fanon n’a cessé de militer activement pendant toute sa vie. Et c’est ce combat incessant que Mehdi Lallaoui a voulu montrer, à la fois à travers quelques  éléments factuels comme les déplacements de Fanon de France en Algérie puis d’Algérie en Tunisie lorsque ce pays devient indépendant à partir de 1956. Fanon se déplace à la fois pour pouvoir agir en tant que militant, c’est-à-dire échapper à la répression mais aussi pour continuer à exercer son métier de médecin psychiatre en contact avec les malades, l’épisode le plus connu , bien représenté dans le film, étant celui qui se passe à l’hôpital psychiatrique de Blida en Algérie où Fanon fut affecté en 1953. Les protestations qu’il élève alors contre la manière dont les malades sont traités fait à la fois partie d’une histoire générale de la psychiatrie et d’une dénonciation des violences exercées par le colonialisme, dont celle-ci n’est qu’un exemple parmi tous les autres.
éléments factuels comme les déplacements de Fanon de France en Algérie puis d’Algérie en Tunisie lorsque ce pays devient indépendant à partir de 1956. Fanon se déplace à la fois pour pouvoir agir en tant que militant, c’est-à-dire échapper à la répression mais aussi pour continuer à exercer son métier de médecin psychiatre en contact avec les malades, l’épisode le plus connu , bien représenté dans le film, étant celui qui se passe à l’hôpital psychiatrique de Blida en Algérie où Fanon fut affecté en 1953. Les protestations qu’il élève alors contre la manière dont les malades sont traités fait à la fois partie d’une histoire générale de la psychiatrie et d’une dénonciation des violences exercées par le colonialisme, dont celle-ci n’est qu’un exemple parmi tous les autres.
En fait sans adopter systématiquement la forme d’une biographie, le film de Mehdi Lallaoui suit d’assez près le cheminement (rapide voire fulgurant) de Frantz Fanon à l’ère de la décolonisation. Son constat est d’abord celui du racisme exercé par les Blancs sur les Noirs (c’est l’époque de « Peau noire masques blancs », paru en 1952) et c’est un thème qui restera toujours au fondement de sa réflexion. Mais celle-ci, 10 ans plus tard, dans « Les Damnés de la terre » (son dernier livre, écrit juste avant sa mort) est devenue, dans une urgence historique, la recherche des conditions pour qu’un « homme neuf » sorte des luttes révolutionnaires dans le cadre des Etats Nationaux—ce qui ne va pas sans dangers et risques de dévoiement.
Cette dernière partie de l’œuvre de Fanon et du legs qu’il a laissé derrière lui est liée à l’avance historique des pays africains qui ont été indépendants avant l’Algérie, comme ce fut le cas pour le Ghana en 1957 et la Guinée en 1958. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Fanon s’est mis à penser que toute connaissance utile venait désormais du continent africain, l’Algérie n’étant qu’un Etat africain parmi d’autres. Il est certain que ce qui a été très important dans ses ultimes expériences lui est venu à travers le cas absolument désolant du leader révolutionnaire congolais Patrice Lumumba, assassiné en Janvier 1961 après avoir été pendant quelques mois en 1960 premier Ministre de la République Démocratique du Congo, et c’est d’ailleurs démocratiquement qu’il avait été élu.
Importants aussi dans l’intense réflexion politique de Fanon les exemples de chefs africains comme Sékou Touré et Kwama Nkrumah, qu’il rapporte à l’Algérie dont l’indépendance est alors imminente. C’est dans une urgence pathétique que Fanon se met sur leurs traces, tant il est vrai que l’avenir de l’Algérie était pour lui un grand sujet d’inquiétudes. Le film de Mehdi Lallaoui, sans avoir l’air d’y insister, nous fait comprendre à quel point certaines d’entre elles étaient prémonitoires, et il faut souligner que bien peu nombreux étaient les penseurs politiques qui à l’époque osaient les formuler. On est forcément accablé de regrets lorsqu’on pense à tout ce que Fanon aurait pensé et dit de ce qui a accompagné l’indépendance algérienne. Il y a une vraie et profonde tristesse chez les leaders indu FLN qu’on voit au début du film à son enterrement. Cependant les plus proches de l’homme qu’il a été sont sans doute ses amis antillais qu’on entend assez longuement dans le film, tels que Patrick Chamoiseau et René Depestre.
 Frantz Fanon n’a certes jamais été oublié de ceux que l’idée de révolution préoccupe, mais l’on retire du film à cet égard une double impression : on ne parle certes pas autant de Frantz Fanon qu’il serait à la fois juste, utile et précieux de le faire dans le temps présent ; mais en même temps, sa mémoire et celle de ses œuvres restent vives et toujours prêtes à resurgir : ce pourrait être le cas depuis deux ou trois ans dans une Algérie à la recherche du hirak ou mouvement susceptible de lui ouvrir les voies d’un renouveau. Que l’on connaisse bien ou non l’œuvre de Frantz Fanon, on peut avoir l’impression et même la conviction qu’elle fournit des armes précieuses à ceux qui veulent se battre pour libérer « les damnés de la terre » de leur damnation. En donnant à voir le regard de cet homme exceptionnel, le film de Mehdi Lallaoui fait comprendre ce qu’a été et ce que reste son impact après plusieurs décennies : une piste à suivre sur ses traces, comme le dit judicieusement son titre.
Frantz Fanon n’a certes jamais été oublié de ceux que l’idée de révolution préoccupe, mais l’on retire du film à cet égard une double impression : on ne parle certes pas autant de Frantz Fanon qu’il serait à la fois juste, utile et précieux de le faire dans le temps présent ; mais en même temps, sa mémoire et celle de ses œuvres restent vives et toujours prêtes à resurgir : ce pourrait être le cas depuis deux ou trois ans dans une Algérie à la recherche du hirak ou mouvement susceptible de lui ouvrir les voies d’un renouveau. Que l’on connaisse bien ou non l’œuvre de Frantz Fanon, on peut avoir l’impression et même la conviction qu’elle fournit des armes précieuses à ceux qui veulent se battre pour libérer « les damnés de la terre » de leur damnation. En donnant à voir le regard de cet homme exceptionnel, le film de Mehdi Lallaoui fait comprendre ce qu’a été et ce que reste son impact après plusieurs décennies : une piste à suivre sur ses traces, comme le dit judicieusement son titre.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film,
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.
Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.

- Mercredi 1er juin, à Lyon, film At(H)ome d’Elisabeth Leuvrey au cinma Opéra, puis table ronde sur les essais nucléaires en Algérie, en partenariat avec l’Observatoire des Armements.
- Jeudi 2 juin à 19h à l’Université Lyon 2 Conférence du professeur Habib Kasdaghli sur Djerba, en partenariat avec le Consulat général de Tunisie de Lyon.
- Vendredi 3 juin 9 heures, intervention de témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au Lycée de la Plaine de l’Ain à Ambérieu en Bugey
- Vendredi 3 juin à la Mairie du 1er arrondissement, « Frantz Fanon et Lyon, d’hier à aujourd’hui » avec Alice Cherki, lectures du comédien Mohamed Brikat, conférence animée par Fafia Djardem, psychiatre, psychanalyste, présidente de Migrations santé Rhône-Alpes.
- Mardi 7 juin, intervention de témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au Lycée de la Mulatière
- Mardi 7 juin à Mon Ciné (Saint Martin d’Hères), projection et débat avec le réalisateur autour du film « Les visages de la victoire » de Lyèce Boukhitine
- Vendredi 10 juin au Centre social Peyri de Vaulx en Velin intervention de témoignages croisés sur la guerre d’Algérie
- Samedi 11 juin, projection et débat avec le réalisateur du film « Ne nous racontez plus d’histoires, de Ferhat Mouhali et Carole Filiu Mouhali.
- Mercredi 15 juin, au Cinéma la Fourmi de Lyon dans le cadre de « La caravane des cinémas d’Afrique » débat autour du film Les femmes du pavillon J.
- Mercredi 22 juin, au cinéma Les 400 coups de Villefranche sur Saône, projection et débat avec le réalisateur de « Les visages de la victoire » de Lyèce Boukhitine
- Vendredi 24 juin, à Villeurbanne, concert de Nouiba (chaabi) pour fêter l’association franco tunisienne Hendi
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

