Lettre culturelle franco-maghrébine #87
Éditorial
Edito
Nous vous proposons ce mois-ci trois livres aussi variés que possible, trois films qui le sont également et trois notes concernant de quelque manière les arts plastiques et les artistes. Voyons plus en détail ce programme substantiel où il va de soi que vous êtes invités à faire votre choix à moins que les nombreux loisirs du mois de mai ne vous incitent (la pluie aidant ?) à un intérêt pour toutes les formes de culture, pourquoi pas?
Les livres auxquels vous pourrez vous intéresser sont des sommes d’une grande richesse. Côté poésie (à ne jamais oublier ! ) il s’agit de l’œuvre du poète franco-algérien , Habib Tengour, dont parlent des commentateurs variés dans le livre intitulé «Les Portes du poème ». Le roman tient aussi une place importante dans cette sélection, le romancier algérien Rachid Mokhtari affichant sa volonté de situer ses personnages dans le tissu historique sur plusieurs générations, non sans une grande distance critique par rapport à ses propres sources, la photographie par exemple (d’où le tire du roman : «Photos de famille ») et aussi à l’égard du discours politique officiel. Enfin pour nous aider à comprendre la culture algérienne, l’ouverture d’esprit dont témoigne Hédia Bensahli dans « L’Algérie juive »est un antidote précieux à de préjugés trop répandus.
Nombreux parmi vous ont déjà vu le film algéro-brésilien de Karim Aïnouz, «Marin des montagnes» dont le grand succès était peut-être inattendu. On se réjouit tout autant de celui que rencontre la réalisatrice marocaine, Leïla Kilani, pour son film « Indivision ». A côté de ces films qui atteignent une dimension internationale, nous ne devons pas oublier ceux dont le succès national mérite réflexion, tel que le marocain «Mon père n’est pas mort» d’Adil Fadili.
La note consacrée à Nicole de Pontcharra est un hommage plus que mérité à celle qui a tant fait pour notre connaissance des artistes marocains, aussi présente à Marrakech que dans notre région. Deux autres notes attirent votre attention sur des expositions offertes au plaisir des Lyonnais, celle de Farid Chaachoua qui de manière intéressante
qualifie son œuvre de «peinture narrative» et celle de Islem Haouati qui s’est entretenu de la sienne avec Michel Wilson.
Ce dernier n’a évidemment pas oublié les amateurs de BD, auxquels il présente le dictionnaire de Lazhari Labter sur la BD algérienne.
Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!
Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

 « Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).
Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.
Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LES PORTES DU POEME », hommage à Habib Tengour, éditions APIC, Alger 2022
Ce livre est un recueil d’articles écrits par une trentaine de contributeurs, dont beaucoup sont aussi des traducteurs et appartiennent au monde franco-allemand de la littérature et de l’édition. Les deux organisateurs qui en ont fait le choix et la présentation (Regina Keil-Sagawe et Hervé Sanson) ont eu le mérite de ne pas s’en tenir aux critiques les plus connu(e)s dans le domaine de la littérature maghrébine et algérienne, d’où le sentiment de nouveauté que donne cet hommage : on y trouve l’intervention de spécialistes qui sont au cœur des problèmes posés par la transmission de la poésie.
 La poésie est certes le genre dominant dans l’œuvre d’Habib Tengour mais il faut insister sur l’une de ses originalités assez rare : il est un grand maître de la prose poétique qu’on trouve dès le début de ses publications, dans les années 1970 (Habib Tengour est né en 1947). Son œuvre comporte aussi du théâtre et des essais, où la réflexion théorique est nourrie par son expérience personnelle.
La poésie est certes le genre dominant dans l’œuvre d’Habib Tengour mais il faut insister sur l’une de ses originalités assez rare : il est un grand maître de la prose poétique qu’on trouve dès le début de ses publications, dans les années 1970 (Habib Tengour est né en 1947). Son œuvre comporte aussi du théâtre et des essais, où la réflexion théorique est nourrie par son expérience personnelle.
Le livre est placé sous un double parrainage qui n’est pas des moindres, puisqu’il s’agit de Mohammed Dib (né en 1920, mort en 2003) et du poète arabe Adonis (né en 1930). Il se développe en cinq grandes parties.
La première comporte dans son titre ce mot « expérience » déjà évoqué, manière de dire que tout ce dont parle le poète vient de sa propre vie. L’origine de celle-ci se situe à Mostaganem en Algérie, mais la suite fait de lui un nomade et un citoyen du monde. A retenir, pour préciser ce point, le titre d’un article qu’il écrivait en 2016 : « L’Algérie est toujours là où je me trouve.» Et aussi, comme signe de cette origine jamais oubliée, la publication en 1997 du recueil intitulé « Gens de Mosta », sur un modèle emprunté à James Joyce.
La deuxième partie est consacrée au théâtre, c’est-à-dire à l’écriture théâtrale d‘Habib Tengour qui commence dès son adolescence en 1962 et comporte cinq pièces jusqu’à présent.
La troisième partie annonce une ouverture vers l’avenir, sur laquelle rebondit l’ article ou plutôt le poème du Marocain Abdellatif Laâbi, intitulé « Que restera-t-il ? ». On en retiendra que selon les propos de la poétesse franco-tunisienne Cécile Oumhani, Habib Tengour a l’art d’intégrer « un héritage littéraire savant et populaire » en lui donnant des accents très contemporains.
 La quatrième partie révèle dès son titre (même s’il semble d’abord obscur) la complexité du problème qu’il tente d’analyser : « Du poème au réel au poème » : il s’agit de savoir quels rapports le poème entretient avec la réalité, rapport indispensable et profond qui n’est en aucun cas de l’ordre de la reproduction ni de l’explication, et qui amène pourtant à concevoir une sorte de double démarche où vont de pair le poète et l’anthropologue. Une démarche qui reste forcément peu lisible (on croit comprendre qu’il en est ainsi pour le poète lui-même) d’autant qu’elle est fondée sur des allers-retours et des détours nécessaires : la grande diversité des articles réunis dans cette partie prouve une fois encore la subjectivité du travail par lequel peut se faire ce rapport à la réalité.
La quatrième partie révèle dès son titre (même s’il semble d’abord obscur) la complexité du problème qu’il tente d’analyser : « Du poème au réel au poème » : il s’agit de savoir quels rapports le poème entretient avec la réalité, rapport indispensable et profond qui n’est en aucun cas de l’ordre de la reproduction ni de l’explication, et qui amène pourtant à concevoir une sorte de double démarche où vont de pair le poète et l’anthropologue. Une démarche qui reste forcément peu lisible (on croit comprendre qu’il en est ainsi pour le poète lui-même) d’autant qu’elle est fondée sur des allers-retours et des détours nécessaires : la grande diversité des articles réunis dans cette partie prouve une fois encore la subjectivité du travail par lequel peut se faire ce rapport à la réalité.
La cinquième partie pose la question de la traversée entre les langues ou pour le dire plus banalement de la traduction—mais il est évident que le mot « banalement » ne signifie ici aucune simplicité, on a au contraire l’impression de toucher au cœur même de ce qui serait l’essence de la poésie.
Il suffit d’ouvrir ce livre pour voir de quel apport sont les dessins d’Hamid Tibouchi par ailleurs poète lui-même en même temps que peintre—il y d’ailleurs dans ce recueil un poème de lui, malicieusement en forme d’acrostiche—confirmant son empathie et sa proximité avec la création algérienne.
L’avantage de ce recueil vient de ce qu’il ne s’agit pas d’un ensemble d’écrits sur Habib Tengour mais qui plutôt sont mêlés aux siens au point d’en être inséparables. Nulle trace d’académisme dans cet hommage ! !
Denise Brahimi
« PHOTOS DE FAMILLE 1 » par Rachid Mokhtari, éditions Chihab Alger 2023
Ce livre est le premier de ce que l’auteur annonce comme une trilogie et comme il fait à lui seul 388 pages (ce qui paraît d’autant plus long que la plupart des romans algériens sont courts) on peut considérer que Rachid Mokhtari a entrepris de développer dans la durée une chronique romanesque dont seul le début nous est donné à lire pour le moment. Chronique dont on comprend qu’elle sera à la fois celle de l’Algérie tout entière et celle de quelques individus particuliers qui vont se succéder dans le temps avant de disparaître. 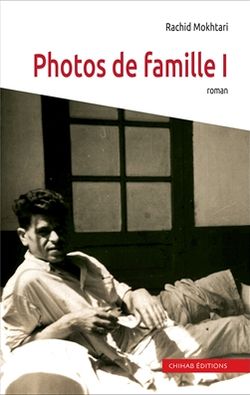 Dans ce premier volume de la trilogie, le personnage à retenir, avant sa disparition prématurée, se prénomme Omar ou Aomar, bien qu’il soit rarement désigné ainsi mais plutôt comme l’être de papier (ce bristol légèrement cartonné utilisé par les photographes) qu’il est resté après sa mort, notamment pour son fils auto-déclaré Narrateur de cette chronique. Il est aussi souvent nommé « le Soldat » ce qu’il fut principalement pendant les trente-et-un ans de sa courte vie, d’abord comme engagé volontaire à l’âge de 20 ans dans l’armée française qui se bat en Indochine, où il est sergent-chef du 7e RTA, puis en Algérie après le retour provoqué par la grave défaite de l’armée coloniale à Diên Biên Phu en 1954 ; mais comme l’Algérie est alors engagée dans la guerre d’indépendance, il déserte et rejoint en 1956 les rangs des maquisards, jusqu’au moment où, devenu officier de l’ALN, il est tué en 1959 dans les massifs forestiers de Fort National, à Sidi Ali ou Thaïr.
Dans ce premier volume de la trilogie, le personnage à retenir, avant sa disparition prématurée, se prénomme Omar ou Aomar, bien qu’il soit rarement désigné ainsi mais plutôt comme l’être de papier (ce bristol légèrement cartonné utilisé par les photographes) qu’il est resté après sa mort, notamment pour son fils auto-déclaré Narrateur de cette chronique. Il est aussi souvent nommé « le Soldat » ce qu’il fut principalement pendant les trente-et-un ans de sa courte vie, d’abord comme engagé volontaire à l’âge de 20 ans dans l’armée française qui se bat en Indochine, où il est sergent-chef du 7e RTA, puis en Algérie après le retour provoqué par la grave défaite de l’armée coloniale à Diên Biên Phu en 1954 ; mais comme l’Algérie est alors engagée dans la guerre d’indépendance, il déserte et rejoint en 1956 les rangs des maquisards, jusqu’au moment où, devenu officier de l’ALN, il est tué en 1959 dans les massifs forestiers de Fort National, à Sidi Ali ou Thaïr.
Telle est l’histoire du « Soldat de Bristol » qui nous apprend peu de choses sur lui en dehors des faits objectifs mais beaucoup sur son environnement dans le ou les villages kabyles où se sont déroulés les épisodes de sa vie privée et notamment ses amours avec deux femmes dont l’une fut la mère du Narrateur.
Alors même qu’on le connaît si peu et qu’il a si peu vécu, mais justement pour cela, il est difficile de ne pas éprouver tendresse et détresse pour ce jeune homme vite effacé de l’histoire—sentiments que son fils le Narrateur n’explicite pas mais qui sont sans doute à l’origine de sa recherche éperdue, obsessionnelle, à travers les photos éparpillées qui sont les seuls vestiges du passé. Mais le livre dément en même temps l’idée trop facile que les  photos pourraient nous parler de ce passé : Non, nous dit Rachid Mokhtari, les photos ne parlent pas, au mieux peut-on tenter de les interpréter mais il faut pour cela aller contre beaucoup d’idées reçues, voire de falsifications volontaires, et c’est certainement la ou en tout cas une des significations principales de son livre, dressé à tous égards contre les manipulations de l’histoire qu’il dénonce avec beaucoup de mépris comme le fait dominant dans cette Algérie où il vit. Détournant de son sens le titre de Nathalie Sarraute, « L’ère du soupçon », on pourrait dire que c’est en effet à cette ère qu’il appartient, ainsi que de nombreux Algériens d’aujourd’hui (auxquels on pourrait d’ailleurs joindre un grand nombre de Marocains) qui se font dénonciateurs de ce qui se passe depuis plus de soixante ans dans leur pays.
photos pourraient nous parler de ce passé : Non, nous dit Rachid Mokhtari, les photos ne parlent pas, au mieux peut-on tenter de les interpréter mais il faut pour cela aller contre beaucoup d’idées reçues, voire de falsifications volontaires, et c’est certainement la ou en tout cas une des significations principales de son livre, dressé à tous égards contre les manipulations de l’histoire qu’il dénonce avec beaucoup de mépris comme le fait dominant dans cette Algérie où il vit. Détournant de son sens le titre de Nathalie Sarraute, « L’ère du soupçon », on pourrait dire que c’est en effet à cette ère qu’il appartient, ainsi que de nombreux Algériens d’aujourd’hui (auxquels on pourrait d’ailleurs joindre un grand nombre de Marocains) qui se font dénonciateurs de ce qui se passe depuis plus de soixante ans dans leur pays.
A l’égard des gens qui, de fait, détiennent le pouvoir depuis l’indépendance, Rachid Mokhtari n’a pas de mots assez durs, il les accable de son mépris. Ce sont principalement des politiques, ou supposés tels, en fait des profiteurs du régime issus du FLN, mais ils ne sont pas les seuls à être dénoncés et les militaires n’ont pas droit à la moindre estime, notamment ceux qui sont traités de pseudo-maquisards, les compagnons d’armes d’Aomar au maquis, qui se prennent pour des justiciers et qui se conduisent de manière « ignoble », ce mot étant de l‘auteur évidemment.
Il paraît normal que le terrorisme islamique soit lui aussi dénoncé, mais c’est l’occasion d’une remarque qui n’est peut-être pas bienvenue dans l’Algérie d’aujourd’hui. Du génocide accompli en Algérie pendant la décennie, il est dit qu’il a fait cinq fois plus de morts que les événements du 8 mai 1945, ce qui ne manque pas d’un certain courage dans un pays qui n’a pas perdu l’habitude de considérer comme inatteignable le degré des horreurs accomplies par le colonialisme.
Le point de départ de la famille qui sert de base à cette chronique étant la Kabylie, et notamment le village appelé Tamazirt, on s’attendrait peut-être à des jugements favorables de l’auteur sur cette région, mais ce n’est pas le cas notamment pour ce qui concerne les mœurs, d’autant que le narrateur, à travers lequel nous en jugeons, en a été gravement victime : nul ne semble choqué par le fait qu’ayant été enlevé à sa mère en 1953, il a été privé de la revoir pendant 13 ans ! Si la famille a eu un sens à l’époque du grand-père elle est devenue désormais un lieu de querelles et d’exclusion et le pouvoir des belles-mères s’exerce dans le sens d’un conservatisme qui va jusqu’à l’odieux.
S’agissant de la possibilité d’un album de famille au sens photographique, descriptif et narratif du terme, la position de l’auteur est singulière, donnant lieu à une pensée et à une écriture complexes. Cette possibilité, à la fois entrevue et déniée, s’exprime à travers l’usage ingénieux et surprenant d’un mode du verbe qui est l’irréel du passé : ce qu’il raconte, ou décrit, aurait pu composer un album de famille si…et encore si…mais il n’en a pas été ainsi et c’est sans doute pourquoi il vaut mieux renoncer à cette possibilité. En tout cas, lorsque s’achève ce premier volume de la trilogie, on n’a pas atteint la constitution d’un véritable album de famille, qui semblait l’objectif du récit.
Denise Brahimi
« L’Algérie juive, l’autre moi que je connais si peu », par Hédia Bensahli, éditions Altava, 2024
Hédia Bensahli s’appuie sur une riche bibliographie et renvoie souvent au travail des historiens, ce qu’elle ne prétend pas être elle-même, ayant écrit ces dernières années deux romans qui ont attiré l’attention sur son talent d’écrivaine. « L’Algérie juive » est un essai par lequel elle s’engage personnellement, prenant souvent le contrepied d’opinions émises dans son pays l’Algérie, de manière catégorique et sans nuance, contrairement à sa propre méthode qui consiste à opposer ses intuitions , observations et expériences à des idées reçues qui n’ont que trop souvent force de loi.
 Pour le dire d’abord très vite et de manière générale, Hédia Bensahli pense qu’on a sous-estimé et minimisé l’importance de la présence juive en Algérie et surtout qu’on a beaucoup trop insisté sur tout ce qui au fil du temps a opposé Juifs et Musulmans dans ce pays, alors que leurs liens et ressemblances ont été tout à fait évidents jusqu’à la fin de l’Algérie Française et jusqu’au départ des Juifs algériens vers d’autres lieux, la France principalement.
Pour le dire d’abord très vite et de manière générale, Hédia Bensahli pense qu’on a sous-estimé et minimisé l’importance de la présence juive en Algérie et surtout qu’on a beaucoup trop insisté sur tout ce qui au fil du temps a opposé Juifs et Musulmans dans ce pays, alors que leurs liens et ressemblances ont été tout à fait évidents jusqu’à la fin de l’Algérie Française et jusqu’au départ des Juifs algériens vers d’autres lieux, la France principalement.
Forte de sa conviction, l’autrice se lance dans un parcours historique en 200 pages, qui comporte deux parties principales, la première allant jusqu’à 183O et l’autre couvrant la période coloniale. Il apparaît, dit l’auteure que « des brassages de populations diverses ont bien eu lieu en Algérie depuis la nuit des temps, et nous sommes bien la résultante de cette stratification ». On croit comprendre que des communautés juives importantes ont existé au Maghreb bien avant les Romains, et bien avant aussi que n’y arrivent les premiers chrétiens. Ce qui incite à évoquer des « juifs berbères » ou juifs d’Afrique, catégorie différente de celle des Juifs côtiers ou Juifs citadins du littoral. Lorsque se développe une concurrence entre Juifs et Chrétiens, les premiers ont tendance à se rapprocher des tribus berbères païennes pour les convertir. En tout cas l’existence de tribus berbères judaïsées est très bien attestée à l’époque historique.
S’agissant de la période musulmane, un des termes dont on dispose pour aborder le vaste sujet des rapports entre juifs et musulmans est la « dhimma, mot d’origine arabe désignant un régime juridique bien particulier, cependant plus variable et moins saisissable que dans la version tendancieuse qui en est donnée fréquemment. Ce statut pesant sur les personnes non musulmanes entraîne le versement d’une taxe au profit des personnes dominantes par les populations dominées. La dhimma a sans aucun doute un caractère discriminatoire qui ne va évidemment pas jusqu’à créer au sein du corps social ce qu’on a appelé plus tard un apartheid, mais dont on a pu parler comme d’un caractère stigmatisant et humiliant pour ceux qui le subissaient. Hédia Bensahli invite cependant à ne pas en juger « à partir de notre perception moderne, actuelle, modelée sur la base des droits internationaux mis en place pour le respect des personnes». Elle pense aussi qu’en Algérie, la représentation des rapports judéo-musulmans a souvent été le fait d’auteurs colonialistes qui en ont profité pour discréditer aussi bien chacun des deux partis en présence.
 Cependant, lorsqu’advient la colonisation à partir de 1830, les Juifs sont supposés affranchis de ce statut discriminatoire qu’est la dhimma. Mais la société n’en est pas moins scindée en deux, ô combien gravement ! : « Les sujets indigènes, juifs et musulmans d’un côté, et les citoyens français de l’autre » : tous les indigènes sont dévalorisés et soumis à des mesures répressives arbitraires. Le rappel de plusieurs épisodes historiques connus (notamment liés aux combats de l’Emir Abdelkader) tend à prouver que les Juifs préfèrent la domination des Arabes à celle des Français ; ce dont le colonisateur n’a que faire, sa stratégie consistant à mettre les populations locales dos à dos.
Cependant, lorsqu’advient la colonisation à partir de 1830, les Juifs sont supposés affranchis de ce statut discriminatoire qu’est la dhimma. Mais la société n’en est pas moins scindée en deux, ô combien gravement ! : « Les sujets indigènes, juifs et musulmans d’un côté, et les citoyens français de l’autre » : tous les indigènes sont dévalorisés et soumis à des mesures répressives arbitraires. Le rappel de plusieurs épisodes historiques connus (notamment liés aux combats de l’Emir Abdelkader) tend à prouver que les Juifs préfèrent la domination des Arabes à celle des Français ; ce dont le colonisateur n’a que faire, sa stratégie consistant à mettre les populations locales dos à dos.
Toute l’étude à laquelle se livre l’auteure de ce livre consiste à montrer comment le 19e siècle colonial n’a cessé de creuser toujours davantage l’écart entre Juifs et Musulmans, en vertu du principe qui consiste à diviser pour mieux régner. Le très célèbre décret Crémieux, quelles que soient les intentions (nullement perverses) de son auteur, est évidemment un moment particulièrement grave et lourd de conséquences dans cette évolution. Celle-ci a été irréversible puisqu’elle a abouti au départ massif des Juifs en 1962.
Fidèle au projet général de son livre, Hédia Bensalhi refuse pourtant d’en finir sur cette note très négative, et elle consacre un de ses chapitres à deux personnages qui pour elle symbolisent ou plutôt incarnent l’appartenance immémoriale des Juifs à l’algérianité. Il s’agit de Daniel Timsit et de Pierre Ghenassia, morts l’un et l’autre aujourd’hui mais qu’il importe de ne pas laisser tomber dans l’oubli. Le premier a été militant du FLN pendant la guerre d’Algérie et s’est toujours considéré comme algérien, petit-fils de rabbin et né dans une famille judéo-berbère : situation dont il s’est très clairement expliqué dans ses récits dont le dernier est paru en 2002, année de sa mort (à l’âge de 73 ans). Le second s’est engagé dans les rangs de l’ALN et il est mort au combat en 1957, à l’âge de 17 ans. Il est pleinement à sa place dans le livre de Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Les juifs algériens dans la lutte anticoloniale, largement cité par l’auteure.
Denise Brahimi
« DICTIONNAIRE ALGERIEN ILLUSTRE DE LA BANDE DESSINEE ET DU DESSIN DE PRESSE 1962-2022 » de Lazhari Labter CROM Editions 2023
Journaliste, poète, éditeur, Lazhari Labter est aussi un remarquable connaisseur de bande dessinée, domaine dans lequel il est investi depuis son jeune âge. Il avait déjà édité un « Panorama de la Bande dessinée algérienne 1969-2009 », et publié chez Barzakh « M’Quidech 1969-2019 Une revue, une équipe, une école ». Fréquentant assidûment les festivals de bande dessinée, il dispose d’un riche fonds d’archives, dans lequel il puise généreusement pour ce splendide dictionnaire.
 Soulignons tout d’abord la remarquable construction de l’ouvrage, avec une introduction historique riche en informations. Elle est suivie d’ un répertoire des auteurs, dessinateurs, dessinateurs de presse et scénaristes, souvent accompagné de photos et de reproductions d’extraits de bandes. Sont ensuite inventoriés les nombreux magazines et journaux qui ont jalonné cette longue période, souvent à la vie courte, mais témoignant d’une volonté constante de distraire et instruire la jeunesse, et de donner un début de vie à des récits, leur permettant ensuite une édition en album. Une rubrique originale fait ensuite entrer lectrice et lecteur dans la galerie de portraits des principaux personnages des magazines. Mention spéciale à Bouzid et Zina, les personnages indestructibles de notre cher Slim. La suivante reprend les couvertures de 312 albums, ce qui témoigne de la richesse relative de la production algérienne. Vient enfin un inventaire et un descriptif des festivals, journées et rencontres, qui en Algérie, sont comme pour le livre des moments indispensables pour populariser les œuvres, le plus souvent très mal diffusées. Il faut bien sûr citer les 15 éditions du Festival International de la Bande Dessinée d’Alger, mais aussi d’autres rencontres dans diverses villes algériennes, soit thématiques, soit spécialisées comme par exemple sur le manga, discipline bien développée en Algérie, et qui reçoit une notable reconnaissance du Japon. Ces festivals connaissent un grand succès, et sont certainement un raison d’espérer pour l’avenir en Algérie d’un genre populaire, mais qui peine à trouver toute sa place.
Soulignons tout d’abord la remarquable construction de l’ouvrage, avec une introduction historique riche en informations. Elle est suivie d’ un répertoire des auteurs, dessinateurs, dessinateurs de presse et scénaristes, souvent accompagné de photos et de reproductions d’extraits de bandes. Sont ensuite inventoriés les nombreux magazines et journaux qui ont jalonné cette longue période, souvent à la vie courte, mais témoignant d’une volonté constante de distraire et instruire la jeunesse, et de donner un début de vie à des récits, leur permettant ensuite une édition en album. Une rubrique originale fait ensuite entrer lectrice et lecteur dans la galerie de portraits des principaux personnages des magazines. Mention spéciale à Bouzid et Zina, les personnages indestructibles de notre cher Slim. La suivante reprend les couvertures de 312 albums, ce qui témoigne de la richesse relative de la production algérienne. Vient enfin un inventaire et un descriptif des festivals, journées et rencontres, qui en Algérie, sont comme pour le livre des moments indispensables pour populariser les œuvres, le plus souvent très mal diffusées. Il faut bien sûr citer les 15 éditions du Festival International de la Bande Dessinée d’Alger, mais aussi d’autres rencontres dans diverses villes algériennes, soit thématiques, soit spécialisées comme par exemple sur le manga, discipline bien développée en Algérie, et qui reçoit une notable reconnaissance du Japon. Ces festivals connaissent un grand succès, et sont certainement un raison d’espérer pour l’avenir en Algérie d’un genre populaire, mais qui peine à trouver toute sa place.
Au fil de l’ouvrage, on peut constater que la vitalité du genre existe de longue date en Algérie, mais les nombreux auteurs, malgré une fonctionnement souvent solidaire, et des démarches collectives comme l’historique revue M’quidech ou plus récemment La taverne graphique ont de tout temps connu des difficultés. L’économie de la discipline est mal assurée, comme celle du livre en général : diffusion quasi inexistante, disparition des librairies. Deux éditeurs algériens diffusent de la BD, en fait uniquement des mangas : Z-Link et Kaza Editions. Dalimen publie des albums, à côté d’autres livres.
 Pour Lazhari Labter, parmi les pistes pour élargir la place de la BD en Algérie, les éditeurs classiques devraient lui faire une place dans leurs parutions. De même, la multiplication des manifestations autour de la BD favoriserait sa diffusion. Il évoque une autre piste, maghrébine : faire en sorte que les albums édités dans un pays du Maghreb puissent être simultanément édités dans les autres pays, en cession de droits, pour élargir les lectorats, stimuler une certaine émulation, et une mise en réseau des auteurs. L’édition de ce dictionnaire semble donner des idées à des éditeurs et autres acteurs du milieu en Tunisie où la démarche pourrait être imitée. A quand une encyclopédie de la Bande dessinée du Maghreb ?
Pour Lazhari Labter, parmi les pistes pour élargir la place de la BD en Algérie, les éditeurs classiques devraient lui faire une place dans leurs parutions. De même, la multiplication des manifestations autour de la BD favoriserait sa diffusion. Il évoque une autre piste, maghrébine : faire en sorte que les albums édités dans un pays du Maghreb puissent être simultanément édités dans les autres pays, en cession de droits, pour élargir les lectorats, stimuler une certaine émulation, et une mise en réseau des auteurs. L’édition de ce dictionnaire semble donner des idées à des éditeurs et autres acteurs du milieu en Tunisie où la démarche pourrait être imitée. A quand une encyclopédie de la Bande dessinée du Maghreb ?
Il faut aussi encourager la création de magazines de BD dont on sait qu’ils donnent à voir de nouvelles créations, ouvrant la porte à l’édition d’albums, et leur acquisition par le public.
Un signe récent et encourageant est à signaler, l’arrivée depuis quelques années dans le monde de la BD d’un grand nombre de créatrices, qui apportent leur talent propre, et aussi une approche plus courageuse de certains sujets, comme ceux liés au corps, au sexe, aux violences faites aux femmes. Citons Houria Kouza, Nawel Bouerad, Fella Matougui, Bouchra Mokhtari (Zozo), Rym Mokhtari, Soumeya Ouarezki, Hakima Touileb…
Les relations entre festivals existent depuis des années et peuvent s’intensifier (Sfax, Angoulême…). Pour le lectorat français et des autres pays francophones, on peut espérer que ces œuvres puissent aussi être diffusées dans d’autres pays, à l’image du travail important, mais encore trop solitaire que fait l’éditrice Alifbata de Marseille, dont nous avons commenté dans cette lettre plusieurs albums. Nous espérons faire intervenir prochainement Lazhari Labter chez nous pour évoquer son travail et ces pistes de développement.
Ce bel ouvrage va vite devenir un instrument indispensable aux amateurs de BD, notamment algériennes. Et peut ouvrir la voie à d’autres développements auxquels Coup de Soleil essaiera de contribuer.
Michel Wilson

Note d’information sur Nicole de Pontcharra
Nicole de Pontcharra, que nous connaissions bien, et dont nous avons commenté le dernier livre, est décédée le 2 novembre 2023 dans le village de la Drôme où elle habitait.
Nous empruntons aux éditions El Manar cette brève présentation de l’écrivaine et historienne de l’art dont le souvenir sera commémoré à Marrakech le 27 avril prochain.
 Nicole POSTNIKOVA de PONTCHARRA a passé une partie de son enfance à Marrakech. Femme de lettres et de culture, esprit curieux de tout, et ouvert à tous, Nicole de Pontcharra, citoyenne du monde de par ses origines, son parcours et ses amitiés, est restée très proche du monde et de la culture arabes — sans renier pour autant ses liens avec la Russie et l’Europe orientale.
Nicole POSTNIKOVA de PONTCHARRA a passé une partie de son enfance à Marrakech. Femme de lettres et de culture, esprit curieux de tout, et ouvert à tous, Nicole de Pontcharra, citoyenne du monde de par ses origines, son parcours et ses amitiés, est restée très proche du monde et de la culture arabes — sans renier pour autant ses liens avec la Russie et l’Europe orientale.
Conservateur-adjoint du Musée d’art contemporain de la ville de Grenoble, aux côtés de Pierre Gaudibert, elle a notamment initié en 1984 la première grande exposition collective de peinture marocaine contemporaine en France, et dirigé en 1999 le n° spécial de la Revue noire consacré au Maroc, ainsi que, avec Maâti Kabal, l’ouvrage Le Maroc en mouvement paru chez Maisonneuve et Larose. Deux ouvrages incontournables pour qui s’intéresse à la culture marocaine : ils font, avec précision, le point sur la situation de l’art dans ce pays.
Note sur l’exposition de Farid Chaachoua « Rétrospective 2006/2024 »
Le peintre expose en ce moment à Lyon des œuvres constituant sans doute une sorte de bilan à l‘usage des autres et peut-être au sien propre, tant il est vrai qu’un artiste a toujours besoin de savoir, par rapport à lui-même, où il en est. Même s’il n’entend suivre aucun projet prédéterminé qui pourrait contrarier son idée de la création artistique, dont Farid Chaachoua dit que pour lui elle « demeure un acte de liberté ».
 Cette prise de conscience de lui-même et de son art s’accommode en revanche fort bien d’un regard rétrospectif comme celui qu’il propose dans son exposition actuelle « Rétrospective 2006/2024 », période considérable pour un artiste qui ne cesse d’être en recherche. Lui seul pourrait dire sans doute à quel point il éprouve le double sentiment d’un renouvellement et d’une continuité.
Cette prise de conscience de lui-même et de son art s’accommode en revanche fort bien d’un regard rétrospectif comme celui qu’il propose dans son exposition actuelle « Rétrospective 2006/2024 », période considérable pour un artiste qui ne cesse d’être en recherche. Lui seul pourrait dire sans doute à quel point il éprouve le double sentiment d’un renouvellement et d’une continuité.
S’agissant de cette dernière, qui pourrait constituer ce qu’il désigne comme son « style », on est incité à parler de ce qu’il appelle une « peinture narrative », expliquant clairement (et c’est un immense mérite !) que c’est une combinaison d’abstraction et d’éléments figuratifs, nous laissant le soin d’apprécier le dosage de l’une et des autres dans ce qu’il met sous nos yeux. On peut supposer que les faits d’actualité et l’environnement social exercent une pression en faveur des éléments figuratifs mais le propre d’un artiste comme lui est de les décaler de plusieurs manières : l’un de ses tableaux s’intitule « Gaza 2015 » : si l’on veut parler de continuité, en voilà une qu’il n’a pas choisie, hélas ! non plus que celle qui lui fait intituler certains tableaux « Décombres » ou « Désolation ». Mais la véritable continuité, plus encore que celle de certaines situations historiques, est celle du regard d’artiste qu’il porte sur elles, ou pour le dire encore plus simplement, de sa sensibilité. C’est d’elle que dépend ce qu’il appelle sa démarche, et dont il s’avère qu’elle est de toute façon fort complexe.
Denise Brahimi
Note sur l’EXPOSITION « PORTRAITS DE LUTTES »Photographies de Islem HAOUATI 17 avril/4 mai ancien Collège Truffaut 4 place du lieutenant Morel à Lyon
L’association Pour la suite du monde en quête de nouveaux récits a organisé cette exposition du photographe algérien Islem Haouati dans un nouveau et beau lieu créé dans l’ancien collège François Truffaut dans le premier arrondissement de Lyon.
 Islem Haouati, natif de Blida a une formation d’architecte qu’il a complétée par des études aux Beaux-Arts à Quimper, et des études de scénographie. La photographie il la pratique de longue date avec une approche de photographie documentaire, un intérêt pour la « street photography », qui touche les personnes, les foules, et les architectures. Installé en France en 2017, aujourd’hui à Paris, il pratique ces différents métiers, le dessin, des installations, des vidéos artistiques…
Islem Haouati, natif de Blida a une formation d’architecte qu’il a complétée par des études aux Beaux-Arts à Quimper, et des études de scénographie. La photographie il la pratique de longue date avec une approche de photographie documentaire, un intérêt pour la « street photography », qui touche les personnes, les foules, et les architectures. Installé en France en 2017, aujourd’hui à Paris, il pratique ces différents métiers, le dessin, des installations, des vidéos artistiques…
Les trois thèmes traités dans cette exposition de photos en noir et blanc illustrent son approche de la photographie des foules et du mouvement, mais aussi « des vies que nous croisons sans les voir » : les manifestations qui ont suivi la mort du jeune Nahel tué par un policier : « Islem Haouati : j’ai assisté à la manifestation de soutien suivie d’émeutes, puis une semaine plus tard à la cérémonie d’enterrement de Nahel. En accord avec l’association de quartier qui organisait, j’ai pu prendre des photos, tout en prenant garde à préserver et respecter l’intimité des moments familiaux. En tant qu’étranger, je suis particulièrement sensible à la question des morts violentes de jeunes, notamment d’origine algérienne, en France, me représentant que si j’avais moi même des enfants je ne voudrais pas qu’ils soient ainsi en danger. Dans mes photos, notamment des moments d’émeutes, je cherche à mettre en avant la tension, plus que la confrontation et l’affrontement entre les jeunes et la police ».
les manifestations actuelles en soutien aux Palestiniens de Gaza ; « Islem Haouati : je développe cette série sur les manifestations pour signifier mon propre engagement et le soutien que je porte pour la Palestine. En Algérie, on grandit avec une grande fraternité, un lien très fort pour la Palestine ».
La troisième série, un peu plus ancienne a été faite en Algérie dans des camps de réfugiés sahraouis, et représente des visages d’enfants dans un écran de télévision.
 Toutes ces photos montrent un regard empathique et pénétrant sur les humains, seuls ou en foule. En Algérie Islem a longtemps photographié des sans abris dans les rues de villes algériennes, leur donnant en quelque sorte droit de cité. Lisons ce qu’en dit l’organisateur de l’exposition, Sébastien Escande : « Le photographe algérien Islem Haouati photographie ces mouvements sous forme d’images sobres en noir et blanc, relatant l’engagement des hommes et femmes dans des luttes pour la paix et la justice sociale, faisant de nombreux portraits dans la rue. Il photographie également d’autres manifestations telles que la marche contre les violences faites aux femmes. Ces manifestations qui rassemblent largement ont en commun de faire appel à la paix, à la justice sociale et à la résistance contre le racisme et la violence faite aux corps. Mobilisation anti-racistes et anti-sexistes en France- Islem Haouati nous amène à une réflexion décentrée de ces actualités françaises, en mettant en avant l’émotion, la force et l’engagement de corps en lutte. »
Toutes ces photos montrent un regard empathique et pénétrant sur les humains, seuls ou en foule. En Algérie Islem a longtemps photographié des sans abris dans les rues de villes algériennes, leur donnant en quelque sorte droit de cité. Lisons ce qu’en dit l’organisateur de l’exposition, Sébastien Escande : « Le photographe algérien Islem Haouati photographie ces mouvements sous forme d’images sobres en noir et blanc, relatant l’engagement des hommes et femmes dans des luttes pour la paix et la justice sociale, faisant de nombreux portraits dans la rue. Il photographie également d’autres manifestations telles que la marche contre les violences faites aux femmes. Ces manifestations qui rassemblent largement ont en commun de faire appel à la paix, à la justice sociale et à la résistance contre le racisme et la violence faite aux corps. Mobilisation anti-racistes et anti-sexistes en France- Islem Haouati nous amène à une réflexion décentrée de ces actualités françaises, en mettant en avant l’émotion, la force et l’engagement de corps en lutte. »
Le choix presque exclusif du noir et blanc, dévoile Islem dans un article, correspond à sa vision un peu grise du monde. Mais paradoxalement porteuse de beaucoup de vitalité.
Nous recommandons de suivre sa page Instagram qui témoigne de la richesse de ce regard.
Michel Wilson

« MARIN DES MONTAGNES », film de Karim Aïnouz, 2021
En dépit de son nom très kabyle, qui lui vient de son géniteur, le réalisateur de ce film est brésilien, c’est au Brésil qu’il est né et qu’il a toujours vécu, près de sa mère brésilienne aussi longtemps qu’elle a été vivante, et en l’absence de son père algérien qui avait pourtant promis de venir les chercher sa mère et lui, sitôt terminée la guerre d’indépendance en Algérie. Cette présentation confond le réalisateur et son personnage, tant il est évident que le sujet du film est largement puisé dans l’autobiographie mais de celle-ci on ne sait jamais jusqu’où elle a été poussée, ni si elle est totale ou partielle. En tout cas, le film « Marin des montagnes » étant présenté comme « documentaire », on peut supposer que la part de la fiction y est réduite ou inexistante.
 L’essentiel du film consiste à montrer la découverte de l’Algérie par Karim Aïnouz lorsqu’il se décide enfin à aller voir le pays de son père, c’est-à-dire le village de Kabylie où vit encore ce qui reste de sa famille paternelle. Et ce retour au pays qui a été assez court semble-t-il est d’une grande originalité, non par suite d’un parti-pris ayant orienté ses choix, mais parce que, très normalement, il n’a pas la même vision que beaucoup de jeunes gens d’origine maghrébine qui vivant en France se décident un jour à aller voir le pays de leurs ancêtres—un pays dont pendant toute leur jeunesse et leur adolescence, ils ont beaucoup entendu parler !
L’essentiel du film consiste à montrer la découverte de l’Algérie par Karim Aïnouz lorsqu’il se décide enfin à aller voir le pays de son père, c’est-à-dire le village de Kabylie où vit encore ce qui reste de sa famille paternelle. Et ce retour au pays qui a été assez court semble-t-il est d’une grande originalité, non par suite d’un parti-pris ayant orienté ses choix, mais parce que, très normalement, il n’a pas la même vision que beaucoup de jeunes gens d’origine maghrébine qui vivant en France se décident un jour à aller voir le pays de leurs ancêtres—un pays dont pendant toute leur jeunesse et leur adolescence, ils ont beaucoup entendu parler !
La distance réelle induit sans doute une distance mentale : ce n’est pas la même chose de traverser l’Atlantique (en bateau) que la Méditerranée. Mais surtout, sa mère elle-même n’ayant jamais connu l’Algérie, le narrateur du film n’a jamais entendu parler de ce pays en connaissance de cause. Par une sorte de renversement de la situation habituelle, c’est lui qui pendant tout son voyage, raconte ce qu’il découvre à sa défunte mère, s’adressant à elle par-delà la mort avec une grande proximité. Proximité affective parce qu’elle est l’effet de son amour pour sa mère. Elle est l’inverse de l’éloignement qu’il ne peut manquer de ressentir pour ce pays dont il ne sait rien, mais le film se situe au moment où les positions sont en train de changer puisque le Brésilien-Kabyle a enfin l’occasion de tout savoir (ou presque) en ouvrant grand ses oreilles et ses yeux.
Jusqu’à ce moment du voyage, l’Algérie avait à peine une sorte d’existence virtuelle dans son imaginaire. La découvrir ne saurait être pour lui une confrontation avec des souvenirs. En fait elle apparaît dans le film comme une sorte de vision, un peu onirique peut-être et qui ne peut donner lieu de sa part à une description réaliste, ce dont témoignent les couleurs qui sont celles d’une œuvre d’art, et ne cherchent pas l’exactitude.
 C’est pourquoi le sentiment de vérité dont le film nous fait part est d’un autre ordre que celui qu’on tirerait d’un reportage minutieux, photographique ou filmique. De manière assez paradoxale, la vie du village kabyle, qui est montrée dans toute sa rudesse et sa rusticité, n’en produit pas moins une impression légère d’enchantement : le visiteur est sans préjugé, il se laisse porter sans appréhension ni réticence, alors même qu’il est à mille lieues de son monde habituel, immergé soudain dans un autre qui lui est étranger. Son impression dominante est sans doute l’étonnement, mais il n’en laisse rien paraître, et de toute façon, si étrangeté il y a, elle n’a rien d’inquiétant. L’idée qu’il est là chez lui semble évidente chez eux qui l’accueillent, qu’ils soient ou pas des membres de sa famille, et on a l’impression qu’il est gagné lui aussi par ce même sentiment. C’est la même étrangeté qu’on ressent dans certains contes de fées et sans doute pressent-il qu’il pourrait s’ensuivre pour lui une sorte d’envoûtement— d’où la décision qu’il prend de partir assez vite pour y échapper. Il sait bien qu’il lui faut regagner son monde, après le passage par cette parenthèse qu’il serait excessif de dire enchantée, mais étonnante sûrement. En passant par la ville d’Alger pour atteindre de là la Kabylie, il a éprouvé des impressions de cette sorte, non sans beaucoup de contradictions, et d’inattendu : ayant entendu des jeunes garçons décrire leur quotidien comme une routine sans avenir et sans joie, le voilà qui tombe par hasard sur une autre groupe, même âge, même apparence, mais qui chante, danse et s’amuse avec une incroyable vitalité. Le narrateur n’est sans doute pas du genre à se contenter d’idées reçues mais son voyage en Algérie les aurait bousculées de toute façon, au cas où il en aurait eu.
C’est pourquoi le sentiment de vérité dont le film nous fait part est d’un autre ordre que celui qu’on tirerait d’un reportage minutieux, photographique ou filmique. De manière assez paradoxale, la vie du village kabyle, qui est montrée dans toute sa rudesse et sa rusticité, n’en produit pas moins une impression légère d’enchantement : le visiteur est sans préjugé, il se laisse porter sans appréhension ni réticence, alors même qu’il est à mille lieues de son monde habituel, immergé soudain dans un autre qui lui est étranger. Son impression dominante est sans doute l’étonnement, mais il n’en laisse rien paraître, et de toute façon, si étrangeté il y a, elle n’a rien d’inquiétant. L’idée qu’il est là chez lui semble évidente chez eux qui l’accueillent, qu’ils soient ou pas des membres de sa famille, et on a l’impression qu’il est gagné lui aussi par ce même sentiment. C’est la même étrangeté qu’on ressent dans certains contes de fées et sans doute pressent-il qu’il pourrait s’ensuivre pour lui une sorte d’envoûtement— d’où la décision qu’il prend de partir assez vite pour y échapper. Il sait bien qu’il lui faut regagner son monde, après le passage par cette parenthèse qu’il serait excessif de dire enchantée, mais étonnante sûrement. En passant par la ville d’Alger pour atteindre de là la Kabylie, il a éprouvé des impressions de cette sorte, non sans beaucoup de contradictions, et d’inattendu : ayant entendu des jeunes garçons décrire leur quotidien comme une routine sans avenir et sans joie, le voilà qui tombe par hasard sur une autre groupe, même âge, même apparence, mais qui chante, danse et s’amuse avec une incroyable vitalité. Le narrateur n’est sans doute pas du genre à se contenter d’idées reçues mais son voyage en Algérie les aurait bousculées de toute façon, au cas où il en aurait eu.
Le pays du père brille évidemment par l’absence de celui-ci mais il n’est pas triste pour autant. Les montagnes qu’on y voit imposent le respect, il en va de même pour la beauté des paysages et pour une sorte de franchise, très directe, dans la manière dont un nouveau venu comme lui est abordé par les habitants. On peut supposer que le fils (le réalisateur) reporte ces qualités sur le père qu’il n’a jamais connu, puisqu’il est né au Brésil, après la séparation (supposée provisoire et pourtant définitive) de ses parents. Alors que d’autres auraient peut-être présenté ce voyage tout entier comme un échec (il ne s’est rien passé, il n’a pas retrouvé son père perdu), rien ne donne à penser qu’il repart déçu, bien au contraire. La conclusion, s’il y en avait une à tirer, serait plutôt : c’était bien qu’il soit venu. Avec un zeste de « saudade »(ce mot portugais est employé dans le film) qui n’est pas de la tristesse mais une sorte de mélancolie non sans charme, liée à un manque que rien ne saurait combler.
Denise Brahimi
Rappelons que nous avions participé à une présentation de son film Nardjès .
Ce film tourné pendant le séjour en Algérie au cours duquel il tourne ce qui sera Marin des Montagnes retrace la journée du 8 mars 2019 d’une jeune femme comédienne algérienne pendant l’une des manifestation du Hirak, qui aura vu une intensification de la présence féminine dans les rassemblements qui vont se poursuivre. Tourné quasi clandestinement avec un smartphone, ce film donne un autre aspect du talent multiforme de Karim Aïnous.
Michel Wilson
« INDIVISION (Birdland ) » film de Leïla Kilani Maroc 2022
Leïla Kilani a certainement un tempérament d’activiste mais aussi une remarquable capacité d’invention qui transforme ses messages en œuvres créatrices. Il faut parler de messages au pluriel, une générosité particulièrement visible dans ce dernier film, qu’elle met d’emblée sous le signe de la pluralité en lui donnant un double titre. « Indivision », avant de prendre une signification symbolique, désigne d’abord le statut d’une grande propriété foncière comme la Mansouria près de Tanger qui sera continûment le lieu de l’action et son magnifique décor. « Birdland », le pays des oiseaux, évoque en revanche à la fois la richesse ornithologique de ce lieu et sa capacité poétique, bien éloignée des problèmes matériels que pose la gestion d’un tel domaine.
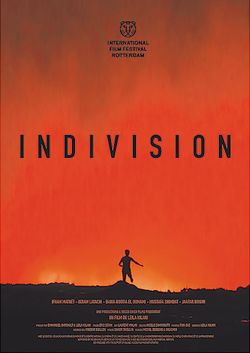 Si différents que soient les thèmes et les problèmes qu’elle aborde, la réalisatrice les fait fusionner de manière très intime alors même que selon les premières apparences on pourrait croire qu’il s’agit d’une simple juxtaposition. Mais une telle manière de faire serait incompatible avec ce qui la caractérise c’est-à-dire l’intensité avec laquelle elle s’immerge et nous immerge dans la violence des émotions, toutes origines confondues. Et l’on se rend compte très vite qu’il serait réducteur de vouloir les distinguer.
Si différents que soient les thèmes et les problèmes qu’elle aborde, la réalisatrice les fait fusionner de manière très intime alors même que selon les premières apparences on pourrait croire qu’il s’agit d’une simple juxtaposition. Mais une telle manière de faire serait incompatible avec ce qui la caractérise c’est-à-dire l’intensité avec laquelle elle s’immerge et nous immerge dans la violence des émotions, toutes origines confondues. Et l’on se rend compte très vite qu’il serait réducteur de vouloir les distinguer.
Rien n’est flou cependant et la vigueur de la réalisation ne nous laisse aucun doute sur les enjeux dont les personnages sont clairement porteurs. Au départ, on pourrait croire à une unité, donnée par le lieu. La Mansouria, vaste domaine largement boisé, appartient de longue date à la famille Bechtani—jusqu’au moment où commence le film, qui est la rupture de cette unité. Celle-ci est voulue et provoquée par la grand-mère Amina, maîtresse femme qui est encore belle et surtout implacable dans sa volonté. Nul n’y a semble-t-il résisté jusque là car elle est à la fois ouvertement autoritaire et insidieusement manipulatrice sans le moindre scrupule lorsqu’il s’agit d’arriver à ses fins.
Or Amina veut vendre la Mansouria, profitant du moment devenu opportun du fait qu’un promoteur immobilier est prêt à en donner un très bon prix. C’est à ce point que le drame éclate, et que vole en éclat l’équilibre ancien. Celui-ci était sinon fragile du moins complexe, du fait des intérêts et caractères divergents au sein de la famille Bechtani, mais aussi en dehors d’elle, car la Mansouria est un lieu de vie pour tous ceux qui y ont trouvé leur place, si modeste soit-elle : de ceux qu’au moyen-âge on aurait sans doute appelé des gueux, car ils sont pauvres en effet, et ne survivent que grâce à cette indivision, dont le titre du film rappelle l’importance et l’ancienneté immémoriale.
 Leïla Kilani ne les montre pas directement dans son film car elle a un autre moyen, visuellement très supérieur, d’illustrer ce qu’est un espace indivis et laissé ouvert à la liberté d’une vie que rien ne vient encadrer ni contraindre : c’est le monde merveilleux et pourtant bien réel des oiseaux qui habitent les arbres de la Mansouria et son ciel, et qui en sont l’autre moitié, opposée en tout à celle que représente la famille Bechtani. Et par-delà cette opposition les deux titres fusionnent car c’est seulement en restant indivise que la Mansouria est offerte au monde des oiseaux, Birdland, devenant du même coup l’enjeu des affrontements au sein de la famille en guerre. Car oui, c’est bien de guerre qu’il s’agit, autre nom des luttes sociales auxquelles Leïla Kilani se montre si sensible depuis le début de son œuvre filmique, inaugurée par « Sur la planche » en 2012. Quiconque a vu ce film sait que les moyens utilisés par les ouvrières ne sont en rien conformes à l’orthodoxie syndicale en matière de lutte des classes. La Mansouria d’«Indivision » ne donne pas les mêmes possibilités que la Tanger populaire des prolétaires au féminin, mais dans ce dernier film le combat est mené aussi par deux personnages féminins, qui s’opposent à leur manière à la redoutable Amina.
Leïla Kilani ne les montre pas directement dans son film car elle a un autre moyen, visuellement très supérieur, d’illustrer ce qu’est un espace indivis et laissé ouvert à la liberté d’une vie que rien ne vient encadrer ni contraindre : c’est le monde merveilleux et pourtant bien réel des oiseaux qui habitent les arbres de la Mansouria et son ciel, et qui en sont l’autre moitié, opposée en tout à celle que représente la famille Bechtani. Et par-delà cette opposition les deux titres fusionnent car c’est seulement en restant indivise que la Mansouria est offerte au monde des oiseaux, Birdland, devenant du même coup l’enjeu des affrontements au sein de la famille en guerre. Car oui, c’est bien de guerre qu’il s’agit, autre nom des luttes sociales auxquelles Leïla Kilani se montre si sensible depuis le début de son œuvre filmique, inaugurée par « Sur la planche » en 2012. Quiconque a vu ce film sait que les moyens utilisés par les ouvrières ne sont en rien conformes à l’orthodoxie syndicale en matière de lutte des classes. La Mansouria d’«Indivision » ne donne pas les mêmes possibilités que la Tanger populaire des prolétaires au féminin, mais dans ce dernier film le combat est mené aussi par deux personnages féminins, qui s’opposent à leur manière à la redoutable Amina.
L’une d’entre elles est la jeune bonne Chinwuya, qu’on voit d’abord soumise à l’exploitation traditionnelle et illimitée pratiquée par la maîtresse de maison jusqu’au moment où elle entre en rébellion. L’autre est Lina, la petite-fille d’Amina et fille de son fils Anis, enfant ou adolescente de 13 ans devenue muette et partiellement autiste à la suite du traumatisme qu’a été la mort de sa mère. Elle communique avec les oiseaux et autres forces naturelles ou mythiques qui restent occultes c’est-à-dire inaccessibles pour les adultes dits normaux. C’est pourquoi Lina fait peur à tout le monde y compris à sa redoutable grand-mère, alors que son père Anis et la jeune bonne Chinwuya l’aiment et la protègent, formant ainsi un pôle de résistance qui s’avère efficace contre les menaces sur la Mansouria. On retrouve ici la même fusion que précédemment entre les moyens sociaux et juridiques et les échappées vers le poétique ou l’irrationnel. Usant des premiers, Anis, belle figure de poète anarchiste, transforme sa part d’héritage en bien « habous », c’est-à-dire inaliénable en droit musulman ; c’est donc lui qui rend la vente impossible, alors que tous les autres le croyaient inapte et inoffensif ! Lina de son côté bouleverse les plans matérialistes et financiers en entraînant tout le monde vers les domaines de l’irrationnel auquel son « autisme » si c’en est un lui donne accès. Ainsi s’invente une utopie par des voies que Leïla Kilani se plaît à désigner comme celles d’une « résistance écopoétique » : le monde vivant non humain vient au secours de nos sociétés menacées.
Denise Brahimi
« MON PERE N’EST PAS MORT », film marocain d’Adil Fadili 2023
Ce film appartient à une riche et importante production marocaine qui revient actuellement sur une période qu’on pourrait croire révolue, celle du Roi Hassan II mort en 1999 alors que son pays était devenu indépendant de la France depuis 1956. Manifestement les Marocains ont besoin de repenser un certain nombre d’événements, sans doute parce qu’ils ne leur paraissent pas suffisamment élucidés voire occultés. Dans le cadre de ces mises au point et précisions nécessaires, le film d’Adi Fadili affirme très clairement que nombre de Marocains ne se sont pas laissés duper par une confusion volontaire de la part du pouvoir et qu’ils ont même été nombreux à mourir du fait de leur refus. L’indépendance acquise sur le plan politique était évidemment incontestable, mais elle ne signifiait en aucune façon que le pays avait accédé à la démocratie. Le moins qu’on puisse dire est que le Roi a immédiatement exercé un pouvoir fort et répressif, grâce à une police redoutable et à ses services secrets.
 Tout cela est très clairement montré dans le film d’Adil Fadili. L’action se passe tout entière dans le cadre d’un cirque, ou plutôt celui-ci fait partie de ce que les gens appellent la foire, grand divertissement populaire comportant des attractions nombreuses et géré par un patron despotique, ce qui peut amener à voir dans cette foire une sorte de métaphore du pays tout entier. Il y a aussi dans la foire des possibilités d’ émerveillement auxquelles est sensible un jeune garçon d’une dizaine d’années, Malik, devenu muet à la mort de sa mère et dont le père travaille dans le cirque, non sans avoir des activités politiques clandestines, jusqu’au jour où la police l’arrête et le fait disparaître sans la moindre explication. Quelques vaillants résistants à l’oppression, mais ils ne sont pas légion, veulent aider Malik à retrouver son père mais on assiste plutôt aux échecs de leur recherche.
Tout cela est très clairement montré dans le film d’Adil Fadili. L’action se passe tout entière dans le cadre d’un cirque, ou plutôt celui-ci fait partie de ce que les gens appellent la foire, grand divertissement populaire comportant des attractions nombreuses et géré par un patron despotique, ce qui peut amener à voir dans cette foire une sorte de métaphore du pays tout entier. Il y a aussi dans la foire des possibilités d’ émerveillement auxquelles est sensible un jeune garçon d’une dizaine d’années, Malik, devenu muet à la mort de sa mère et dont le père travaille dans le cirque, non sans avoir des activités politiques clandestines, jusqu’au jour où la police l’arrête et le fait disparaître sans la moindre explication. Quelques vaillants résistants à l’oppression, mais ils ne sont pas légion, veulent aider Malik à retrouver son père mais on assiste plutôt aux échecs de leur recherche.
Il est d’autant moins facile de savoir ce qu’il en adviendra finalement que le ton du film n’est pas celui d’une enquête rigoureuse, mais plus souvent, du fait que le spectateur voit à travers les yeux de Malik, on se meut dans une sorte de conte pour enfant, un enfant très mature il est vrai, qui découvre le monde et s’y emploie au fil d’aventures diverses : on pourrait parler d’un conte initiatique, au sens où il s’agit de comprendre peu à peu ce qui est d’abord obscur ou caché et le film nous dit qu’un garçon comme Malik est plus doué pour cela que les adultes : il va partout et rien ne lui échappe ; même s’il ne le dit pas, ne serait-ce que parce qu’il est muet, il est mu par un désir du père encore accru par l’absence de mère, et bien qu’il trouve en chemin des pères de substitution qui seraient volontaires pour ce rôle, lui ne s’y trompe pas: quoi qu’il en soit, ils ne sont pas le père et ne peuvent pas l’être, telle est la ligne directrice du film, celle qui maintient le film dans son projet en dépit de ses allures fantaisistes et de ses vagabondages : on passe allégrement du sacrifice d’Isaac par son père Abraham au « Dormeur du val » de Rimbaud, c’est un autre sens du mot « foire » pour désigner un lieu où tout se trouve même et surtout dans le plus grand désordre , ce qui peut aller jusqu’à la « foire d’empoigne » lorsque les acteurs se laissent aller à leur véhémence. D’ailleurs, c’est bien d’une foire d’empoigne qu’il s’agit dans ce Maroc livré sans contrôle aux appétits des plus forts.
 Adil Fadili parlant de son film se montre fidèle aux goûts et aux enthousiasmes de sa jeunesse qui le poussent en tant que cinéaste à « dénicher une histoire captivante, capable d’interpeller le public et de l’emporter dans un voyage captivant ». Son film est très apprécié du public marocain sans doute parce qu’il a su ne rien sacrifier de ses multiples aspects. Sa part de revendication politique ne peut évidemment échapper à personne, mais rien ne manque pour autant au divertissement attendu d’un spectacle populaire. Le regard de l’enfant suscite le merveilleux, il y a assez de plaisanteries pour faire naître le rire, et abondance aussi de très bonne musique octroyée généreusement par un orchestre d’hommes accompagné de chanteuses ou « cheikhates »—d’ailleurs le film a obtenu un prix de la musique originale au festival de Tanger en 2023. On a l’impression que Mon père n’est pas mort est fait d’abord pour un public marocain, ce qui n’est pas exclusif évidemment ; cependant ce n’est pas toujours le cas, tant il est vrai que le sentiment d’appartenir à un pays mal connu ou méconnu peut inciter les réalisateurs à un cinéma de dévoilement, pour se faire connaître au regard des autres. En tout cas, le cinéma marocain n’est sûrement pas mort, on a le sentiment que dans sa diversité, il est plus vivant que jamais.
Adil Fadili parlant de son film se montre fidèle aux goûts et aux enthousiasmes de sa jeunesse qui le poussent en tant que cinéaste à « dénicher une histoire captivante, capable d’interpeller le public et de l’emporter dans un voyage captivant ». Son film est très apprécié du public marocain sans doute parce qu’il a su ne rien sacrifier de ses multiples aspects. Sa part de revendication politique ne peut évidemment échapper à personne, mais rien ne manque pour autant au divertissement attendu d’un spectacle populaire. Le regard de l’enfant suscite le merveilleux, il y a assez de plaisanteries pour faire naître le rire, et abondance aussi de très bonne musique octroyée généreusement par un orchestre d’hommes accompagné de chanteuses ou « cheikhates »—d’ailleurs le film a obtenu un prix de la musique originale au festival de Tanger en 2023. On a l’impression que Mon père n’est pas mort est fait d’abord pour un public marocain, ce qui n’est pas exclusif évidemment ; cependant ce n’est pas toujours le cas, tant il est vrai que le sentiment d’appartenir à un pays mal connu ou méconnu peut inciter les réalisateurs à un cinéma de dévoilement, pour se faire connaître au regard des autres. En tout cas, le cinéma marocain n’est sûrement pas mort, on a le sentiment que dans sa diversité, il est plus vivant que jamais.
Denise Brahimi
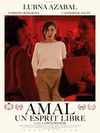 Note sur « Amal » par Yamna Sahli
Note sur « Amal » par Yamna Sahli
« Dans la prochaine Lettre (n°88) de Coup de soleil, Yamna Sahli, membre active de notre Association à plusieurs égards, vous proposera un commentaire du film (belge) de Jawad Rhalib : « Amal. Un esprit libre ».
Espérons que beaucoup d’entre vous l’auront vu pendant les semaines à venir et n’en apprécieront que davantage la lecture proposée par Yamna. »
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

- 29 avril Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Anna de Noailles à Evian
- 30 avril, Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Collège François Mugnier de Bons en Chablais
- 2 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Condorcet de Saint Priest, avec intervention de l’historien Paul Max Morin
- 3 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au collège Saint Exupéry de Lyon
- 6 mai Film marin des Montagnes au cinéma Le Mourguet à Sainte Foy les Lyon
- 7 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Hélène Boucher de Vénissieux
- 14 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Jacques Brel de Vénissieux
- 24 mai Film Indivision avec sa réalisatrice Leila Kilani au cinéma les Alizés de Bron
- 30 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au collège Paul d’Aubarède de Saint Genis Laval, puis au collège Paul Emile Victor de Rilleux la Pape
- 31 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Collège Louise de Savoie de Pont d’Ain
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


Bravo encore une fois pour ce numéro 67 toujours aussi instructif !
Omar Hallouche