Critique : roman « Hizya » de Maïssa Bey
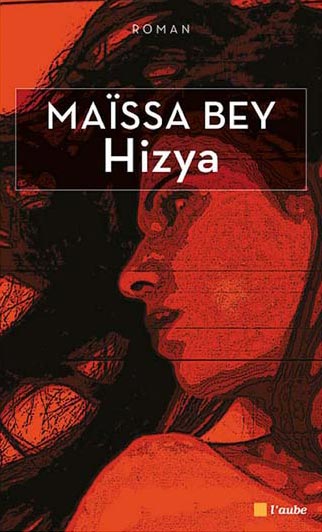
« Hizya » de Maïssa Bey, Éditions de l’Aube, 2015
Ce roman de Maïssa Bey, qui arrive après une douzaine d’autres, permet de comprendre et de confirmer ce qu’on pourrait appeler sa manière, dont on peut dire d’emblée qu’elle est à la fois discrète et efficace, laissant des traces profondes chez le lecteur alors même qu’il n’y a aucune recherche d’effet —et l’on constate même que l’auteure évite tous les effets rendus possibles par son sujet.
Ce sujet, du moins celui qui est très fréquemment le sien, est la manière dont vivent les femmes algériennes, le plus souvent celles d’aujourd’hui. C’est l’une d’entre elles qui a donné son nom ou plutôt son prénom au roman, mais ce point demande quelques précisions, car il y a non pas une mais deux Hizya entrecroisées, celle du passé et celle du présent, la première servant de figure mythique qui nourrit les rêveries de la seconde.
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Hizya a été l’héroïne d’une somptueuse et bouleversante histoire d’amour, elle a aimé et été aimée par Sayed mais elle est morte subitement un mois après leur mariage et cette belle « histoire d’amour et de mort » (c’est l’expression employée pour parler de « Tristan et Iseult ») a été chantée par le poète algérien Mohamed Ben Guittoun. Hizya la contemporaine est une jeune femme ordinaire appartenant aux classes moyennes mais un peu déclassée, parce qu’après des études universitaires qui ne débouchent sur aucun emploi, elle décide de travailler dans un salon de coiffure pour gagner sa vie et contribuer à faire vivre sa famille.
C’est évidemment dommage pour elle (et pour l’Algérie tout entière) de devoir accepter ce renoncement, mais l’auteure pas plus que son héroïne ne dramatisent la situation qui en découle, on a même l’impression qu’Hizya vit comme un privilège relatif le fait de pouvoir travailler à l’extérieur, grâce à la largeur d’esprit de son père qui ne se laisse pas influencer par les préjugés rétrogrades. On a d’autres occasions dans le roman de constater qu’Hizya n’est pas une malheureuse victime brimée par sa famille, encore moins maltraitée, ni empêchée de fréquenter un jeune homme de son choix—même s’il est évident, dans le contexte algérien, que cette relation se doit de rester clandestine. Mais contrairement à un cliché très répandu (qui sans doute correspond aussi à une réalité), lorsque son frère aîné la découvre par hasard avec ce garçon, il la rassure et lui accorde son soutien. C’est dire que Maïssa Bey se refuse à un certain misérabilisme qui n’est pas dans sa manière et qui serait ici nuisible plutôt qu’utile à son propos.
Précisons autant que possible ce qu’il en est de celui-ci : en dépit de ce qui vient d’être dit, la romancière ne fait nullement en la personne d’Hizya le portait d’une jeune femme algérienne à peu près heureuse, en tout cas autant qu’on peut l’être, et à peu près satisfaite sinon tout à fait comblée. La tonalité du livre, pour n’être ni violente ni tragique, n’en est pas moins mélancolique et désabusée. Il faut pour le comprendre en revenir à la première Hizya, celle qui nourrit les rêves d’amour de la seconde. Ce qui nous est dit dans le roman est que les rêves de celle-ci n’ont aucune chance de devenir réalités, et qu’en revanche ils laissent dans la vie de la jeune coiffeuse de vingt-trois ans une place en creux qui ne peut manquer d’être douloureuse, comme dans une amputation où l’on souffre du membre absent. Hizya est très consciente du fait qu’il manque quelque chose dans sa vie et que sans aucun doute ce quelque chose lui manquera toujours. Ce qu’elle n’arrive pas à trouver ou à créer est la possibilité d’un dépassement par rapport au quotidien morne et prévisible, elle souffre à cet égard d’une forme d’impuissance dont elle ne rend d’ailleurs personne responsable, ni elle-même ni les autres. Ce qui certes évite le drame mais ne permet aucune espèce de joie.
S’agissant d’une jeune femme insatisfaite, certains commentaires n’ont pas manqué le rapprochement avec l’Emma Bovary de Flaubert. Mais on sait que le romancier français conduit son héroïne à travers de terribles tribulations, adultère, endettement et finalement suicide dans d’horribles conditions. Maïssa Bey ne suggère rien de tel pour le sort à venir d’Hizya, tout se passe comme si l’âge de la tragédie ou du drame bourgeois était désormais relégué dans la légende ; et si l’on pense au beau poème chanté par son époux pour la première Hizya, c’est aussi de la poésie et du lyrisme qu’il ne saurait être question dans la vie de l’Algérienne contemporaine, comme s’il lui fallait payer ses quelques acquisitions récentes, bien réelles sans doute, à ce prix très frustrant d’une totale banalisation. L’auteure parle de ce qu’elle appelle « une vie ordinaire » et le plus terrible est qu’elle en parle, non comme d’un présent qui pourrait laisser place à quelque espoir pour l’avenir mais comme d’un futur totalement prévisible et déjà si l’on ose dire « bouclé ».
On pense aux propos recueillis de la bouche de certains « harragas », qui sont des hommes et non des femmes mais qui dans certains cas du moins (naturellement, il y a aussi les raisons politiques, économiques etc.) disent être partis parce qu’ils ne supportaient pas l’absence totale de perspective pour l’avenir. Ce ne serait donc pas le présent qui serait le plus dur à supporter mais l’avenir lorsque, si l’on ose dire paradoxalement, il n’y en a pas.
Cet état de stagnation a été propre aux femmes, entraînant leur apathie et leur résignation, dans bien d’autres pays que l’Algérie ; et pour ne parler que de la France, il n’est pas besoin de remonter plus loin que la première moitié du 20e siècle pour en trouver des exemples. Il est vrai que le propre des romanciers est souvent de pousser les choses à l’excès pour les rendre plus visibles et plus démonstratives ; ce n’est pas la manière choisie par Maïssa bey, et dans le contexte algérien, souvent paroxystique, son choix est appréciable.
Denise BRAHIMI

