Cultures franco-maghrébines – Lettre #20
ÉDITO
Le mois de mars voué au dieu de la guerre est, pour faire bonne mesure, celui où est honorée la moitié féminine de l’humanité.
Notre lettre de ce mois ne fait pas exception, et évoque plusieurs œuvres de femmes ainsi que des situations et des vies de femmes, vues par des femmes ou des hommes. Cela nous permet de découvrir plusieurs créations culturelles de belle qualité que nous avons plaisir à vous relayer.
Cette lettre se veut aussi votre lettre: n’hésitez pas à nous suggérer ou ne recommander telle exposition ou tel livre ou film à commenter.
Bonne lecture.
PS: Le menu de cette lettre était déjà copieux. Le passionnant film « Enquête au Paradis » de Merzak Hallouache sera chroniqué le mois prochain.
En attendant, vous pourrez le voir en présence d’une des personnes intervenant dans le film le 17 mars à Villefontaine (17h), le 18 mars au Toboggan de Décines (14h), le 19 mars à Bourg en Bresse (19h), le 20 mars à Nantua (20h30), le 21 mars à Villefranche sur Saône le 23 mars à Ciné Duchère (20h). Bravo à toutes ces salles, et GRAC qui ont organisé cette tournée. Nous les soutenons.
Michel Wilson.

« LES BIENHEUREUX », film algérien de Sofia Djama (2017) avec Nadia Kaci, Sami Bouadjila
 Visible en salles juste après le film de Karim Moussaoui En attendant les hirondelles, le film de Sofia Djama, qui connaît lui aussi un succès bien mérité, confirme un sentiment très euphorique : décidément, le cinéma algérien accède à une ère nouvelle et parvient à se faire reconnaître dans sa nouveauté, grâce à la réalisation talentueuse d’hommes et de femmes aptes à faire comprendre au public ce qu’il en est aujourd’hui même de leur pays.
Visible en salles juste après le film de Karim Moussaoui En attendant les hirondelles, le film de Sofia Djama, qui connaît lui aussi un succès bien mérité, confirme un sentiment très euphorique : décidément, le cinéma algérien accède à une ère nouvelle et parvient à se faire reconnaître dans sa nouveauté, grâce à la réalisation talentueuse d’hommes et de femmes aptes à faire comprendre au public ce qu’il en est aujourd’hui même de leur pays.
Quelques documentaires avaient été comme des hirondelles (pour parler comme Karim Moussaoui) annonçant cet autre printemps arabe, qui ne pouvait prendre la même forme qu’en Tunisie par exemple, du fait que toute l’histoire contemporaine de l’Algérie est marquée par ce terrible épisode qu’on appelle la décennie noire et qui est en effet le point de départ du tableau tracé dans Les Bienheureux. Avec beaucoup de retard, du fait de la politique officielle qui a privilégié la recherche d’un apaisement factice par occultation des événements, il semblerait que beaucoup d’Algériens découvrent maintenant et osent affirmer que ce terrible épisode (pas moins d’une dizaine d’années) ne peut tout simplement être caché sous le tapis,  en attendant que les choses veuillent bien rentrer d’elles-mêmes dans l’oubli. Le film de Sofia Djama montre et notamment par le personnage d’Amal admirablement joué par Nadia Kaci que non seulement la décennie noire a créé une sorte de génération sacrifiée, ceux et celles qui comme Amal et son mari Samir ont réussi à survivre(comme ils le disent l’un et l’autre, c’est à la fois peu et beaucoup), mais que de plus elle compromet et laisse en suspens le sort d’un groupe socio-culturel qui ne se voit plus d’avenir en Algérie, la communauté des francophones démocrates, laïques, menacés par l’islamisation de fait , dont le film s’emploie à donner des preuves.
en attendant que les choses veuillent bien rentrer d’elles-mêmes dans l’oubli. Le film de Sofia Djama montre et notamment par le personnage d’Amal admirablement joué par Nadia Kaci que non seulement la décennie noire a créé une sorte de génération sacrifiée, ceux et celles qui comme Amal et son mari Samir ont réussi à survivre(comme ils le disent l’un et l’autre, c’est à la fois peu et beaucoup), mais que de plus elle compromet et laisse en suspens le sort d’un groupe socio-culturel qui ne se voit plus d’avenir en Algérie, la communauté des francophones démocrates, laïques, menacés par l’islamisation de fait , dont le film s’emploie à donner des preuves.
Il le fait à travers une action très simple et très convaincante, tant il est vrai que les faits montrés sont connus de tout le monde et ne s’inventent pas. Le couple d’Amal et Sami décide de fêter le vingtième anniversaire de son mariage en allant dîner au restaurant (avec quelques réticences de sa part à elle qui sans doute prévoit d’éventuelles contrariétés). S’accumulent alors des difficultés en série qui ne peuvent manquer de gâcher la soirée et même au-delà : café où les femmes ne peuvent entrer, restaurant où on ne sert pas d’alcool en terrasse, obligation d’aller dans un hôtel pour touristes absolument sinistre et vraisemblablement hors de prix. Finalement le couple se retrouve au commissariat de police, un banal agent de la circulation ayant découvert qu’Amal avait bu de l’alcool avant de prendre le volant. Pas d’autre solution que d’en appeler à l’intervention d’un ami haut placé, qui se révèle efficace en effet.
La génération suivante a d’ailleurs recours au même type d’intervention : la jeune Fériel délivre grâce au commissaire de police qui la protège ses deux amis (au sens purement amical du mot). Ils se sont fait prendre en ayant sur eux la plus ordinaire des substances illicites que fument semble-t-il la plupart des jeunes gens.
On s’aperçoit assez vite que pratiquement le film tourne autour d’une question et une seule, il est vrai décisive parce qu’elle engage tout l’avenir des intéressés : partir ou rester ? La qualité du film vient de ce que la réponse n’est pas simple, ni pour les  personnages, ni pour les spectateurs qui ne peuvent manquer de s’interroger. Certes Amal qui veut partir est convaincante, d’autant plus qu’elle le veut pour assurer l’avenir de son fils, qui en Algérie n’en a semble-t-il aucun. Comme dans le premier épisode d’En attendant les hirondelles, on voit un garçon supposé étudiant qui ne parvient pas à éprouver le moindre intérêt pour les études universitaires. Echec patent du système ou banal décrochage dont il y a des exemples partout ?
personnages, ni pour les spectateurs qui ne peuvent manquer de s’interroger. Certes Amal qui veut partir est convaincante, d’autant plus qu’elle le veut pour assurer l’avenir de son fils, qui en Algérie n’en a semble-t-il aucun. Comme dans le premier épisode d’En attendant les hirondelles, on voit un garçon supposé étudiant qui ne parvient pas à éprouver le moindre intérêt pour les études universitaires. Echec patent du système ou banal décrochage dont il y a des exemples partout ?
Mais comme Sami qui résiste autant qu’il peut à ce projet de départ, on se dit que quitter son pays ne peut pas être la bonne solution et que ce serait vraiment dommage d’avoir résisté si longtemps pour abandonner finalement la partie. Il a, lui, un projet sur place : créer une clinique (il est gynécologue), mais est-ce à tort ou à raison qu’il se sent près du but et finalement capable de l’atteindre ?
Ce qui est beau et pathétique dans ce film est qu’on assiste à une sorte de balance et de basculement toujours possible entre passé et présent. Difficile de ne pas ressentir que le passéisme est un enfermement n’offrant qu’une bien maigre compensation lorsque le petit groupe d’amis devenus des « anciens combattants » se met à entonner sur l’air de Léo Ferré le poème d’Aragon L’affiche rouge en hommage au groupe Manouchian. Sans doute ont-ils été à leur manière des combattants pendant la décennie —d’ailleurs achevée depuis dix ans au moment où se situe le film (2008) —mais on croit comprendre que plusieurs d’entre eux se sont contentés de partir, en France sans doute, ce qui est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles Samir n’est pas favorable au départ.
Les raisons sont toute autres pour lesquelles son fils lui non plus n’a pas envie de partir, c’est tout simplement qu’il ne se trouve pas mal et même plutôt bien là où il est, et c’est une raison qui mérite qu’on en tienne compte, même si les critiques du film n’en ont fait jusqu’ici aucun cas (comme d’habitude, ils ne retiennent d’un film sur l’Algérie que le tableau le plus sombre qui soit). Lorsque ce garçon se moque doucement de la peur d’être égorgé, encore vive chez ses parents, peut-être a-t-il raison d’y voir la rémanence d’une époque aujourd’hui révolue (sauf exception). On se souvient alors que le but d’un film est de montrer, pas de démontrer, et de poser des questions, pas d’y répondre. Ce que celui-ci fait admirablement.
Denise Brahimi
« RAZZIA » Film belgo-franco-marocain de Nabil Ayouch (2017) avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdellilah Rachid…
 Le dernier film de Nabil Ayouch tourne une nouvelle fois autour de la société marocaine en abordant de multiples sujets, sans pour autant dérouter le spectateur. L’écriture du film, par le réalisateur et par son épouse, Maryam Touzani, qui joue pour la première fois à l’écran dans un des rôles principaux, est fine et virtuose. Chaque personnage est peint de manière approfondie, et le spectateur peut aisément s’identifier à des caractères assez nombreux. Les allers et retour entre le passé (les années 80) autour du personnage de l’instituteur Abdallah (tragique et superbe Amine Emadji) et aujourd’hui, s’intercalent dans le récit des différentes histoires, dans un savant entrelacs. Entrelacs aussi entre le village du Haut Atlas d’hier et le Casablanca d’aujourd’hui. Chaque personnage apporte une touche nouvelle au tableau que Nabil Ayouch fait du Maroc d’aujourd’hui, sans jamais camper un archétype lourdement démonstratif. Joués par des acteurs remarquables (certains déjà vus dans « Les chevaux de feu » ou « Much loved ») et certainement remarquablement dirigés par un réalisateur qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine, tous ces personnages ont une vie propre, une voix, un corps, une mise en mouvement séduisants et qui nous attachent à eux.
Le dernier film de Nabil Ayouch tourne une nouvelle fois autour de la société marocaine en abordant de multiples sujets, sans pour autant dérouter le spectateur. L’écriture du film, par le réalisateur et par son épouse, Maryam Touzani, qui joue pour la première fois à l’écran dans un des rôles principaux, est fine et virtuose. Chaque personnage est peint de manière approfondie, et le spectateur peut aisément s’identifier à des caractères assez nombreux. Les allers et retour entre le passé (les années 80) autour du personnage de l’instituteur Abdallah (tragique et superbe Amine Emadji) et aujourd’hui, s’intercalent dans le récit des différentes histoires, dans un savant entrelacs. Entrelacs aussi entre le village du Haut Atlas d’hier et le Casablanca d’aujourd’hui. Chaque personnage apporte une touche nouvelle au tableau que Nabil Ayouch fait du Maroc d’aujourd’hui, sans jamais camper un archétype lourdement démonstratif. Joués par des acteurs remarquables (certains déjà vus dans « Les chevaux de feu » ou « Much loved ») et certainement remarquablement dirigés par un réalisateur qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine, tous ces personnages ont une vie propre, une voix, un corps, une mise en mouvement séduisants et qui nous attachent à eux.
Rajoutons aussi le bonheur de ces « quasi personnages » que sont le Film Casablanca de Michael Curtis, et le célèbre « Play it again Sam », que demande Ingrid Bergman au pianiste Dooley Wilson, et le chanteur Freddy Mercury des Queens et son non moins célèbre « We are the champions ». Ces références, qui prennent une belle place dans le film, sont les mythes qui emplissent la vie de deux personnages.
Ilyas, l’ancien petit bègue chouchouté par l’instituteur Abdallah, et devenu serveur dans  le restaurant « Chez Jacques » tenu par le « beau gosse » Joseph, juif de Casa, qui a succédé à son père Jacques, croit dur comme fer que tout a été tourné à Casa, et rapporte à Joseph des légendes autour de Bogart et Bergman, que Joe écoute en souriant.
le restaurant « Chez Jacques » tenu par le « beau gosse » Joseph, juif de Casa, qui a succédé à son père Jacques, croit dur comme fer que tout a été tourné à Casa, et rapporte à Joseph des légendes autour de Bogart et Bergman, que Joe écoute en souriant.
L’autre, Hakim, musicien et chanteur issu de la medina s’identifie à son héros y compris dans la dégaine qui lui vaut les lazzis homophobes des gamins du quartier, le regard torve de son père, mais l’admiration inconditionnelle de sa petite sœur.
Ces deux mythes sont du reste réincarnés, par Joe qui joue « As time goes by » et Hakim qui donne a capela une version très convaincante et déchirante de « We are the champions » devant une salle de spectacle vide… Un autre beau moment musical est le chant berbère que lance Yto devant un paysage de cimetière de montagne, alors qu’elle vient d’être quittée par Abdallah, chassé par l’arabisation de l’enseignement. Citons aussi un extrait d’un très beau rap sur Casablanca et sa jeunesse marginalisée…
Nabil Ayouch travaille paraît-il sur un projet de comédie musicale. La place donnée à la musique dans ses films permet d’en espérer beaucoup…
 La musique n’est pas seule à donner à ce film une vraie beauté. La photographie, déjà appréciée dans Much Loved valorise le propos du film, par des cadrages évidents, des scènes de nuit un peu dorées… L’écriture du film est également à saluer. Abdallah, l’instituteur, attaché à enseigner aux enfants dans leur langue berbère la beauté de leurs montagnes, celle de l’univers, et « ce qu’il y a derrière » a des mots très beaux pour exprimer son chagrin de leur voir imposer par l’inspecteur d’ânonner en arabe des choses qu’ils ne comprennent pas : « Qu’importe la langue, si vous leur ôtez la voix, si les montagnes deviennent sourdes ».
La musique n’est pas seule à donner à ce film une vraie beauté. La photographie, déjà appréciée dans Much Loved valorise le propos du film, par des cadrages évidents, des scènes de nuit un peu dorées… L’écriture du film est également à saluer. Abdallah, l’instituteur, attaché à enseigner aux enfants dans leur langue berbère la beauté de leurs montagnes, celle de l’univers, et « ce qu’il y a derrière » a des mots très beaux pour exprimer son chagrin de leur voir imposer par l’inspecteur d’ânonner en arabe des choses qu’ils ne comprennent pas : « Qu’importe la langue, si vous leur ôtez la voix, si les montagnes deviennent sourdes ».
Même lyrisme quand Yto se tatoue le visage pour partir chercher l’homme qu’elle aime : « Sur mon visage, j’ai gravé ma bataille, au sang et au charbon, Au milieu de mon front l’olivier, symbole de la force, sur chaque joue l’œil de dieu, l’étoile qui guide l’homme dans la nuit ».
Razzia, décidément très riche, offre de multiples scènes à deux personnages permettant des échanges touchants ou violents, entre Joe et Ylies, ou encore avec son père Jacques qui déplore qu’il n’y à plus assez de juifs pour honorer les morts, entre Hakim et sa petite sœur, entre Yto et Salima, entre Ines et sa vieille bonne Dada, ou la petite bonne des voisins dont elle est amoureuse… L’amour d’Yto et d’Abdallah est joliment suggéré, sans beaucoup de mots…
Cette trame opulente, dans laquelle il est possible de recueillir de multiples jolis plaisirs cinématographiques, est au service d’un message et d’une analyse politico sociologique sans concession. Sur les nombreux travers d’une société marocaine en cours de modernisation, où prolifèrent les clivages sociaux, l’homophobie, une forme discrète d’antisémitisme, l’absence de débouchés pour les jeunes des classes populaires, une arrogance hors sol de la bourgeoisie « tchitchi » comme on disait à Alger. Sur les fossés intergénérationnels. Sur le cantonnement des femmes à des rôles de faire valoir, et sur l’influence de l’islamisme qui s’oppose aux réformes rétablissant une égalité…
La « razzia » du titre est-elle au premier degré celle à laquelle se livrent les jeunes manifestants de la fin du film ? Ou la révolte généralisée qui, sous diverses formes explose au même moment opposant les doux musiciens aux petits bourgeois prétentieux ? Où s’en va Salima dans l’océan avec le bébé qu’elle porte ? Que va faire Ylias à qui Joe fait perdre ses illusions sur le Casablanca de Curtis ?
Le film se termine sur bien des questions, pas très optimistes.
Le spectateur en sort un peu secoué, mais enrichi d’une multitude de petits cadeaux de cinéma.
Nabil Ayouche a bien du talent…
Michel Wilson
« BRÛLE LA MER », film tunisien de Maki Berchache (2014)
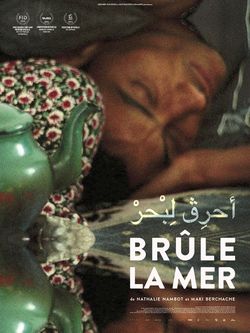 Le réalisateur Maki Berchache faisait partie des 25 000 Tunisiens qui ont traversé la Méditerranée vers Lampedusa après la chute de Ben Ali, profitant de la brèche ouverte dans le carcan tunisien. Son film n’est nullement celui d’un professionnel même débutant, il ne correspond pas à l’idée que le public peut se faire d’un film, même en reconnaissant à ce genre une grande liberté, et il n’est pas non plus conforme à ce qu’on attend actuellement d’un film posant le problème des migrants—il serait sans doute plus juste dans ce cas de dire : le problème de la migration. A partir du cas de Maki et surtout de sa parole, c’est en effet la signification même de ce phénomène qui est interrogée par le film, non pas de manière cohérente et construite, mais au contraire à travers un ensemble de propos dont on ne voit pas d’emblée la logique qui les unit.
Le réalisateur Maki Berchache faisait partie des 25 000 Tunisiens qui ont traversé la Méditerranée vers Lampedusa après la chute de Ben Ali, profitant de la brèche ouverte dans le carcan tunisien. Son film n’est nullement celui d’un professionnel même débutant, il ne correspond pas à l’idée que le public peut se faire d’un film, même en reconnaissant à ce genre une grande liberté, et il n’est pas non plus conforme à ce qu’on attend actuellement d’un film posant le problème des migrants—il serait sans doute plus juste dans ce cas de dire : le problème de la migration. A partir du cas de Maki et surtout de sa parole, c’est en effet la signification même de ce phénomène qui est interrogée par le film, non pas de manière cohérente et construite, mais au contraire à travers un ensemble de propos dont on ne voit pas d’emblée la logique qui les unit.
D’où vient le besoin de migrer, chez un jeune Tunisien comme Maki ? S’agit-il de quitter un pays où il n’y a pas de travail pour aller en chercher dans un autre où il y en a ? Est-ce la volonté de quitter un lieu où l’on est soumis à une insoutenable oppression pour aller vivre dans un autre où l’on se sentira libre (mais encore faudrait-il savoir exactement quel sens le migrant donne à ce mot) ?
La réponse est beaucoup moins simple qu’on ne pourrait croire et en tout cas, à l’origine de ce besoin, il n’y a sûrement pas que des raisons purement matérielles, il faut même admettre qu’on est en présence d’un phénomène en partie mystérieux, ou en tout cas qui ne s‘explique pas d’emblée. La preuve en est dans un paradoxe au moins apparent qui est le point de départ du film. Celui-ci s’ouvre en effet sur le célèbre « printemps arabe » de 2011 parfois appelé révolution du jasmin, en hommage à cette fleur qui est comme l’emblème de la Tunisie. Le film en fait un très vibrant éloge, tout à fait enthousiaste et il ne vient pas à l’idée du jeune réalisateur Maki d’en parler comme d’un échec. Mais alors dans ce cas pourquoi ne pas faire confiance à un avenir qui pourrait être proche, et pourquoi ne pas attendre, si possible activement, l’amélioration espérée pour la Tunisie. ? Pourquoi vouloir à toute force la quitter et au péril de sa vie (les migrants n’ignorent rien du danger) au moment où les choses pourraient s’arranger, voire changer complétement comme le dit si bien le mot « révolution ».
En fait, si logique il y a, elle est tout à fait autre et repose entièrement sur le mot « liberté ». Pour des jeunes gens comme Maki, les deux mots, révolution et liberté, sont à peu près équivalents, et le mot liberté lui-même signifie principalement liberté de mouvement, liberté de déplacement, libre circulation et possibilité d’aller où l’on veut, en tout cas hors de la Tunisie. Sitôt que Ben Ali est renversé, c’est donc comme si le signal de départ était donné, et c’est une véritable frénésie qui s’empare des aspirants à la migration.
 Autre paradoxe au moins apparent : les jeunes Tunisiens comme Maki ne sont pas misérables ni sans travail ni sans aucune ressource : il est lui-même guide pour touristes à Zarzis dans le sud de la Tunisie(au sud-est de l’île de Djerba) , et même s’il explique à un moment donné que ce métier lui rapporte ou lui rapportait bien peu, il reconnaît que c’est tout de même un moyen de contribuer au budget familial qui comporte plusieurs sources de revenus, un peu de culture, la récolte des olives, un peu d’élevage qui fournit la viande et le lait, et surtout la pêche, dont il ne nous est pas dit qu’elle est en régression. Par ailleurs Maki ne fait pas du tout état de difficultés familiales qui pourraient expliquer sa volonté de partir.
Autre paradoxe au moins apparent : les jeunes Tunisiens comme Maki ne sont pas misérables ni sans travail ni sans aucune ressource : il est lui-même guide pour touristes à Zarzis dans le sud de la Tunisie(au sud-est de l’île de Djerba) , et même s’il explique à un moment donné que ce métier lui rapporte ou lui rapportait bien peu, il reconnaît que c’est tout de même un moyen de contribuer au budget familial qui comporte plusieurs sources de revenus, un peu de culture, la récolte des olives, un peu d’élevage qui fournit la viande et le lait, et surtout la pêche, dont il ne nous est pas dit qu’elle est en régression. Par ailleurs Maki ne fait pas du tout état de difficultés familiales qui pourraient expliquer sa volonté de partir.
En revanche ce qui attend les jeunes migrants au terme de leur voyage éreintant et dangereux, lorsqu’enfin ils atteignent Paris, se présente sous le jour le plus sinistre et dissuasif, aucun lieu où loger, aucun travail envisageable, pas un sou en poche, et un accueil ou plutôt un non-accueil tout à fait démoralisant, aussi bien de la part d’anciens touristes venus en Tunisie que de celle de Tunisiens de Paris sur lesquels leurs compatriotes croyaient pouvoir compter. Le risque est grand de tomber dans la délinquance ou dans la clochardisation. Et en dépit  d’efforts absolument considérables pour obtenir des papiers, ce qui ne serait d’ailleurs qu’une toute première étape en vue d’un mode de vie moins précaire, la situation de ces garçons semble bloquée.
d’efforts absolument considérables pour obtenir des papiers, ce qui ne serait d’ailleurs qu’une toute première étape en vue d’un mode de vie moins précaire, la situation de ces garçons semble bloquée.
Il peut arriver que face à ce constat, l’un deux prenne la seule décision raisonnable qui est de rentrer au pays. Mais il semble que ce soit étonnamment rare, alors même que comme Maki, tous se disent insatisfaits, voire trahis et floués. Et pourquoi cela ? Eh ! bien parce qu’ils ont le sentiment qu’ils ont des droits mais que ces droits ne sont pas respectés. On ne voit pas de quels droits il pourrait s’agir, sinon des droits de l’homme en général, une idée qui en effet s’est beaucoup répandue dans le monde d’aujourd’hui. Pourquoi n’auraient-ils pas le droit de vivre en France, et n’est-ce pas là une criante injustice ?
Les associations qui tentent d’améliorer leur sort ne posent pas le problème en termes théoriques mais pratiques—ce qui est en effet la réponse à une urgence, la situation la plus dramatique étant celle des enfants mineurs, arrivés sans aucun parent au terme de vicissitudes indescriptibles. La nécessité d’une action humanitaire s’impose, mais elle ne répond pas à la question posée par le caractère paradoxal de la migration. Un critique a bien montré son ampleur, définissant le film en ces mots : « Il ne s’agit pas d’un documentaire sur
l’émigration ou la révolution, c’est un essai sur la liberté ou plutôt de liberté : une tentative d’évasion réelle et fictive auquel la fabrication d’un film participe, prenant part de ce processus d’émancipation : brûle la mer, les frontières, les lois, les papiers… Qu’est-ce que rompre avec sa vie passée, quitter son pays, sa famille où prévalent encore vaille que vaille des liens très forts de solidarité, d’entraide et un attachement ancestral à la terre, pour rejoindre le monde mythifié et dominé par les rapports capitalistes. Qu’est-ce que : Vivre sa vie ? »
Denise Brahimi

« SEXE ET MENSONGES », de Leila Slimani éd. des Arènes, 2017
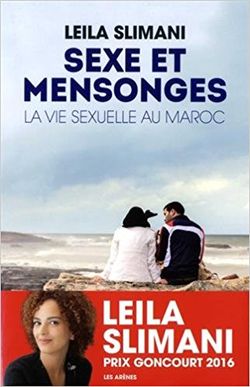 Il se peut que le titre de ce livre rappelle à certains cinéphiles celui d’un film de Steven Soderbergh, Sexe, mensonges et vidéo (1989), dont le personnage principal enregistrait en vidéo des confidences de femmes (parfois très crues) sur leur vie sexuelle. Cependant le livre de Leïla Slimani est entièrement consacré à la situation dans son pays le Maroc comme l’indique bien son sous-titre : « La vie sexuelle au Maroc ». C’est un livre essentiellement constitué par une quinzaine de témoignages, presque tous de femmes, qui souvent sont venues spontanément se raconter à l’auteure, tant il est vrai que le besoin de parole est considérable, chez des femmes qui non sans raison se considèrent comme des victimes et se sentent menacées d’étouffement. Ces témoignages renvoient à une situation qui fondamentalement est toujours la même, mais les personnages dont parle Leïla Slimani bénéficient du fait qu’étant romancière elle parvient à leur donner même brièvement une personnalité, souvent attachante ; et il est vrai qu’on résiste difficilement en tant que lecteur ou lectrice, au pathétique de certaines situations évoquées, bien que le but du livre soit d’abord de montrer et d’expliquer, quitte à chacun et à chacune de savoir s’il est attendri ou indigné.
Il se peut que le titre de ce livre rappelle à certains cinéphiles celui d’un film de Steven Soderbergh, Sexe, mensonges et vidéo (1989), dont le personnage principal enregistrait en vidéo des confidences de femmes (parfois très crues) sur leur vie sexuelle. Cependant le livre de Leïla Slimani est entièrement consacré à la situation dans son pays le Maroc comme l’indique bien son sous-titre : « La vie sexuelle au Maroc ». C’est un livre essentiellement constitué par une quinzaine de témoignages, presque tous de femmes, qui souvent sont venues spontanément se raconter à l’auteure, tant il est vrai que le besoin de parole est considérable, chez des femmes qui non sans raison se considèrent comme des victimes et se sentent menacées d’étouffement. Ces témoignages renvoient à une situation qui fondamentalement est toujours la même, mais les personnages dont parle Leïla Slimani bénéficient du fait qu’étant romancière elle parvient à leur donner même brièvement une personnalité, souvent attachante ; et il est vrai qu’on résiste difficilement en tant que lecteur ou lectrice, au pathétique de certaines situations évoquées, bien que le but du livre soit d’abord de montrer et d’expliquer, quitte à chacun et à chacune de savoir s’il est attendri ou indigné.
Leïla Slimani n’hésite pas à encadrer les confidences qu’elle a recueillies de commentaires riches et abondants, mais elle ne se prend pas pour une théoricienne et ne se met pas dans la posture d’une intellectuelle ; et elle ne convoque pas non plus, comme le faisait Assia Djebar à son époque, les devoirs de la « sororité ». En fait, elle se situe explicitement dans la suite de cette Marocaine malheureusement décédée (en novembre 2015 à Rabat) qu’elle considère comme sa grande ancêtre, Fatima Mernissi, sociologue de formation et féministe déclarée.
 Féministe, Leïla Slimani l’est certainement mais au sens où elle s’attache principalement aux victimes des attitudes déplorables qu’on trouve dans la société marocaine à l’égard de toute sexualité. Les groupes marginaux, tels que les homosexuels et les prostituées, sont les plus violemment ostracisés et il n’est pas étonnant que Leïla Slimani soit très liée à un autre écrivain marocain Abdellah Taïa, le premier à avoir ouvertement déclaré dans la presse marocaine son homosexualité (En juin 2007, il fait la couverture du magazine marocain Tel Quel sous le titre : « Homosexuel, envers et contre tous »).
Féministe, Leïla Slimani l’est certainement mais au sens où elle s’attache principalement aux victimes des attitudes déplorables qu’on trouve dans la société marocaine à l’égard de toute sexualité. Les groupes marginaux, tels que les homosexuels et les prostituées, sont les plus violemment ostracisés et il n’est pas étonnant que Leïla Slimani soit très liée à un autre écrivain marocain Abdellah Taïa, le premier à avoir ouvertement déclaré dans la presse marocaine son homosexualité (En juin 2007, il fait la couverture du magazine marocain Tel Quel sous le titre : « Homosexuel, envers et contre tous »).
Cet acte courageux convient particulièrement au propos que se donne l’auteure de Sexe et mensonges, qui est de dénoncer l’hypocrisie régnante dans la société marocaine, qu’on peut tout à fait résumer en reprenant ses propres mots : « Au Maroc, gouvernants, parents, professeurs, tiennent le même discours : Faites ce que vous voulez, mais faites-le en cachette. »
Et si elle convoque en premier lieu les gouvernants, c’est parce que les lois elles-mêmes, très répressives, définissent en apparence une société où toute espèce de relation sexuelle hors mariage est absolument prohibée.
Naturellement, on a plusieurs fois l’occasion de constater dans le livre que lesdites relations sexuelles sont en fait extrêmement répandues mais dans des conditions que l’auteure et bien d’autres avec elles désormais, jugent inacceptables. La seule solution est de se cacher mais ce n’est pas facile et pour beaucoup de femmes, un rapport sexuel dans des conditions déplorables de clandestinité est tout à fait frustrant. Il est possible que certains hommes y trouvent la satisfaction d’un besoin immédiat, mais il semble bien qu’à cet égard, l’homme et la femme ne vivent pas la sexualité de la même façon, et que les femmes supportent mal de n’être qu’un objet permettant cette satisfaction. Cet état de fait entraîne d’ailleurs une des formes (par ailleurs extrêmement nombreuses !) de corruption qui existent dans le royaume puisqu’il suffit souvent ou parfois de glisser quelques billets dans la main du policier préposé à la surveillance des mœurs pour qu’il ferme les yeux sur le délit constaté.
La question économique revient de plus en plus fréquemment dans le livre au point que Leïla Slimani en arrive à penser et dit finalement clairement que l’accès à une sexualité virtuellement satisfaite est tout bonnement (si l’on peut dire ! ) une affaire d’argent : les riches s’en sortent très bien et on ne leur fera pas d’ennuis, les pauvres sont persécuté(e)s par des tracasseries dont sont par exemple systématiquement victimes les plus pauvres des prostituées, celles qui se font « payer en légumes » comme on dit semble-t-il au Maroc pour les désigner.
 Leïla Slimani rejoint une forme particulière de féminisme en défendant un droit à la jouissance ou au plaisir sexuel pour les femmes qui pendant trop longtemps ont accepté en silence d’en être privées. Le grand mérite de son livre, et on espère que ce sera aussi un moyen de son efficacité, est qu’elle défend ce droit avec ce qu’on pourrait appeler beaucoup de naturel, comme une sorte d’évidence tranquille, qui n’implique aucune revendication hystérique ni ostentatoire. C’est peut-être pour cela que son livre apparaît comme caractéristique d’une nouvelle génération qui certes a encore beaucoup à faire. Mais il serait injuste de dire qu’il n’y a à cet égard au Maroc—pour s’en tenir à cet exemple—ni évolution ni progrès. L’existence même d’un livre comme Sexe et mensonges prouve que la parole se libère, non sans soubresauts évidemment et non sans risques pour ceux et celles qui y contribuent. Leïla Slimani évoque pour finir l’affaire Kamel Daoud et les accusations en tout genre ou venant de tout bord que celui-ci s’est attiré pour avoir osé parler de la misère sexuelle des Musulmans (ou de certains d’entre eux) : Le sexe est la plus grande misère dans le « monde d’Allah ».
Leïla Slimani rejoint une forme particulière de féminisme en défendant un droit à la jouissance ou au plaisir sexuel pour les femmes qui pendant trop longtemps ont accepté en silence d’en être privées. Le grand mérite de son livre, et on espère que ce sera aussi un moyen de son efficacité, est qu’elle défend ce droit avec ce qu’on pourrait appeler beaucoup de naturel, comme une sorte d’évidence tranquille, qui n’implique aucune revendication hystérique ni ostentatoire. C’est peut-être pour cela que son livre apparaît comme caractéristique d’une nouvelle génération qui certes a encore beaucoup à faire. Mais il serait injuste de dire qu’il n’y a à cet égard au Maroc—pour s’en tenir à cet exemple—ni évolution ni progrès. L’existence même d’un livre comme Sexe et mensonges prouve que la parole se libère, non sans soubresauts évidemment et non sans risques pour ceux et celles qui y contribuent. Leïla Slimani évoque pour finir l’affaire Kamel Daoud et les accusations en tout genre ou venant de tout bord que celui-ci s’est attiré pour avoir osé parler de la misère sexuelle des Musulmans (ou de certains d’entre eux) : Le sexe est la plus grande misère dans le « monde d’Allah ».
Denise Brahimi
« PAROLES D’HONNEUR » Roman graphique de Leila Slimani et Laetitia Coryn, (Editions Les Arènes BD), 2017
Dès la sortie du livre « Sexe et mensonges » l’éditeur Les Arènes a proposé à l’auteur de l’adapter en roman graphique, ce qu’elle a accepté d’enthousiasme: « C’était l’occasion pour moi de raconter cette histoire comme une fiction, d’incarner mes personnages, mais aussi de donner à voir la beauté de ces femmes et de mon pays ».
 Laetitia Coryn a accompagné Leila Slimani dans de nombreux entretiens, et sa palette apporte efficacement cette incarnation et la mise en espace évoquées par l’auteur. Auteure d’une « Histoire du sexe », beau succès de librairie, la dessinatrice s’est ingénié à illustrer les lieux des rencontres, à donner visages et mouvements, attitudes crédibles qui font mieux qu’accompagner le texte de Leila Slimani, mais le soutiennent et l’animent. Le choix du titre « paroles d’honneur » décrit bien deux des aspects qui traversent l’ouvrage: des mots et des paroles abondantes, cathartiques souvent, et cette notion mal digérée d’honneur, des familles, des maris, mais tellement peu des femmes elles-mêmes. On se prend de sympathie pour les nombreuses interlocutrices qui dialoguent avec l’auteure, pour plusieurs hommes aussi, dont certains avouent souffrir « de cette morale rétrograde et hypocrite ». La plupart se battent contre le carcan social qui les oppresse et formule l’espoir de voir progresser la situation dans leur pays.Entre autres choses, cela passera par des réformes juridiques comme par exemple l’article 490 du Code pénal qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement « toutes personnes de sexes différents qui n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ». Base de bien des barrages à une vie libre et épanouie pour de nombreuses femmes.
Laetitia Coryn a accompagné Leila Slimani dans de nombreux entretiens, et sa palette apporte efficacement cette incarnation et la mise en espace évoquées par l’auteur. Auteure d’une « Histoire du sexe », beau succès de librairie, la dessinatrice s’est ingénié à illustrer les lieux des rencontres, à donner visages et mouvements, attitudes crédibles qui font mieux qu’accompagner le texte de Leila Slimani, mais le soutiennent et l’animent. Le choix du titre « paroles d’honneur » décrit bien deux des aspects qui traversent l’ouvrage: des mots et des paroles abondantes, cathartiques souvent, et cette notion mal digérée d’honneur, des familles, des maris, mais tellement peu des femmes elles-mêmes. On se prend de sympathie pour les nombreuses interlocutrices qui dialoguent avec l’auteure, pour plusieurs hommes aussi, dont certains avouent souffrir « de cette morale rétrograde et hypocrite ». La plupart se battent contre le carcan social qui les oppresse et formule l’espoir de voir progresser la situation dans leur pays.Entre autres choses, cela passera par des réformes juridiques comme par exemple l’article 490 du Code pénal qui punit d’un mois à un an d’emprisonnement « toutes personnes de sexes différents qui n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ». Base de bien des barrages à une vie libre et épanouie pour de nombreuses femmes.
Le combat auquel a choisi de participer Leila Slimani est crucial, et le choix d’une version graphique de ses dialogues peut efficacement y contribuer… Si du moins les marocain-e-s y ont accès.
Michel Wilson
« DAMES DE FRAISE, DOIGTS DE FEES, Les invisibles de la migration saisonnière en Espagne », de Chadia Arab Casablanca, (En toutes lettres, collection Enquêtes), 2018
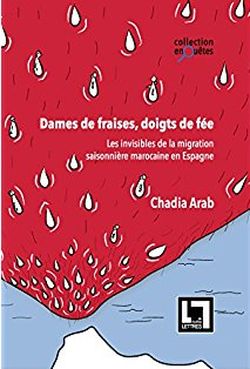 Le joli titre et la jolie couverture de ce petit livre recouvrent une réalité un peu moins poétique, bien que les informations qu’on en tire forment un ensemble équilibré : ce n’est pas une dénonciation ni un pamphlet mais plutôt un ensemble de constats, dont l’auteure, la chercheuse franco-marocaine Chadia Arab, fait preuve de nuances et d’une aptitude à analyser les situations dans toute leur complexité.
Le joli titre et la jolie couverture de ce petit livre recouvrent une réalité un peu moins poétique, bien que les informations qu’on en tire forment un ensemble équilibré : ce n’est pas une dénonciation ni un pamphlet mais plutôt un ensemble de constats, dont l’auteure, la chercheuse franco-marocaine Chadia Arab, fait preuve de nuances et d’une aptitude à analyser les situations dans toute leur complexité.
Dans quel genre ou dans quelle catégorie ranger son livre, sachant que dans le sous-titre, le mot « invisibles » est à mettre au féminin ? Les femmes marocaines qui en sont les personnages (évidemment bien réelles : il ne s’agit pas d’un roman !) partent chaque année de leur village (ce sont essentiellement des rurales ) pour aller dans le sud de l’Espagne à Huelva travailler (un travail très dur, elles en sont prévenues mais ce n’est pas ce qui peut les faire hésiter) à la cueillette des fraises ; car Huelva est devenu un centre international de cette production juteuse ( !) pour ceux qui en tirent les bénéfices, si importants que les fraises sont parfois désignées comme l’or rouge : de fait n’importe quel client de supermarché peut constater qu’elles y sont omniprésentes à peu près toute l’année. Pour un point de vue plus général sur cette situation (non négligeable pour la vie économique de l’Espagne), on peut ajouter que d’autres fruits rouges sont également cultivés dans cette région et que d’autres migrantes sont travailleuses saisonnières pour leur collecte, des Roumaines en grand nombre, des Polonaises, et aussi des hommes qui constituent le groupe des Maliens.
 Chadia Arab ne s’intéresse qu’aux Marocaines, dont elle a fait l’objet de son étude et de sa recherche à partir de 2010 et pendant plusieurs années. En fait ses observations vont pratiquement jusqu’à aujourd’hui ce qui est important car elle constate une évolution récente qui malheureusement ne va pas dans le bon sens et s’avère au contraire défavorable aux femmes, notamment parce que plusieurs institutions qui les aidaient et les protégeaient ont disparu.
Chadia Arab ne s’intéresse qu’aux Marocaines, dont elle a fait l’objet de son étude et de sa recherche à partir de 2010 et pendant plusieurs années. En fait ses observations vont pratiquement jusqu’à aujourd’hui ce qui est important car elle constate une évolution récente qui malheureusement ne va pas dans le bon sens et s’avère au contraire défavorable aux femmes, notamment parce que plusieurs institutions qui les aidaient et les protégeaient ont disparu.
Sans cette longue durée, le travail de Chadia Arab aurait pu être une enquête journalistique, intelligente et approfondie, comme il en existe dans le journalisme d’investigation —qui d’une manière sur laquelle on peut s’interroger semble être assez souvent une pratique féminine : que l’on pense à Florence Aubenas et à son livre Le Quai de Ouistreham de 2010. Mais de l’enquête journalistique Chadia Arab qui est chercheuse universitaire est passée à l’enquête sociologique, en gardant toujours, au départ et même tout au long de son travail, la même méthode. Celle-ci a consisté à se rendre sur le terrain, évidemment de nombreuses fois, et à partager dans toute la mesure du possible la vie de quelques-unes au moins des femmes marocaines qui pratiquent ou ont pratiqué cette forme très particulière de migration.
C’est en effet dans le cadre d’une histoire (et d’une typologie) des migrations qu’on peut ranger le travail de Chadia Arab, qui a le mérite d’être très vivant et très concret, en sorte qu’on n’a aucune peine à en lire les résultats et qu’on voudrait même en savoir davantage sur les femmes qu’il nous a donné l’occasion de croiser. Il y a beaucoup de rapprochements à faire avec la migration des hommes eux aussi marocains lorsque dans les années 50 du siècle dernier on est venu les chercher jusque dans leurs villages pour les emmener travailler dans les mines du Nord de la France. Les interlocutrices de Chadia Arab citent notamment le nom d’un recruteur, Félix Mora, connu pour le grand nombre de Marocains qu’il a emmenés dans la région de Lens et qui ont quitté pour des raisons évidemment économiques le sud misérable de leur pays. Dans tous les cas la migration se fait sur contrat, renouvelable, la caractéristique des femmes étant qu’elles sont embauchées comme saisonnières et de nombreuses précautions sont prises pour qu’en effet elles retournent au Maroc au bout de quelques mois, quitte à revenir l’année suivante si les patrons ont encore besoin d’elles. D’où l’expression « une immigration jetable » employée par l’auteure du livre, et qui correspond aussi au sentiment exprimé par certaines des femmes, humiliées à juste titre de n’être traitées que comme des objets utilisables ou non.

La garantie trouvée par les employeurs pour que les femmes retournent régulièrement dans leur pays est de choisir des mères, dont la plupart éprouvent intensément le désir de revoir leurs enfants. Il n’empêche qu’elles sont obligées d’abandonner ceux-ci à leur famille et parfois dans des conditions très aléatoires. Certaines, surtout si elles sont divorcées ou célibataires, prennent le risque de rester illégalement en Espagne (ou plus tard dans d’autres pays européens comme la France) et y deviennent des sans-papiers, dont la survie est des plus problématiques et ne peut manquer de passer par la prostitution.
Cependant une partie très importante du livre consiste dans l’évaluation nuancée des effets de cette migration dans l’histoire des femmes et de leur émancipation. Les séjours en Espagne jouent évidemment dans ce sens, ne serait-ce et pour commencer que pour des questions d’habillement, les femmes passant souvent à cette tenue moderne qu’est le jean —quitte à remettre la djellaba quand elles retournent au Maroc. Il est évident qu’en Espagne leur liberté de mouvement est plus grande, elles n’hésitent pas à sortir le soir après le travail pour se divertir, non sans maquillage et autres coquetteries impensables dans les misérables villages d’où viennent la plupart d’entre elles. Elles ont aussi la possibilité de rencontres masculines, voire de mises en ménage même pour celles qui ont un mari au Maroc. Il arrive d’ailleurs que le mari en question insiste pour que sa femme reste en Espagne, tant il est vrai que le seul but de tout cela est de pouvoir rapporter un peu d’argent au pays. Que de questions pose une telle enquête, alors même qu’elle garde des apparences modestes ! C’est un travail très précieux auquel ont contribué l’éditeur marocain et l’Ambassade de France au Maroc.
Denise Brahimi

- Dimanche 4 mars, 18h: Film « Les Bienheureux » à Ciné Duchère Lyon en présence de la réalisatrice Sofia Djama
- Lundi 5 mars 20h: Film « Les Bienheureux » au cinéma Les Alizés de Bron en présence de la réalisatrice Sofia Djama
- Jeudi 8 mars 19h Film « Les gracieuses » en présence de la réalisatrice Fatima Sissani, à la Maison des Passages
- Vendredi 9 mars 17h30 aux Amphi de Vaulx en Velin, Film « Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans » en présence de la réalisatrice Fatima Sissani
- Samedi 10 mars à 15h Bibliothèque de la Part Dieu, Jacques Ferrandez et ses romans graphiques sur Camus.
- Du 8 au 15 mars Saint Martin d’Hères partenariat avec Mon Ciné Les rendez vous des cinémas d’Afrique, avec « La Belle et la meute » de Kaouther Ben Hania hle 9 mars à 20h, et « Razzia » de Nabil Ayouch, le dimanche 11 mars 17h.
- Mardi 13 mars, à Mon Ciné à Saint Martin d’Hères 20h Film « Maintenant ils peuvent venir » de Salem Brahimi en présence du comédien Amazigh Kateb
- mercredi 14 mars, à 19h au palais du Travail Villeurbanne Conférence de Karima Bennoune auteure de « Votre fatwa ne s’applique pas ici »
- Jeudi 22 mars Rencontre « 2 regards de femmes sur la Ville de Fez » avec les écrivaines Naima Lahbil et Francine Kahn et leurs livres respectifs
- Dimanche 25 mars au Cinéma Jeanne Mourguet de Sainte Foy, à 16h30, Film « En attendant les hirondelles » de Karim Moussaoui
- Mardi 27 mars au Cinéma Jeanne Mourguet à 20h30, Film Maintenant ils peuvent venir » en présence d’Amazigh Kateb



Pingback: Cultures franco-maghrébines - Lettre #22 - Coup de soleil en Rhône-Alpes