Cultures franco-maghrébines – Lettre #14
ÉDITO
Nous sommes heureux de vous proposer notre dernière lettre culturelle, avant la coupure de l’été. Notre prochain rendez-vous sera le 1er octobre. Vous aurez ainsi le temps de lire, si nous avons su vous en donner l’envie, les livres que nous vous présentons ce mois-ci. C’est en effet un mois littéraire qui fait suite au mois cinématographique de notre lettre précédente. En outre, cette livraison nous permet d’aborder les trois pays du Maghreb, ce à quoi notre association est attachée.
Nous espérons vous intéresser, et nous serons heureux de connaître vos réactions, suggestions, critiques éventuelles.
Tous les vœux de bel été de toute l’équipe de Coup de Soleil en Rhône-Alpes.
Michel Wilson


« Sacrées questions… Pour un islam d’aujourd’hui » de Faouzia Charfi (2017 Odile Jacob)
Avec ce nouvel ouvrage, l’auteure poursuit la démarche engagée dans « La science voilée » (2013, Odile Jacob) son livre précédent. Physicienne réputée, ayant occupé de hautes fonctions universitaires, puis la responsabilité de secrétaire d’État dans le gouvernement provisoire tunisien de 2011, elle assume un rôle de femme de conviction au service de la liberté, des droits humains, du libre accès à la connaissance, les arts, l’intelligence. Elle défend aussi, ce faisant, l’œuvre et le souvenir de son mari, Mohamed Charfi, grand ministre de l’éducation, démissionnaire en 1994, auteur d’un livre remarquable, « Islam et liberté, le malentendu historique (1999).
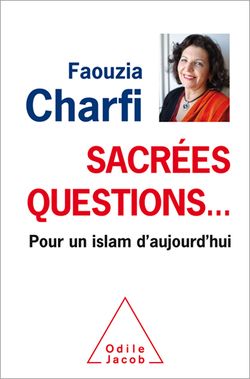 Inquiète de la réaction de beaucoup de ses étudiants récusant divers contenus scientifiques, elle s’est engagée, comme la femme de sciences qu’elle est, dans une clarification minutieuse des sources dogmatiques religieuses qui pèsent sur les sociétés musulmanes. Partageant de longue date les combats pour la liberté et l’émancipation de son pays, elle puise dans cette expérience, y compris celle de mère de famille, la matière d’une observation de la confrontation entre les forces contradictoires qui font de la Tunisie le laboratoire d’une société musulmane du 21ème siècle.
Inquiète de la réaction de beaucoup de ses étudiants récusant divers contenus scientifiques, elle s’est engagée, comme la femme de sciences qu’elle est, dans une clarification minutieuse des sources dogmatiques religieuses qui pèsent sur les sociétés musulmanes. Partageant de longue date les combats pour la liberté et l’émancipation de son pays, elle puise dans cette expérience, y compris celle de mère de famille, la matière d’une observation de la confrontation entre les forces contradictoires qui font de la Tunisie le laboratoire d’une société musulmane du 21ème siècle.
Son livre est à la fois celui d’une chercheuse, soucieuse de creuser et croiser ses sources, d’une pédagogue offrant au lecteur une claire compréhension de notions pourtant complexes, et d’une femme politique moderne contemplant avec inquiétude et admiration la vitalité de la société tunisienne où se confrontent depuis tant d’années et alternent progrès social et sociétal et régressions liberticides.
La plupart des questions (le Coran créé ou incréé, la place de la charia, les sources du dogme, l’islam politique, le voile, le ramadan, l’éducation, l’héritage des femmes, le calendrier islamique, les images…) sur lesquelles les sociétés musulmanes débattent plus ou moins intensément selon les périodes sont abordées par les sources, les confrontations d’analyses et par des exemples concrets.
Une place importante est accordée aux grands courants de l’islam, wahhabisme, islam politique des Frères musulmans, l’islah, le réformisme musulman, les audaces du premier Bourguiba, les contributions de nombreux intellectuels contemporains…
Il est frappant de constater que la plupart des interdits restreignant ou encadrant les libertés ne proviennent pas des versets du Coran, mais de hadiths voire de règles créées par consensus ou analogie, dans des époques souvent lointaines.
La part donnée au consensus établi dans des siècles lointains tend à dominer et prendre le pas sur celle des textes sacrés. « On l’a sacralisé tel que se le représentaient les ulema de l’époque de la codification, après lui avoir conféré les attributs de la perfection… » (Abdelmajid Charfi « L’Islam entre le message et l’histoire »).
Ainsi pour l’apostasie, la charia prescrit la peine de mort contre le musulman qui abjure sa religion; pourtant le Coran ne prévoit pas cette infraction, au contraire (« point de contrainte en matière de religion »), seul un hadith rapporté par une seule personne (ahad) dit »celui qui change de religion, tuez le »… Renforcé par les Ouléma par le « consensus du silence », l’histoire n’ayant pas rapporté que les compagnons du Prophète se soient explicitement prononcés sur la création de la règle.
Voilà donc sur quel fondement discutable, y compris au plan religieux, est imposée une des règles les plus attentatoires aux libertés universelles.
L’auteure reprend cet argument du livre de Mohamed Charfi, en souhaitant contribuer à le faire mieux connaître de l’ensemble des musulmans.
A propos du ramadan, Faouzia Charfi rappelle la pratique de sobriété et de solidarité avec les démunis, qui était celle de son son enfance, dans la logique de son fondement religieux. Elle s’indigne du contraste avec la pratique contemporaine de débauche alimentaire que la société tunisienne « réislamisée » vit aujourd’hui, au point que crise économique ou pas, le gouvernement doive doper les approvisionnements pour répondre à une consommation multipliée en cette période de jeûne… Quelle agression pour celles et ceux pour qui a été créé ce temps d’abstinence!
Ne pas jeûner peut être compensé en nourrissant un pauvre, rappelle t elle, ce qu’ignorent de nombreuses personnes, faute d’un accès au texte coranique.
D’autres indignations, d’autres inquiétudes ou marques de tristesse font bruisser certaines pages de ce livre, par delà les studieuses analyses de textes profanes ou religieux.
Face aux poupées sans visages que le commerce islamique impose aux petites filles de parents trop crédules. Autre surinterprétation du texte coranique.
Face au refus réitéré d’établir enfin en Tunisie l’égalité successorale entre les femmes et les hommes, seuls d’habiles contournement permettant aujourd’hui aux parents éclairés de faire justice à leurs filles.
L’auteure place son espoir dans des signaux comme la proposition de loi déposée en 2016 proposant l’égalité successorale, ou la levée enfin obtenue des réserves tunisiennes opposées à ce propos à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes.
La femme de science retrouve toute sa verve quand elle confronte la tradition de l’observation visuelle du croissant lunaire rétablie par Ben Ali en Tunisie, donnant dans un certain désordre le signal du début et de la fin du ramadan, avec la capacité contemporaine de maîtriser le temps comme l’a prouvé la rencontre entre la sonde Rosetta et la comète 67P. Encore l’effet d’un hadith…
Elle s’émeut que tout ce que la science moderne doit aux astronomes musulmans soit ainsi oublié, que le prix Nobel pakistanais Abdus Salam ait été conspué dans un journal arabo- islamique comme suivant « la doctrine hérétique soufiste de Wahdatul-Wujud ».
Reconnaitre « l’héritage oublié » de l’Occident à l’égard de la nation arabe « fait partie » pour elle, emboîtant le pas d’Alain de Libera, » du travail que nous devons poursuivre contre l’obscurantisme qui revient à vive allure ».
Faouzia Charfi conclut son livre en refusant le piège d’un « sacré » qui récuse raison et critique historique. Convaincue de l’urgence de lutter contre les obstacles aux libertés individuelles posés par un l’islam politique oeuvrant pour des États régis par la seule norme religieuse, elle prend tranquillement position: « j’ai choisi d’appartenir au monde des libertés, celui qui permet de vivre ensemble dans le respect de chacun ».
Cet ouvrage met remarquablement au débat l’alternative entre la possibilité de sociétés musulmanes fières de leurs vraies valeurs et de leur contribution à la civilisation contemporaine et des systèmes dogmatiques fondés sur une lecture étroite de règles écrites dans un passé lointain et pour des contextes révolus. Il le fait par l’analyse minutieuse des textes religieux et de leurs diverses interprétations, et de multiples exemples vécus illustrant tant les abus générés par la propagation d’un projet politico-religieux, que les multiples combats de femmes et d’hommes qui luttent pour un autre monde.
Cette alternance entre lucidité, amour de la démarche scientifique, indignation et tristesse face aux impostures, admiration de la créativité de ceux qui s’y opposent fait toute la richesse de la contribution de cette « intellectuelle combattante ».
Michel Wilson
 Leïla Slimani et Abdellah Taïa dans L’officiel du Maroc (Mars 2017): une amitié sans tabou.
Leïla Slimani et Abdellah Taïa dans L’officiel du Maroc (Mars 2017): une amitié sans tabou.
En mars 2017, le Salon du Livre de Paris avait choisi le Maroc comme pays invité, ce qui a permis aux visiteurs français de rencontrer nombre d’écrivains marocains, et notamment les étoiles montantes, c’est-à-dire ceux qui se sont fait connaître récemment. De ce nombre, Leïla Slimani qui a obtenu le prix Goncourt cette année pour son roman « Chanson douce », et Abdellah Taïa qui vient de publier « Celui qui est digne d’être aimé ». L’un et l’autre, d’origine marocaine, vivent en France, et dans un long entretien publié par L’Officiel du Maroc, ils réfléchissent à leurs points communs, en commençant par un aspect peut-être inattendu de ce qui les rapproche, à savoir leur amitié. Ce qui d’emblée les rend sympathiques et touchants pour les lecteurs que nous sommes.
Sans doute à cause de leur âge, et de leur allure juvénile, on a tendance à les trouver charmants, alors même que leurs propos sont sérieux et profonds. Et pour commencer par l’amitié, leur entretien est une véritable célébration de ce lien qui existe entre eux, alors que ce sujet est rarement abordé entre homme et femme. Il est vrai qu’elle est facilitée lorsque l’homosexualité de l’un des deux supprime entre eux la pression du désir sexuel et rend possible une relation d’un autre ordre—ici affectueuse et fondée sur beaucoup d’affinités. A ce propos ils mettent surtout l’accent sur le fait que leur chance a été de se rencontrer en France, car les liens qu’ils ont développés n’auraient pu exister au Maroc, malgré leur commune qualité d’écrivains.
Pourquoi donc une amitié n’aurait-elle pu se développer entre eux dans leur pays d’origine ? L’obstacle dont ils parlent est rigoureusement d’ordre social, c’est la profonde rupture qui existe au Maroc entre les riches et les pauvres, Leïla appartenant à la première catégorie et Abdellah à la seconde. Telle est la situation de départ, irrémédiablement, et aussi longtemps qu’ils vivaient au Maroc il leur était impossible voire impensable de l’ignorer ou de la surmonter. Comme ils insistent beaucoup sur cet aspect l’un et l’autre, sans le reporter à un passé qui pourrait être désormais révolu, on est bien obligé de se dire qu’il en est encore ainsi : au Maroc, le pauvre n’a aucune chance d’exister aux yeux du riche, il s’agit d’une structure sociale si forte que les individus ne parviennent pas à la surmonter— même si la famille de Leïla et notamment sa mère médecin a toujours été ouverte et généreuse, dans la mesure du possible, évidemment.
Donc Leïla et Abdellah n’ont pu développer leur amitié qu’une fois en France, ce qui veut dire que grâce à eux, pour nous qui les lisons, la France devient le pays de l’amitié, un très beau nom auquel on n’aurait pas forcément pensé en tant que franco-français. Et ce n’est pas la seule fois que des étrangers rendent grâce à des qualités de ce pays où elles sont trop souvent masquées aux yeux même de ceux qui en font preuve.
Cependant, il ne suffit pas de venir à Paris pour que le passé marocain s’efface. L’humiliation—c’est le nom qui convient pour dire ce qu’Abdellah Taïa a subi (du fait de sa pauvreté et de sa sexualité différente) —est ce qui s’oublie le moins facilement. A ce propos Leïla invoque le nom de Dostoïevski dont on sait en effet qu’il a largement développé ce thème dans son œuvre et pas seulement dans celui de ses romans qui s’intitule Humiliés et offensés (1861). Ce qui a le mérite de donner un éclairage important et révélateur sur son propre roman Chanson douce, pour tenter de comprendre l’énigme du personnage principal, la nounou meurtrière.
L’entretien entre les deux écrivains développe alors longuement un thème qui à dire vrai a toujours été très fréquent dans toute la littérature maghrébine d’expression française, celui de la liberté dont on jouit en France, à la fois en tant que personne et en tant qu’écrivain, par opposition, implicite ou explicite, avec toute la gamme des contraintes incluses dans le mode de vie maghrébin. Le contraste sur ce point entre les deux cultures a été suffisamment développé, parfois douloureusement, pour qu’on n’ait pas à y revenir ; et inutile de dire que la liberté est particulièrement appréciable lorsqu’on veut tenter de vivre une sexualité différente, même si les avancées à cet égard restent moins importantes en France que dans d’autres pays.
Cependant en dehors de toute différence sexuelle à assumer, la résistance principale de la société marocaine, au cœur de débats contemporains parfois extrêmement violents, concerne les représentations de la sexualité féminine, qui pour l’essentiel reste un tabou. Etant marocains d’origine, les deux interlocuteurs pensent à ce qui s’est passé dans leur pays, à propos du film de Nabil Ayouch intitulé Much loved qui est de 2015. Cette représentation d’une certaine forme de prostitution existant au Maroc a été considérée comme pornographique et interdite dans ce pays. Mais le plus grave consiste dans les agressions qu’a subies l’actrice principale du film, Loubna Abidar, qui a fait preuve d’un très grand courage. Nos deux écrivains considèrent qu’elle a assumé la part de subversion inhérente à toute création artistique, devenant pour eux une sorte de modèle de référence, même si leur vie en France les met à l’abri de cette violence. On sait qu’un mois après leur entretien, un autre film, algérien celui-là, A mon âge je me cache encore pour fumer (voir notre Lettre n°13), pose le même problème et s’engage totalement dans la cause de l’indispensable féminisme maghrébin. Leïla et Abdallah, étant écrivains, parlent de la manière dont ils mènent leur part du combat dans et par l’écriture.
Cette possibilité, ou plus encore cette vocation, leur permet de se situer en un lieu qui n’est plus le Maroc ni la France, ce qui accessoirement (mais c’est un stade important dans l’histoire des idées) les met à l’abri du sentiment d’exil qu’ils récusent. Il est clair qu’ils ont le Maroc en commun, ce qui est une des bases de leur complicité ; c’est l’essence de leur être qui est imprescriptible et ne se définit pas en nombre d’années passées dans ou hors leur pays. Mais sur cette référence omniprésente, point n’est besoin d’insister explicitement. Le Maroc est présent dans la France dont ils parlent, sans qu’il y ait exclusion obligée de l’une de leurs appartenances pour que l’autre puisse se vivre et se dire.
Denise Brahimi
Christian Phéline et Agnès Spiquel-Courtille : Camus, militant communiste, Alger, 1935-1937, Gallimard 2017
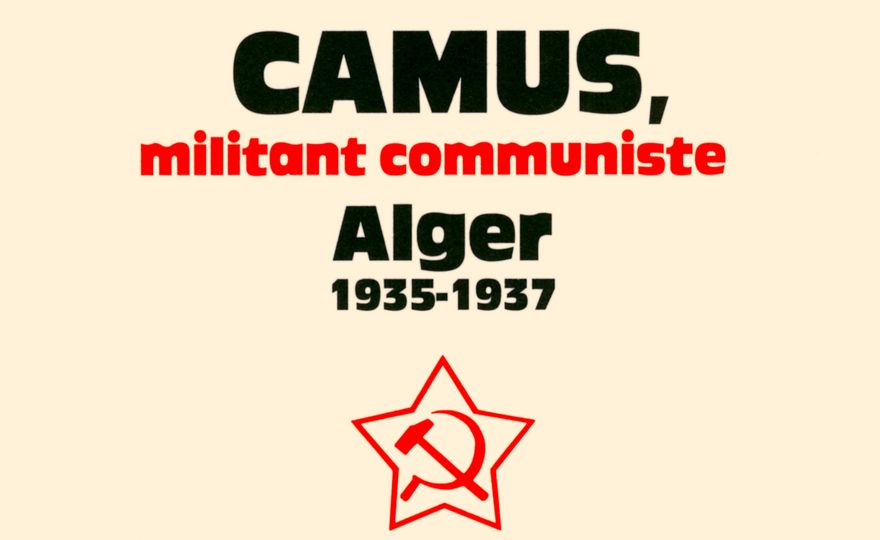 Un essai sur Camus, qui va au-delà de ses promesses
Un essai sur Camus, qui va au-delà de ses promesses
Le contenu du livre dépasse largement son titre même s’il respecte ses engagements concernant Camus. On a la preuve de ce dépassement (bienvenu) si on jette un regard sur la chronologie qui fait partie des annexes : elle couvre la période 1931-1956 et présente sous une forme concise d’utiles rappels historiques sur ces 25 ans.
Sur Camus, le livre regroupe de manière nuancée les raisons diverses de son adhésion au Parti qui deviendra peu après le PCA, Parti Communiste Algérien. Raisons plus ou moins convaincantes, à la fois vraisemblables (plusieurs sont données par Camus lui-même) et admissibles mais pourtant pas complétement déterminantes. Le fait d’avoir eu une enfance pauvre n’est une condition ni nécessaire ni suffisante, même si on peut admettre qu’elle a joué dans le cas du jeune Albert Camus, qui n’a pas encore 22 ans, en faveur de son adhésion en septembre 1935.
Et à l’autre extrémité de son bref parcours dans les rangs du communisme, les deux auteurs du livre se livrent aussi à une analyse détaillée des circonstances de leur rupture, qui pourrait bien être un départ volontaire en même temps qu’une exclusion. La multiplicité des témoignages et des affirmations incompatibles les amène à en faire un examen minutieux avant de proposer les dates qui paraissent les plus vraisemblables. Pour la rupture, ce serait octobre-novembre 1937.
Ni l’adhésion de Camus au PC, ni son exclusion du PCA ne sont d’ailleurs vraiment étonnantes.
Pour ce qui est de la première, on a envie de dire que pendant toute une partie du 20e siècle, l’adhésion au moins temporaire au communisme a été un passage obligé pour les jeunes intellectuels épris de justice sociale et désireux de manifester par un acte fort leur soutien aux exploités. La sincérité de Camus ne fait aucun doute, ses connaissances théoriques en matière de théorie marxiste, léniniste, a fortiori stalinienne étaient certainement plus limitées, même si ses proches de l’époque sont tous impressionnés par ses lectures et ses connaissances. Lorsque vient le moment où le Parti cherche à justifier son expulsion, il est question de ses tendances trotskystes—vrai ou faux— mais de toute manière on n’a pas l’impression qu’à cet égard non plus il ait été véritablement un théoricien. Il s’agissait surtout de porter contre lui une accusation grave, représentant une sorte d’hérésie monstrueuse plus encore qu’une simple déviation.
 Les deux auteurs de l’essai qui sont extrêmement prudents et ne se prononcent pas sans preuve, penchent manifestement vers une autre explication de son exclusion. Et à dire vrai elle touche à des faits qui sont au cœur du livre, de même qu’ils ont été au cœur de la vie politique en Algérie pendant au moins une trentaine d’années, incluant toute la période pendant laquelle Camus en a vécu intensément les complexités si douloureuses pour lui. A travers la très riche personnalité du militant indépendantiste Amar Ouzegane, l’essai continue son parcours au-delà de la mort de Camus. Ouzegane lui-même fut exclu du Parti communiste en 1947, comme Camus l’avait été dix ans plus tôt.
Les deux auteurs de l’essai qui sont extrêmement prudents et ne se prononcent pas sans preuve, penchent manifestement vers une autre explication de son exclusion. Et à dire vrai elle touche à des faits qui sont au cœur du livre, de même qu’ils ont été au cœur de la vie politique en Algérie pendant au moins une trentaine d’années, incluant toute la période pendant laquelle Camus en a vécu intensément les complexités si douloureuses pour lui. A travers la très riche personnalité du militant indépendantiste Amar Ouzegane, l’essai continue son parcours au-delà de la mort de Camus. Ouzegane lui-même fut exclu du Parti communiste en 1947, comme Camus l’avait été dix ans plus tôt.
On a compris que la grande question à laquelle ce Camus militant communiste apporte une contribution très précise et remarquablement informée est celle des rapports entre communisme et nationalisme, s’agissant d’un pays soumis au régime colonial et de plus en plus engagé dans la lutte (qui deviendra une guerre) pour y échapper. Au début de 1937, succédant à l’Etoile nord-africaine dissoute par le Front Populaire, se crée le PPA ou Parti du Peuple Algérien, dont les dirigeants sont arrêtés un peu plus tard dans cette même année. Nombre de preuves assez sûres permettent d’affirmer que Camus se sentait désireux de soutenir leur cause, ce qui n’était pas l’opinion ni l’attitude dominante au PCA. Divergence évidemment grave, et encore, le mot est faible, suffisante en tout cas pour expliquer une exclusion—conformément à la pratique communiste qui était sans nuance et sans ménagement. L’absence d’affinités (encore un euphémisme !) de Camus pour cette pratique (et toutes les autres dont elle n’est qu’un aspect) fait partie de ce qui sera de la part de Camus un éloignement grandissant à l’égard du communisme, sans la moindre velléité de retour sur cette tentative des années 1935-1937.
 Est-ce à dire qu’elles ont été une sorte de temps mort dans la carrière de Camus ? En aucune manière, et les deux auteurs de l’essai n’ont pas de mal à montrer quelle a été au contraire la richesse de ce moment pour sa formation, dans le domaine culturel au sens large, comportant non seulement des avancées intellectuelles mais plus encore des entreprises en tous genres appelées dans le livre « initiatives » : manière de dire que certaines n’ont pas été de longue durée mais qu’elles témoignaient néanmoins d’une belle créativité. On remarque notamment l’importance du théâtre pour Camus pendant ces deux années, ce qui n’est que le début d’une activité qu’il maintiendra, dans toute la mesure du possible, pendant les vingt-cinq ans qui suivront.
Est-ce à dire qu’elles ont été une sorte de temps mort dans la carrière de Camus ? En aucune manière, et les deux auteurs de l’essai n’ont pas de mal à montrer quelle a été au contraire la richesse de ce moment pour sa formation, dans le domaine culturel au sens large, comportant non seulement des avancées intellectuelles mais plus encore des entreprises en tous genres appelées dans le livre « initiatives » : manière de dire que certaines n’ont pas été de longue durée mais qu’elles témoignaient néanmoins d’une belle créativité. On remarque notamment l’importance du théâtre pour Camus pendant ces deux années, ce qui n’est que le début d’une activité qu’il maintiendra, dans toute la mesure du possible, pendant les vingt-cinq ans qui suivront.
Restent les deux autres parties du livre : d’une part des extraits d’une correspondance entre Amar Ouzegane, dirigeant communiste de la première heure, et Charles Poncet, « compagnon de route » du Parti et ami très proche de Camus ; d’autre part un ensemble de documents concernant aussi bien Amar Ouzegane que Camus. C’est sur ces deux parties du livre que s’appuie la première, concernant Camus militant communiste dans les années 35-37. Mais elles ont aussi pour effet de nous renseigner sur les débats qui ont eu cours pendant les trois dernières décennies de l’Algérie coloniale—à partir de ce problème essentiel, épineux ô combien, des relations entre le parti communiste (un peu le PCF, beaucoup le PCA) et les partis nationalistes algériens, successifs ou simultanés. Le mérite des auteurs est considérable, car s’il est vrai que ces relations ont été difficiles de toute manière, elles sont tout aussi difficiles à analyser, encore aujourd’hui.
Denise Brahimi
 Albert Memmi : Penser à vif : de la colonisation à la laïcité
Albert Memmi : Penser à vif : de la colonisation à la laïcité
Textes réunis et présentés par Hervé Sanson, Non Lieu, 2017
Albert Memmi mérite bien qu’on lui rende hommage, ce que ce livre fait de la meilleure façon, c’est-à-dire en citant nombre de ses œuvres, sur un grand laps de temps. De 1941 à 2002, c’est en effet considérable voire exceptionnel, et comme le livre est réparti en six chapitres thématiques, cela veut dire que l’on revient six fois sur un parcours tout en nuances, consacré à la fois à l’approfondissement continu de thèmes récurrents et à une attention vigilante aux événements qui se sont évidemment multipliés pendant cette succession de décennies. Dans ce recueil de textes, Albert Memmi est vu comme essayiste et non comme romancier, ce qu’il est également comme on sait. Pour l’essentiel il s’agit de réflexions et d’analyses portant sur les relations sociales dans le monde que Memmi a eu l’occasion de connaître et d’observer, principalement dans la Tunisie ou il est né puis en France où sa première œuvre marquante a été le Portrait d’un colonisé en 1957. A la fin de l’année en cours, Memmi né en 1920, aura quatre-vingt dix-sept ans. Son entretien avec Hervé Sanson, publié à la fin du livre, montre à quel point les avatars de cette très longue histoire sont présents à son esprit, et lui ont permis de préciser sans relâche les principaux concepts qu’il en a dégagés, inventant parfois les mots pour les dire avec une acuité qui refuse la pensée floue et les emportements supposés lyriques. Car c’est beaucoup, et souvent, à travers le choix des mots qu’il traque toute facilité dangereuse et tout fanatisme, ce qui ne l’empêche pas d’être un homme de convictions.
Le regroupement thématique dont le lecteur de ce livre bénéficie en toute clarté n’exclut pas que le déroulement des chapitres soit aussi partiellement chronologique, raison pour laquelle le premier d’entre eux s’intitule « Colonisation et décolonisation » puisque c’est au moment où ces questions se posaient avec la plus grande acuité que Memmi est entré dans la vie intellectuelle. Rien de plus éclairant à cet égard que les différences qui le séparent de Frantz Fanon, et dont plusieurs des textes cités font état. Ses critiques n’ayant rien perdu de leur pertinence, il n’est pas inutile d’y revenir après les années récentes qui ont donné lieu à une véritable sacralisation de Frantz Fanon dans les milieux post-coloniaux et anti-racistes.
Cette dernière question, le racisme, est probablement celle à laquelle Albert Memmi a consacré le plus grand nombre de réflexions, d’abord en tant que victime de cette attitude aussi déplorable que répandue, par laquelle il a été très tôt concerné en tant que juif —ce dont il traite dans son deuxième chapitre, « Judaïsme et judéité », puis de manière élargie, en tant que philosophe pour qui l’antisémitisme n’est qu’un aspect ou une variante de ce qu’il appelle « l’hétérophobie », à laquelle sont consacrés les textes du cinquième chapitre, justement intitulé « Du racisme à l’hétérophobie ».
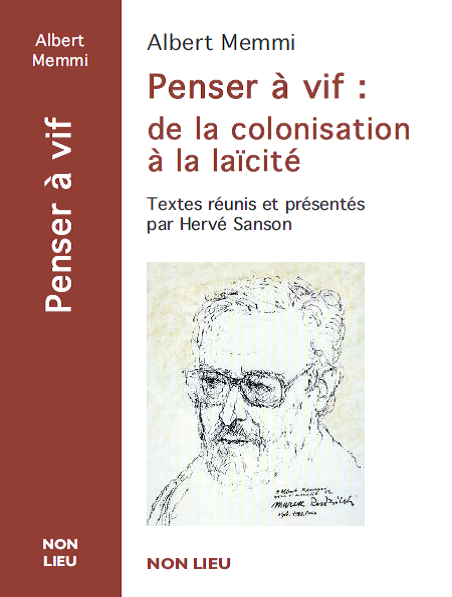 En employant ce dernier mot, Memmi n’a nullement l’intention de minimiser ou d’adoucir, si faire se pouvait, la pensée raciste, les comportements racistes, et l’omniprésence au quotidien d’attitudes où se manifeste le racisme, même si c’est le plus souvent sur le mode de la dénégation. Il agit en philosophe en cela qu’il recherche les causes, dans une anthropologie qui est si l’on peut dire physique avant d’être culturelle, mais à la réflexion, il n’y a évidemment pas de quoi se réjouir ou être optimiste et d’ailleurs Memmi ne l’est pas. En homme modéré à l’esprit toujours analytique et précis, il se définit comme quelqu’un qui est à la fois pessimiste dans le court terme et optimiste à long terme, laissant à ces formules leur marge inévitable d’imprécision.
En employant ce dernier mot, Memmi n’a nullement l’intention de minimiser ou d’adoucir, si faire se pouvait, la pensée raciste, les comportements racistes, et l’omniprésence au quotidien d’attitudes où se manifeste le racisme, même si c’est le plus souvent sur le mode de la dénégation. Il agit en philosophe en cela qu’il recherche les causes, dans une anthropologie qui est si l’on peut dire physique avant d’être culturelle, mais à la réflexion, il n’y a évidemment pas de quoi se réjouir ou être optimiste et d’ailleurs Memmi ne l’est pas. En homme modéré à l’esprit toujours analytique et précis, il se définit comme quelqu’un qui est à la fois pessimiste dans le court terme et optimiste à long terme, laissant à ces formules leur marge inévitable d’imprécision.
On sait que l’une des grandes différences qui le sépare des intellectuels dits de gauche (dans leur très grande majorité) est sa position à l’égard du sionisme, qu’il refuse de diaboliser, et dont il continue à croire qu’il a été un mouvement nécessaire voire indispensable et inévitable en son temps. La fidélité à cette conviction, quoi qu’on en pense par ailleurs, ne peut manquer de lui faire honneur tant sont fortes les pressions et les différentes formes d’exclusion qu’elle a entraînées. Memmi n’est pas violent dans sa manière de s’exprimer, il n’en est pas moins d’une remarquable ténacité, et du fait qu’il a beaucoup étudié les phénomènes de domination/ soumission (notamment sous le nom de « dépendance » dans le quatrième chapitre de cet essai), il sait ce que veulent dire des mots comme résistance ou liberté. C’est précisément ce qui frappe à la lecture ou re-lecture de ces textes (dont certains étaient restés inédits) : Memmi n’est jamais complaisant ni à l’égard des autres ni à l’égard de lui-même, ce qui est d’autant plus remarquable qu’il écoute et entend ce qu’on lui dit, comme le prouve l’entretien qui termine le livre—mais rien ne l’empêchera jamais de penser par lui-même, telle est la grande leçon que l’on retire de cette confrontation avec ses écrits.
Parler de « générosité amusée » pour définir son attitude actuelle est certainement une manière d’exprimer son aspiration à la sagesse, ce dont on ne voit guère de trace dans le monde contemporain, et surtout pas lorsqu’on approche le domaine du politique, mais c’est pourtant de cela qu’il s’agit chez lui, et on en a la preuve dans l’absence de gémissement ou d’indignation. Memmi n’a aucune envie d’être un vieillard indigné—dont acte—et on peut lui savoir gré d’éviter ce qu’il considèrerait sans doute comme une facilité. Pas non plus de gémissement ni de référence au tragique, attitudes spectaculaires qui ne sont pas de son fait. On doit donc admirer qu’il soit parvenu à s’imposer sans recourir aux procédés médiatiques connus et dont on nous dit qu’ils sont incontournables à notre époque. En ce sens, publier et re-publier Memmi est sans doute la seule attitude digne de lui, beaucoup plus que ne le serait la volonté de l’exhiber dans telle ou telle émission à grand spectacle. Celles-ci font partie des différents moyens que les hommes de notre époque inventent pour se rassurer —et dont lui, Albert Memmi, a cherché toute sa vie à se passer.
Denise Brahimi




Il manque un information sur les auteurs du Livre sur Camus
Le livre sur Camus paraît très intéressant. Mais il manque à l’article le nom des auteurs
et celui de l’éditeur.