Lettre culturelle franco-maghrébine #57
ÉDITO
La Lettre suit plusieurs fils directeurs, ce qui apparaît clairement lorsqu’il s’agit de renouer les liens après la période d’été. Les plus proches d’entre eux unissent l’Association Coup de Soleil à la région Auvergne Rhône Alpes, dont émanent les deux premiers articles que nous publions dans cette Lettre, consacrés l’un au travail du metteur en scène Dominique Lurcel et l’autre à celui de la romancière Dalie Farah.
Des pays du Maghreb c’est de la Tunisie qu’il sera le plus question ce mois-ci, à travers un livre de souvenirs et de réflexions d’Hocine Tandjaoui et un film documentaire intitulé « Fatallah »qui attire l’attention sur un groupe de jeunes Tunisiens défavorisés, malgré ou à cause de leur passion pour la musique.
Musique et cuisine sont les aspects très concrets que prend l’échange entre les individus et entre les peuples, André Cohen Aknin raconte comme il les utilise pour tenter de trouver un contact avec sa mère frappée par la maladie d’Alzheimer, tandis que dans le récit intitulé « Une famille bretonne en Kabylie » on voit comment Kabyles et Bretons sont rapprochés par leurs musiques respectives.
Une bonne nouvelle concerne la reprise de la revue Awal, interrompue depuis plusieurs années et qui consacrera bientôt un nouveau numéro à Mouloud Feraoun. Et une autre vient du cinéma, auquel nous devons un nouveau film de l’actrice-réalisatrice Hafsia Herzi, « Bonne Mère » où elle parle de son enfance à Marseille sur un ton original et touchant.
Denise Brahimi

« PASSEPORTS POUR LA LIBERTE » par Dominique Lurcel, avec Nadia Larbiouène
Représentations à la Maison des Passages de Lyon les 11 et 12 juin 2021
Ces représentations n’ont été que plus appréciables d’avoir été longuement attendues mais elles l’auraient été de toute façon, tant les idées foisonnent dans ce dialogue passionnant. Même si (à la différence de ce qui a pu se passer ailleurs) il n’y avait pas ici la caisse de résonance d’un public scolaire.
Pour ceux qui voudraient rafraîchir leurs connaissances à ce sujet, il serait utile de se reporter à la Lettre de Coup de soleil n°52 du 1e mars 2021. Rappelons que le spectacle, tiré de situations et de personnages réels, fabrique une forme théâtrale à partir des entretiens qui ont eu lieu il y a  quelques années déjà entre le sociologue Stéphane Beaud et une jeune femme, Samira Belhoumi ; celle-ci, née en France dans une famille de l’immigration algérienne, a pris la nationalité française et réussi à se donner à la fois une culture et une situation sociale qui pourraient paraître inespérées. Le sociologue s’interroge sur les moyens par lesquels elle y est parvenue et sur l’éventuel prix à payer pour ce succès. La jeune femme revient sur son enfance et son adolescence, pendant lesquelles sa remarquable réussite scolaire lui a valu le soutien de ses enseignants pour tenter d’aller au-delà, en commençant modestement, après le bac, par des études d’infirmière.
quelques années déjà entre le sociologue Stéphane Beaud et une jeune femme, Samira Belhoumi ; celle-ci, née en France dans une famille de l’immigration algérienne, a pris la nationalité française et réussi à se donner à la fois une culture et une situation sociale qui pourraient paraître inespérées. Le sociologue s’interroge sur les moyens par lesquels elle y est parvenue et sur l’éventuel prix à payer pour ce succès. La jeune femme revient sur son enfance et son adolescence, pendant lesquelles sa remarquable réussite scolaire lui a valu le soutien de ses enseignants pour tenter d’aller au-delà, en commençant modestement, après le bac, par des études d’infirmière.
Le spectacle met sous nos yeux ou plutôt dans nos oreilles plusieurs faits qui manifestement interrogent le sociologue et sans doute aussi le public de la pièce. Paradoxalement Samira n’a trouvé aucune aide, c’est le moins qu’on puisse dire, auprès de sa mère qui pourtant parlait français, alors que son père, analphabète, l’a plusieurs fois soutenue et encouragée à des moments décisifs de sa vie. On se dit qu’on ne peut espérer d’une femme traditionnelle comme cette mère, aux prises avec les duretés du quotidien (nombreux enfants à élever, détresse financière etc.), qu’elle renonce à l’aide de sa fille aînée —et d’ailleurs celle-ci constate chaque jour à quel point elle est indispensable.
Une autre question sur laquelle le sociologue lui demande des éclaircissements est celle du mariage, don on sait à quel point il peut être problématique dans la vie des Maghrébines en milieu traditionnel. Il a très vite été convenu chez les Belhoumi que Samira se marierait sitôt passé le bac, et malgré sa décision de ruser avec cette obligation, Samira finit pas s’y soumettre, bien décidée par devers elle à n’en faire qu’une étape sur les chemins de sa liberté. C’est bien ainsi finalement que les choses se passeront mais non sans tribulations diverses : mariage, retour chez les parents avec le mari qui ne travaille pas, départ à Paris, divorce etc. Le sociologue semble un peu éberlué par la complexité de ce dispositif, mais on se dit qu’en effet c’est sans doute comme cela qu’il fallait faire et que de toute façon il n’y avait sans doute pas moyen de faire autrement ! Samira parle discrètement du moment où elle découvre sa liberté et tout ce qu’elle va pouvoir faire dès lors qu’elle vit librement. Elle est une personne raisonnable et on sait qu’elle ne se perdra pas en chemin mais enfin c’est un risque que d’autres ont pu courir en pareil cas. Interrogée sur le genre d’homme qu’elle a désiré trouver à cette étape de sa vie, elle explique qu’en effet la question s’est posée à elle de manière troublante, tant elle se sentait incapable de supporter la conception que se font les Musulmans du mariage et des obligations de leur épouse. On l’aurait donc plutôt vue s’orienter vers un mariage avec un Français, mais, nouveau paradoxe, elle dit sans s’en expliquer qu’elle a épousé un Musulman. La conclusion est que les choses ne sont jamais simples et que même avec l’aide d’un sociologue, même dans le cadre d’un entretien honnête et sincère, il reste beaucoup de choses obscures, inévitablement.
 La dernière partie de la pièce confirme cette impression, de deux manières au moins. Alors même que Samira s’est prêtée avec beaucoup de bonne volonté à l’interrogatoire auquel Stéphane Beaud la soumet, et alors même que celui-ci fait preuve de beaucoup d’insistance, même ou justement quand il sent qu’elle a des difficultés (de plusieurs ordres sans doute) à s’expliquer, on a n’a pas du tout l’impression que tout est dit ni surtout que tout est clair. Et il y a là une sorte de rebondissement qui fait tout l’intérêt de cette mise en scène, décidément subtile et minutieuse.
La dernière partie de la pièce confirme cette impression, de deux manières au moins. Alors même que Samira s’est prêtée avec beaucoup de bonne volonté à l’interrogatoire auquel Stéphane Beaud la soumet, et alors même que celui-ci fait preuve de beaucoup d’insistance, même ou justement quand il sent qu’elle a des difficultés (de plusieurs ordres sans doute) à s’expliquer, on a n’a pas du tout l’impression que tout est dit ni surtout que tout est clair. Et il y a là une sorte de rebondissement qui fait tout l’intérêt de cette mise en scène, décidément subtile et minutieuse.
Mais alors, demande légitimement le sociologue à la jeune femme quand elle arrive au bout de son récit, vous devriez avoir le sentiment que pour vous du moins tout va bien et que vous pouvez vous réjouir de la manière dont vous avez finalement réussi votre vie (sous-entendu : à tous égards et selon vos désirs). Or s’il pose cette question, c’est que Samira a dit plusieurs fois très fermement et avec conviction qu’elle était en colère, et même gravement fâchée. Certaines des raisons pour lesquelles il en est ainsi sont dites explicitement, elles concernent par exemple l’idée de l’islam qui s’est récemment répandue en France et qu’elle juge tout à fait fausse. Mais on comprend aussi que le problème est plus vaste et que même si elle n’en veut à personne, surtout pas à ses parents, son parcours, notamment dans l’enfance et dans l’adolescence, a été d’une telle dureté qu’elle ne peut s’éprouver elle-même comme une personne épanouie. Il y a des séquelles à ce qu’elle a vécu, c’est inévitable et certain, et c’est ce qu’on comprend en tant que public de la pièce, qui joue alors le rôle d’une sorte de miroir grossissant, ou même de révélateur, sur ce que Samira ne peut peut-être pas formuler tout à fait clairement.
Non, personne ne dira finalement qu’il s’agit d’une belle histoire de réussite, dont chacun ne peut que se féliciter. Et ce n’est pas ce que, s’agissant d’un certain cinéma américain, on appelle un « feel good movie ». Reste au contraire le sentiment d’une sorte de déficit de bonheur ou de déficit d’amour, dont elle comprend que rien ne pourra les combler. Le fait est d’autant plus remarquable que cet entretien évite tout attendrissement, le sociologue ne sortant jamais de son rôle pour manifester empathie ou amitié. Les histoires poignantes sont celles qui nous font comprendre que le malheur vécu est ineffaçable, et de plus, cette histoire-là n’est pas une fiction !
Denise Brahimi
 Dominique Lurcel
Dominique Lurcel
A propos de son adaptation pour la scène des entretiens qu’il a eu avec Samira Belhoumi, Dominique Lurcel a bien voulu nous donner quelques indications précieuses sur sa manière de travailler :
» Il est vrai que, de façon récurrente depuis la création (1997) de ma Compagnie, je travaille sur des textes qui ne sont pas originellement destinés à la scène, et qui, quelle que soit leur forme première (Conversation, Journal, livre entier…), sont de l’ordre du témoignage. Paroles qui, à chaque fois à mes yeux, touchent à l’universel.
Dans tous les cas, je dirais que les choses se jouent pour moi en deux temps (pas toujours dans le respect de la chronologie)
1/ Le temps, décisif, de l’adaptation. Le plus long. Je n’entrerai pas ici dans le détail des difficultés spécifiques rencontrées en fonction des différences formelles. L’important : il s’agit toujours d’une approche progressive, par cercles concentriques, prises de notes, premiers choix (les évidences), puis resserrement, souvent douloureux mais inévitable, dans une volonté de respect absolu des équilibres internes du texte, en m’accordant une liberté plus grande vis-à-vis de sa structure (question du montage final)
Ce temps de l’adaptation est aussi celui de l’appropriation, lente et profonde : au fur et à mesure de l’avancement de l’adaptation, s’impose progressivement la forme de la mise en scène, la plupart du temps minimaliste (choix esthétique : donner la priorité au texte, ne pas « distraire » ; choix politique : pouvoir jouer partout, s’adapter à tous les lieux, dans et hors théâtres).
2/ Le temps des répétitions, qui est celui de l’incarnation : la direction d’acteur, démarche qui peut se résumer dans une « transmission d’appropriation » : faire en sorte que le comédien/la comédienne fasse peu à peu sien/sienne l’univers et le langage du personnage qui lui a été confié. Il s’agit bien, en effet, d’un « personnage » que l’on traite théâtralement : apport très riche en éléments dramaturgiques ; travail au plus près de l’énergie de l’écriture, pour la rendre la plus fluide possible aux oreilles du spectateur (sans jamais en trahir la forme, qu’elle soit littéraire ou orale), arriver à en transmettre le sens dans sa plus grande plénitude. En refusant tout pathos, l’ennemi absolu ».

« LE DOIGT » roman par Dalie Farah, éditions Grasset, 2021
Ce livre est le deuxième publié par l’auteure, il n’est pas inutile d’avoir lu le précédent, publié en 2019 sous le titre Impasse Verlaine, pour apprécier celui-là et pour être d’emblée de plain pied avec ce qu’il nous dit, mais ce n’est pas indispensable non plus. Manifestement il s’agit de livres en partie ou même en grande partie autobiographiques mais puisque Dalie Farah préfère  le mot roman qui en effet est le plus large et le plus ouvert, on n’est pas obligé de prendre tout ce qu’elle nous dit sur sa narratrice au premier degré, en tout cas ce n’est pas sur ce type de distinction au sein du genre romanesque qu’elle veut mettre l’accent, elle n’a pas de problème à parler d’elle-même à la troisième personne et cela n’en pose pas non plus au lecteur. Dans ce livre comme dans la réalité elle est « la prof » et l’action se passe entre collège et lycée, entre Clermont-Ferrand et Thiers. A cet égard elle est très consciente de sa légitimité : le concours d’agrégation auquel elle a été reçue lui vaut une intégration sans réserve à l’éducation nationale.
le mot roman qui en effet est le plus large et le plus ouvert, on n’est pas obligé de prendre tout ce qu’elle nous dit sur sa narratrice au premier degré, en tout cas ce n’est pas sur ce type de distinction au sein du genre romanesque qu’elle veut mettre l’accent, elle n’a pas de problème à parler d’elle-même à la troisième personne et cela n’en pose pas non plus au lecteur. Dans ce livre comme dans la réalité elle est « la prof » et l’action se passe entre collège et lycée, entre Clermont-Ferrand et Thiers. A cet égard elle est très consciente de sa légitimité : le concours d’agrégation auquel elle a été reçue lui vaut une intégration sans réserve à l’éducation nationale.
On connaît le vocabulaire employé pour parler de personnages comme elle, issue de l’émigration et dont l’enfance s’est passée dans un milieu très défavorisé : exemple de méritocratie, assimilation très réussie etc. Mais évidemment il n’y aurait pas de roman et surtout pas de roman de Dalie Farah si on pouvait s’en tenir là. Impasse Verlaine remontait dans le temps, de deux générations auparavant jusqu’à celle de l’auteure encore enfant. Chronologiquement, Le Doigt peut être considéré comme la suite et son action s’étend sur une vingtaine d’années jusqu’au moment où « la prof » va avoir à peu près cinquante ans (Dalie Farah est née en 1973). Il est important que l’action ne soit pas ponctuelle ni plus ou moins au présent mais se développe au contraire au fil des années, comme la narratrice le répète plusieurs fois en y insistant. Car de là vient qu’on s’interroge forcément sur le caractère répétitif des événements qui ponctuent son histoire et qui adviennent à la fois pour elle et par elle. Mais que veut donc dire ce « par elle » sur lequel elle s’interroge elle-même, au point que la question apparaît comme essentielle à son roman ?
Par trois fois au cours de ce récit « la prof » est confrontée à une violence individualisée : il s’agit de trois individus différents, deux adolescents qui l’agressent physiquement ou verbalement dans l’exercice de son métier, et un homme qui est amené à la gifler suite au « doigt d’honneur » qu’elle lui fait par deux fois, d’où le titre du roman. Faut-il comprendre qu’elle est véritablement persécutée et qu’une malchance persistante s’acharne contre elle, comme un mauvais destin ? Ce n’est pas ce qu’elle dit, et elle ne se décrit pas elle-même en victime du sort.

Portrait of Dalie Farah 18/12/2018 ©Philippe MATSAS/Opale via Leemage
Sans doute est-ce un peu cela tout de même mais un peu seulement car elle est bien consciente de provoquer au moins en partie les désagréments (plus graves que bénins) dont elle traîne ensuite les conséquences, non sans mainte difficulté pour en venir à bout : problèmes physiques suites à des coups reçus, procès-avocat–jugement et interventions de l’administration qui est ce qu’elle est, c’est-à-dire insensible aux cas individuels et aux arguments. Or il est clair qu’elle pourrait éviter une bonne partie de tout cela si elle était moins réactive ou plus conciliante, on le dira comme on voudra, en tout cas plus lisse et moins encline aux accrochages à rebondissements. Assurément la vie, pour elle et avec elle, n’est pas un long fleuve tranquille mais plutôt une sorte de corde à nœuds sur laquelle elle s’écorche elle-même plutôt que de la lâcher tout bonnement.
Il serait faux de dire qu’elle aime la bagarre, plus juste de dire qu’elle ne sait pas vivre autrement parce qu’elle n’a jamais appris. Pour ceux qui savent, grâce à Impasse Verlaine, les coups qu’elle a reçus pendant toute son enfance, les nodosités de sa vie adulte semblent en être les traces, sans doute indélébiles, comme des cicatrices internes et profondes. D’origine accidentelle elles font pourtant partie de son être et le constituent, c’est pourquoi il n’y a aucun sens à croire qu’elle pourrait un jour les oublier, et en épargner la sensation ou le contact à ceux qui s’approchent d’elle. Mais elle a trop d’esprit, ou de pudeur pour les leur imposer tout de go. D’où sa drôle ou drolatique manière d’aborder ce qui pourrait être tragique, du moins sinistre, en le racontant ou en le mettant en scène à sa façon. Celle-ci se caractérise par la recherche d’une expression qui est tout sauf naturelle et aisée mais qui est ce qu’on appelle un style.
Son besoin d’amuser les autres, quitte à faire le clown, s’explique sans doute par sa peur de les incommoder, et de les éloigner, en leur communicant un malheur contagieux. Toutes les peurs qu’elle s’est incorporées, dans sa chair et dans son esprit, l’habitent de plusieurs façons qui ne la laissent pas en paix mais l’amènent aussi à en faire trop pour les autres, de manière intrusive, voire dérangeante : la chose vraiment impossible pour elle serait de lâcher le présent, ou d’oublier le passé. On se dit parfois que dans un coin de l’Enfer de Dante, il doit y avoir des individus de cette sorte, et que comme tous les autres habitants de ce terrible lieu, ils sont évidemment des victimes mais de la catégorie que le poète Baudelaire appelle Héautontimoroumenos, mot barbare quoique grec et en effet terrible qui veut dire « bourreau de soi-même ». « La prof », décidément, n’est pas une femme simple, sa longue habitude de recevoir des coups fait qu’elle est aussi dans une perpétuelle esquive et dans une sorte de jeu qui consiste à les provoquer autant qu’à les détourner. Et c’est en plus un jeu auquel elle s’emploie à faire participer les autres, retournant par exemple voir sa mère pour lui dire comment elle a parlé d’elle dans son premier roman, ou bien encore forçant l’homme dont elle a reçu une gifle à revenir sur les faits qui l’ont poussé à cela.
L’essence de la littérature serait dans cette sorte de creusement imposé aux autres comme à soi-même, sans jamais renoncer à aller toujours plus loin, car le crime à punir serait de ne rien faire, de choisir l’obéissance et la soumission.
Denise Brahimi
« AINSI QUE TOUS LES HOMMES » par Hocine Tandjaoui, 108 Edition, 2020
Alors que cette mention est la plus répandue de nos jours dans le monde de l’édition, il n’est pas dit de ce livre qu’il est un roman. Et pourtant il le devrait car il est loin d’être composé uniquement de données et de fragments autobiographiques, même si, comme il est normal et fréquent, c’est bien là le terreau dans lequel l’auteur a puisé, apportant dans plus d’un cas des précisions sur ce qu’il a pu observer lui-même, de par sa vie et sa profession.  Mais c’est aussi quelqu’un qui tient à faire œuvre d’écrivain, non seulement parce que, comme il apparaît très vite, il maîtrise l’art d’écrire et en fait profiter ses lecteurs, mais aussi parce qu’il organise son livre de façon très élaborée et selon une mise en forme en différentes variations de son projet fondamental.
Mais c’est aussi quelqu’un qui tient à faire œuvre d’écrivain, non seulement parce que, comme il apparaît très vite, il maîtrise l’art d’écrire et en fait profiter ses lecteurs, mais aussi parce qu’il organise son livre de façon très élaborée et selon une mise en forme en différentes variations de son projet fondamental.
Celui-ci apparaît dans le sous-titre, beaucoup plus éclairant que le titre lui-même parce qu’il est composé de trois termes précis, trois noms de villes : « Naples/Tunis/ Skopje ». Pour le narrateur il s’agit de lieux bien connus, surtout les deux premiers entre lesquels s’est partagée sa vie personnelle d’Italo-Tunisien. Mais la troisième ville, Skopje, capitale de la Macédoine, est si petite que point n’est besoin d’y avoir vécu pour comprendre ce qu’elle est, et ce qui s’y passe aujourd’hui. De toute façon les trois villes telles que représentées dans le livre ont en commun d’être des lieux à la fois bien réels (et d’ailleurs admirablement évoqués ou décrits) et par ailleurs des lieux qu’on pourrait dire symboliques des malheurs de notre temps. Ils sont exemplaires au sens négatif du mot et méritent pour cette raison une analyse de détail signifiant à peu près : voilà, hélas, comment les choses se passent dans le monde où nous vivons—encore s’agit-il de lieux qui ne sont pas en guerre au moment où l’auteur nous les décrit !
Donc ce sont des lieux qui pour des raisons diverses ne vont pas bien, mais l’auteur fabrique un fil directeur et une trame romanesque pour ne pas avoir à nous le dire tout de go. Romancier en cela, il le montre plutôt, du fait de ce qu’il est amené à entreprendre au cours de ce qu’on peut appeler d’un terme général sa recherche : quête au sens le plus concret ou quête de sens à travers un fatras d’événements et de situations dont il découvre qu’ils sont sous-analysés quand ils ne sont pas occultés.
Au départ le narrateur qui est archéologue de profession, formé à ce métier pour l’exercer en Tunisie, (c’est-à-dire dans le pays le plus riche qui soit à cet égard) est chargé par une vieille tante napolitaine, prénommée Esther, de retrouver celui qui fut son père à elle et donc le grand-père de Bernardo. Il s’agit d’un certain Tomasso, qu’on apprendra à connaître, mais dont la seule chose qu’on sache au départ est qu’il a disparu. Voilà qui ressemble à une intrigue policière mais on apprendra peu à peu et surtout à la fin du livre, en revenant sur l’histoire encore proche ou récente de la Tunisie, qu’elle est liée aux événements sociaux et politiques qui se sont passés et se passent encore dans ce pays. Tomasso est ou plutôt était un homme de bien, ou pour le dire plus globalement encore un « homme bien ». Il a voulu l’indépendance de la Tunisie, par souci de la justice et rejet du colonialisme, alors même qu’il était totalement dépourvu d’ambition personnelle et du désir de posséder ; ce qui ne pouvait que le rendre plus facile à gruger—et de nombreux profiteurs aux dents longues ne s’en sont évidemment pas privés. La manière dont il a été spolié est très bien expliquée dans le livre qui à partir d’exemples comme celui-ci explicite ce qu’on a coutume de désigner d’un seul mot : l’incroyable corruption qui a régné en Tunisie à l’époque de Ben Ali et de sa redoutable épouse. Il semble qu’il y ait eu pendant plusieurs années dans ce malheureux pays une prédilection pour la pratique scandaleuse consistant à exproprier sans vergogne les propriétaires légitimes, et à construire aussitôt sur les terres ainsi récupérées des ensembles immobiliers vendus à haut prix—le tout évidemment sans le moindre souci de l’environnement (comme on s’en doute, c’est une litote, très en deçà de l’effarante réalité !)
Encore en Tunisie, le livre d’Hocine Tandjaoui dénonce la gestion révoltante du patrimoine archéologique, qui laisse totalement à l’abandon l’immense et à dire vrai exceptionnel héritage laissé par la longue et prospère époque carthaginoise, privant ainsi les Tunisiens de toute une part, immense, de leur passé.
Mais la dénonciation que comporte son livre (dont c’est un aspect essentiel) s’appuie sur des faits encore plus flagrants et consternants dans les chapitres consacrés à Skopje.  Hocine Tandjaoui y rappelle et ramène à la surface ce que l’histoire officielle, malheureusement incontestée, a utilisé sans vergogne pour en tirer parti mensongèrement. Il s’agit ici du problème des migrants et d’un petit groupe de sept Pakistanais et Indiens assassinés près de Skopje, qu’on a fait passer pour de dangereux terroristes, de façon évidemment mensongère, comme le prouvent les recherches menées par l’auteur.
Hocine Tandjaoui y rappelle et ramène à la surface ce que l’histoire officielle, malheureusement incontestée, a utilisé sans vergogne pour en tirer parti mensongèrement. Il s’agit ici du problème des migrants et d’un petit groupe de sept Pakistanais et Indiens assassinés près de Skopje, qu’on a fait passer pour de dangereux terroristes, de façon évidemment mensongère, comme le prouvent les recherches menées par l’auteur.
Manipulation scandaleuse de l’opinion, à l’image d’une autre qu’il évoque et qui devrait rester dans les annales tant ses conséquences ont été désastreuses à l’échelle mondiale : il s’agit du moment où les Américains, en la personne de Colin Powell, ont réussi à persuader le monde que l’Irak de Saddam Hussein possédait et fabriquait des armes de destruction massive : c’était en 2003, on sait maintenant que la guerre qui a eu lieu en Irak de 2003 à 2011 a fait 500.000 morts.
S’il est vrai qu’à Naples, on peut accuser la Mafia des plus grands méfaits qui menacent en permanence ses habitants, on comprend à lire Hocine Tandjaoui que l’œuvre de destruction larvée sinon massive qui non seulement empêche tout progrès mais cause la régression dans les pays dont il parle, n’a même pas besoin d’être soutenue par un pouvoir aussi fort que celui de la Mafia. Des disparitions s’opèrent sans que nous puissions faire autre chose que d’en prendre acte. Conclusion de la tante Esther : il faut oublier Tomasso.
Denise Brahimi
« UN LIT DANS L’0CEAN » par André Cohen Aknin, éditions parole, 2021
Plutôt que d’un roman, mieux vaut parler pour ce livre d’un récit poétique, titre que l’auteur lui-même avait suggéré pour l’un de ses premiers textes, « Le sourire de l’absente » en 2012.
L’absente ici, c’est la mère du Narrateur, absente à elle-même car elle est toujours de ce monde, mais durement frappée par la maladie d’Alzheimer, dont il est bien évident qu’elle ne sortira pas désormais, malgré les efforts, sans doute un peu dérisoires, que son fils fait en ce sens. Il est venu la voir là où elle vit désormais, à Cannes, sous la garde constante d’une personne payée pour veiller sur elle. A dire vrai, c’est plutôt le frère aîné du narrateur qui s’en occupe et qui assume la charge de cette vieille dame, Juliette, alors que lui-même s’en est peu soucié jusque là. Et cette visite est autant une recherche de lui-même que de sa mère, en tout cas une tentative de retour en un lieu qui leur serait commun.
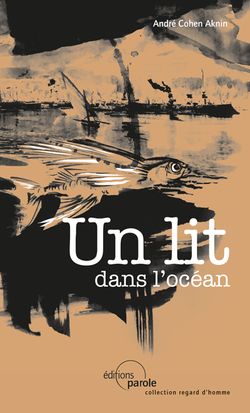 Cette tentative n’est pas complétement inaboutie, ni pour l’un ni pour l’autre, même si l’idée de guérison n’a pas plus de sens que celle d’un retour au passé. Le fils s’y prend d’une manière originale, et sans doute la moins inadaptée. Il va essayer de faire resurgir le passé par le biais de quelques sensations dont quelque chose aurait pu survivre au naufrage de la raison. Ce ne sera donc pas les sensations les plus élaborées et si l’on peut dire les plus culturelles, mais un mélange de goût et d’odorat, lié à ce qui a été un aspect essentiel dans la vie de Juliette, à savoir la cuisine : une cuisine très particulière, celle des juifs algériens telle qu’elle la pratiquait à Oran avant que le rapatriement en France ne l’amène à quitter l’Algérie dans des circonstances historiques dont l’auteur ne parle pas directement, puisque tel n’est pas le sujet de son livre. C’est une cuisine que les non avertis découvriront et que d’autres reconnaîtront peut-être, à base d’ingrédients tout à fait spécifiques et que le narrateur, par chance, réussit à trouver à Cannes grâce à un épicier d’origine algérienne qui devient un véritable ami, à dire vrai le seul, pendant son séjour.
Cette tentative n’est pas complétement inaboutie, ni pour l’un ni pour l’autre, même si l’idée de guérison n’a pas plus de sens que celle d’un retour au passé. Le fils s’y prend d’une manière originale, et sans doute la moins inadaptée. Il va essayer de faire resurgir le passé par le biais de quelques sensations dont quelque chose aurait pu survivre au naufrage de la raison. Ce ne sera donc pas les sensations les plus élaborées et si l’on peut dire les plus culturelles, mais un mélange de goût et d’odorat, lié à ce qui a été un aspect essentiel dans la vie de Juliette, à savoir la cuisine : une cuisine très particulière, celle des juifs algériens telle qu’elle la pratiquait à Oran avant que le rapatriement en France ne l’amène à quitter l’Algérie dans des circonstances historiques dont l’auteur ne parle pas directement, puisque tel n’est pas le sujet de son livre. C’est une cuisine que les non avertis découvriront et que d’autres reconnaîtront peut-être, à base d’ingrédients tout à fait spécifiques et que le narrateur, par chance, réussit à trouver à Cannes grâce à un épicier d’origine algérienne qui devient un véritable ami, à dire vrai le seul, pendant son séjour.
Le fils de Juliette a certainement connu dans sa vie bien d’autres aventures, notamment des voyages, et la cuisine n’a pas été son occupation habituelle, ni même occasionnelle, auparavant. Il est très émouvant de voir l’application qu’il met à retrouver les recettes de sa mère, non sans tâtonnements mais avec beaucoup d’application et de modestie ! On comprend, sans qu’il soit besoin de commentaires autres que factuels (tels que l’importance des haricots dans cette cuisine) l’importance de l’expérience qu’il vit à travers cette forme de retrouvailles ; et sans doute ne savait-il pas qu’il allait la vivre en venant à Cannes, pas plus que nous ne savons ce qui lui en restera après son départ, qu’on sait définitif, à la fin de ce petit livre. Mais c’est un moment qu’il aura vécu sans réserve, et c’est en cela qu’il est touchant.
Pour ce qui est de Juliette elle-même et pour autant qu’il soit possible d’en parler, on ne peut dire que les tentatives et la présence de son fils n’aient sur elle aucun effet, même si elle est bien évidemment incapable de le signifier en langage articulé. En fait elle s’est inventé un langage à elle, que son fils essaie de reproduire pour nous le livrer, un agencement de sons qui semblent correspondre à une sorte de musique intérieure et qui ne sont pas dus au hasard puisqu’ils sont récurrents.
Sur le rôle et la place possibles de la musique dans cette redoutable maladie (dont on consent à parler davantage aujourd’hui, malgré le silence dans  lequel les malheurs sont traditionnellement enfouis), le livre d’André Cohen Aknin ouvre des horizons en citant abondamment des chants et des chanteuses aussi dont la plus connue est sans doute Reinette l’Oranaise ; en sorte que son « récit poétique » est aussi un récit musical, au sens où on parle par exemple de « comédie musicale » mais de façon plus secrète et plus intime. Reinette l’Oranaise était d’origine juive puisque fille d’un rabbin de Tiaret, de même Line Monty, dont l’auteur cite assez longuement les paroles, qui étaient un mélange de français et d’arabe :
lequel les malheurs sont traditionnellement enfouis), le livre d’André Cohen Aknin ouvre des horizons en citant abondamment des chants et des chanteuses aussi dont la plus connue est sans doute Reinette l’Oranaise ; en sorte que son « récit poétique » est aussi un récit musical, au sens où on parle par exemple de « comédie musicale » mais de façon plus secrète et plus intime. Reinette l’Oranaise était d’origine juive puisque fille d’un rabbin de Tiaret, de même Line Monty, dont l’auteur cite assez longuement les paroles, qui étaient un mélange de français et d’arabe :
« Et on m’appelle l’Orientale
La blonde au regard fatal… »
Le narrateur découvre que sa mère a chanté à la manière de Reinette l’Oranaise alors que lui-même, adolescent à l’époque, détestait ce genre de chansons, au profit de Richard Antony et des Chaussettes noires. La mémoire absente de sa mère est finalement pour lui un moyen de retrouver des bribes de leur passé, commun ou séparé. Sans évoquer le témoignage trop écrasant de Proust, il apparaît que la mémoire obéit à des procédures qui n’ont rien de rationnel, et que peut-être même elle les fuit. L’histoire de Juliette pourrait être une sorte de métaphore de ce qui s’est passé dans l’histoire de l’Algérie il y a quelques décennies, un engloutissement dont pourtant, sous une forme presque inaudible, on trouve ici ou là des remontées aussi saisissantes qu’inespérées. Le récit poétique d’André Cohen Aknin ne cherche pas à en faire la théorie, il n’en est que plus convaincant.
Denise Brahimi
« UNE FAMILLE BRETONNE EN KABYLIE » par Jean-Etienne le Roux, éditions L’Harmattan, 2021
L’auteur de ce livre n’est plus un jeune homme puisqu’il est né en 1943. En revanche lorsque sa femme Dany et lui partirent en 1969 en Algérie pour enseigner au titre de la « coopération » (c’est ainsi qu’on disait à l’époque), emmenant avec eux leur bébé de deux ans, ils formaient ensemble un jeune couple aussi touchant qu’inexpérimenté.
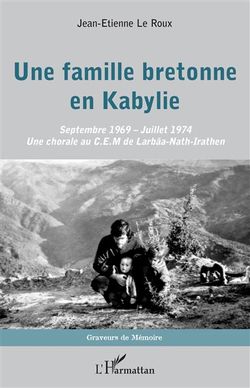 Pour ce qui est de l’expérience, ils eurent le temps d’en acquérir pendant les 5 ans que dura leur séjour, interrompu une fois par an pour un retour en France pendant les vacances d’été. Mais de toute façon, ce qu’ils avaient en abondance, dès leur départ de France pour cette Kabylie dont ils ignoraient tout, c’est un mélange de courage, de confiance et de simplicité au bon sens du mot qui leur permit de s’adapter à leur travail et à leur entourage, sans que le moindre drame soit venu semble-t-il perturber leur vie quotidienne, d’ailleurs très laborieuse et très encadrée. Ce qui amène à parler de simplicité est justement l’absence totale voire étonnante de dramatisation, là où d’autres que Jean-Etienne Le Roux se seraient peut-être laissés tenter par le pathos ou du moins la mise en valeur des difficultés rencontrées et un peu de cet attendrissement sur soi-même qui accompagne souvent le souvenir des débuts dans la vie. Le peu de détails qui nous sont donnés donne à penser que ce n’était pas toujours facile, d’autant qu’un deuxième bébé leur est né pendant ces années-là, mais on chercherait en vain une plainte ou une récrimination. Et en particulier, dans tout ce qui concerne les rapports avec la population de Larbâa-Nath-Irathen, c’est-à-dire les parents des élèves qui fréquentaient le collège où le couple le Roux enseignait, il n’est jamais question d’incompréhension ou de difficultés auxquelles on aurait s’attendre d’autant plus que les deux enseignants bretons avaient trop de travail pour se mettre à apprendre la langue kabyle, qu’ils ont ignorée jusqu’au bout. Certes il est question ici ou là des précautions qu’ils prennent pour ne pas heurter les usages du pays, c’est Dany Le Roux qui se charge de recevoir les filles à la maison quand il en est besoin, mais les photos qui sont abondantes dans le livre prouvent à quel point les élèves se plaisaient à fréquenter la maison de leurs professeurs, et l’on ne voit nulle part la moindre trace de méfiance ou tout simplement de distance entre maîtres et élèves.
Pour ce qui est de l’expérience, ils eurent le temps d’en acquérir pendant les 5 ans que dura leur séjour, interrompu une fois par an pour un retour en France pendant les vacances d’été. Mais de toute façon, ce qu’ils avaient en abondance, dès leur départ de France pour cette Kabylie dont ils ignoraient tout, c’est un mélange de courage, de confiance et de simplicité au bon sens du mot qui leur permit de s’adapter à leur travail et à leur entourage, sans que le moindre drame soit venu semble-t-il perturber leur vie quotidienne, d’ailleurs très laborieuse et très encadrée. Ce qui amène à parler de simplicité est justement l’absence totale voire étonnante de dramatisation, là où d’autres que Jean-Etienne Le Roux se seraient peut-être laissés tenter par le pathos ou du moins la mise en valeur des difficultés rencontrées et un peu de cet attendrissement sur soi-même qui accompagne souvent le souvenir des débuts dans la vie. Le peu de détails qui nous sont donnés donne à penser que ce n’était pas toujours facile, d’autant qu’un deuxième bébé leur est né pendant ces années-là, mais on chercherait en vain une plainte ou une récrimination. Et en particulier, dans tout ce qui concerne les rapports avec la population de Larbâa-Nath-Irathen, c’est-à-dire les parents des élèves qui fréquentaient le collège où le couple le Roux enseignait, il n’est jamais question d’incompréhension ou de difficultés auxquelles on aurait s’attendre d’autant plus que les deux enseignants bretons avaient trop de travail pour se mettre à apprendre la langue kabyle, qu’ils ont ignorée jusqu’au bout. Certes il est question ici ou là des précautions qu’ils prennent pour ne pas heurter les usages du pays, c’est Dany Le Roux qui se charge de recevoir les filles à la maison quand il en est besoin, mais les photos qui sont abondantes dans le livre prouvent à quel point les élèves se plaisaient à fréquenter la maison de leurs professeurs, et l’on ne voit nulle part la moindre trace de méfiance ou tout simplement de distance entre maîtres et élèves.
 Il est vrai que comme le rappelle Jean-Etienne Le Roux, les événements de 1968 qui ont eu lieu peu de temps auparavant ont modifié ces rapports et ouverts la voie des rapprochements. Mais enfin le couple de jeunes Français est bien conscient que les affrontements de la guerre d’Algérie sont encore très proches et ils ne s’étonneraient pas de rencontrer une hostilité résiduelle bien explicable, or il n’en est rien. La question est abordée clairement, franchement, par leurs interlocuteurs kabyles, qui leur disent pourquoi on ne leur en veut pas, à eux, de ce qui s’est passé. Le narrateur du livre en a gardé un souvenir plein d’estime et de considération, qui donne la tonalité générale du récit. Vingt ans après leur retour, en 1995, se sont passés en France des événements d’une grande violence et d’une grande agressivité, alors que rien de tel n’est perceptible dans les relations humaines à Larbâa-Nath-Irathen, ce Fort National dont on sait pourtant à quel point il a subi les ravages physiques et psychiques de la Guerre d’Algérie, grâce au « Journal » de l’écrivain Mouloud Feraoun, d’ailleurs évoqué par Jean-Etienne Le Roux au début de son livre.
Il est vrai que comme le rappelle Jean-Etienne Le Roux, les événements de 1968 qui ont eu lieu peu de temps auparavant ont modifié ces rapports et ouverts la voie des rapprochements. Mais enfin le couple de jeunes Français est bien conscient que les affrontements de la guerre d’Algérie sont encore très proches et ils ne s’étonneraient pas de rencontrer une hostilité résiduelle bien explicable, or il n’en est rien. La question est abordée clairement, franchement, par leurs interlocuteurs kabyles, qui leur disent pourquoi on ne leur en veut pas, à eux, de ce qui s’est passé. Le narrateur du livre en a gardé un souvenir plein d’estime et de considération, qui donne la tonalité générale du récit. Vingt ans après leur retour, en 1995, se sont passés en France des événements d’une grande violence et d’une grande agressivité, alors que rien de tel n’est perceptible dans les relations humaines à Larbâa-Nath-Irathen, ce Fort National dont on sait pourtant à quel point il a subi les ravages physiques et psychiques de la Guerre d’Algérie, grâce au « Journal » de l’écrivain Mouloud Feraoun, d’ailleurs évoqué par Jean-Etienne Le Roux au début de son livre.
L’une des raisons pour lesquelles les Le Roux ne peuvent que se sentir proches de leurs voisins kabyles, c’est qu’ils vivent matériellement de la même manière qu’eux, et certainement pas mieux : même nourriture, à partir de ce qu’on peut trouver localement, même maison, équipée elle aussi avec les moyens du bord et, de manière générale, certainement rien qui pourrait être vu comme une forme de supériorité, et pas même de différence. C’est d’ailleurs en cela qu’on touche au sens profond du livre : l’idée de ressemblance, illustrée par un rapprochement entre musique bretonne et musique kabyle.
Sans être un musicien émérite, Jean-Etienne le Roux a reçu une modeste formation musicale qui l’aide à apprécier les chants de Kabylie et à composer pour eux des orchestrations, sans trahir leur caractère kabyle initial. C’est ainsi qu’il a pu reprendre des chansons de Slimane Azem ou de Chérif Keddam, célèbres chanteurs kabyles, pour en faire de versions orchestrées et les mettre au répertoire de la chorale qu’il avait créée avec et pour les élèves du collège où il enseignait. Sa grande fierté à lui est d’avoir pu constater à quel point ses élèves eux-mêmes étaient fiers du résultat obtenu, comme on peut voir sur les photos d’un certain nombre de concerts où ils se sont produits dans les années 70, à Tizi-Ouzou, Dellys, Sétif ou Alger. Même si, à ce qu’il semble, leur talent n’a pas toujours été assez mis en exergue et récompensé, les jeunes qui ont participé à la chorale ont beaucoup appris, et repris ensuite, du travail de composition que leur a enseigné leur maître breton.
C’est ainsi que le livre se compose de 80 pages de récit environ, et d’un gros ensemble de partitions, où l’on peut trouver un nombre important de chants traditionnels algériens en version orchestrée, qui portent un double titre, en kabyle et en breton. Ce qu’une des collaboratrices algérienne et mélomane du musicien breton appelle « un acte fort de coopération ».
Denise Brahimi

« BONNE MÈRE », film français de Hafsia Herzi, 2021
Le succès de ce film est la bonne nouvelle de l’été 2021 qui n’est pas spécialement euphorique et aussi celle du Festival de Cannes pour cette même année où de l’avis général il n’a pas été très brillant. Il vaut la peine de s’interroger sur les raisons de cet accueil favorable des critiques et du public, pour un film dont on se disait a priori qu’il n’apportait sans doute rien de bien nouveau : consacré par la réalisatrice, née en France, à l’un des quartiers Nord de Marseille qui a été celui de son enfance, il s’annonçait comme une évocation de la violence qui y sévit notoirement, tout autant que dans le tristement célèbre 93 ou quartier Nord de Paris,—et ces lieux redoutables ont déjà été l’objet de films qui ont en vain alerté l’opinion sur une situation que des faits criminels viennent constamment rappeler. Pour ce qui est des quartiers Nord de Marseille, en ce même été 2021, ils font beaucoup parler d’eux à propos d’affrontements sanglants provoqués entre bandes rivales par  le trafic de la drogue—celui que montre aussi le film de Hafsia Herzi qui a raconté elle-même le dangereux tournage de quelques scènes où l’on voit en direct ce qu’il en est.
le trafic de la drogue—celui que montre aussi le film de Hafsia Herzi qui a raconté elle-même le dangereux tournage de quelques scènes où l’on voit en direct ce qu’il en est.
Drogue, violence, prostitution, tels sont malheureusement les aspects bien connus de la vie dans ces quartiers, que la réalisatrice connaît pour y avoir vécu et qu’elle ne songe certainement pas à occulter. Et pourtant, là commence une sorte de paradoxe qui est certainement lié au succès du film même si le public ne se rend pas compte d’emblée du décalage entre ce qu’il y trouve réellement et ce qu’il s’attendait à y trouver. Car s’il est bien clair que les aspects attendus sont présents dans le film, ils ne sont pas au cœur de ce que montre celui-ci, de ce à quoi il se consacre et sur quoi il veut attirer notre attention. Si l’on osait employer d’emblée un mot aussi énorme et audacieux dans un tel contexte, on dirait que c’est un film d’amour, ce qui, de la part de la réalisatrice n’est sans doute pas étonnant malgré son sujet. Ce film est le second qu’elle réalise, et sans revenir sur le sujet du précédent, « Tu mérites un amour » (2019) on peut en dire que comme le titre l’indique, l’amour est en effet son sujet principal voire unique. Celui-ci n’est pas moins présent dans les rôles qu’elle tient en tant qu’actrice, dont ceux que lui a confiés le réalisateur qui l’a fait connaître, Abdellatif Kechiche, et notamment dans « La Graine et le Mulet »(2007) : Hafsia Herzi excelle à faire comprendre l’amour au sens large du terme, celui qui ne se limite pas à la relation sexuelle ou même l’ignore, mais qui définit au sens le plus plein une relation aux autres faite de tendresse et d’une immense compassion.
Celle qui en est porteuse dans « Bonne Mère » est une figure de mère, seule pour tenir à bout de bras ses garçons et filles déjà adultes ou encore adolescents, et grand-mère aussi quoique jeune encore, malgré l’usure de la vie éreintante qu’il lui faut mener pour les faire vivre tant bien que mal, mais sur le plan matériel en tout cas, très convenablement et sans privation.
 Hafsia Herzi a beaucoup dit qu’elle avait voulu rendre hommage à sa propre mère, d’origine algérienne, alors que son père était tunisien. Elle le fait parfaitement bien, d’autant mieux que sans étalage de sentimentalité. C’est justement ce ton qu’il faut préciser car il n’est pas lyrique, mais pas non plus enfermé dans le réalisme voire le naturalisme à la Zola qui a marqué durablement la représentation du monde du travail pour les plus défavorisé(e)s. Nora la mère fait double tâche puisqu’elle est à la fois femme de ménage à l’aéroport pour le nettoyage des avions au sol et d’autre part, à titre privé, au service d’une vieille dame seule que sa famille essaie de maintenir à la maison. Son premier travail est salarié, il est très contrôlé et sans doute exigeant mais pour autant ni vexatoire ni solitaire et sans joie. Le second est fondé sur la tendresse réciproque qui unit Nora et la vieille dame qui a besoin d’elle, de sa présence et d’e son amour que de ses soins. Nora travaille durement, elle est fatiguée mais on l’entend rarement se plaindre et l’on comprend que comme elle le dit, elle restera une « femme debout » aussi longtemps que ses jambes la porteront. Elles est digne et maintient aussi toute sa famille à un certain niveau de dignité, quoi qu’il en soit. Dans le monde de Nora, les conditions de vie n’avilissent pas l’être humain jusqu’à la bestialité, et chacun préserve une certaine image de lui-même à ses propres yeux au tant qu’aux yeux des autres : le plus âgé des fils est en prison pour des faits graves et sans doute y a-t-il eu mort d’homme vu la longueur de sa détention, mais pour autant il ne perd pas sa place dans la famille ni même le respect qui lui est accordé, sans parler de l’affection, évidemment.
Hafsia Herzi a beaucoup dit qu’elle avait voulu rendre hommage à sa propre mère, d’origine algérienne, alors que son père était tunisien. Elle le fait parfaitement bien, d’autant mieux que sans étalage de sentimentalité. C’est justement ce ton qu’il faut préciser car il n’est pas lyrique, mais pas non plus enfermé dans le réalisme voire le naturalisme à la Zola qui a marqué durablement la représentation du monde du travail pour les plus défavorisé(e)s. Nora la mère fait double tâche puisqu’elle est à la fois femme de ménage à l’aéroport pour le nettoyage des avions au sol et d’autre part, à titre privé, au service d’une vieille dame seule que sa famille essaie de maintenir à la maison. Son premier travail est salarié, il est très contrôlé et sans doute exigeant mais pour autant ni vexatoire ni solitaire et sans joie. Le second est fondé sur la tendresse réciproque qui unit Nora et la vieille dame qui a besoin d’elle, de sa présence et d’e son amour que de ses soins. Nora travaille durement, elle est fatiguée mais on l’entend rarement se plaindre et l’on comprend que comme elle le dit, elle restera une « femme debout » aussi longtemps que ses jambes la porteront. Elles est digne et maintient aussi toute sa famille à un certain niveau de dignité, quoi qu’il en soit. Dans le monde de Nora, les conditions de vie n’avilissent pas l’être humain jusqu’à la bestialité, et chacun préserve une certaine image de lui-même à ses propres yeux au tant qu’aux yeux des autres : le plus âgé des fils est en prison pour des faits graves et sans doute y a-t-il eu mort d’homme vu la longueur de sa détention, mais pour autant il ne perd pas sa place dans la famille ni même le respect qui lui est accordé, sans parler de l’affection, évidemment.
Ce qui sauve ce petit groupe humain, grâce au modèle que représente Nora, est de n’être ni dans la plainte ni dans la récrimination, et le trait le plus remarquable de ce qu’on entend dans le film est le refus de l’auto-victimisation. Pas non plus chez aucun d’entre eux le déni de sa part de responsabilité, qu’il s’agirait d’imputer aux autres, dont viendrait tout le mal : la police n’est pas mise en cause pour ses agissements ni l’Etat français globalement stigmatisé, on n’entend pas de discours vengeur sur la colonisation, ni non plus pour ou contre telle ou telle race ou religion. L’antisémitisme est explicitement exclu, l’islamisme n’a pas droit de cité, c’est le cas de le dire, sans qu’on puisse penser qu’Hafsia Herzi parle d’un temps où ces fléaux n’existaient pas, celui de son enfance et de sa jeunesse n’étant pas si lointain. D’où l’on peut conclure que mine de rien, la réalisatrice signifie qu’elle ne mange pas de ce pain-là et l’on peut espérer qu’elle n’est pas la seule à s’y refuser, pensée réconfortante ô combien. Ce film nous dit qu’après tout, il vaut mieux assumer une certaine naïveté que de tomber dans des poncifs au service de propagandes diverses. La douceur visible sur le visage d’Hafsia Herzi ne retire sans doute rien à la fermeté de ses décisions intérieures, qui sont de celles auxquelles on ne se tient qu’avec courage et détermination. Le succès du film est de la part du public une manière de l’en remercier.
Denise Brahimi
« FATHALLAH, DIX ANS ET UNE REVOLUTION PLUS TARD », film de Wided Zoghlami, 2000, Festival AFLAM 2021
Le sujet de ce film d’une réalisatrice tunisienne devient explicite grâce à son sous-titre, qui pourtant reste très en deçà des sentiments exprimés par ses personnages. Elle est d’un niveau social très différent du leur et sur le plan ethnique, elle mélange des origines belge, sicilienne, tunisienne à une éducation française. Mais elle a connu la bande de jeunes garçons qu’elle donne à entendre dans son film grâce à la musique, qui est la passion commune à plusieurs d’entre eux. Elle s’intéresse plus particulièrement à celui dont le prénom est Halim, qu’elle désire beaucoup aider. Ils se marient et elle l’attend pendant qu’il est en prison, mais ils se séparent après sa sortie, et cette aventure (au sens fort du terme) occupe les dix années dont il est question dans le titre du film : ils reconnaissent l’un et l’autre qu’ils en sortent très profondément et sans doute durablement marqués. Cependant ce fil directeur reste très discret et c’est à autre chose que Wided Zoghlami consacre son film.
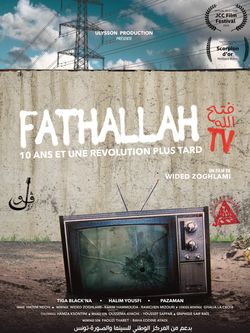 Cette période de 10 années va de 2007 à 2017, et l’on n’apprendra à personne qu’elle englobe en son centre celui qui a été le premier des « printemps arabes », cette effervescence révolutionnaire qui a eu pour premier effet de renverser le président tunisien Ben Ali. Le film ne revient pas sur le détail de ces événements très connus, on pourrait dire qu’il les enjambe et circule autour d’eux, mais en fait il se consacre surtout à l’attente qui s’en est suivie et plus encore à la déception qu’elle a engendrée, assez vite semble-t-il (2012 ?). C’est en ce sens que vont la plupart des propos tenus, et en tout cas dans ce quartier appelé Fathallah ou encore Djebel Jeloud, on n’en entend pas un seul signifiant l’adhésion au nouveau régime, ou au nouveau président. Il est vrai qu’il s’agit d’un quartier déshérité, mais le moins qu’on puisse dire est que la révolution n’a pas amélioré le sort de ses habitants, la plupart des garçons parlant même de régression. Les plus jeunes sont féroces et s’expriment sur le mode de l’ironie et de la dérision. Pourtant on comprend très bien que la liberté de parole n’est pas acquise ni sans danger. Et pratiquement tous les personnages du film ont plus ou moins séjourné en prison ; ce qui est peut-être le moins grave de ce qui peut leur arriver, car on parle beaucoup de gens qui ont été enlevés devant leur porte et qu’on n’a jamais revus.
Cette période de 10 années va de 2007 à 2017, et l’on n’apprendra à personne qu’elle englobe en son centre celui qui a été le premier des « printemps arabes », cette effervescence révolutionnaire qui a eu pour premier effet de renverser le président tunisien Ben Ali. Le film ne revient pas sur le détail de ces événements très connus, on pourrait dire qu’il les enjambe et circule autour d’eux, mais en fait il se consacre surtout à l’attente qui s’en est suivie et plus encore à la déception qu’elle a engendrée, assez vite semble-t-il (2012 ?). C’est en ce sens que vont la plupart des propos tenus, et en tout cas dans ce quartier appelé Fathallah ou encore Djebel Jeloud, on n’en entend pas un seul signifiant l’adhésion au nouveau régime, ou au nouveau président. Il est vrai qu’il s’agit d’un quartier déshérité, mais le moins qu’on puisse dire est que la révolution n’a pas amélioré le sort de ses habitants, la plupart des garçons parlant même de régression. Les plus jeunes sont féroces et s’expriment sur le mode de l’ironie et de la dérision. Pourtant on comprend très bien que la liberté de parole n’est pas acquise ni sans danger. Et pratiquement tous les personnages du film ont plus ou moins séjourné en prison ; ce qui est peut-être le moins grave de ce qui peut leur arriver, car on parle beaucoup de gens qui ont été enlevés devant leur porte et qu’on n’a jamais revus.
Le bilan tout à fait clair et qui va jusqu’à la fin de la période concernée c’est-à-dire 2017, amène les jeunes à considérer que leur classe d’âge se divise en trois catégories, dont chacune n’exclut pas forcément les autres : les chômeurs qui essaient en vain de trouver un travail (les jeunes de ce quartier ne trouvent pas grâce aux yeux des employeurs) ; ceux qui sont en prison pour des causes officiellement liées à la drogue, incluant ceux qui en ont consommé ou ceux qui en font commerce ; ceux qui passent leur temps à essayer de partir, les candidats à l’immigration clandestine, dont une partie se noie en mer et l’autre se fait renvoyer à son point de départ, quitte à recommencer à la première occasion. Il est vrai cependant que les principaux personnages montrés dans le film, Halim, Tiga, Paza, constituent une catégorie un peu à part, du fait de leur amour pour la musique et de leur ferme intention de s’y consacrer. Leur désir profond serait de pouvoir en vivre, chez eux en Tunisie, mais en l’état actuel des choses, ils le savent totalement irréalisable. C’est pour faire de la musique qu’ils voudraient partir, mais l’exemple de Halim prouve que même quand ils partent, leur succès ailleurs n’est pas garanti, d’autant que la situation d’émigré est de celles qui incitent à la délinquance, et qu’il y a partout des prisons effroyables comme en Tunisie.
 Très conscients de leur sort, certains de ces garçons en disent l’injustice. Imed raconte de manière pathétique ce qu’il ressent lorsqu’il voit passer des voitures de luxe, et des couples de jeunes gens riches à l’intérieur. Pourquoi eux et pas moi ? Son sentiment d’exclusion est insoutenable parce que le rejet subi est injustifiable : « ce pays nous appartient à tous ». Mais jamais le film n’entre dans un langage abstrait ou théorique, car il s’appuie sur la présence des corps, et principalement des visages en gros plans. A cet égard on ne peut qu’admirer la galerie de portraits, au sens pictural du mot, que la réalisatrice nous donne à regarder. Les yeux, magnifiques, souvent soulignés de khôl, font penser à ceux qu’on voit chez certains portraits du Fayoum, qui eux remontent aux premiers siècles de notre ère et qui, sans qu’on puisse dire quelle émotion ils contiennent, expriment une très intense présence ; de toute façon, ce n’est pas un rapprochement saugrenu puisqu’on sait que Wided Zoghlami, dès l’enfance, s’intéressait aux beaux-arts. En tout cas sa sensibilité artistique apparaît très fort dans ce film, où la musique est constamment présente. On ne peut s’en tenir à dire qu’il s’agit d’un documentaire, c’est un film au sens plein du mot, qui cherche d’autant plus à nous impliquer que personne, dans leur propre pays, ne se soucie de ceux qui en sont les personnages.
Très conscients de leur sort, certains de ces garçons en disent l’injustice. Imed raconte de manière pathétique ce qu’il ressent lorsqu’il voit passer des voitures de luxe, et des couples de jeunes gens riches à l’intérieur. Pourquoi eux et pas moi ? Son sentiment d’exclusion est insoutenable parce que le rejet subi est injustifiable : « ce pays nous appartient à tous ». Mais jamais le film n’entre dans un langage abstrait ou théorique, car il s’appuie sur la présence des corps, et principalement des visages en gros plans. A cet égard on ne peut qu’admirer la galerie de portraits, au sens pictural du mot, que la réalisatrice nous donne à regarder. Les yeux, magnifiques, souvent soulignés de khôl, font penser à ceux qu’on voit chez certains portraits du Fayoum, qui eux remontent aux premiers siècles de notre ère et qui, sans qu’on puisse dire quelle émotion ils contiennent, expriment une très intense présence ; de toute façon, ce n’est pas un rapprochement saugrenu puisqu’on sait que Wided Zoghlami, dès l’enfance, s’intéressait aux beaux-arts. En tout cas sa sensibilité artistique apparaît très fort dans ce film, où la musique est constamment présente. On ne peut s’en tenir à dire qu’il s’agit d’un documentaire, c’est un film au sens plein du mot, qui cherche d’autant plus à nous impliquer que personne, dans leur propre pays, ne se soucie de ceux qui en sont les personnages.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film,
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- Du 4 au 26 septembre, à Lyon L’Algérie plurielle : Journées culturelles chawiyas (Opéra Underground, Institut Français de civilisation musulmane, Maison des Passages…), diverses manifestations , concerts de Houria AICHI, , expositions, tables rondes, ateliers de danse…etc. Programme complet ICI
- Samedi 18 septembre, à Lyon (Maison des Passages) spectacle de lecture des textes d’Algérie à cœur livre publié à partir des textes écrits en ateliers d’écritures par des membres de notre association, qui liront leur texte dans un spectacle mis en scène par Dominique Lurcel.
- Vendredi 1er octobre et samedi 2 octobre, à Lyon (Salons de l’Hôtel de Ville), Hommage à Michel Cornaton, avec une table ronde de samedi 2 sur Les camps de regroupement de la guerre d’Algérie. Films « A Mansourah tu nous as séparés » de Dorothée Myriam Kellou, et « Sur les traces des camps de regroupement » par Saïd Oulmi, en présence des réalisatrice et réalisateur, interventions de Fabien Sacriste, Kamel Kateb, Samia Henni, et Slimane Zeghidour.
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


Bonjour.
Je viens de m’abonner à la Lettre et je voulais exprimer toute mon admiration pour la qualité des articles qui y sont développés notamment par Denise BRAHIMI, articles qui constituent une nécessaire et très bonne visibilité à des œuvres littéraires, cinématographiques ou artistiques du Maghreb. Je lui dois personnellement le premier et le plus abouti des commentaires sur mon premier roman publié aux éditions Nirvana en Tunisie en septembre 2020, « Adieu maman ! Redites-moi la vie ». Ce roman vient de recevoir le Prix Spécial du Jury du COMAR d’OR le 4 septembre 2021 et un excellent accueil critique. Merci encore et bravo pour la somme d’efforts et la qualité de votre implication comme passeurs de culture et de rencontres entre les deux rives de la Méditerranée