Lettre culturelle franco-maghrébine #76
Editorial
Cette Lettre du 1er mai 2023 répond à une double exigence. D’une part nous y restons dans la continuité de nos problématiques habituelles, qui correspondent à la définition et au projet que s’est donnée l’Association Coup de Soleil. C’est ainsi que nous parlerons d’au moins deux livres qui concernent la guerre d’Algérie, notamment pour nous faire entendre la voix des témoins (il y en a une vingtaine dans le livre de Farah Khodja : « Récits d’Algérie ») et pour évoquer une synthèse très utile sur la question des camps de regroupement, qui font l’objet du livre de Fabien Sacriste publié aux Presses de SciencePo. Nous retrouverons sous un jour particulier avec le livre de Fatima Besnaci-Lancou le problème des Harkis, qui fort heureusement n’ont pas été tous ni complétement abandonnés à la fin de la guerre.
Mais l’après-guerre aussi et la manière dont l’Algérie a dû faire face dès l’indépendance fait aujourd’hui l’objet d ‘un retour en arrière de la part des historiens, et c’est ainsi que nous pouvons lire grâce à Mohammed Harbi une histoire passionnante de ce que fut à l’époque de Ben Bella une tentative pour mettre en place l’autogestion.
D’autre part et de manière un peu plus diverse, nous chercherons en France et dans les pays du Maghreb des aperçus parfois très originaux de modes de vie sur lesquels s’est porté le regard de quelques commentateurs ou écrivains. La Tunisie très contemporaine est évoquée dans un court roman intitulé de manière assez piquante « Le centre d’appel des écrivains disparus, »et dont l’auteur fait le choix d’éviter le plus possible tout discours politique et idéologique. Côté Maroc, on trouve des informations sur le mode de vie et d’émancipation de jeunes femmes de Casablanca qui travaillent comme serveuses dans certains cafés de la ville, et savent tirer profit de cet emploi.
Le livre à succès de cette sélection est celui de Kaouthar Adimi, désormais connue et appréciée ; il s’intitule « Au vent mauvais » et s’est vu couronné à juste titre d’un prix littéraire ces derniers temps.
Côté films, nous en évoquons un, « Chaâba », qui est assez proche de ce que racontait Azouz Begag dans son roman devenu un classique : « Le gone du Chaâba » (1986). Il s’agit donc d’un retour sur ce que furent les débuts de l’immigration algérienne en région Lyonnaise.
Enfin ceux qui attendent chaque mois que Michel Wilson les mette sur la piste d’une BD ne pourront que se réjouir de son dernier choix : le roman graphique « Oum Kalthoum, naissance d’une diva ».
Denise Brahimi
Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?
Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

« RECITS D’ALGERIE » par Farah Khodja, éditions Faces cachées, 2022
Le mot « récits » est évidemment au pluriel, parce qu’il s’agit d’un recueil de témoignages assez nombreux, une vingtaine environ ; ils portent principalement sur la période de la Guerre d’Algérie, s’agissant de faits qui vont de la période coloniale à l’indépendance, vus à travers les propos tenus par des hommes et des femmes qui ont été en lien direct avec les événements. Mais étant donné le temps qui s’est écoulé depuis lors, et dont attestent les nombreuses photos de ceux qui en ont été les acteurs (et qui étaient parfois à l’époque de très jeunes adolescents), on ne s’étonnera pas si les propos recueillis dans les 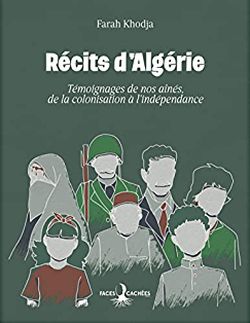 témoignages qui composent le livre sont souvent relayés par leurs descendants. Ce qui veut dire concrètement que les enquêteuses dont Farah Khodja a su s’entourer (il s’agit d’un projet collectif de collecte et de transmission) sont entrées dans un processus comportant plusieurs étapes. Il fallait d’abord retrouver et localiser les « aînés » susceptibles d’avoir des souvenirs précis et de bien vouloir les raconter ; puis de les faire passer d’un stade oral à un stade écrit, souvent en arabe pour être susceptibles d’être compris et contrôlés par les témoins directs, donc les plus fiables ; puis encore, au stade suivant il a fallu passer de la transcription en arabe à sa traduction en français, qui est la langue choisie pour la publication de ces témoignages.
témoignages qui composent le livre sont souvent relayés par leurs descendants. Ce qui veut dire concrètement que les enquêteuses dont Farah Khodja a su s’entourer (il s’agit d’un projet collectif de collecte et de transmission) sont entrées dans un processus comportant plusieurs étapes. Il fallait d’abord retrouver et localiser les « aînés » susceptibles d’avoir des souvenirs précis et de bien vouloir les raconter ; puis de les faire passer d’un stade oral à un stade écrit, souvent en arabe pour être susceptibles d’être compris et contrôlés par les témoins directs, donc les plus fiables ; puis encore, au stade suivant il a fallu passer de la transcription en arabe à sa traduction en français, qui est la langue choisie pour la publication de ces témoignages.
On constate très vite que tout le travail accompli pour la mise en forme du livre a eu pour but de le rendre très lisible et d’un accès facile à tous égards. Car il ne fallait pas seulement assurer cette clarté d’un point de vue linguistique, mais aussi historiquement en rappelant clairement les faits dont il s’agit et les personnages plus ou moins connus que les témoignages sont amenés à évoquer. Le livre a donc recours à de nombreuses notes marginales ainsi qu’à un glossaire qui en quelques pages donne les explications essentielles. C’est dire que « Récits d‘Algérie » sera sûrement un livre très utile pour les enseignants, dont les élèves ignorent absolument tout de ce qui évoque au moins quelques souvenirs chez leurs parents ou a fortiori leurs grands-parents. La présentation matérielle du livre qui est très joliment fait, avec usage de couleurs variées et de nombreuses photos, ne peut qu’aider elle aussi à son utilisation en milieu scolaire .
Mais la variété même des récits qu’il apporte fait qu’il ne concerne pas seulement les anciens combattants de la guerre d’Algérie et leurs descendants. De toute façon, la catégorie « anciens combattants » a ici un double sens puisqu’il y en a eu des deux côtés, aussi bien celui de l’armée française que celui des moudjahidines dont la parole a pu se faire entendre à partir de l’indépendance de 1962. Côté français, il y a plusieurs exemples de ceux que tout le monde a connus sous le nom d’appelés et dont beaucoup ont très peu apprécié le rôle qu’on leur a fait jouer au service du régime colonial : plusieurs décennies plus tard, ils n’en ont pas encore fini de dire leur mécontentement.
 Côté algérien, on constate une fois de plus que les hommes montés au maquis comme on disait alors n’ont pas été les seules victimes potentielles de la répression armée ; les civils et notamment tous les villageois ou presque ont été harcelés parce que toujours soupçonnés d’aider ceux de leurs compatriotes partis se battre clandestinement ; et par « harcèlement » il n’y a aucun doute à avoir : la torture fait principalement partie des moyens utilisés pour obtenir des aveux. Les récits permettent aussi de comprendre ce qui était particulièrement pénible et plus ou moins occulte dans ce qui a ravagé la population pendant plusieurs années : pratique de la délation, rôle néfaste des harkis : les survivants parlent de ce qui a sévi pendant la guerre comme d’un cauchemar quotidien.
Côté algérien, on constate une fois de plus que les hommes montés au maquis comme on disait alors n’ont pas été les seules victimes potentielles de la répression armée ; les civils et notamment tous les villageois ou presque ont été harcelés parce que toujours soupçonnés d’aider ceux de leurs compatriotes partis se battre clandestinement ; et par « harcèlement » il n’y a aucun doute à avoir : la torture fait principalement partie des moyens utilisés pour obtenir des aveux. Les récits permettent aussi de comprendre ce qui était particulièrement pénible et plus ou moins occulte dans ce qui a ravagé la population pendant plusieurs années : pratique de la délation, rôle néfaste des harkis : les survivants parlent de ce qui a sévi pendant la guerre comme d’un cauchemar quotidien.
A quoi s’ajoutent un certain nombre d’épisodes ou d’événements qui ont été marquants et que le livre situe dans l’ordre chronologique bien que son but premier ne soit pas de fournir une reconstitution historique. Le 8 mai 45, le premier novembre 54, le 17 octobre 1961 (à Paris), le 18 mars 62 et le 5 juillet 62 font l’objet de courtes monographies qu’on pourrait considérer aussi comme de petits dossiers à la rescousse des mémoires défaillantes ; en tout cas c’est une présentation un peu différente de celle qu’on trouve dans les entretiens et elle fournit à ceux-ci un cadre ou des références qui aident à les structurer.
Cependant le livre, qui donne la parole à des hommes et à des femmes du passé, est parfois, souvent, très émouvant. La remontée des souvenirs étant parfois très dure, on apprécie de trouver ici ou là un peu de tendresse humaine, dont l’exemple pourrait être cette lettre fictive de Lina N. adressée à son défunt grand-père, « lettre ouverte à l’homme que j’admire le plus au monde ».
De ces différents entretiens qui s’ajoutent les uns aux autres ressort finalement une sorte de tissage qui lie les histoires individuelles entre elles et qui compense les très nombreuses insuffisances à déplorer pendant des décennies dans les programmes scolaires. Farah Khodja qui a fait ses études en France en a elle-même souffert et elle a entrepris ce livre (à partir de 2020) pour contribuer désormais de les combler.
Denise Brahimi
« LES CAMPS DE REGROUPEMENT EN ALGERIE » par Fabien Sacriste, Les Presses de Sciences Po, 2022
Ce livre est peut-être le plus récent mais certainement pas le seul qui ait été consacré à la question dont il parle depuis le début de notre siècle (même s’il y avait déjà eu des travaux importants auparavant, notamment ceux de Michel Cornaton). Le sous-titre précise qu’il s’agit de faire l’histoire des « déplacements forcés » d’une population rurale arrachée à ses villages d’origine pour être regroupée ailleurs sous le contrôle de l’armée. 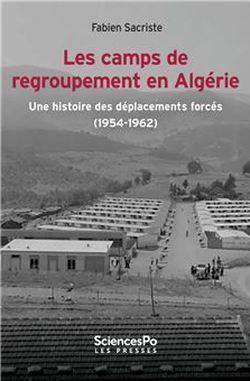 Tout ce qui est évoqué dans le livre de Fabien Sacriste s’est produit entre 1954 et 1962, c’est-à-dire très exactement pendant le temps de la guerre d’Algérie, dans une crise aux aspects divers qui certes a comporté successivement différentes périodes, mais sans qu’aucune d’entre elles ait pu échapper à la présence militaire chargée de conforter le pouvoir colonial. Tous les termes employés à l’époque pour parler de ces camps de regroupement doivent être entendus dans la perspective d’un maintien voire d’un renforcement de celui-ci : c’est la guerre et rien ne permet d’en douter. Pour ne prendre qu’un exemple, lorsque ces camps sont évoqués comme un moyen de « protéger » les populations civiles, ce mot utilisé par le langage officiel ne peut avoir qu’un sens : il s’agit de les protéger contre l’action subversive du FLN, qui les exploite sans vergogne et sans hésiter le moins du monde à les mettre en danger de mort.
Tout ce qui est évoqué dans le livre de Fabien Sacriste s’est produit entre 1954 et 1962, c’est-à-dire très exactement pendant le temps de la guerre d’Algérie, dans une crise aux aspects divers qui certes a comporté successivement différentes périodes, mais sans qu’aucune d’entre elles ait pu échapper à la présence militaire chargée de conforter le pouvoir colonial. Tous les termes employés à l’époque pour parler de ces camps de regroupement doivent être entendus dans la perspective d’un maintien voire d’un renforcement de celui-ci : c’est la guerre et rien ne permet d’en douter. Pour ne prendre qu’un exemple, lorsque ces camps sont évoqués comme un moyen de « protéger » les populations civiles, ce mot utilisé par le langage officiel ne peut avoir qu’un sens : il s’agit de les protéger contre l’action subversive du FLN, qui les exploite sans vergogne et sans hésiter le moins du monde à les mettre en danger de mort.
Mais évidemment ces mêmes regroupements sont loin de les protéger contre la misère et la faim, qui résultent au contraire du fait qu’ils sont privés de leurs terres et autres ressources traditionnelles, le plus souvent très modestes mais pourtant suffisantes pour survivre. En fait, dans les camps, ils ne sont plus autre chose que des personnes assistées. Cet aspect économique de la situation ainsi créée n’est d’ailleurs pas le seul à entraîner tout un ensemble de perturbations, concernant leurs modes de vie et de pensée qui étaient certes totalement traditionnels— mais enfin c’était les seuls qu’ils connaissaient et la violence du déracinement dont ils se sont trouvés victimes n’était certainement pas le bon moyen pour les ouvrir à des conceptions plus modernes, étayées par l’idée de progrès. D’ailleurs, comme le dit le sous-titre du livre, il s’agit de déplacements forcés et non de migrations volontaires à leur initiative, comme il y en a eu sans aucun doute lorsqu’il devenait évident qu’en restant où ils étaient, les gens s’exposaient à de trop grands dangers, dont celui de périr et de voir périr leurs enfants pour cause de famine.
Il apparaît donc que des distinctions sont nécessaires entre tous les bouleversements subis alors par le monde rural et qu’il ne faut employer les mots pour le dire qu’avec beaucoup de discernement.
Plus largement il apparaît qu’on ne peut éviter, pour parler des situations créées alors par la guerre, de s’exposer à des connotations d’une grande portée affective et idéologique. L’exemple en est l’emploi du mot « camp » lui-même, dont on sait bien qu’une dizaine d’années après la Deuxième guerre mondiale il évoque forcément les camps de concentration nazis, d’autant que si on prend ces mots à la lettre, on peut dire la même chose des camps créés par l’armée française pendant la guerre d’Algérie : c’était effectivement des camps qui permettaient de concentrer toute la population d’une région en la localisant dans un espace restreint et maîtrisable. Pour autant, la comparaison avec les camps nazis est absolument irrecevable dans la mesure où ces derniers étaient essentiellement des camps d’extermination. Avec beaucoup d’honnêteté, certains de ceux qui ont vécu dans les camps de regroupement en Algérie n’ont pas hésité à dire les avantages qu’ils y ont trouvés et notamment celui d’être scolarisés dans de bonnes conditions. C’est le cas du journaliste et écrivain Slimane Zeghidour qui apporte son témoignage là-dessus dans un livre relativement récent (2017).
 Le regroupement des Algériens dans les camps a provoqué des désaccords assez vifs et non résolus à ce jour entre des chercheurs d’obédience différente, d’un part Pierre Bourdieu et son groupe, s’appuyant sur la pensée marxiste et d’autre part Michel Cornaton et les penseurs inspirés par lui. C’est dire que Fabien Sacristie pour écrire sa thèse a dû prendre en compte des interprétations diverses de ce qu’ont signifié les camps de regroupement en Algérie, pourtant bien documentés, bien visibles et nombreux, puisqu’il y en a eu environ deux mille, par lesquels sont passés environ deux millions de gens, ce qui est tout à fait énorme. Evidemment. Il n’est pas sûr que tous étaient des soutiens actifs et volontaires du FLN mais de toute façon il est certain que les camps les ont empêchés de jouer ce rôle—et d’ailleurs, c’était leur but non dissimulé.
Le regroupement des Algériens dans les camps a provoqué des désaccords assez vifs et non résolus à ce jour entre des chercheurs d’obédience différente, d’un part Pierre Bourdieu et son groupe, s’appuyant sur la pensée marxiste et d’autre part Michel Cornaton et les penseurs inspirés par lui. C’est dire que Fabien Sacristie pour écrire sa thèse a dû prendre en compte des interprétations diverses de ce qu’ont signifié les camps de regroupement en Algérie, pourtant bien documentés, bien visibles et nombreux, puisqu’il y en a eu environ deux mille, par lesquels sont passés environ deux millions de gens, ce qui est tout à fait énorme. Evidemment. Il n’est pas sûr que tous étaient des soutiens actifs et volontaires du FLN mais de toute façon il est certain que les camps les ont empêchés de jouer ce rôle—et d’ailleurs, c’était leur but non dissimulé.
La création de ces « nouveaux villages » puisque c’est ainsi qu’on appelle parfois les camps, a certainement contribué à la déstructuration d’un pays déjà bien malmené par le système colonial. Et beaucoup contribué aussi aux difficultés rencontrées après l’indépendance lorsqu’il s’agissait pour le nouvel Etat de faire redémarrer l’économie du pays.
Denise Brahimi
« ILS ONT DIT NON A L’ABANDON DES HARKIS » par Fatima Besnaci-Lancou et Houria Delourme-Bentayeb, éditions Loubatières, 2022
Ce titre un peu long a le mérite d’être tout à fait clair et explicite. Il suffit de remplacer le « ils » sur lequel il s’ouvre par une série de noms de personnes, une vingtaine environ, et l’on comprend que ce livre est en fait un recueil de témoignages recueillis par ses deux autrices, l’une et l’autre historiennes spécialisées dans l’histoire de la guerre d’Algérie contemporaine de leur enfance, et arrivées l’une et l’autre en France en 1962. Fatima Besnaci-Lancou est très impliquée dans l’histoire des harkis et Houria Delourme-Bentayeb dans tout ce qui touche à l’enseignement en France de la guerre d’Algérie.
 Il y a à leur livre commun un sous-titre, « désobéir pour sauver », qui pourrait être la devise de la plupart des témoins qu’elles présentent elles-mêmes de manière détaillée et dont elles font entendre la parole. Il est évident que leur souci est de leur rendre justice, le moment actuel étant favorable à un retour sur cet épisode tragique qu’a été l’histoire des Harkis occultée pendant une soixante années —le mot épisode est sans doute beaucoup trop faible pour en parler et pour dire toute l’horreur qu’ont vécue des milliers de personnes dont beaucoup ne sont plus là pour témoigner aujourd’hui. Disparus pendant les événements eux-mêmes et notamment en 1962 ; en voie de disparition aujourd’hui à cause de leur âge parce que le temps a passé et l’on dirait qu’on a découvert en cette année 2022 les 60 ans qui nous séparent désormais des accords d’Evian—ceux-ci ont été un moment décisif à tous égards et notamment dans l’histoire des harkis. Pour ne donner qu’un exemple, le plus connu des témoins présentés par ce livre, François Meyer , né en 1933, vient de disparaître le 10 juin de la présente année 2022 . C’est de lui qu’est la formule si simple et si belle : « J’ai fait la promesse à mes harkis que je ne les abandonnerai pas ».
Il y a à leur livre commun un sous-titre, « désobéir pour sauver », qui pourrait être la devise de la plupart des témoins qu’elles présentent elles-mêmes de manière détaillée et dont elles font entendre la parole. Il est évident que leur souci est de leur rendre justice, le moment actuel étant favorable à un retour sur cet épisode tragique qu’a été l’histoire des Harkis occultée pendant une soixante années —le mot épisode est sans doute beaucoup trop faible pour en parler et pour dire toute l’horreur qu’ont vécue des milliers de personnes dont beaucoup ne sont plus là pour témoigner aujourd’hui. Disparus pendant les événements eux-mêmes et notamment en 1962 ; en voie de disparition aujourd’hui à cause de leur âge parce que le temps a passé et l’on dirait qu’on a découvert en cette année 2022 les 60 ans qui nous séparent désormais des accords d’Evian—ceux-ci ont été un moment décisif à tous égards et notamment dans l’histoire des harkis. Pour ne donner qu’un exemple, le plus connu des témoins présentés par ce livre, François Meyer , né en 1933, vient de disparaître le 10 juin de la présente année 2022 . C’est de lui qu’est la formule si simple et si belle : « J’ai fait la promesse à mes harkis que je ne les abandonnerai pas ».
Cette disparition progressive et inévitable des témoins explique le plan adopté par les deux autrices du livre, une première partie consacrée aux personnes encore en vie au moment de l’écriture ou de la publication du recueil ( neuf hommes et une femme), et une seconde partie un peu moins développée dont on peut reprendre ici le titre exact : « Actes et initiatives de femmes et d’hommes, disparus à ce jour, qui ont sauvé ou participé au sauvetage des familles de harkis. »
Ces deux séries de témoignages et de rappels historiques sont encadrées par deux textes dont on pourrait dire qu’ils leur apportent la caution de chercheurs reconnus, l’historien Jacques Frémeaux et le spécialiste de l’enseignement de la guerre d’Algérie Benoît Falaize. Leur participation à ce volume montre toute l’importance de celui-ci, bien au-delà du fait qu’il nous met en présence d’êtres vivants et nous fait entendre leur parole, et en plus de cet autre fait qui est la volonté d’exprimer une gratitude et une émotion . C’est un livre écrit avec le cœur, celui des deux autrices et d’abord, évidemment, celui de la vingtaine de personnes qui s’y trouvent évoquées.
Pour la première partie, où l’on peut rencontrer des gens aussi remarquables que François Meyer et l’Abbé Alain Maillard de la Morandais, mettons l’accent sur la seule femme qui y qui y figure, Madeleine Le Pezron, née en 1929 : elle s’est occupée des harkis dans le cadre d’une Association, l’AMFRA, Aide aux Musulmans français repliés d’Algérie. A propos du discours du Président Macron (20 septembre 2021), elle a eu ces mots à la fois simples et d’une grande justesse : « C’est bien qu’il ait demandé pardon aux harkis mais il y a bien longtemps que la France aurait dû le faire. Bon, il n’est jamais trop tard pour bien faire. » La vérité sort de la bouche des vieilles dames !
 Pour la seconde partie, on choisira aussi un exemple unique faute de pouvoir les citer tous. Nicolas d’Andoque, né en 1931, rencontre l’Algérie à l’occasion de son service militaire en 1956 ; pour passer d’emblée à la fin de l’histoire on peut donner le détail de ce qu’il a dû faire pour aider vingt-cinq Algérien(ne)s qui le désiraient à venir en France, faute d’autre moyen pour les aider à sauver leur vie : « Pour arriver à Alger, il aura fallu non seulement déjouer les contrôles du FLN mais aussi éviter l‘OAS dont les tireurs surveillaient tous les musulmans. Quelques jours plus tard, sous la protection des parachutistes, ils embarqueront dans le Ville de Bordeaux malgré les menaces émanant du Ministère des Affaires algériennes qui interdisait tout transport de supplétifs en dehors du ‘plan général de rapatriement’ ». Et pour résumer la suite, c’est au prix d’efforts considérables que les amis de Nicolas d’Andoque ont pu se mobiliser pour éviter que ce petit groupe de harkis ne soit refoulé.
Pour la seconde partie, on choisira aussi un exemple unique faute de pouvoir les citer tous. Nicolas d’Andoque, né en 1931, rencontre l’Algérie à l’occasion de son service militaire en 1956 ; pour passer d’emblée à la fin de l’histoire on peut donner le détail de ce qu’il a dû faire pour aider vingt-cinq Algérien(ne)s qui le désiraient à venir en France, faute d’autre moyen pour les aider à sauver leur vie : « Pour arriver à Alger, il aura fallu non seulement déjouer les contrôles du FLN mais aussi éviter l‘OAS dont les tireurs surveillaient tous les musulmans. Quelques jours plus tard, sous la protection des parachutistes, ils embarqueront dans le Ville de Bordeaux malgré les menaces émanant du Ministère des Affaires algériennes qui interdisait tout transport de supplétifs en dehors du ‘plan général de rapatriement’ ». Et pour résumer la suite, c’est au prix d’efforts considérables que les amis de Nicolas d’Andoque ont pu se mobiliser pour éviter que ce petit groupe de harkis ne soit refoulé.
Ce que comprendront très bien ceux et celles qui ont eu la chance de voir le film de Philippe Faucon « Les Harkis» dont il a été question dans la précédente Lettre de Coup de soleil (n°68).
Plus que toute espèce de commentaires, ces récits de vie nous amènent à imaginer ou plutôt à reconstituer par empathie les différents sentiments et convictions qui ont pu pousser ces témoins à choisir la désobéissance, alors même qu’ils appartenaient à une armée en guerre. Respect des engagements, sens des responsabilités, impossibilité morale d’abandonner à leur sort des gens dont on sait qu’ils mourront (et d’une manière horrible) si on ne les aide pas. De toute évidence les gens dont ce livre nous parle avaient une conscience et n’ont pas transigé avec elle. C’est ainsi, nous dit-on, que 43.000 personnes ont pu être sauvées, dont plus de la moitié étaient des enfants. Comment ne pas saluer les sauveteurs, qui ont eu le courage de dire « non à l’abandon » ?
Denise Brahimi
« L’AUTOGESTION EN ALGERIE » par Mohammed Harbi, éditions Syllepses 2022
Ce livre porte un sous-titre qui nous éclaire parfaitement sur ce qu’a voulu dire et chercher son auteur : « Une autre révolution ? » et l’on peut même dire que l’essentiel de sa signification est contenu dans le ? : une autre révolution était-elle possible en Algérie, que celle qui a eu lieu réellement? Elle aurait pu y mettre en place, si elle avait eu lieu, un régime politico-social dont à dire vrai il y a peu d’exemples historiques mais qui n’en est pas moins connu sous le nom d’autogestion ?
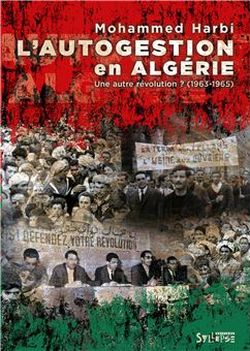 Là est toute la question que pose ce livre : l’auteur est particulièrement autorisé pour y répondre, puisque c’est à lui principalement sinon exclusivement que le projet de mettre en place l’autogestion a incombé sitôt les débuts de l’indépendance en 1962. On pourrait dire que cette tentative, et cette expérience, ont été d’assez courte durée : 1963-1965, entièrement sous la présidence de Ben Bella, ce qui est d’ailleurs une de données du problème que Mohammed Harbi a eu à résoudre, et qu’il invoque pour expliquer au moins partiellement les difficultés qu’il a rencontrées. Mais ce fut évidemment bien pire après 1965, ou plus exactement ce fut à cette date la fin de toutes les tentatives en cours puisque Mohammed Harbi fut emprisonné sitôt le coup d’état de Boumediène en 1965 et son arrivée au pouvoir. Pour autant, le bilan, riche et nuancé, que fait l’auteur dans le présent livre, montre que même inabouties, ces recherches sur le terrain furent passionnantes et encore dignes d’être analysées aujourd’hui.
Là est toute la question que pose ce livre : l’auteur est particulièrement autorisé pour y répondre, puisque c’est à lui principalement sinon exclusivement que le projet de mettre en place l’autogestion a incombé sitôt les débuts de l’indépendance en 1962. On pourrait dire que cette tentative, et cette expérience, ont été d’assez courte durée : 1963-1965, entièrement sous la présidence de Ben Bella, ce qui est d’ailleurs une de données du problème que Mohammed Harbi a eu à résoudre, et qu’il invoque pour expliquer au moins partiellement les difficultés qu’il a rencontrées. Mais ce fut évidemment bien pire après 1965, ou plus exactement ce fut à cette date la fin de toutes les tentatives en cours puisque Mohammed Harbi fut emprisonné sitôt le coup d’état de Boumediène en 1965 et son arrivée au pouvoir. Pour autant, le bilan, riche et nuancé, que fait l’auteur dans le présent livre, montre que même inabouties, ces recherches sur le terrain furent passionnantes et encore dignes d’être analysées aujourd’hui.
Le grand intérêt de « L’autogestion en Algérie » est d’apporter une analyse précieuse parce que très documentée, de la façon dont avait été conçue la mise en place de ce mode de gestion totalement nouveau dans le pays, et de la nature des obstacles divers qui n’ont cessé de s’y opposer. La première des trois parties que le livre comporte est destinée à faire comprendre ce que furent les comités de gestion dans plusieurs régions que l’auteur a bien connues. Le récit de cette expérience historique est passionnant parce que minutieux. On ne peut que résumer très sommairement ce qui s’est passé dans ces lieux.
Il faut se représenter l’énormité du problème qui s’est posé après le départ massif sinon total des colons qui étaient propriétaires des terres et les exploitaient à leur profit à la manière coloniale. Même chose d’ailleurs pour les maisons et les appartements dont il fallait savoir que faire après le départ de leurs occupants.
Il est évident qu’un certain nombre d’Algériens décolonisés se sentaient tout prêts à occuper les espaces et les biens ainsi libérés en copiant presque à l’identique les méthodes utilisées précédemment par leurs prédécesseurs. Cependant, beaucoup d’autres, bien conscients que l’Algérie se devait d’accomplir une révolution annoncée, voulaient à toute force éviter que se constitue une bourgeoisie détentrice des richesses privées longtemps convoitées. Nombre de ceux-là considéraient que les biens abandonnés par les colons devaient désormais être considérés comme biens de l’Etat mais encore fallait-il empêcher qu’ils tombent aux mains de ceux qui se considéraient comme les représentants de cet Etat-Nation conquis avec l’indépendance. L’autogestion, définie par quelques théoriciens avertis et expérimentés pouvait passer pour la seule solution acceptable mais certes difficile à  organiser. Le livre de Mohammed Harbi évoque plusieurs fois un de ceux qui à l’époque y avaient déjà longuement réfléchi, Michel Raptis d’origine grecque connu sous le nom de Pablo et leader trotskyste d’une révolution internationale propre à succéder aux régimes coloniaux. Mais Mohammed Harbi devait d’abord régler les problèmes à l’échelon très local de régions algériennes encore organisées comme elles l’étaient jusqu’en 1962. La réorganisation devait se faire selon les principes de l’autogestion, absolument nouvelle et aussi ignorée des ouvriers que des cadres (souvent autoproclamés) du nouveau régime. L’autogestion implique que les décisions soient prises collectivement, par l’ensemble des personnes concernées, mais beaucoup des témoignages rapportés par Mohammed Harbi font entendre des ouvriers consternés de leur propre incompétence et de l’absence de toute espèce de gens qui puissent les conseiller ou les aider. En fait, toutes les circonstances étaient réunies pour que s’exercent la corruption, le vol et autres pratiques néfastes que nul n’était en état ou en situation de contrôler. Mohammed Harbi constate que le Président auquel il a eu l’affaire était tout à fait incapable de prendre des mesures pourtant indispensables pour éviter à la révolution de dériver.
organiser. Le livre de Mohammed Harbi évoque plusieurs fois un de ceux qui à l’époque y avaient déjà longuement réfléchi, Michel Raptis d’origine grecque connu sous le nom de Pablo et leader trotskyste d’une révolution internationale propre à succéder aux régimes coloniaux. Mais Mohammed Harbi devait d’abord régler les problèmes à l’échelon très local de régions algériennes encore organisées comme elles l’étaient jusqu’en 1962. La réorganisation devait se faire selon les principes de l’autogestion, absolument nouvelle et aussi ignorée des ouvriers que des cadres (souvent autoproclamés) du nouveau régime. L’autogestion implique que les décisions soient prises collectivement, par l’ensemble des personnes concernées, mais beaucoup des témoignages rapportés par Mohammed Harbi font entendre des ouvriers consternés de leur propre incompétence et de l’absence de toute espèce de gens qui puissent les conseiller ou les aider. En fait, toutes les circonstances étaient réunies pour que s’exercent la corruption, le vol et autres pratiques néfastes que nul n’était en état ou en situation de contrôler. Mohammed Harbi constate que le Président auquel il a eu l’affaire était tout à fait incapable de prendre des mesures pourtant indispensables pour éviter à la révolution de dériver.
La deuxième partie du livre est centrée sur un hebdomadaire, « Révolution africaine » dont Mohammed Harbi fut directeur à la demande de Ben Bella de juin 1963 jusqu’à juin 1964. Pour résumer les objectifs du journal on peut dire qu’ils sont doubles mais sans contradiction et de manière complémentaire, car il s’agit d’une part d’aider les mouvements de libération en Afrique, en leur assurant le soutien de leaders révolutionnaires à visée internationale et d’autre part d’affirmer l’importance et la place de l’Algérie dans ces processus. L’importance de l’autogestion ne cesse d’être réaffirmée et Mohammed Harbi reçoit sur ce point l’aide de Daniel Guérin, militant anticolonialiste communiste et révolutionnaire. La troisième et dernière partie regroupe des textes et documents sur lesquels s’appuie cette histoire encore étonnamment vivante et présente de ce qu’a été la tentative d’autogestion en Algérie.
Denise Brahimi
« LE CENTRE D’APPEL DES ECRIVAINS DISPARUS » par Aymen Gharbi, éditions Asphalte 2023
Ce roman au titre plaisant n‘est pas l’œuvre d’un débutant, son auteur a une bonne quarantaine d’années et il est déjà l’auteur de deux autres romans, « Magma Tunis » (2018) et « La Ville des impasses » (2021). Comme l’indique son premier titre, son inspiration lui vient beaucoup de la ville de Tunis et de la Tunisie, mais c’est aussi un écrivain résolument francophone, qui a une véritable passion pour la littérature française, son centre de ralliement avec celle-ci étant la ville de Montpellier dont il est beaucoup question dans son dernier roman.
« Magma Tunis et « La Ville des impasses » sont des titres qui indiquent bien que l’auteur ne fait pas un portrait flatteur de la ville d’où il vient avant d’aborder la France mais il n’en donne pas pour autant une image pleinement repoussante, bien au contraire. Il est 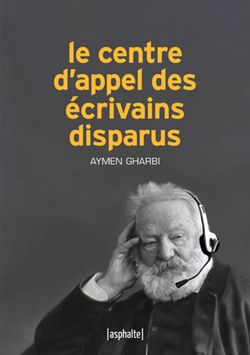 évident qu’à certains égards et paradoxalement, Tunis lui plaît beaucoup et lui convient : il se pourrait même que son but principal lorsqu’il entre en littérature soit de la décrire, ou mieux vaudrait dire de l’évoquer, car il y met beaucoup de fantaisie voire de loufoquerie. La ville selon son cœur est sans doute plutôt Nabeul, comme lieu de l’origine, du moins il en est ainsi pour Oualid, qui est le personnage principal du « Centre d’appel des écrivains disparus », mais son écriture fait de Tunis une ville inépuisable et toujours surprenante— il est vrai que c’est aussi le lieu de ses premières amours, lorsqu’il y vient en tant qu’étudiant. Il faut peut-être attribuer à son goût très fort pour le cinéma sa pratique de certains gros plans ou plans de détail très minutieux mais pour autant on ne saurait dire qu’il soit un écrivain réaliste ou purement réaliste, car il est aussi pourvu (ce qui va de pair avec le goût de la littérature et du cinéma) d’un imaginaire remarquable et d’un goût marqué pour les idées farfelues, comme celle qui donne le titre de son dernier livre. De quoi s’agit-il ?
évident qu’à certains égards et paradoxalement, Tunis lui plaît beaucoup et lui convient : il se pourrait même que son but principal lorsqu’il entre en littérature soit de la décrire, ou mieux vaudrait dire de l’évoquer, car il y met beaucoup de fantaisie voire de loufoquerie. La ville selon son cœur est sans doute plutôt Nabeul, comme lieu de l’origine, du moins il en est ainsi pour Oualid, qui est le personnage principal du « Centre d’appel des écrivains disparus », mais son écriture fait de Tunis une ville inépuisable et toujours surprenante— il est vrai que c’est aussi le lieu de ses premières amours, lorsqu’il y vient en tant qu’étudiant. Il faut peut-être attribuer à son goût très fort pour le cinéma sa pratique de certains gros plans ou plans de détail très minutieux mais pour autant on ne saurait dire qu’il soit un écrivain réaliste ou purement réaliste, car il est aussi pourvu (ce qui va de pair avec le goût de la littérature et du cinéma) d’un imaginaire remarquable et d’un goût marqué pour les idées farfelues, comme celle qui donne le titre de son dernier livre. De quoi s’agit-il ?
Oualid participe avec quelques compagnons, aussi typés et aussi drolatiques que lui, à la mise en place d’un centre d’appel très original : les clients ont la possibilité d’appeler par téléphone et d’obtenir au bout du fil un grand écrivain de leur choix. D’où les formules pleines d’humour qui en font la publicité : « Si vous voulez parler avec Victor Hugo, tapez 1. Si vous voulez parler avec Honoré de Balzac, tapez 2… Oualid lui-même a choisi de répondre aux appels destinés à Samuel Beckett, moins demandé que les deux précédents, le premier surtout ! Cependant, il est évident que si Beckett lui plaît c’est par une certaine forme d’humour dont il donne d’ailleurs un exemple en mettant en exergue en tête de son livre un bref passage de cet auteur, extrait de sa pièce intitulée « Fin de partie ».
Ce choix de l’humour est très caractéristique d’un auteur qui certes n’ignore rien des vicissitudes que traverse son pays (la Tunisie à l’époque du printemps arabe de 2011) et ses personnages (notamment celui qui d’une manière plus ou moins autobiographique est une sorte de double de lui-même), mais qui pour autant évite absolument de tenir ce qu’on appelle un discours d’idées, nourri de débats politiques et idéologiques. Il n’est pas impossible que des bribes de celui-ci apparaissent ici ou là , et notamment dans les propos de certains personnages, car tous ces jeunes gens qui sont encore étudiants ou qui l’ont été ont beaucoup à dire et à l’occasion le font très bien, les filles pas moins que leurs camarades et amis.
 Venant de la part d’un jeune Maghrébin, qui lit beaucoup et voit beaucoup de films, cette attitude est remarquable, elle est forcément volontaire et constitue une sorte d’esquive, où il faut peut-être identifier un trait assez typiquement tunisien —si l’on considère, par l’effet d’une généralisation sans doute trop hâtive, que côté algérien la critique politique serait le trait dominant tandis que du côté marocain, ce serait plutôt les problèmes de société et de mœurs.
Venant de la part d’un jeune Maghrébin, qui lit beaucoup et voit beaucoup de films, cette attitude est remarquable, elle est forcément volontaire et constitue une sorte d’esquive, où il faut peut-être identifier un trait assez typiquement tunisien —si l’on considère, par l’effet d’une généralisation sans doute trop hâtive, que côté algérien la critique politique serait le trait dominant tandis que du côté marocain, ce serait plutôt les problèmes de société et de mœurs.
Remarquable aussi le peu de place fait par un garçon comme Oualid (et l’on peut sans doute dire par l’auteur lui-même Aymen Gharbi) au problème religieux, en sorte que comme il arrive souvent à l’époque actuelle, on a le sentiment que l’islam préoccupe beaucoup plus les écrivains, penseurs (etc.) qui vivent en dehors des pays musulmans ; à l’intérieur de ceux-ci, la confrontation avec les partis islamistes est pourtant une réalité très présente au quotidien ; mais peut-être est-ce justement cette forte réalité qui lui évite de prendre un caractère fantasmatique comme c’est le cas en France par exemple.
Le court épilogue du livre est d’ailleurs important parce que l’auteur y donne quelques clefs. En tout cas il y explique qu’une certaine politisation stupide et bornée qui sévit autour de lui (en Tunisie et en France) l’incite à réagir en prenant une attitude inverse : « Je me suis mis à écrire des pièces absurdes et déconnectées de la réalité». L’absurde évidemment nous ramène à Beckett, qui joue comme un modèle dans ce livre mais un modèle non prescriptif car l’humour ne saurait être un donneur de leçons.
Denise Brahimi
« CAFES D’HOMMES, SERVICES DE FEMMES. Les serveuses de cafés dans les quartiers populaires à Casablanca », par Sana Benbelli, éditions du Croquant 2023
Ce livre est un travail universitaire dans le domaine de la sociologie, agréé à ce titre par les maîtres en la matière, à l’Université Hassan II de Casablanca. Sana Benbelli se montre experte et pratique le renouvellement actuellement en cours dans le traitement de cette science sans pour autant ignorer les règles mises en usage par ses prédécesseurs. 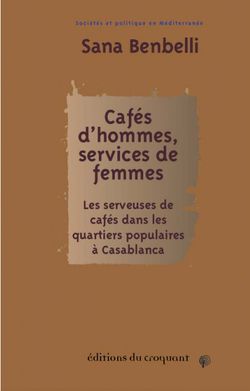 L’abondance et la précision des notes infrapaginales de son livre, très riches en mentions bibliographiques, montre qu’elle disposait de toutes les connaissances nécessaires pour traiter le sujet qui lui tient à cœur et qu’on peut sommairement résumer ainsi : dans la ville économiquement la plus importante et la plus novatrice du Maroc, Casablanca, comment décrire et apprécier l’évolution incontestable de certaines femmes issues du milieu populaire mais en rupture avec leur statut traditionnel voire ancestral ? Les serveuses de café ont paru à Sana Benbelli des exemples de cette évolution, et il semble qu’elles se soient prêtées assez facilement au genre de conversation que l’enquêtrice sollicitait. Ces entretiens font certes partie du travail nécessaire en sociologie et généralement ils alternent avec des recherches théoriques (ou avec les résultats obtenus par un certain nombre de celles-ci) passées ou présentes dans ce même domaine.
L’abondance et la précision des notes infrapaginales de son livre, très riches en mentions bibliographiques, montre qu’elle disposait de toutes les connaissances nécessaires pour traiter le sujet qui lui tient à cœur et qu’on peut sommairement résumer ainsi : dans la ville économiquement la plus importante et la plus novatrice du Maroc, Casablanca, comment décrire et apprécier l’évolution incontestable de certaines femmes issues du milieu populaire mais en rupture avec leur statut traditionnel voire ancestral ? Les serveuses de café ont paru à Sana Benbelli des exemples de cette évolution, et il semble qu’elles se soient prêtées assez facilement au genre de conversation que l’enquêtrice sollicitait. Ces entretiens font certes partie du travail nécessaire en sociologie et généralement ils alternent avec des recherches théoriques (ou avec les résultats obtenus par un certain nombre de celles-ci) passées ou présentes dans ce même domaine.
C’est bien ainsi que Sana Benbelli a procédé mais à ce constat il faut ajouter une suite qui n’est pas de moindre importance même si on ne s’en aperçoit pas forcément au premier abord ni à la lecture du titre qu’elle a choisi pour sa thèse . En fait ce titre qui certes peut passer pour prometteur reste bien en-deçà de ce que le lecteur découvre dans la deuxième moitié du livre, dont l’objet principal est une description qu’on pourrait dire sur le vif de la vie quotidienne des serveuses de café ; les quartiers populaires et certains cafés qui s’y trouvent ont été présentés auparavant par la sociologue, faisant aussi œuvre d’historienne, d’urbaniste, de géographe etc., mais pas encore de romancière ou de nouvelliste au sens balzacien, c’est-à-dire réaliste de ces mots.
S’étant mise à l’écoute des jeunes femmes qu’elle a rencontrées et qui pour la plupart ont entre vingt et trente ans (en tout cas aucune ne doit dépasser 37 ans pour obtenir ce genre d’emploi ), Sana Benbelli a travaillé avec beaucoup de précision et de minutie, comme si le caractère très concret de ses rencontres l’avait entraînée bien au-delà du souci de son enquête. Nous devinons fort bien qu’il en est ainsi du fait de la sympathie qui s’est ajoutée à la curiosité éprouvée par Sana Benbelli pour beaucoup d’entre elles et plus que tout par ce qu’il convient d’appeler le respect dont elle témoigne à leur égard. Les serveuses de café forment une catégorie qu’elle s’emploie à caractériser de plusieurs manières, donnant le sentiment qu’il y a rarement des règles (par qui seraient-elle écrites ?) pour les définir mais que pourtant celles-ci existent implicitement. C’est une sorte de non-dit, mais les femmes sont tout à fait capables de l’expliciter, ici à la demande de l’enquêtrice, et elles le font alors avec une intelligence remarquable. En une centaine de pages, on a l’impression d’avoir à peu près compris ce que sont les qualités nécessaires pour devenir une bonne serveuse de café et pour garder cette situation un certain temps, bien que par définition, elle soit plus ou moins temporaire—et il s’agit plus souvent de départ volontaire que de renvoi.
 Il est tout à fait vrai que l’art des serveuses est pour une bonne part de comprendre ce que les clients viennent chercher au café et de ne pas s’y tromper grossièrement : certes ils veulent trouver en elles de la féminité mais cela ne veut pas dire du sexe à consommer car il y a d’autres lieux pour cela ; les serveuses doivent être agréables dans toute leur manière d’être, attitudes, gestes, vêtements et maquillage, pas nécessairement belles de visage mais de corps plaisant. D’ailleurs cette image de la féminité qu’elles doivent faire circuler dans l’espace très restreint du café où elles évoluent est assez flatteuse pour des femmes jeunes ou encore jeunes, aussi le font-elles spontanément et sans contrainte. De manière assez remarquable les femmes qui s’expriment dans les entretiens se disent assez satisfaites du choix qu’elles ont fait volontairement. La grosse affaire évidemment est qu’en travaillant elles gagnent de l’argent, leur argent dont elles disposent librement, même si c’est pour en donner une part ou une bonne part à leur famille : c’est un véritable renversement du rôle qu’elles y jouaient traditionnellement et leur image dans la société toute entière s’en trouve transformée.
Il est tout à fait vrai que l’art des serveuses est pour une bonne part de comprendre ce que les clients viennent chercher au café et de ne pas s’y tromper grossièrement : certes ils veulent trouver en elles de la féminité mais cela ne veut pas dire du sexe à consommer car il y a d’autres lieux pour cela ; les serveuses doivent être agréables dans toute leur manière d’être, attitudes, gestes, vêtements et maquillage, pas nécessairement belles de visage mais de corps plaisant. D’ailleurs cette image de la féminité qu’elles doivent faire circuler dans l’espace très restreint du café où elles évoluent est assez flatteuse pour des femmes jeunes ou encore jeunes, aussi le font-elles spontanément et sans contrainte. De manière assez remarquable les femmes qui s’expriment dans les entretiens se disent assez satisfaites du choix qu’elles ont fait volontairement. La grosse affaire évidemment est qu’en travaillant elles gagnent de l’argent, leur argent dont elles disposent librement, même si c’est pour en donner une part ou une bonne part à leur famille : c’est un véritable renversement du rôle qu’elles y jouaient traditionnellement et leur image dans la société toute entière s’en trouve transformée.
Avec une grande subtilité la sociologue montre comment finalement beaucoup d’autres choses changent aussi à partir de là. L’argent a un rapport avec l’avenir, à travers les projets : presque toutes les serveuses de café ont un plan, lié à l’argent qu’elles réussissent à mettre de côté. Un aspect très émouvant de cette attitude concerne leurs enfants : la plupart des femmes en ont au moins un, entièrement à leur charge et c’est à eux, c’est-à-dire à leurs études (concernant aussi le sport) qu’est consacré en premier lieu l’argent qu’elles gagnent en travaillant au café. En dépit d’inévitables échecs (dont beaucoup sont dus à l’addiction) leur travail va incontestablement dans le sens d’un progrès, dans une société où la stagnation et l’immobilisme sont reconnus comme des fléaux. Il y a un avenir pour les serveuses de café car c’est elles qui le font.
Denise Brahimi
« AU VENT MAUVAIS » de Kaouther Adimi, roman, éditions du Seuil, 2022
De ce roman on peut dire qu’il est la toute dernière œuvre de Kaouther Adimi puisqu’il date de l’été 2022, et l’on peut remarquer qu’il est d’une plus grande ampleur que les quatre précédents, puisqu’il entend évoquer, de manière précise et suivie, un laps de temps équivalent à celui d’une vie humaine. L’histoire commence pour le dire sommairement avant la Deuxième guerre mondiale, pour aller non pas jusqu’à la période actuelle mais jusqu’en 1992 qui est une date tout à fait significative dans l’histoire de l’Algérie : c’est le moment où le pays plonge, de manière effroyable, dans la guerre civile—époque tristement célèbre dite de la décennie noire. Le roman porte une dédicace de l’auteure « A mes grands parents » et les dernières pages sont tout à fait explicites à cet égard : les deux personnages principaux du livre, Tarek et Leïla, sont en effet les grands  parents de Kaouther Adimi , le 3ème personnage qui y joue aussi un rôle important, l’écrivain Saïd (qui meurt à la fin du livre) étant beaucoup plus difficile à identifier : est-il de pure fiction ou fait-il référence, plus ou moins précisément, à un personnage qui a réellement existé ?
parents de Kaouther Adimi , le 3ème personnage qui y joue aussi un rôle important, l’écrivain Saïd (qui meurt à la fin du livre) étant beaucoup plus difficile à identifier : est-il de pure fiction ou fait-il référence, plus ou moins précisément, à un personnage qui a réellement existé ?
Se pose à partir de là la question des éléments biographiques voire autobiographiques dans le livre. De toute manière, ils sont utilisés en toute liberté et sans doute avec beaucoup de transpositions—ce qui est une différence notoire avec ce que font beaucoup de « fresques historiques », c’est l’expression consacrée, dont les auteurs reviennent à partir de souvenirs personnels ou familiaux sur telle ou telle période encore récente de l’’histoire d’Algérie. Pour donner une idée de la manière dont travaille Kaouther Adimi , on peut prendre l’exemple des chapitres qu’elle consacre à une certaine villa romaine magnifique, véritable merveille où Tarek a la chance (improbable) de pourvoir séjourner en toute liberté ; on se dit sans être devin qu’elle a certainement des rapports avec la villa Médicis où Kaouther Adimi séjournait encore, semble-il, au moment où elle écrivait le présent roman ! C’est de sa part une très jolie manière, à la fois claire et allusive, de rendre hommage au lieu qui l’a hébergée.
Pour certains passages de son livre, concernant par exemple le sort des soldats nord-africains pendant et après la Deuxième guerre mondiale, la source utilisée par l’auteure est indiquée, elle a pu la consulter aux archives ; de même, pour le très long passage consacré au tournage du film « La Bataille d’Alger » par le réalisateur italien Pontecorvo, Kaouther Adimi renvoie à deux documentaires sur lesquels elle a pu s’appuyer, dont celui de Malek Bensmaïl qui date de 2017. On comprend qu’une fresque historique implique plus ou moins l’utilisation et l’intégration de passages puisés à diverses sources, d’ailleurs on sait déjà par ses romans antérieurs que la romancière s’appuie sur des faits réels pour démarrer son récit (dans « Nos richesses » (2017), elle s’inspire largement d’un personnage bien réel, Edmond Charlot, qui fut libraire et éditeur à Alger).
En tout cas, « Au vent mauvais » donne au lecteur le sentiment d’un équilibre réussi entre ses deux éléments qui sont d’une part l’historique et le collectif et d’autre part le particulier et l’intime. A l’intérieur de ce deuxième aspect qui est l’histoire du couple de ses grands-parents, la romancière fait une place importante, sans même avoir besoin de la souligner, à la préoccupation féministe qui est caractéristique de notre époque. C’est d’autant plus vrai lorsque la personne qui écrit, (en 2022), est une femme qu’on attend

(Photo by JOEL SAGET / AFP)
sur ce terrain. Kaouther Adimi ne se dérobe pas, non pour faire œuvre de militante, mais parce que sa Leïla est certainement le personnage le plus complexe du livre et que, de ce fait, tout ce qui concerne les femmes y apparaît sur le mode de la contradiction. Femme victime dès son plus jeune âge lorsqu’on lui impose un mariage détestable, mais aussi femme capable de fuir cette situation , témoignant de ce mélange de force et de faiblesse difficile à cerner, chez certains femmes traditionnelles au sein du patriarcat : courage incroyable chez Leïla pour faire face, seule, à la nécessité de nourrir et d’élever une demi-douzaine d’enfants, mais incapacité d’accéder à autre chose que les tâches domestiques écrasantes (malgré un apprentissage solitaire et plus ou moins clandestin de l’écriture), refus du savoir qui comporte toujours une part plus ou moins grande de danger, et soumission respectueuse à la religion ancestrale. Leïla, femme forte et intelligente, est aussi une femme contrainte et ligotée. On pourrait même dire que par rapport à une femme plus âgée qui lui a servi de mère de substitution, de protectrice et de modèle, elle est moins libre, moins inventive, moins indépendante par rapport aux normes (violentes et cruelles) de la société villageoise : la très relative modernisation de celle-ci pourrait avoir entraîné une sorte de modèle unique défavorable aux fortes personnalités.
Cependant Kaouther Adimi ne s’engage pas dans la voie d’une réflexion sociologique, elle passe sur les deux générations qui séparent Leïla de ses petites-filles, donnant plutôt l’impression que l’histoire étant ce qu’elle est ,il faut s’attendre à franchir des étapes, dont chacune est soumise au jeu de tendances contraires et comporte des obstacles difficiles à surmonter.
On peut s’étonner que la littérature , c’est-à-dire un usage particulièrement expert des mots, soit présentée dans le livre comme dangereux voire pervers, en la personne de l’écrivain Saïd .
Ce personnage reste dans l’ombre (qui sera prématurément celle de la mort) et garde ses mystères. Sans doute l’auteure avait-elle besoin de ressorts dramatiques, que Saïd lui fournit.
Leïla se sent particulièrement victime des agissements de celui-ci, manière de dire que les femmes traditionnelles sont exposées sans défense face à certains comportements comme ceux de Saïd. Ils revendiquent une supposée modernité qui s’avère principalement masculine et non respectueuse des femmes. Tarek se sent beaucoup moins atteint que Leïla par la divulgation de l’intime à laquelle Saïd s’est livré, c’est bien la preuve que les femmes restent plus vulnérables et plus souvent victimes.
Denise Brahimi
« OUM KALTHOUM naissance d’une diva» Roman graphique de Nadia Hathroubi-Safsaf et Chadia Loueslati (Editions JC Lattès mars 2023).
Cet album a pris récemment sa place dans les devantures des libraires et semble connaître un beau début de succès.
 Oum Khaltoum conserve partout une extraordinaire popularité ce qui explique en partie ce succès. C’est aussi à notre connaissance la première bande dessinée consacrée à cette grande dame, et la couverture de l’ouvrage où le visage de la diva, probablement vers la fin de sa vie, ressort en blanc, avec ses lunettes noires sur un fond noir, ce qui capte le regard qui s’attarderait sur la vitrine d’une librairie.
Oum Khaltoum conserve partout une extraordinaire popularité ce qui explique en partie ce succès. C’est aussi à notre connaissance la première bande dessinée consacrée à cette grande dame, et la couverture de l’ouvrage où le visage de la diva, probablement vers la fin de sa vie, ressort en blanc, avec ses lunettes noires sur un fond noir, ce qui capte le regard qui s’attarderait sur la vitrine d’une librairie.
Rien de funèbre pour autant dans ce joli livre.
Saluons le dessin de Chadia Loueslati au style très personnel, qui restitue avec grâce la gestuelle des personnages, les expressions des visages, et documente de façon très crédible les différents lieux où évolue l’héroïne du livre et les personnes qui l’entourent. Le choix des couleurs est très sobre, monochrome gris-bleu pour la partie qui introduit l’histoire, puis un élégant sépia pour le récit de vie de « Thouma ». Des enluminures en graphie arabe enjolivent le livre…
La dessinatrice n’a encore que quelques albums BD à son actif, mais ils ont tous reçu un bon accueil public, et des prix.
Le scenario de cette biographie est assez simple : une jeune journaliste, Diane Moulins, assiste à un concert d’Oum Khaltoum à l’Olympia le 13 novembre 1967, à l’invitation de Bruno Coquatrix. Elle découvre la chanteuse et l’engouement éperdu qu’elle suscite dans le public. Ce soir-là, 3 heures de concert avec … trois chansons. Coquatrix lui dit que c’est Charles De Gaulle qui lui a suggéré d’inviter celle qu’il surnomme « La Dame », et lui obtient une interview, le lendemain au Georges V.
 Ceci amène à la deuxième partie, avec le récit de sa vie par Oum Khaltoum, illustré en sépia.
Ceci amène à la deuxième partie, avec le récit de sa vie par Oum Khaltoum, illustré en sépia.
Celle qui allait devenir une des plus grandes divas internationales (que la Callas appelait « la voix incomparable »!) naît dans un petit village du delta du Nil, et reçoit de son père, très pieux, qui enseigne les chants religieux, le nom de la fille bien-aimée du prophète Mohammed.
Son enfance est marquée par une longue conquête d’émancipation ; l’école coranique, où elle parvient à se faire inscrire par ses parents pauvres, puis respecter pour échapper aux tâches ancillaires auxquelles la vouait le cheikh, la reconnaissance de ses qualités vocales, qui lui valent de commencer à se produire…habillée en garçon, aux côtés de son père, puis la reconnaissance de son statut de chanteuse, puis l’accès à un répertoire profane…
Elle fait la connaissance au Caire du poète Ahmed Rami qui écrira ensuite la plupart de ses chansons. A 22 ans elle commence à se produire sur des scènes, désormais comme une chanteuse « en robe simple et distinguée », un grand mouchoir à la main pour se rassurer… En 1926, premier album « Si je te pardonne », premier succès de vente, les propositions de concerts affluent dans différents pays. Elle donne un concert en direct hebdomadaire à la radio égyptienne, devient la voix du Caire. En 1936, Fritz Lang, encore allemand, lui propose son premier film, dont elle négocie des conditions qui la respectent : « Wedad » est sélectionné à la Biennale de Venise. Belle entrée dans une carrière cinématographique… Puis sa carrière accompagnera également les étapes de la vie politique égyptienne : elle chante à l’investiture du roi Farouk, multiplie plus tard les concerts de soutien au régime de Nacer, qui la surnommera « notre quatrième pyramide ».
 Elle soutiendra aussi la cause palestinienne, et chantera à la radio « Nous sommes tous des fedayins ».
Elle soutiendra aussi la cause palestinienne, et chantera à la radio « Nous sommes tous des fedayins ».
Elle se marie à 53 ans à son ami et médecin Hassen El Hafnaoui, en obtenant un contrat de mariage incluant le droit de divorcer…
Son décès à 76 ans au Caire est un choc immense en Egypte et dans le monde arabe. 2 millions de personnes accompagnent son cercueil…
Le livre se termine sur des références discographiques et filmographiques, sur d’intéressants croquis de recherche, ce qui permet de constater que la couverture choisie et bien la meilleure des 5 versions.
En refermant l’album on se trouve enrichi par ce récit d’une vie peu banale, dépeignant l’émancipation obstinée d’une jeune paysanne née à la toute fin du 19ème siècle, riche d’un talent incomparable, mais aussi d’une belle intégrité dans ses engagements et son attachement à son pays.
Et on s’empresse d’aller écouter la voix de cette immense chanteuse…
Michel Wilson

« CHAABA, DU BLED AU BIDONVILLE », film documentaire réalisé par Wahid Chaïb et Laurent Benitah, 2023
Ce documentaire qui vient d’être présenté à Lyon est particulièrement à sa place dans cette ville où ont eu lieu les faits représentés et reconstitués, même si on peut le voir en tout autre lieu pour son intérêt historique et pour la qualité humaine des gens qu’il nous donne à entendre et à voir.
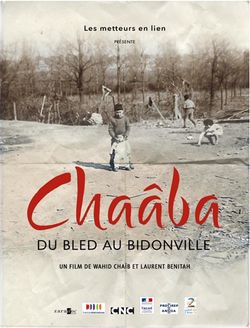 La période à laquelle remontent les témoignages qui le constituent est bien délimitée, c’est ce moment qui inaugure l’histoire de l’émigration algérienne en France, dans les années 50 du siècle dernier. Historiquement peu d’années le séparent du retour à la paix après la Deuxième guerre mondiale et il est certain qu’en France, il y a alors beaucoup à faire pour tenter de réparer les dégâts causés par celle-ci. Le mot reconstruction est d’abord à prendre au sens propre, il faut construire des logements car la crise en ce domaine est aiguë, comme le prouve le cri lancé par l’Abbé Pierre en 1954 en faveur des sans-abri. Les Algériens qui viennent alors en France n’ont aucune peine à y trouver du travail car on a besoin d’eux et de leur force physique, alors qu’au même moment en Algérie (encore « française ») ils ont toutes les peines du monde à survivre et à nourrir leurs familles.
La période à laquelle remontent les témoignages qui le constituent est bien délimitée, c’est ce moment qui inaugure l’histoire de l’émigration algérienne en France, dans les années 50 du siècle dernier. Historiquement peu d’années le séparent du retour à la paix après la Deuxième guerre mondiale et il est certain qu’en France, il y a alors beaucoup à faire pour tenter de réparer les dégâts causés par celle-ci. Le mot reconstruction est d’abord à prendre au sens propre, il faut construire des logements car la crise en ce domaine est aiguë, comme le prouve le cri lancé par l’Abbé Pierre en 1954 en faveur des sans-abri. Les Algériens qui viennent alors en France n’ont aucune peine à y trouver du travail car on a besoin d’eux et de leur force physique, alors qu’au même moment en Algérie (encore « française ») ils ont toutes les peines du monde à survivre et à nourrir leurs familles.
Les Algériens dont il est question dans le documentaire sont un groupe de 25 familles qui toutes comportent un nombre d’enfants importants et qui sont très liées entre elles, en sorte qu’on peut vraiment les désigner sous le nom de communauté : tous sans exception sont absolument solidaires et constituent un seul ensemble, ce qui est d’autant plus vrai qu’ils ont entre eux un fort sentiment de solidarité : on peut aller jusqu’à dire, sur la foi de leurs propos ( un véritable « cri du cœur »de tous ceux qui ont vécu cette période) que cette solidarité est ce qui leur leur a permis de survivre alors que les conditions de vie matérielle étaient très difficiles (c’est un euphémisme !). Comme le dit bien le titre du documentaire, l’endroit où ils vivaient était très exactement ce qu’on appelle un bidonville, ensemble de baraques tout en bois dont l’équipement était rudimentaire et dont eux-mêmes s’étonnent rétrospectivement qu’ils aient réussi à y tenir pendant plusieurs  années. Et pourtant l’emplacement de ce chaâba, dont ils parlent comme d’une sorte de trou perdu ou de non lieu (c’est le sens du mot en arabe dialectal), n’était qu’à faible distance de la ville de Lyon, en fait à Villeurbanne dans le quartier de la Feyssine, Avenue Monin. Mais les seuls mouvements consistaient pour les hommes dans les trajets pour leur travail, tandis que pour les femmes, c’était l’espace de l’une à l’autre de ces baraques dans lesquelles elles vivaient enfermées.
années. Et pourtant l’emplacement de ce chaâba, dont ils parlent comme d’une sorte de trou perdu ou de non lieu (c’est le sens du mot en arabe dialectal), n’était qu’à faible distance de la ville de Lyon, en fait à Villeurbanne dans le quartier de la Feyssine, Avenue Monin. Mais les seuls mouvements consistaient pour les hommes dans les trajets pour leur travail, tandis que pour les femmes, c’était l’espace de l’une à l’autre de ces baraques dans lesquelles elles vivaient enfermées.
Le documentaire qui dure une cinquantaine de minutes ne peut ouvrir que des aperçus sur cette première génération, arrivée en France au début des années 50. On y voit quelques détails qu’on a peine à dire pittoresques tant ce mot est odieux quand il s’agit d’une très grande misère, ici par exemple la présence d’une chèvre parmi les habitants.
En fait la période évoquée dure jusqu’après la fin de la guerre d’Algérie, en 1967. Le moment sur lequel on est le mieux renseigné est celui qu’évoque le « Le gône du chaâba »(on sait que « gône » est le nom donné au gosse lyonnais), livre autobiographique de l’écrivain et chercheur Azouz Begag, paru aux éditions du Seuil en 1986, qui connut et connaît encore un vif succès. Azouz Begag (né en 1957) est très présent dans le documentaire, ses souvenirs et ses réflexions lui donnent une dimension sensible et émouvante, en l’absence de tout misérabilisme.
Un autre personnage connu apporte son témoignage et sa réflexion, c’est Christian Delorme, parfois appelé le curé des Minguettes, prêtre catholique français spécialiste du dialogue interreligieux, qui a joué un rôle important à la fin de l’année 1983 dans un mouvement pacifique appelé la Marche des Beurs. Cette marche pour l’égalité et contre le racisme a été une magnifique réponse à la montée de l’extrême droite et de ce qu’on appelait alors le FN ou Front National.
Mais les époques sont bien distinctes : contrairement à ce qui s’est passé par la suite, c’est-à-dire à l’époque actuelle, les tensions sociales ne mettent pas en avant la question religieuse et l’islamisme assimilé au terrorisme n’est pas encore l’objet de toutes les  hantises. Les témoignages qu’on entend de ceux qui ont appartenu à la première génération, alors même que c’était déjà la guerre d’Algérie, sont étonnamment unanimes sur ce point : à cette époque, les travailleurs migrants et leurs familles n’étaient pas encore victimes d’agressions et d’injures racistes, il y avait plus généralement semble-t-il une sorte de compassion pour les conditions de vie de ces travailleurs si cruellement défavorisés. Et c’est précisément de ce sujet que traite le documentaire « du bled au bidonville », remarquable en ce qu’on n’y sent jamais ni haine ni récrimination. A certains égards il est même un hommage multiple au travail accompli grâce aux idées républicaines, telles qu’elles sont mises en œuvre par l’école et quelques autres institutions, et telles qu’elles sont accueillies dans les familles d’immigrés, justement persuadées qu’elles sont le meilleur atout pour la fabrique d’une meilleure société. « Meilleure société » veut dire ici plus égalitaire, tous les efforts auxquels on assiste dans le film prouvent que c’est possible sinon facile d’y accéder.
hantises. Les témoignages qu’on entend de ceux qui ont appartenu à la première génération, alors même que c’était déjà la guerre d’Algérie, sont étonnamment unanimes sur ce point : à cette époque, les travailleurs migrants et leurs familles n’étaient pas encore victimes d’agressions et d’injures racistes, il y avait plus généralement semble-t-il une sorte de compassion pour les conditions de vie de ces travailleurs si cruellement défavorisés. Et c’est précisément de ce sujet que traite le documentaire « du bled au bidonville », remarquable en ce qu’on n’y sent jamais ni haine ni récrimination. A certains égards il est même un hommage multiple au travail accompli grâce aux idées républicaines, telles qu’elles sont mises en œuvre par l’école et quelques autres institutions, et telles qu’elles sont accueillies dans les familles d’immigrés, justement persuadées qu’elles sont le meilleur atout pour la fabrique d’une meilleure société. « Meilleure société » veut dire ici plus égalitaire, tous les efforts auxquels on assiste dans le film prouvent que c’est possible sinon facile d’y accéder.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.
Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.
Nous souhaitons aussi contribuer à la diffusion du livre posthume de notre cher Abdelhamid LAGHOUATI, poète, artiste plasticien, ami de Jean Sénac et de tant d’autres. Une souscription est ouverte pour commander son livre par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes à Saint Martin d’Hères.
SOUSCRIPTION
BON DE COMMANDE
Je commande .. .. .. .. exemplaire(s) de « Entre cri et passion » de Abdelhamid Laghouati.
Je règle par : ☐ chèque bancaire
☐ autre moyen (sauf carte bancaire)
☐ postal
À l’ordre de :
Maison de la Poésie Rhône-Alpes
33 avenue Ambroise Croizat
38400 Saint-Martin-d’Hères
Date : .. .. / .. .. / .. .. Signature :

- Du 25 avril au 20 mai, accueil de deux permacultices algériennes pour des stages et des visites dans le Gard, Lyon, Paris, Bastia… dans le cadre d’un programme de coopération avec l’association algérienne TORBA.
- Mardi 2 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Boissy d’Anglas d’Annonay
- Jeudi 4 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Condorcet de Saint-Priest
- Jeudi 4 mai Vernissage de l’exposition « Indicible » de Farid Chaachoua à Lyon. Exposition du 4 au 17 mai
- Mercredi 10 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lyécée Anna de Noailles d’Evian
- Jeudi 11 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au collège François Munier
- Du Lundi 15 mai au mercredi 17 mai Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie aux collèges Michelet et Elsa Triolet de Vénissieux
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.

