Lettre culturelle franco-maghrébine # 36
ÉDITO
Nous avons dû renoncer à diffuser notre Lettre en septembre, le temps de résoudre un problème technique qui empêchait d’accéder aux images.
Les choses semblent de nouveau en ordre, et nous vous donnons ce nouveau rendez-vous avec la richesse des publications et des productions artistiques relatives au Maghreb et/ou réalisées par des artistes du Maghreb.
Ce mois-ci nous proposons un bain d’histoire -mais l’histoire n’est jamais loin dans les œuvres du Maghreb…- avec le premier volume du livre de Jacques Frémeaux, des retrouvailles avec le dernier Guemriche, le plaisir du nouveau récit de Kaouther Adimi, la belle histoire de femmes de la « complainte du point noué », et la non moins belle observation de la vie algérienne d’Alice Schwarzer.
Nous vous inviterons aussi à découvrir lors de sa sortie prochaine le beau film Papicha.
Bonne lecture, en espérant vous donner l’envie de vous plonger dans ces oeuvres.
Denise Brahimi et Michel Wilson

« LES PETITS DE DECEMBRE » de Kaouther Adimi (Seuil 2019)
On n’a pas oublié le livre précédent de Kaouther Adimi, Nos Richesses (2017) qui avait eu beaucoup de succès. Ce dernier date d’un mois à peine, et le titre n’est pas suffisamment évocateur pour qu’on puisse juger de son sujet. Pourtant le mot « petits » indique que les personnages principaux en sont des enfants, d’une dizaine d’années. Il se peut que l’auteure n’ait pas voulu employer ce mot, « enfants », pour éviter toute confusion avec les Enfants de minuit (1981), qui a précédé les célèbres Versets sataniques (1988) dans l’œuvre de Salman Rushdie.
Les « petits » dont parle Kaouther Adimi sont présentés de manière attendrissante, mais non mièvre. Ils sont trois principalement dont deux garçons, Jamyl et Mahdi, et une fille Inès, bientôt rejoints par d’autres jusqu’à ce qu’il y en ait une quarantaine, véritable petite troupe de « gentils » qui vont s’organiser pour résister aux « méchants » de cette histoire, principalement deux généraux de l’armée algérienne, connus et puissants, ce qui est évidemment l’histoire du pot de terre contre le pot de fer, ou de David contre Goliath ; à quoi on a compris qu’il s’agit d’une fable, d’un conte ou si l’on veut d’une parabole—en tout cas c’est là un des aspects du livre, mais pas le seul.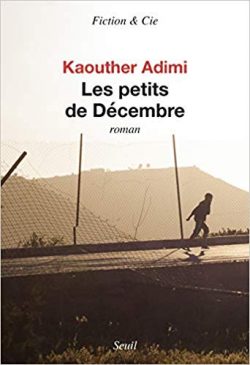 En effet, le tour de force de Kaouther Adimi vient de ce que dans un livre très simple et clairement écrit, elle arrive à concilier des qualités très différentes, appartenant à plusieurs genres littéraires. S’il est bien vrai que comme dans un conte pour enfants, ces derniers sont les victimes innocentes de deux maîtres du monde puissants et brutaux qui usurpent leur seul bien—le bout de terrain où ils ont l’habitude de jouer au ballon— les lecteurs ont droit à toutes les précisions, sociologiques, géographiques et chronologiques, qu’on trouve habituellement dans les romans réalistes, alors que les contes s’en tiennent à des généralités.
En effet, le tour de force de Kaouther Adimi vient de ce que dans un livre très simple et clairement écrit, elle arrive à concilier des qualités très différentes, appartenant à plusieurs genres littéraires. S’il est bien vrai que comme dans un conte pour enfants, ces derniers sont les victimes innocentes de deux maîtres du monde puissants et brutaux qui usurpent leur seul bien—le bout de terrain où ils ont l’habitude de jouer au ballon— les lecteurs ont droit à toutes les précisions, sociologiques, géographiques et chronologiques, qu’on trouve habituellement dans les romans réalistes, alors que les contes s’en tiennent à des généralités.
L’histoire se passe à Dély-Brahim, petite commune proche d’Alger, dans une cité dite du 11 décembre 1960, d’où le mot « décembre » qui se trouve dans le titre du livre : c’est une allusion historique à la résistance populaire qui s’est manifestée à cette date pour l’indépendance de l’Algérie. Ainsi travaille l’auteure, à la fois dans des détails très concrets et dans un réseau de significations symboliques très fortes. Les événements qui nous sont racontés sont datés de 2016, plus précisément de février 2016, ce qui veut dire qu’ils précèdent ceux qui ont démarré en février 2019, mais que bien évidemment ils ont un rapport avec eux. On pourrait parler de faits apparemment minimes ou anecdotiques, mais ils sont pourtant précurseurs de ceux qui allaient exploser à un tout autre niveau trois ans après (avec le même aspect « jeunes contre vieux » dans les deux cas).
Pour ce qui est des personnages, Kaouther Adimi retrace avec beaucoup de soin l’histoire qui a fait d’eux ce qu’ils sont, et qui est en même temps une histoire de l’Algérie contemporaine depuis l’indépendance, l’accent étant principalement mis sur la période des années noires, en tout cas sur toutes les formes de complicité et de corruption qui expliquent l’ascension fulgurante des deux généraux et le pouvoir fabuleux dont ils disposent à tous égards dans le pays. Il faut que le lecteur en soit bien conscient pour mesurer ce qu’il y a de prodigieux dans la résistance que leur opposent les enfants, même si elle ne peut aller au-delà d’une courte durée. La force des « petits » est qu’ils sont inattaquables, en tout cas pas ouvertement, c’est pourquoi les généraux ne peuvent en venir à bout que par la ruse, en provoquant un incendie criminel sur le terrain occupé par leurs minuscules ennemis. La scène se passant de nuit, c’est un miracle qu’elle ne fasse pas de petite victime, mais ce n’est évidemment pas un risque qui puisse inquiéter les généraux !
Si donc on veut résumer les principaux méfaits qui caractérisent ceux-ci, on y trouve en premier lieu l’usurpation sans vergogne à des fins personnelles d’un territoire collectif —comme aux plus beaux jours de la conquête coloniale (Maupassant dans les années 1880 à très clairement expliqué cela) : sous couvert d’un achat quasi fictif, on transforme un bien ou un lieu en territoire personnel, non sans brandir les papiers officiels qui sont supposés garantir la propriété ainsi acquise : rien de plus facile, évidemment. Contre l’obstacle humain que représente un adversaire éventuellement récalcitrant, il existe des formes de violence plus ou moins dissimulées, choisies cyniquement de manière à être inattaquables et dont les victimes deviennent les présumés coupables—il en va ainsi de l’incendie, facilement imputable aux enfants. Kaouther Adimi ne hausse jamais le ton et c’est un autre de ses traits remarquables que son aptitude à évoquer les violences clairement et sans réserve, mais sans pour autant prendre la posture de l’imprécateure qui éructe des dénonciations. Sur ce point, elle est comparable aux enfants qui sont les héros de son conte : résistance et révolte mais sans agression car celle-ci étant l’arme de l’adversaire, il importe de s’en distinguer. On a dans le livre un bon exemple de sa manière, plus subtile que l’affirmation d’un militantisme explicite : c’est la place qu’elle fait à Inès, une fille, reconnue et soutenue par ses deux « petits » compagnons. Elle a le mérite de nous faire comprendre que ce qui est gentil n’est pas forcément anodin. A la violence des faits qu’elle décrit elle préfère opposer une sorte de douceur et ce mélange pourrait bien être la marque de son écriture. Ce qui lui confère une place à part dans le roman algérien ou franco-algérien d’aujourd’hui. Il est clair que l’évocation de faits brutaux ne saurait en être exclue. Mais la réponse ne consiste pas forcément en une surenchère, ni dans les mots ni dans l’action.
Kaouther Adimi ne hausse jamais le ton et c’est un autre de ses traits remarquables que son aptitude à évoquer les violences clairement et sans réserve, mais sans pour autant prendre la posture de l’imprécateure qui éructe des dénonciations. Sur ce point, elle est comparable aux enfants qui sont les héros de son conte : résistance et révolte mais sans agression car celle-ci étant l’arme de l’adversaire, il importe de s’en distinguer. On a dans le livre un bon exemple de sa manière, plus subtile que l’affirmation d’un militantisme explicite : c’est la place qu’elle fait à Inès, une fille, reconnue et soutenue par ses deux « petits » compagnons. Elle a le mérite de nous faire comprendre que ce qui est gentil n’est pas forcément anodin. A la violence des faits qu’elle décrit elle préfère opposer une sorte de douceur et ce mélange pourrait bien être la marque de son écriture. Ce qui lui confère une place à part dans le roman algérien ou franco-algérien d’aujourd’hui. Il est clair que l’évocation de faits brutaux ne saurait en être exclue. Mais la réponse ne consiste pas forcément en une surenchère, ni dans les mots ni dans l’action.
Denise Brahimi
« CHRONIQUES D’UNE IMMIGRATION CHOISIE » de Salah Guemriche (Editions de l’Aube, 2019)
Etant donné le grand nombre de livres déjà publiés par ce journaliste, essayiste, intellectuel et penseur, on peut supposer qu’il a réussi à faire passer auprès des lecteurs quelques-unes des idées auxquelles il tient. Ce dernier volume a l’avantage de revenir au moins partiellement sur plusieurs de ses ouvrages précédents et de faire le point sur l’essentiel qui a émergé de son œuvre en quelques décennies.
D’origine algérienne Salah Guemriche a choisi l’immigration en France depuis 1976, et présente dans ce recueil des articles qui remontent à 1982, les derniers englobant une réflexion sur la très récente et inachevée révolution algérienne de 2019. On le suit à travers 45 textes qui sont des analyses très minutieuses et très informées de sujets récurrents mais toujours renouvelés, le travail journalistique s’attachant chaque fois à leur forme la plus actuelle. La lecture de ce recueil est facilitée par le regroupement des articles en une demi-douzaine de chapitres, tous dus à la position particulière « choisie » par l’auteur entre la France et l’Algérie après l’indépendance de cette dernière, au temps du terrorisme islamique et de l’islamophobie qui s’en est trouvée accrue. En fait, dans son premier chapitre en tout cas, Salah Guemriche remonte bien plus avant dans le temps historique pour y rencontrer Charles Martel, une légende dangereuse parce que surexploitée politiquement. Son intention est très explicite et apparaît dans un titre tel que : « Comment le mythe de la bataille de Poitiers s’est installé ». Cependant il apparaît qu’en dépit d’opinions bien affirmées, l’auteur n’écrit pas en tant que polémiste, et ne perd pas de temps à enfoncer des portes ouvertes, tant il est vrai qu’il y a beaucoup à faire à examiner un certain nombre « d’obsessions », c’est son mot, qui pour être le fait d’obsédés n’en méritent pas moins le débat. Il y a chez Salah Guemriche une honnêteté remarquable dans sa manière jamais méprisante ni injurieuse ni réductrice de traiter ses adversaires ; ce qui, eu égard aux sujets qu’il aborde et à la force de ses convictions, peut paraître exceptionnel.
En fait, dans son premier chapitre en tout cas, Salah Guemriche remonte bien plus avant dans le temps historique pour y rencontrer Charles Martel, une légende dangereuse parce que surexploitée politiquement. Son intention est très explicite et apparaît dans un titre tel que : « Comment le mythe de la bataille de Poitiers s’est installé ». Cependant il apparaît qu’en dépit d’opinions bien affirmées, l’auteur n’écrit pas en tant que polémiste, et ne perd pas de temps à enfoncer des portes ouvertes, tant il est vrai qu’il y a beaucoup à faire à examiner un certain nombre « d’obsessions », c’est son mot, qui pour être le fait d’obsédés n’en méritent pas moins le débat. Il y a chez Salah Guemriche une honnêteté remarquable dans sa manière jamais méprisante ni injurieuse ni réductrice de traiter ses adversaires ; ce qui, eu égard aux sujets qu’il aborde et à la force de ses convictions, peut paraître exceptionnel.
Il se montre tout aussi soucieux de ménager le pour et le contre dans son analyse des relations récentes entre la France et l’Algérie, ne reculant jamais devant des sujets qui peuvent paraître extrêmement délicats, qu’il s’agisse des harkis, du particularisme kabyle en France ou des « bienfaits de la colonisation. » Lorsque les articles expriment des prises de position sur des sujets précis et concrets, qui appellent de sa part une réaction immédiate à des faits d’actualité, on admire tout autant les nuances qu’il n’en apporte pas moins à son argumentation. Il en va de même pour les problèmes particulièrement épineux mettant en cause Israël, la Palestine et toute la gamme des réactions suscitées en France par ces deux pays : on le découvre opposé au boycott des écrivains israéliens au Salon du Livre de 2008 mais tout autant aux attitudes et déclarations de son collègue Boualem Sansal, auquel il parvient à s’adresser fraternellement (pour une semonce fraternelle pourrait-on dire, mais sans ménagement) alors qu’ils sont très loin d’avoir les mêmes positions. C’est d’ailleurs ce que souligne dans ce même contexte le célèbre Jean Daniel, vantant la qualité d’un adversaire comme Salah Guemriche, de ceux qui sont rares et qu’on respecte d’autant plus : « En tout cas, si opposé que je sois aux thèses de Salah Guemriche, il devient pour moi un interlocuteur. Il me rappelle tous les intellectuels de gauche pendant la guerre d’Algérie, qui en France, contre l’histoire et contre la raison, estimaient qu’il n’y avait qu’une seule forme d’occupation (Le Nouvel Observateur, 18 juin 2012). Comme il fait allusion, entre autres, à Jean-Paul Sartre, on mesure la valeur du compliment !
Etant très passionné par le vocabulaire, l’origine des mots et le sens induit par leur étymologie, Salah Guemriche a beaucoup réfléchi à deux termes qui tiennent une grande place dans les idéologies contemporaines, antisémitisme et islamophobie. Le premier est extraordinairement piégé, il est souvent utilisé de nos jours comme moyen de chantage et les choses en sont arrivées à un point tel qu’il vaudrait sans doute mieux s’en tenir à un mot symétrique d’islamophobie, qui serait judéophobie. Pour avoir beaucoup travaillé sur la part de racisme qui de toute évidence vient se nicher dans le guêpier des mots, ne faut-il pas faire preuve de la plus grande circonspection. ? C’est à quoi nous incitent ces « Chroniques » qui certes, comme leur nom l’indique, essaient de s’y retrouver au jour le jour entre ambivalences et occultations. Elles ne restent jamais anecdotiques sous la plume de cet auteur, qui saisit des occasions précises, mais les rattache aux débats généraux qui lui tiennent à cœur. On est frappé par le fait que l’écriture de Salah Guemriche exprime, aussi posément que fermement, le résultat d’une réflexion. Rien à voir donc avec des propos médiatiques, tenus comme il dit, « à grand bruit ». Ce vacarme pourrait bien être le signe de l’idéologie au sens péjoratif du mot. Une des grandes forces de Salah Guemriche est de ne pas se laisser intimider par les braillements, et les coups de force qu’ils couvrent plus ou moins. Son arme principale est l‘extrême attention qu’il porte à la lecture des textes, nombreux sont ceux qu’il convoque, sans jamais donner le sentiment qu’il procède par étalage d’érudition. Il est un excellent représentant de la promotion des sciences du langage qui s’est produite pendant les dernières décennies du 20e siècle. Les mots comptent avant tout et on ne saurait jamais trop leur demander d’être des « signifiants ». Parmi eux le mot-clef lui semble incontestablement celui de laïcité, qui se suffit à lui-même et qui dit tout. Il voudrait en faire le 3e mot inscrit dans la devise de la République à la place de « fraternité » qui ne lui plaît guère. Trop souvent démenti et donc employé hypocritement ? Galvaudé par les dévots qui veulent évoquer à travers lui la communauté des Musulmans ? Salah Guemriche ne mange pas de ce pain-là, c’est pourquoi, quand il emploie un mot tel que celui-là, il lui rend sciemment toute sa force, et l’arrache à son sens routinier. Il en est ainsi dans son dernier article, qui évoque « le peuple du 22 février : « des marches interminables et des chants de ferveur et de fraternité », sans céder ni à l’angélisme ni à la glorification». Après cela vient un dernier appel à la prudence : « A ce stade, en effet, il faut raison et vigilance garder ».
Pour avoir beaucoup travaillé sur la part de racisme qui de toute évidence vient se nicher dans le guêpier des mots, ne faut-il pas faire preuve de la plus grande circonspection. ? C’est à quoi nous incitent ces « Chroniques » qui certes, comme leur nom l’indique, essaient de s’y retrouver au jour le jour entre ambivalences et occultations. Elles ne restent jamais anecdotiques sous la plume de cet auteur, qui saisit des occasions précises, mais les rattache aux débats généraux qui lui tiennent à cœur. On est frappé par le fait que l’écriture de Salah Guemriche exprime, aussi posément que fermement, le résultat d’une réflexion. Rien à voir donc avec des propos médiatiques, tenus comme il dit, « à grand bruit ». Ce vacarme pourrait bien être le signe de l’idéologie au sens péjoratif du mot. Une des grandes forces de Salah Guemriche est de ne pas se laisser intimider par les braillements, et les coups de force qu’ils couvrent plus ou moins. Son arme principale est l‘extrême attention qu’il porte à la lecture des textes, nombreux sont ceux qu’il convoque, sans jamais donner le sentiment qu’il procède par étalage d’érudition. Il est un excellent représentant de la promotion des sciences du langage qui s’est produite pendant les dernières décennies du 20e siècle. Les mots comptent avant tout et on ne saurait jamais trop leur demander d’être des « signifiants ». Parmi eux le mot-clef lui semble incontestablement celui de laïcité, qui se suffit à lui-même et qui dit tout. Il voudrait en faire le 3e mot inscrit dans la devise de la République à la place de « fraternité » qui ne lui plaît guère. Trop souvent démenti et donc employé hypocritement ? Galvaudé par les dévots qui veulent évoquer à travers lui la communauté des Musulmans ? Salah Guemriche ne mange pas de ce pain-là, c’est pourquoi, quand il emploie un mot tel que celui-là, il lui rend sciemment toute sa force, et l’arrache à son sens routinier. Il en est ainsi dans son dernier article, qui évoque « le peuple du 22 février : « des marches interminables et des chants de ferveur et de fraternité », sans céder ni à l’angélisme ni à la glorification». Après cela vient un dernier appel à la prudence : « A ce stade, en effet, il faut raison et vigilance garder ».
Denise Brahimi
Ma famille algérienne par Alice Schwarzer, trad. de l’allemand (2018), éditions de l’Observatoire 2019
« MA FAMILLE ALGERIENNE » de Alice Schwarzer, trad. de l’allemand (2018), (éditions de l’Observatoire 2019)
Alice Schwarzer est une journaliste connue de longue date en Allemagne, notamment pour son soutien à la cause féministe. On l’a parfois surnommée la Simone de Beauvoir allemande car elle se considère elle-même comme une disciple de la philosophe française auteure du Deuxième sexe. Ce livre est le résultat d’une enquête très fournie qu’Alice Schwarzer a menée dans son pays d’adoption l’Algérie. On n’y rencontre pas seulement des femmes mais aussi beaucoup d’hommes et la parité semble à peu près respectée dans l’importance des entretiens accordés à la journaliste. Plusieurs des chapitres qui constituent le livre portent en titre deux prénoms, l’un masculin l’autre féminin : « Chez Lilia et Karim », « Chez Amar et Naziha ». La journaliste a voulu entendre les voix des unes et des autres, et il est très rare qu’elle fasse état d’une réticence.  Naturellement certains des couples qu’elle évoque, pour les avoir vus vivre de près, connaissent des problèmes et des dysfonctionnements. On n’en est pas moins frappé par la rupture entre leur mode de vie au quotidien et ce qui a déjà été dit tant de fois, notamment dans les récits littéraires, sur les vestiges encore bien présents au Maghreb du patriarcat traditionnel. Dans plusieurs des couples dont nous parle Alice Schwarzer, les hommes participent régulièrement aux travaux du ménage et s’occupent beaucoup des enfants, certaines des femmes interrogées sur ce point reconnaissent volontiers les faits, quitte à ajouter non sans malice : « compte tenu de ce que sont les hommes en Algérie », car elles savent qu’elles s’adressent à une féministe européenne, ici allemande.
Naturellement certains des couples qu’elle évoque, pour les avoir vus vivre de près, connaissent des problèmes et des dysfonctionnements. On n’en est pas moins frappé par la rupture entre leur mode de vie au quotidien et ce qui a déjà été dit tant de fois, notamment dans les récits littéraires, sur les vestiges encore bien présents au Maghreb du patriarcat traditionnel. Dans plusieurs des couples dont nous parle Alice Schwarzer, les hommes participent régulièrement aux travaux du ménage et s’occupent beaucoup des enfants, certaines des femmes interrogées sur ce point reconnaissent volontiers les faits, quitte à ajouter non sans malice : « compte tenu de ce que sont les hommes en Algérie », car elles savent qu’elles s’adressent à une féministe européenne, ici allemande.
La journaliste en dit assez sur le niveau de vie des gens de sa « famille algérienne » (au total cela fait plus d’une vingtaine de personnes d’âges variés dont elle parle avec précision) pour que nous puissions à peu près les situer socialement et sociologiquement. Ce ne sont pas des gens pauvres, il n’est pas question de gêne financière et ils se nourrissent certainement mieux que les gens qu’on pourrait dire de même niveau en Allemagne ou en France, sans parler de l’habillement sur lequel ils et elles ne lésinent pas non plus : les femmes sont coquettes et les bijoux jouent un rôle important On peut en juger par la présence dans le livre d’un cahier de photos prises par une autre Allemande, Bettina, qui accompagne Alice Schwarzer. Qu’il s’agisse de commerçants, de professions libérales, de fonctionnaires, ou même de femmes au foyer dans les familles où il y a de nombreux enfants, on pourrait dire que tous sont représentants d’une classe moyenne dont l’importance numérique, dans l’Algérie contemporaine, n’est certainement pas un fait anodin. En dehors des traits spécifiques, qui caractérisent chaque culture et son héritage culturel, cette classe moyenne ressemble beaucoup à celles qu’on peut trouver en Europe et en Amérique, et sans doute aussi sur d’autres continents. Ce ne sont pas des parvenus et on n’y voit pas de gens qui se seraient enrichis ostensiblement par des trafics illicites —la déplorable corruption. Tous et toutes accordent beaucoup de soin à préparer l’avenir de leurs enfants, et sont convaincus du rôle déterminant joué par l’éducation à laquelle ils veillent soigneusement, les études supérieures étant considérées comme un must pour garçons et filles.
S’agissant de la religion, la journaliste semble n’avoir rencontré que des gens qui étaient (ou plutôt qui sont, car c’est d’un état des lieux tout à fait actuel qu’il s’agit) si l’on peut dire normalement musulmans, attachés à la pratique religieuse mais sans prosélytisme ni ostentation. Personne ne se déclare non croyant, même ceux et celles qui se permettent quelques manquements occasionnels et ne mettent pas que du thé dans les théières. L’avis unanime est que les années noires ont été une horreur et que personne n’en veut plus. Ma famille algérienne confirme ce qu’on sait plus ou moins, non seulement l’amputation considérable subie par l’Algérie du fait des massacres et des morts, mais aussi en raison des très nombreux départs de ceux qui ont fui, notamment au Québec pays tranquille, accueillant et de plus francophone. Une des questions qu’on se pose dans la « famille » concerne les retours éventuels de ceux qui sont partis, ce qui va de pair avec le désir de se stabiliser , si toutefois l’état du pays permet qu’on y vive enfin paisiblement. Les propos recueillis par l’auteure du livre donnent le sentiment qu’on a affaire à une population raisonnable et dont on comprend les motivations. Ce qui est d’autant plus remarquable qu’elle n’évite pas les sujets qui pourraient fâcher ou du moins mettre mal à l’aise—par exemple la pénible affaire des agressions sexuelles en masse commises par des Maghrébins à Cologne pendant la nuit du Nouvel An 2016. A aucun moment on ne sent dans ce livre une sorte d’obsession raciste ou raciale, dont on sait pourtant qu’en Allemagne aussi elle caractérise les partis d’extrême-droite. Comme c’est le cas en France, où tout ce qui touche à cette question est aggravé par les souvenirs d’un passé encore proche et qui a du mal à passer, celui de l’époque coloniale et de la Guerre d’Algérie.
Les propos recueillis par l’auteure du livre donnent le sentiment qu’on a affaire à une population raisonnable et dont on comprend les motivations. Ce qui est d’autant plus remarquable qu’elle n’évite pas les sujets qui pourraient fâcher ou du moins mettre mal à l’aise—par exemple la pénible affaire des agressions sexuelles en masse commises par des Maghrébins à Cologne pendant la nuit du Nouvel An 2016. A aucun moment on ne sent dans ce livre une sorte d’obsession raciste ou raciale, dont on sait pourtant qu’en Allemagne aussi elle caractérise les partis d’extrême-droite. Comme c’est le cas en France, où tout ce qui touche à cette question est aggravé par les souvenirs d’un passé encore proche et qui a du mal à passer, celui de l’époque coloniale et de la Guerre d’Algérie.
C’est en cela que le livre d’Alice Schwarzer permet au lecteur français d’intéressantes comparaisons. Les peuples ne vivent pas que d’opinions exprimées, l’existence des inconscients collectifs est indéniable, l’Allemagne se débat avec le sien qui pour des raisons historiques n’est pas le même que celui de la France. Dans les relations d’Alice Schwarzer avec sa « famille algérienne », on ressent une sérénité et une empathie joyeuse qui font le charme de cette enquête. C’est probablement moins facile quand interfère l’existence d’une culpabilité plus ou moins consciente dont la source est dans une histoire qui aura bientôt deux siècles.
Denise Brahimi
« COMPLAINTES DU POINT NOUE, LA MANUFACTURE DE LODEVE » par Roseline Villaumé, (éditions Domens Pézenas et Livres EMCC, 2019)
Bien que ce livre soit désigné comme roman par son auteure, il ne l’est que très partiellement et s’appuie sur une documentation recueillie sur place à Lodève lorsque Roseline Villaumé y habitait en 2012. On sait que Lodève, dans le département de l’Hérault, possède une annexe de la Manufacture nationale de la Savonnerie et qu’on y fabrique des tapis de haut niveau. Les ouvriers (faut-il dire artisans ? ou artistes ?) qui travaillent à cette fabrication, sont appelés liciers, ou licières s’il s’agit de femmes et c’est justement le cas dans l’histoire racontée par Roseline Villaumé, dont la fiction donne vie à trois d’entre elles. Elles s’appellent Alice, Leïla et Fadhila, ce qui indique pour les deux dernières une origine algérienne. Et c’est en effet l’originalité de cette histoire que de trouver son origine à la fin de la guerre d’Algérie lorsqu’on a cherché à implanter en France, en leur donnant du travail, les harkis ramenés par l’armée française, avec femmes et enfants.
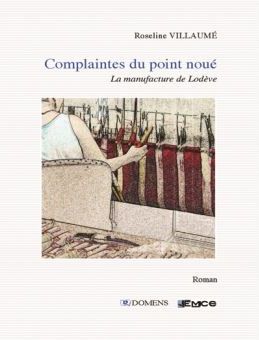 Pour les femmes, c’était une bonne idée que d’utiliser leur connaissance du tissage en créant un atelier où elles pourraient tirer parti de cette pratique traditionnelle, non sans la reconvertir évidemment. Roseline Villaumé a dû apprendre elle aussi quelques notions techniques et le vocabulaire nécessaire pour parler de ce métier. Elle le fait avec précision et de manière intéressante mais ce n’est pas l’essentiel ou pas seulement de ce qu’elle a voulu mettre en valeur dans son roman puisque roman il y a. Habituée à fréquenter les textes littéraires, elle s’intéresse à ce qu’on pourrait appeler du terme le plus banal qui soit « la vie des gens »et ici en particulier à la relation de ces femmes entre elles, chacune ayant comme on s’en doute une histoire particulière, pour les Algériennes lourdement chargée d’événements traumatisants.
Pour les femmes, c’était une bonne idée que d’utiliser leur connaissance du tissage en créant un atelier où elles pourraient tirer parti de cette pratique traditionnelle, non sans la reconvertir évidemment. Roseline Villaumé a dû apprendre elle aussi quelques notions techniques et le vocabulaire nécessaire pour parler de ce métier. Elle le fait avec précision et de manière intéressante mais ce n’est pas l’essentiel ou pas seulement de ce qu’elle a voulu mettre en valeur dans son roman puisque roman il y a. Habituée à fréquenter les textes littéraires, elle s’intéresse à ce qu’on pourrait appeler du terme le plus banal qui soit « la vie des gens »et ici en particulier à la relation de ces femmes entre elles, chacune ayant comme on s’en doute une histoire particulière, pour les Algériennes lourdement chargée d’événements traumatisants.
Le cas d’Alice est le moins problématique, même s’il n’était pas facile à cette jeune femme française formée à Paris de trouver sa place parmi des Algériennes dont la sympathie ne lui était certes pas acquise d’emblée. Timide, elle sort d’une rupture sentimentale qui l’a incitée à s’éloigner, et elle souffre de se sentir si peu apte à communiquer. Pour Fadhila il y a un obstacle supplémentaire dû au fait que cette vieille femme (mais pas si vieille peut-être) ne parle à peu près pas le français. Mais ce n’est clairement pas le seul nœud contre lequel il lui faut se battre, le mot « nœuds » étant porteur de la métaphore qui est au cœur de tout le livre : au sens premier, ce sont les nœuds du tapis de laine qui est tissé selon la technique dite du « point noué », au sens second il s’agit des nœuds qui étranglent et génèrent une angoisse difficilement surmontable à chaque instant et dans toutes les circonstances de la vie au quotidien.  Leïla est une forte femme, qui finalement s’impose par sa compétence et parvient à la direction de l’atelier. Mais à quel prix ! Sans doute toutes les femmes qui travaillent et élèvent en même temps leurs enfants connaissent-elles ce genre de fatigue et la lutte à mener contre l’épuisement. Mais Leïla vit dans un milieu encore traditionnel où les femmes ne trouvent pas d’aide pour mener leur double tâche. Elle était encore une fillette lorsque sa famille a débarqué à Lodève, après le passage par un camp de transit, en novembre 1964. Elle a vu le courage et la patience qu’il a fallu à sa mère pour s’initier à un genre de tapis si différent de ceux qu’elle fabriquait en Algérie. A l’âge de 16 ans Leïla est entrée pleinement dans la vie de l’atelier, et n’en a jamais connu d’autre. Promue chef d’atelier, elle vit dans une sorte de crispation continuelle, qui lui interdit tout relâchement, tout moment de tranquillité. Elle fait partie de ce qu’on peut considérer comme une deuxième génération, celle dont la vie a commencé à peu près avec l’installation en France et dont le travail, au sens professionnel du mot, a toujours été le seul horizon. Devenue une femme dure, elle n’est certes pas dans la plainte ou la « complainte » dont parle le titre du livre, et ne peut surtout pas ni ne veut s’y adonner. C’est à propos d’autres femmes dont elle évoque le passé algérien et la rupture déchirante avec leur ancien monde que l’auteure du livre est tentée d’employer ce mot. S’agissant de Leïla, elle nous donne à comprendre ce qu’il y a en elle de tension, douloureuse sans doute, comme s’il n’y avait pas de place dans sa vie pour la tendresse et le laisser aller. Peut-on parler à son propos d’intégration réussie ou de réussite sociale ? Selon les apparences, certains répondraient oui sans hésiter mais le livre de Roseline Villaumé nous incite pour le moins à éviter ce genre de langage. Mieux vaut le laisser aux Officiels parisiens venus récupérer le magnifique tapis désormais achevé pour que s’ouvrent à lui les fastes de l’Elysée.
Leïla est une forte femme, qui finalement s’impose par sa compétence et parvient à la direction de l’atelier. Mais à quel prix ! Sans doute toutes les femmes qui travaillent et élèvent en même temps leurs enfants connaissent-elles ce genre de fatigue et la lutte à mener contre l’épuisement. Mais Leïla vit dans un milieu encore traditionnel où les femmes ne trouvent pas d’aide pour mener leur double tâche. Elle était encore une fillette lorsque sa famille a débarqué à Lodève, après le passage par un camp de transit, en novembre 1964. Elle a vu le courage et la patience qu’il a fallu à sa mère pour s’initier à un genre de tapis si différent de ceux qu’elle fabriquait en Algérie. A l’âge de 16 ans Leïla est entrée pleinement dans la vie de l’atelier, et n’en a jamais connu d’autre. Promue chef d’atelier, elle vit dans une sorte de crispation continuelle, qui lui interdit tout relâchement, tout moment de tranquillité. Elle fait partie de ce qu’on peut considérer comme une deuxième génération, celle dont la vie a commencé à peu près avec l’installation en France et dont le travail, au sens professionnel du mot, a toujours été le seul horizon. Devenue une femme dure, elle n’est certes pas dans la plainte ou la « complainte » dont parle le titre du livre, et ne peut surtout pas ni ne veut s’y adonner. C’est à propos d’autres femmes dont elle évoque le passé algérien et la rupture déchirante avec leur ancien monde que l’auteure du livre est tentée d’employer ce mot. S’agissant de Leïla, elle nous donne à comprendre ce qu’il y a en elle de tension, douloureuse sans doute, comme s’il n’y avait pas de place dans sa vie pour la tendresse et le laisser aller. Peut-on parler à son propos d’intégration réussie ou de réussite sociale ? Selon les apparences, certains répondraient oui sans hésiter mais le livre de Roseline Villaumé nous incite pour le moins à éviter ce genre de langage. Mieux vaut le laisser aux Officiels parisiens venus récupérer le magnifique tapis désormais achevé pour que s’ouvrent à lui les fastes de l’Elysée.
Denise BrahimiAlgérie
« 1830-1914, NAISSANCE ET DESTIN D’UNE COLONIE » par Jacques Frémeaux, Desclée de Brewer, 2019
C’est une chance de trouver un tel bilan dans un livre qui reste de dimensions modestes et d’une parfaite lisibilité. Nous bénéficions dans ce livre de la parfaite maîtrise d’un historien conforme à l’idée qu’on peut continuer à se faire de cette profession, documentation précise sans être envahissante, objectivité et recherche d’un équilibre entre des points de vue trop souvent polémiques et irrecevables à force d’être poussés jusqu’à l’extrême. L’un des plaisirs qu’on a à lire ce livre est le sentiment qu’il est fiable, ne cherchant pas à influencer le lecteur mais à l’informer. Les qualités dont il fait preuve seront sans doute plus appréciables encore dans le second volume qui prendra la suite de celui-ci pour conduire l’histoire de la relation entre la France et l’Algérie jusqu’à son dénouement.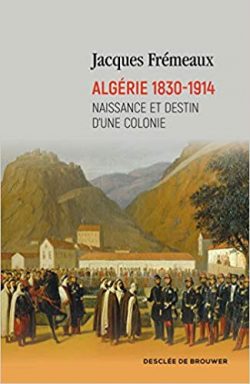 Dans le volume que nous avons actuellement sous les yeux, la recherche historique porte essentiellement sur les aspects militaires d’une conquête qui a été longue et difficile et sur l’organisation, au fur et à mesure, de ce qui doit permettre et encadrer le fonctionnement du régime colonial (politique, administratif, économique). L’auteur s’appuie à la fois sur ses propres travaux, notamment ceux qui concernent la lutte menée par l’armée française contre Abd el-Kader et, chapitre sans doute moins connu de nos jours, ce que furent les « bureaux arabes dont le rôle, limité dans le temps, n’en a pas moins été un aspect original et intéressant de la conquête. Mais il utilise aussi les très grands livres consacrés par des historiens éminents à la colonisation française en Algérie, ceux de Charles-André Julien, Charles-Robert Ageron et Xavier Yacono. L’existence de ces travaux lui permet d’être synthétique et de prendre un recul suffisant pour proposer, de manière prudente et modérée, néanmoins ferme, quelques appréciations.
Dans le volume que nous avons actuellement sous les yeux, la recherche historique porte essentiellement sur les aspects militaires d’une conquête qui a été longue et difficile et sur l’organisation, au fur et à mesure, de ce qui doit permettre et encadrer le fonctionnement du régime colonial (politique, administratif, économique). L’auteur s’appuie à la fois sur ses propres travaux, notamment ceux qui concernent la lutte menée par l’armée française contre Abd el-Kader et, chapitre sans doute moins connu de nos jours, ce que furent les « bureaux arabes dont le rôle, limité dans le temps, n’en a pas moins été un aspect original et intéressant de la conquête. Mais il utilise aussi les très grands livres consacrés par des historiens éminents à la colonisation française en Algérie, ceux de Charles-André Julien, Charles-Robert Ageron et Xavier Yacono. L’existence de ces travaux lui permet d’être synthétique et de prendre un recul suffisant pour proposer, de manière prudente et modérée, néanmoins ferme, quelques appréciations.
Le déroulement du livre ne pouvait évidemment être autre que chronologique puisqu’il s’agissait de marquer les étapes qui ont rythmé ces soixante-quatorze ans, en commençant forcément, comme l’histoire elle-même, par le célèbre débarquement de 1830 à Sidi Ferruch, ou plutôt même un peu avant pour faire connaître les origines de l’événement. Après quoi la conquête militaire va de pair avec l’établissement des colons puisqu’il s’agit et c’est le trait fondamental de ce qui s’est passé en Algérie, d’y mettre en place une colonie de peuplement. Les témoignages ne manquent pas sur les expropriations parfois éhontées qui ont permis d’attirer des colons et du moins pour certains d’entre eux de réussir brillamment—mais il faut rappeler que ce fut pour certains seulement. Sans revenir sur des faits désormais très connus, sur lesquels l’auteur donne néanmoins le minimum requis de précisions (et sans doute n’a-t-il pas été facile de déterminer en quoi consistait ce minimum), on peut s’arrêter un instant sur son sujet de prédilection, à savoir, comme on l’a déjà dit, les « bureaux arabes » qui entrent en fonctionnement à partir de 1844. Leurs chefs, assez peu nombreux (environ deux cents), sont chargés de gérer les relations avec la population arabe. Ce sont pour la plupart de jeunes officiers sortis des grandes écoles, dont on peut citer pour exemple Jean-Auguste Margueritte, malheureusement mort prématurément à la bataille de Sedan en 1870. Ils entretiennent des relations, parfois complexes mais indispensables, avec les notables locaux et prennent des initiatives dans les domaines économique et social, parfois inspirées du saint-simonisme. Ils sont également chargés de la médecine et de l’enseignement. De manière intéressante, Jacques Frémeaux les rapproche des « réformistes » musulmans, ces chefs d’Etat qui au même moment s’efforcent d’engager leurs pays dans la voie du progrès, sur le modèle occidental quelque peu aménagé. Cependant, en Algérie, ils sont au service de la colonisation et il ne saurait en être autrement. D’autre part le style de relation franco-arabe qu’ils ont essayé d’instaurer n’est pas sans rapport avec la politique dite du « Royaume arabe » qui a été la grande idée de l’Empereur Napoléon III s’agissant de l’Algérie qui lui tenait à cœur mais l’auteur est manifestement de ceux qui sont très critiques à l’égard de cette politique et la considèrent plutôt comme une velléité restée indécise et inaboutie. Non sans rappeler, avec le souci d’équilibre qui le caractérise, que cette politique se retrouve peut-être avec succès dans celle qui fut plus tard appliquée au Maroc par Lyautey ; et que De Gaulle aurait déclaré en 1960 : (avec le royaume arabe) « on est passé à côté de la seule formule qui aurait été viable ». Quoi qu’il en soit, après 1871, la politique de la Troisième République s’en éloigne radicalement et se fonde sur des principes différents. L’expression en vigueur sera désormais, et pour longtemps, « L’Algérie française », c’est-à-dire l’assimilation de l’Algérie à la France. Cependant, le début de cette nouvelle politique est de bien mauvais augure, puisqu’il s’agit de l’insurrection générale de 1871, le nombre d’insurgés étant évalué à 800.000 personnes, dont la répression par la France a eu des conséquences gravissimes, et surtout le terrible appauvrissement de la Kabylie, qui ne réussira pas à s’en remettre pendant toute la période coloniale.
Quoi qu’il en soit, après 1871, la politique de la Troisième République s’en éloigne radicalement et se fonde sur des principes différents. L’expression en vigueur sera désormais, et pour longtemps, « L’Algérie française », c’est-à-dire l’assimilation de l’Algérie à la France. Cependant, le début de cette nouvelle politique est de bien mauvais augure, puisqu’il s’agit de l’insurrection générale de 1871, le nombre d’insurgés étant évalué à 800.000 personnes, dont la répression par la France a eu des conséquences gravissimes, et surtout le terrible appauvrissement de la Kabylie, qui ne réussira pas à s’en remettre pendant toute la période coloniale.
Le bilan provisoire (jusqu’en 1914) qu’établit finalement Jacques Frémeaux insiste sur l’ambivalence de cette Algérie dite française, pour laquelle à cette date du moins on ne saurait parler d’échec—en tout cas pas dans le domaine économique, où l’on peut au contraire affirmer l’existence d’une réelle « prospérité coloniale » (c’est le titre du 10e chapitre du livre, qui en comporte 12). S’agissant des relations avec les Algériens Musulmans, il nous est sans doute difficile d’échapper à une lecture rétrospective du fait que nous savons ce que sera la fin de l’histoire, quarante-huit ans plus tard. Jacques Frémeaux se contente de parler de « motifs d’insatisfaction et d’inquiétude », formule que certains dénonceront sans doute comme une litote (atténuation) ! Mais il est vrai que les contestations et remontrances sont encore sporadiques. Suite au second volume …
Denise Brahimi

« PAPICHA » Film de Mounia Meddour, France Algérie 2019
Depuis le festival de Cannes 2019, où on a pu le voir dans la sélection « Un certain regard », on attend la sortie nationale de ce film, prévue pour octobre 2019. Les Lyonnais et quelques autres ont eu la chance de le voir en avant-première, avec trois semaines d’avance sur les autres et l’on sait déjà quelles sont les chances qui permettent d’espérer un beau succès pour ce film à petit budget, dont le financement n’est pas encore complétement assuré. Il est vrai que montrer ce film à Cannes en mai 2019, c’est-à-dire trois mois après le mouvement dit du 22 février de cette même année, est une remarquable coïncidence historique qui ne peut que bénéficier au film. Ce mouvement a entraîné la chute du pouvoir de Bouteflika et entend contrôler les élections du futur gouvernement pour qu’elles respectent les exigences démocratiques. Il est essentiellement le fait de jeunes gens garçons ou filles, dont le courage et la créativité éclatent dans tout ce qu’on en voit. Or dans Papicha aussi l’action est menée par des jeunes et qui plus est essentiellement par des femmes : quatre jeunes filles qui vivent à la cité universitaire d’Alger, ce qui est un souvenir autobiographique de la réalisatrice Mounia Meddour. Il s’agit donc d’un « film de femmes », réalisatrice et actrices, ce qui, le moins qu’on puisse dire, est dans l’air du temps, notre temps. En tout cas, on voit bien quelle conjonction de situations et d’événements attire forcément la bienveillance du public à l’égard de Papicha, sans parler du fait que rejaillit favorablement sur Mounia Meddour la réputation de son père Azzedine Meddour, l’un des grands noms sinon le plus connu du cinéma dit amazigh (mettant l’accent sur l’histoire et la langue des Berbères de Kabylie), notamment pour son film La Montagne de Baya (1997). Montrer de nos jours des jeunes filles algériennes qui résistent à la violence armée des islamistes est une sorte de satisfaction jubilatoire que le public ne peut manquer d’éprouver.
Il est vrai que montrer ce film à Cannes en mai 2019, c’est-à-dire trois mois après le mouvement dit du 22 février de cette même année, est une remarquable coïncidence historique qui ne peut que bénéficier au film. Ce mouvement a entraîné la chute du pouvoir de Bouteflika et entend contrôler les élections du futur gouvernement pour qu’elles respectent les exigences démocratiques. Il est essentiellement le fait de jeunes gens garçons ou filles, dont le courage et la créativité éclatent dans tout ce qu’on en voit. Or dans Papicha aussi l’action est menée par des jeunes et qui plus est essentiellement par des femmes : quatre jeunes filles qui vivent à la cité universitaire d’Alger, ce qui est un souvenir autobiographique de la réalisatrice Mounia Meddour. Il s’agit donc d’un « film de femmes », réalisatrice et actrices, ce qui, le moins qu’on puisse dire, est dans l’air du temps, notre temps. En tout cas, on voit bien quelle conjonction de situations et d’événements attire forcément la bienveillance du public à l’égard de Papicha, sans parler du fait que rejaillit favorablement sur Mounia Meddour la réputation de son père Azzedine Meddour, l’un des grands noms sinon le plus connu du cinéma dit amazigh (mettant l’accent sur l’histoire et la langue des Berbères de Kabylie), notamment pour son film La Montagne de Baya (1997). Montrer de nos jours des jeunes filles algériennes qui résistent à la violence armée des islamistes est une sorte de satisfaction jubilatoire que le public ne peut manquer d’éprouver.
Paradoxalement, c’est aussi pour tout ce qu’il ne dit pas et ne fait pas que le film a des chances d’être bien reçu. L’action se passe dans les années 1990, en plein dans ce qu’on appelle la décennie noire, lutte féroce et guerre civile meurtrière extrêmement traumatisante et dont on est encore loin d’avoir tiré au clair tous les aspects. Or il est tout à fait évident que le film Papicha ne propose pas et n’essaie même pas de suggérer la moindre analyse historique ni politique de cette période sur laquelle il paraît pourtant difficile de ne pas s’interroger. D’où sort le terrorisme islamique et qu’est-ce qui lui a permis de prendre par les armes le pouvoir qui lui avait été refusé bien qu’il l’ait emporté par la voie électorale ? Quelle fut alors la riposte de l’état, de sa police et de son armée ? On peut supposer qu’il y a chez Mounia Meddour une volonté bien claire de ne pas aborder ces questions si lancinantes qu’elles soient ou justement parce qu’elles sont lancinantes. En quoi on peut supposer aussi que son attitude est conforme aux vœux d’une bonne partie du public. Les jeunes d’aujourd’hui, ceux qui manifestent dans la rue depuis le 22 février ont d’autres urgences et souhaitent une rupture avec tout ce sinistre passé. Beaucoup d’événements de l’époque sont restés obscurs, et bon nombre de ceux qui bon gré mal gré y ont participé ne souhaitent certainement pas qu’on s’acharne à les élucider. Pour ce qui est de ce qu’on peut appeler le grand public, notamment en France, Il lui convient tout à fait que le monde représenté soit partagé entre d’affreux porteurs de kalachnikovs comme dans les films populaires et dans les BD et de courageuses filles leurs victimes sur lesquelles on ne peut que pleurer. C’est un heureux choix de casting qui a donné le rôle principal à l’actrice Lyna Khoudri, une vraie professionnelle alors que les autres ne le sont pas. Elle confère à son personnage, Nedjma, une vraie consistance due à son talent de styliste et à la constance de sa volonté. L’habileté de la réalisatrice est de faire en sorte que le métier auquel aspire Nedjma est à la fois manuel et créatif, en tout cas pas de type intellectuel, ce qui aurait peut-être moins facilement séduit le public. La revendication qui apparaît dans le film est certes féministe, mais à un sens très large : qu’on laisse aux femmes le droit d’exercer leur compétence et leur talent quand elles en ont, et surtout qu’on leur laisse la joie de vivre, d’être gaies, de s’amuser, tant il est vrai que leurs supposés dévergondages, tels qu’on les voit dans le film, sont vraiment bien innocents et anodins : mettre du rouge à lèvres, porter des shorts et pas de foulards, sortir clandestinement de la cité non pour aller se livrer à des orgies mais, dans le cas de Nedjma, pour aller vendre les robes qu’elle coud avec l’aide de sa mère à des filles qui ont beaucoup d’argent.
C’est un heureux choix de casting qui a donné le rôle principal à l’actrice Lyna Khoudri, une vraie professionnelle alors que les autres ne le sont pas. Elle confère à son personnage, Nedjma, une vraie consistance due à son talent de styliste et à la constance de sa volonté. L’habileté de la réalisatrice est de faire en sorte que le métier auquel aspire Nedjma est à la fois manuel et créatif, en tout cas pas de type intellectuel, ce qui aurait peut-être moins facilement séduit le public. La revendication qui apparaît dans le film est certes féministe, mais à un sens très large : qu’on laisse aux femmes le droit d’exercer leur compétence et leur talent quand elles en ont, et surtout qu’on leur laisse la joie de vivre, d’être gaies, de s’amuser, tant il est vrai que leurs supposés dévergondages, tels qu’on les voit dans le film, sont vraiment bien innocents et anodins : mettre du rouge à lèvres, porter des shorts et pas de foulards, sortir clandestinement de la cité non pour aller se livrer à des orgies mais, dans le cas de Nedjma, pour aller vendre les robes qu’elle coud avec l’aide de sa mère à des filles qui ont beaucoup d’argent.
C’est peut-être sur cet aspect social que le film apporte les précisions les plus intéressantes. Nedjma et ses amies sont de milieu populaire, elle doivent se démener pour gagner un peu d’argent que leur famille n’a pas. En revanche parmi les clientes de Nedjma, on en voit qui appartiennent certainement à une bourgeoisie très riche et qui ne sont pas montrées sous un jour sympathique. La réalisatrice s’inscrit dans le courant actuellement dominant en Algérie, la dénonciation des profiteurs du régime, qui doivent évidemment leur richesse à la corruption. A quoi le film oppose compétence, mérite, travail. Ce serait encore un des atouts qui jouent en sa faveur, en ces temps de « transition démocratique » où il importe de condamner tous ceux dont la fortune et le pouvoir sont notoirement mal acquis. Pour autant la réalisatrice se garde bien d’insister sur ce qui aurait pu être une dénonciation précise et assumée. Elle dit s’être gardée de toute violence et de toute véhémence, ce qui peut paraître étonnant puisque ces traits ont au contraire caractérisé le contexte historique de son film, la tristement célèbre « décennie noire ». Raison pour laquelle la fin du film peut paraître escamotée. On voit bien qu’il s’agit de montrer le moins de sang possible et surtout pas d’entrer dans les rangs du cinéma « gore » en laissant l’horreur surgir. C’est un choix délibéré en faveur de la réconciliation.
Denise Brahimi

Sortie le 8 octobre du Film Papicha. A surveiller dans vos salles préférées.
- le 26 octobre à 15 h à Lyon, Maison des Passages 44 rue Saint-Georges 69005 Lyon, En Algérie, en Poésies par la Compagnie Novecento, Nadia Larbiouène sera accompagnée par la mandole de Nacer Hamzaoui. au programme Kateb Yacine, Jean Senac, Zineb Laouedj, Albert Camus…


Merci pour votre travail et l’ information que vous donne sur les livres dont le theme es l’Algerie
Merci a Denise et tout l’ equipe
Ximena du Chili
Bonjour,
J’apprécie cet agenda qui informe sur les nouveautés culturelles sur le Maghreb
Je propose de rajouter une rubrique sur le tourisme au Maghreb
C’est le cas de notre agence associative de promotion des cultures et du voyage (association 1901)
Je vous invite à consulter notre site https://www.apcv.org
Je reste à l’écoute pour de plus amples informations
Amicales salutations
RAS
Merci pour votre lettre fort intéressante, Denise et Michel. Joël Arlin de Saint Etienne, professeur au collège St Louis. Auteur de 2 ouvrages: « Dieu de ma vie » Editions Persée et « Le grand chemin » Editions Peuple Libre. Mon itinéraire spirituel décrit dans ces ouvrages est celui d’un homme en marche qui essaie d’être un soufi passionné de mystique, de dialogue inter-religieux et interculturel. Je suis aussi pour l’enseignement du fait religieux à l’école à la suite du rapport Debray, seul vrai rempart au fanatisme et à l’obscurantisme. Amitiés Joël Arlin Ps: j’étais au colloque à St Etienne il y a 3 mois.