Lettre culturelle franco-maghrébine #48
ÉDITO
Commençons par Mohammed Dib et ses photos : nous vous en avons parlé la dernière fois, nous sommes très heureux de continuer aujourd’hui en publiant les commentaires que nous avons reçus pour deux d’entre elles — ils sont d’une telle qualité qu’on en est ébloui ! Les photos ayant été publiées dans la Lettre du 1er octobre (jointes à l’article sur « Tlemcen ou les lieux de l’écriture ») nous espérons que vous irez les voir à nouveau et qu’elles continueront à vous inspirer. Et nous souhaitons continuer à recevoir vos commentaires de certaines de ces photos (à votre choix ) pour les publier dans nos prochaines « Lettres ».
Après cela nous vous proposons un choix d’articles variés sur des livres récents. Ceux de Benjamin Stora et de Julien Lacassagne sont le fait d’historiens ; le premier nous aide à mettre de l’ordre dans ce que nous savons ou croyons savoir, l’autre nous ouvre des horizons et nous propose des idées remarquablement novatrices. S’agissant de Gisèle Halimi qui vient de disparaître à 93 ans, Annick Cojean met en valeur quelques points essentiels des combats qu’elle a menés en faveur du droit des femmes. Le livre de la jeune Fatima Daas illustre d’ailleurs le fait que les femmes n’en ont pas fini de se battre, pour des causes anciennes ou nouvelles.
Au chapitre des informations, nous vous donnons à lire celle que Danièle Almendros nous avait communiquée il y a quelques temps, et qui malheureusement est désormais périmée. Il s’agit d’un spectacle travaillé avec le metteur en scène Dominique Lurcel dans lequel se sont impliqués plusieurs membres de Coup de soleil, que nous serons évidemment très heureux de retrouver sur une scène de théâtre, pour mieux faire connaissance avec eux quand les circonstances s’y prêteront de nouveau.
D. Almendros « Je vous convie à une lecture de nos ateliers d’écriture autobiographique lyonnais évoquant par bribes une histoire de l’Algérie de la fin de la colonisation à nos jours. Une histoire composite résultant de l’entrelacement du vécu de dix personnes toutes nées en Algérie bien que d’âges et d’origines diverses : algériens des rives de la Méditerranée aux montagnes de la Kabylie et « pieds-noirs ». Les textes qui vous seront lus sont tirés de la chair même de leur vécu et c’est ce matériau sensible qui vous sera présenté le 7 novembre à la Maison des Passages à Lyon. Deux séances sont prévues, à 15 et à 18 H.)
Mais c’était compter sans le virus et sans les décisions récentes de confinement dont Dominique Lurcel dit combien elles sont frustrantes:
Dominique Lurcel : « Le couperet est donc tombé : nous ne pourrons pas nous retrouver les 6 et 7 novembre prochains…
Il est évident que ce n’est que partie remise ; n’empêche, le choc est rude, et je pense très fort à vous toutes et tous… ».
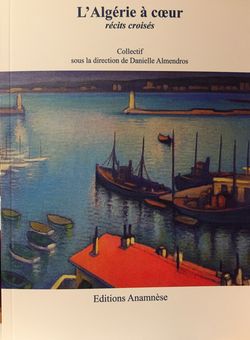 En attendant ce prochain rendez-vous il reste le livre avec la sélection des textes : « L’Algérie à cœur récits croisés » qu’il vous est possible de commander via notre site pour 15€, port compris.
En attendant ce prochain rendez-vous il reste le livre avec la sélection des textes : « L’Algérie à cœur récits croisés » qu’il vous est possible de commander via notre site pour 15€, port compris.
Denise Brahimi

« TLEMCEN OU LES LIEUX DE L’ECRITURE » de Mohammed Dib , co-édition éditions Barzakh 2020, éditions Images Plurielles 2020
Libres commentaires sur quelques photos du livre.
« OMBRE ET LUMIÈRE » Annie Barranco octobre 2020
 Ombre de la guerre jetée sur l’enfance, plus allongée, plus sombre, au fil des années et de l’intensité des combats à Marnia, dans l’ouest de l’Algérie, si près de la frontière marocaine.
Ombre de la guerre jetée sur l’enfance, plus allongée, plus sombre, au fil des années et de l’intensité des combats à Marnia, dans l’ouest de l’Algérie, si près de la frontière marocaine.
Lumière débordante de soleil, toute vouée à la terre fertile des vergers qu’irriguait Tafna, la rivière généreuse. De leur symphonie naturelle, dans un nuancier de camaïeu vert, chaque mois de mai explose la floraison blanche étoilée des citronniers, des orangers, embaumant tout alentours, de la vaste campagne opulente aux moindres misérables gourbis du « village nègre ».
Mon regard, exercé très jeune à ce jeu d’ombre et de lumière, sait débusquer des lumineuses apparences, de sombres réalités.
« Les faux beaux jours ont lui tout le jour ma pauvre âme, et les voici vibrer aux cuivres du couchant. Ferme les yeux, pauvre âme, et rentre sur-le-champs » : ce que je fais, précisément route de Tlemcen, courant presque dès la sortie de l’école jusqu’à la maison où enfin je me réfugie. La poésie de Paul Verlaine inachevée, encore sur les lèvres, je claque la porte sur la guerre la laissant sous le regard bleu d’un ciel sans nuage.
Je les croisais chaque jour ces cavaliers d’un autre temps, juchés sur leur monture, âne, mule ou mulet. Et je cheminais un moment avec eux jusqu’à ce que le carrefour principal nous sépare, sorte de triage sociale, économique, communautaire, coloniale tout simplement.
Moi, je poursuivais à droite, vers le centre-ville européen où se trouvaient l’école, l’hôpital, l’église, les quartiers chics des professions libérales, jardins publics, restaurants, cafés…
Ailleurs, plus écartées, les casernes nombreuses de la Légion Etrangère, Parachutistes, Bérets-Verts, concentration impressionnante de militaires français présents et très actifs dans ce coin paradisiaque.
Eux, les cavaliers indigènes sortis d’un nulle part lointain et invisible, leur « village nègre », remontaient encore un peu cette longue route de Tlemcen traversante, tournaient dans les hauteurs, là où apparaissaient de loin les cîmes des arbres. Alors, s’étalaient au milieu d’une végétation bien entretenue, les vastes domaines tenus par les puissants colons… Toutes les ressources agricoles leur appartenaient. Ils régissaient en maître, d’une poigne ferme, définitive.
Journaliers modestes, exploités depuis des générations, leur monture semblait connaître le chemin. Elle trottinait d’un sabot sûr et régulier. Sans doute une odeur de verger en fleurs ou d’herbe tendre, peut-être ici le bruit particulier de la rivière sur les cailloux ou encore un rayon de soleil plus précis sur le harnais, et la bête de selle s’arrêtait net : une longue journée harassante commençait pour l’homme…
… « Si ces hiers allaient manger nos beaux demains ?
Si la vieille folie était encore en route ? »…
« UNE JEUNE FILLE » Rosa Cortes Octobre 2020
 Une jeune fille tlemcenienne, entre ombres et lumière, joues rondes, lèvres serrées, moue boudeuse, regard hautain, distant ou peut-être plus simplement triste et angoissé… Parée de bijoux, la poitrine écrasée de colliers, la tête pliant sous le fardeau de boucles et de couronnes… l’or, le poids de l’or brodé, incrusté, accroché, s’impose comme révélateur d’une cérémonie obligée, présente ou à venir. Cérémonie ou sacrifice ? Fête ou initiation ? Est-ce une mariée inquiète ou une vestale offerte ? Elle semble si jeune, si fragile, si apeurée. L’or est-il là pour calmer ses angoisses ? L’envelopper de ces certitudes que sa jeunesse ignore encore ? Ou cette deuxième peau l’ancre-t-elle dans sa beauté illuminée par ces éclats de métal précieux ? Est-elle envahie par un ennui profond qu’aucun tourment ne peut ébranler ? Et ces multiples bijoux peuvent-ils lui faire oublier la laideur supposée dissimulée de l’autre côté du mur et que laisse présager la peinture écaillée? Est-ce cette fuite vers un ailleurs sans réponse qui voile ses yeux et fige ses traits ? Belle, elle attend, impassible en apparence mais le corps hiératique révèle un imperceptible mouvement lancé vers l’avant, comme le frémissement d’un désir impatient…
Une jeune fille tlemcenienne, entre ombres et lumière, joues rondes, lèvres serrées, moue boudeuse, regard hautain, distant ou peut-être plus simplement triste et angoissé… Parée de bijoux, la poitrine écrasée de colliers, la tête pliant sous le fardeau de boucles et de couronnes… l’or, le poids de l’or brodé, incrusté, accroché, s’impose comme révélateur d’une cérémonie obligée, présente ou à venir. Cérémonie ou sacrifice ? Fête ou initiation ? Est-ce une mariée inquiète ou une vestale offerte ? Elle semble si jeune, si fragile, si apeurée. L’or est-il là pour calmer ses angoisses ? L’envelopper de ces certitudes que sa jeunesse ignore encore ? Ou cette deuxième peau l’ancre-t-elle dans sa beauté illuminée par ces éclats de métal précieux ? Est-elle envahie par un ennui profond qu’aucun tourment ne peut ébranler ? Et ces multiples bijoux peuvent-ils lui faire oublier la laideur supposée dissimulée de l’autre côté du mur et que laisse présager la peinture écaillée? Est-ce cette fuite vers un ailleurs sans réponse qui voile ses yeux et fige ses traits ? Belle, elle attend, impassible en apparence mais le corps hiératique révèle un imperceptible mouvement lancé vers l’avant, comme le frémissement d’un désir impatient…
Vous trouverez ci-dessous 12 photographies issues du livre et aimablement mises à notre disposition par Abed Abidat, co-éditeur. Nous vous proposons de nous adresser votre commentaire (une 1/2 page) sur l’une de ces photos que vous choisirez, et si vous le souhaitez la photo et votre commentaire seront publiés dans une de nos prochaines lettre. Ces publications s’échelonneront dans les prochains mois, prolongeant ainsi notre hommage à ce grand écrivain.
Michel Wilson












« PAPA QU’AS TU FAIT EN ALGERIE? » par Raphaëlle Branche, éditions La Découverte, 2020
Il s’agit d’un essai, fort copieux (plus de 500 pages), de nature sociologique, alors que son auteure est professeure d’histoire, connue pour ses travaux antérieurs portant sur la guerre d’Algérie : elle est en particulier l’auteure d’un livre qui s’intitule : La Torture et l’Armée pendant la Guerre d’Algérie (2001), ce qui prouve qu’elle n’hésite pas à aborder des sujets délicats, et souvent refoulés.
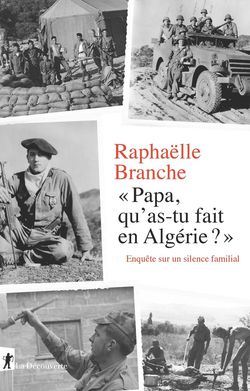 Le titre de son dernier livre est beaucoup plus sérieux que sa formulation ne pourrait le faire croire, et il dit très exactement quoique en peu de mots ce qui est son objet. S’agissant toujours de la Guerre d’Algérie, cette fois l’auteure l’aborde sous la forme d’une question, ce qui justifie le fait qu’elle l’ait traitée au moyen d’une enquête ou plutôt d’enquêtes, de grande envergure à la fois par le nombre de personnes qui ont été interrogées et par celui des années nécessaires pour le mener à bien. Le livre s’appuie presque exclusivement sur les données ainsi recueillies mais elles n’ont de données que le nom car il fallait évidemment aller les chercher et surtout les interpréter, en sorte que s’il s’agit en effet d’une enquête sociologique, il faut immédiatement ajouter que son ressort principal est l’empathie éprouvée par l’auteure pour les gens dont elle nous parle et qu’elle fait parler. Il s’agit pour elle de les comprendre, évidemment à travers leurs mots mais aussi lorsque ces derniers sont rares ou absents. Et c’est précisément pourquoi elle a maintenu dans son titre la forme interrogative, manière de dire qu’à l’égard du matériau qu’elle utilise, elle y a trouvé parfois plus de questions que de réponses, ou des embryons de réponses à partir desquels il lui fallait extrapoler.
Le titre de son dernier livre est beaucoup plus sérieux que sa formulation ne pourrait le faire croire, et il dit très exactement quoique en peu de mots ce qui est son objet. S’agissant toujours de la Guerre d’Algérie, cette fois l’auteure l’aborde sous la forme d’une question, ce qui justifie le fait qu’elle l’ait traitée au moyen d’une enquête ou plutôt d’enquêtes, de grande envergure à la fois par le nombre de personnes qui ont été interrogées et par celui des années nécessaires pour le mener à bien. Le livre s’appuie presque exclusivement sur les données ainsi recueillies mais elles n’ont de données que le nom car il fallait évidemment aller les chercher et surtout les interpréter, en sorte que s’il s’agit en effet d’une enquête sociologique, il faut immédiatement ajouter que son ressort principal est l’empathie éprouvée par l’auteure pour les gens dont elle nous parle et qu’elle fait parler. Il s’agit pour elle de les comprendre, évidemment à travers leurs mots mais aussi lorsque ces derniers sont rares ou absents. Et c’est précisément pourquoi elle a maintenu dans son titre la forme interrogative, manière de dire qu’à l’égard du matériau qu’elle utilise, elle y a trouvé parfois plus de questions que de réponses, ou des embryons de réponses à partir desquels il lui fallait extrapoler.
Le plus surprenant dans ce titre est sans doute l’emploi du mot « Papa » mais on ne saurait mieux dire que l’essentiel de ce qu’elle raconte se passe dans l’intimité familiale et l’on pourrait aller jusqu’à dire au cœur des secrets dont cette intimité est le lieu ; mais le mot « secret » renvoie à des attitudes volontaires et très conscientes, c’est pourquoi il vaut peut-être mieux parler de non-dits, terme plus vague correspondant mieux aux réalités que la sociologue tente d’explorer. Le saisissement produit par toutes ces histoires tient beaucoup au fait qu’elles sont vécues dans le cadre familial, qui est incontestablement celui de la plus grande intimité ; mais que d’autre part et justement à cause de cette très grande proximité, des barrières se sont installées, très vite, et consolidées avec le temps alors même qu’on aurait pu imaginer ou espérer le contraire. C’est pourquoi le livre de Raphaëlle Branche se devait de suivre une chronologie, ce qu’elle fait très clairement.
Elle aborde successivement trois parties à peu près égales, entre lesquelles se répartissent une dizaine de chapitres. C’est d’abord « La guerre » elle-même, de 1956 à 1962, puis « Le retour » et enfin « L’héritage » qui concerne davantage les fils et même les petits-fils de ceux qui ont été les soldats de cette « Guerre sans nom » (c’est le titre du documentaire de 1992 consacré par Bertrand Tavernier et Patrick Rotman aux appelés de la guerre d’Algérie.)
Le parti pris et le but de son enquête étant clairement défini, Raphaëlle Branche n’a pas à parler (sauf indirectement) de ce qui se passe sur le terrain entre les soldats de l’armée française et ses adversaires algériens. Et si la validité du combat mené par ces derniers est ici ou là évoquée dans le livre, c’est parce que la question traverse forcément l’esprit de ces jeunes Français—si fraîchement débarqués et si ignorants qu’ils soient de ce qui concerne l’Algérie. Cette ignorance est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles ils parlent fort peu de ce qu’on est en train de leur faire faire, alors même que leur correspondance avec leur famille est abondante et tient une grande place dans leur vie quotidienne : pas de téléphone mais des lettres, la question étant évidemment de savoir ce qu’on dit ou ce qu’on ne dit pas.
Il est bien compréhensible que ces jeunes garçons ne veuillent pas inquiéter leurs familles, surtout pas la mère, ni même le père, en sorte qu’on ne trouve guère de révélations plus précises, et plus critiques, voire révoltées, que dans des lettres au frère, parfois à la sœur. Mais de toute façon, pour que ces garçons prennent conscience du rôle qu’on leur fait jouer, il faut du temps et de la réflexion tant il est vrai qu’ils étaient très peu et très mal informés avant leur départ. Comme il n’avait été question que de maintien de l’ordre et évidemment pas de guerre, l’un d’eux pensait qu’il serait utilisé comme une sorte de « casque bleu », nom donné aux soldats de l’ONU chargés du maintien de la paix. De toute manière reste le problème de formuler (dans les mots d’une lettre) ce qu’on ressent et même ce qu’on voit—ce qui n’a jamais été facile pour personne et notamment pas pour qui n’a jamais su qu’il aurait à le faire.
 Parler au moment du retour ? Il est probable que ni les uns, c’est-à-dire la famille, ni les autres, c’est-à-dire les ex-soldats, n’ont envie de le faire : le moment ne paraît pas opportun tant il est vrai que l’urgence est de se réadapter, et d’éviter l’enfermement dans le passé alors que l’urgence est au présent. Urgences multiples d’ailleurs : trouver du travail ou se remettre à celui qu’on avait, retrouver les fiancées d’avant ou en trouver de nouvelles et surtout se dépêcher de les épouser, tant il est vrai que la seule chose à faire est d’aller de l’avant et de fonder une famille comme on dit. L’enquêtrice donne plusieurs exemples de cette attitude, la plus fréquente, qui loin de faire place à des récits au passé induit au contraire un désir de les mettre de côté, au moins provisoirement. Pour ce qui est des autres cas, lorsque des garçons qui n’arrivent pas à oublier n’ont plus d’autre recours que celui, très improbable, de la psychiatrie, on imagine bien que leurs témoignages, si tant est qu’on arrive à les récupérer, ne peuvent en aucune façon servir à constituer une histoire. Et malheureusement l’éloignement dans le temps n’est pas une garantie de guérison.
Parler au moment du retour ? Il est probable que ni les uns, c’est-à-dire la famille, ni les autres, c’est-à-dire les ex-soldats, n’ont envie de le faire : le moment ne paraît pas opportun tant il est vrai que l’urgence est de se réadapter, et d’éviter l’enfermement dans le passé alors que l’urgence est au présent. Urgences multiples d’ailleurs : trouver du travail ou se remettre à celui qu’on avait, retrouver les fiancées d’avant ou en trouver de nouvelles et surtout se dépêcher de les épouser, tant il est vrai que la seule chose à faire est d’aller de l’avant et de fonder une famille comme on dit. L’enquêtrice donne plusieurs exemples de cette attitude, la plus fréquente, qui loin de faire place à des récits au passé induit au contraire un désir de les mettre de côté, au moins provisoirement. Pour ce qui est des autres cas, lorsque des garçons qui n’arrivent pas à oublier n’ont plus d’autre recours que celui, très improbable, de la psychiatrie, on imagine bien que leurs témoignages, si tant est qu’on arrive à les récupérer, ne peuvent en aucune façon servir à constituer une histoire. Et malheureusement l’éloignement dans le temps n’est pas une garantie de guérison.
La partie intitulée « L’héritage » passe à la génération suivante, celle des fils et des filles, et rejoint à cet égard ce qu’on peut lire dans le recueil qui utilise lui aussi ce même mot : L’Algérie en héritage, collectif dirigé par Leïla Sebbar et Martine Mathieu-Job (2020). Et c’est à ce point que nous en sommes, loin de pouvoir mesurer encore ce que Raphaëlle Branche évoque comme une « empreinte durable sur la société française ».
Denise Brahimi
« BERBERES JUIFS, L’EMERGENCE DU MONOTHEISME EN AFRIQUE DU NORD » par Julien Cohen-Lacassagne, éditions La fabrique, 2020
Cet essai historique va à l’encontre de beaucoup d’idées reçues, à la place desquelles il en suggère d’autres qui sont beaucoup plus convaincantes, et il a le mérite de le faire en un petit nombre de pages (environ 160) qui sont tout à fait claires et argumentées. Le sujet abordé, des plus problématiques, concerne l’origine des Juifs d’Afrique du Nord et on se doute bien qu’il requiert la compétence de nombreux historiens, dont l’auteur connaît évidemment l’œuvre et les théories ; cependant son livre n’est pas un ouvrage d’érudition, on pourrait presque dire qu’il fait confiance au simple bon sens pour récuser des positions qui paraissent intenables si on veut bien y réfléchir au lieu de répéter ce que tout le monde dit.
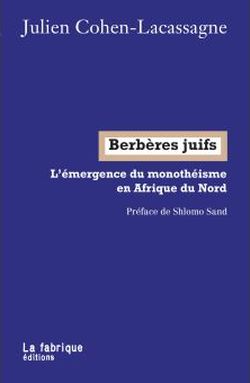 Que dit-on en effet couramment sur cette origine, qui aurait le mérite d’être bien datée, très exactement de 70 après Jésus-Christ, date à laquelle les Romains se sont emparés de la Judée et en auraient expulsé tous les habitants. L’arc de Titus à Rome porte en effet témoignage d’un départ sinon d’une expulsion. Les Juifs chassés de Jérusalem auraient alors commencé un interminable exil qui les a conduits à s’installer dans diverses parties du monde, au nord comme au sud de la Méditerranée, et notamment en Afrique du nord, vaste région alors occupée par des tribus berbères, au sein desquelles les Juifs auraient gardé leurs particularités religieuses et ethniques.
Que dit-on en effet couramment sur cette origine, qui aurait le mérite d’être bien datée, très exactement de 70 après Jésus-Christ, date à laquelle les Romains se sont emparés de la Judée et en auraient expulsé tous les habitants. L’arc de Titus à Rome porte en effet témoignage d’un départ sinon d’une expulsion. Les Juifs chassés de Jérusalem auraient alors commencé un interminable exil qui les a conduits à s’installer dans diverses parties du monde, au nord comme au sud de la Méditerranée, et notamment en Afrique du nord, vaste région alors occupée par des tribus berbères, au sein desquelles les Juifs auraient gardé leurs particularités religieuses et ethniques.
A cette façon de raconter l’histoire s’opposent un certain nombre de faits. Il n’y a aucun témoignage fiable, archéologique ou autre, permettant de penser qu’il y a eu en divers lieux d’Afrique du Nord des arrivages massifs de Juifs après leur supposée expulsion même s’ils ont en effet été chassés du temple de Jérusalem, ce qui est une tout autre affaire (mais y avait-il de quoi créer des communautés nombreuses dans plusieurs pays ?). En revanche il est question de Juifs utilisant pour écrire l’alphabet hébraïque et se singularisant par leur religion (monothéiste) bien avant les dates de l’exil causé par les Romains en 70. Et pour s’en tenir à l’Afrique du Nord, il semble bien que cette présence juive ait été particulièrement importante aux moments florissants de l’Empire carthaginois, ce qui amène évidemment à s’interroger sur les rapports anthropologiques et culturels entre les Phéniciens et les Juifs. Les premiers étaient de grands navigateurs qui ont pu aider les seconds à se déplacer en longeant la côte sud de la Méditerranée d’Est en Ouest. Il paraît certain que les Juifs ont été soucieux d’un prosélytisme qui est d’ailleurs le propre de tous les monothéismes ; et c’est ainsi que des Berbères implantés en Afrique du nord depuis des millénaires auraient été convertis au judaïsme en quantité non négligeable, en sorte qu’il conviendrait de les désigner non pas comme Juifs mais comme berbères judaïsés. De là viendrait la grande ressemblance si souvent remarquée au Maghreb, jusqu’à la colonisation, entre population juive et population berbère, alors que la très grande majorité de celle-ci est devenue musulmane à partir du 7e siècle. Dans cette histoire de Berbères convertis et judaïsés, on comprend bien que, comme le dit l’auteur, il n’y a ni « exil ni errance », c’est le titre de l’un de ses chapitres, et que, comme il le dit aussi, il faut « apprendre à désapprendre »—ce qui est particulièrement difficile quand il s’agit de croyances concernant l’identité.
 Julien Cohen-Lacassagne explique très bien comment certaines particularités juives ont pu être transformées en une essence distincte et incomparable selon les besoins de différentes causes. Dès les premiers siècles de notre ère s’est établie une concurrence intraitable entre chrétiens et juifs pour savoir lequel de leurs deux monothéismes prendrait la relève du paganisme romain déclinant, de moins en moins capable de satisfaire les aspirations religieuses d’un grand nombre de gens. Le christianisme a été vainqueur de cette longue compétition, apportant ce qu’elles voulaient aussi bien aux classes pauvres qu’aux élites de la pensée. Mais pour gagner ce rude combat, il ne pouvait manquer de caricaturer son rival et de l’enfermer dans son inquiétante étrangeté.
Julien Cohen-Lacassagne explique très bien comment certaines particularités juives ont pu être transformées en une essence distincte et incomparable selon les besoins de différentes causes. Dès les premiers siècles de notre ère s’est établie une concurrence intraitable entre chrétiens et juifs pour savoir lequel de leurs deux monothéismes prendrait la relève du paganisme romain déclinant, de moins en moins capable de satisfaire les aspirations religieuses d’un grand nombre de gens. Le christianisme a été vainqueur de cette longue compétition, apportant ce qu’elles voulaient aussi bien aux classes pauvres qu’aux élites de la pensée. Mais pour gagner ce rude combat, il ne pouvait manquer de caricaturer son rival et de l’enfermer dans son inquiétante étrangeté.
Le rôle néfaste du décret Crémieux qui à partir de 1870 « francise » les Juifs d’Algérie est d’avoir développé dans ce pays un antisémitisme d’autant plus dangereux que forcément lié à celui qui sévissait en France à la même époque—celle des années 1880 (La France juive, de Drumont est de 1886, et bientôt après arrive l’Affaire Dreyfus, évidemment).
C’est au sens figuré, requérant une interprétation religieuse et mystique, que les Juifs d’Afrique du Nord ont pu parler pendant des siècles de leur pays perdu et rêver d’y retourner un jour, qui mettrait fin à leur exil. Il était évidemment facile de les manipuler en jouant sur ce désir et sur ce rêve, comme l’a fait la propagande sioniste dès le moment où il s’agissait de faire d’Israël un Etat et une nation, après la Deuxième guerre mondiale.
On peut donc parler d’une série deux fois millénaire de circonstances qui ont contribué à enfermer les Juifs dans une essentialité échappant à toute Histoire, alors que c’est justement celle-ci, et elle seulement, qui est porteuse de rationalité. Les Juifs vivant en Israël sont sans doute les premières victimes de cette fabrication d’une judéité dans laquelle ils sont enfermés.
Julien Cohen-Lacassagne se réfère ici à ce qu’écrit un historien israélien, Shlomo Sand , qui a écrit la préface de son livre mais aussi plusieurs autres à titre personnel et revenant tous sur la même idée : Comment le peuple juif fut inventé (2008) , Comment la terre d’Israël fut inventée. De la Terre sainte à la mère patrie (2012). Le premier acte auquel nous sommes invités par le courant de pensée qu’il représente consiste à prendre conscience de cette fabrication, alors que tout est fait au contraire pour qu’elle nous apparaisse comme la Vérité— le V majuscule signifiant que ce discours, si néfaste, bénéficie de toutes les garanties y compris celle de la religion. Il faut évidemment beaucoup de courage pour s’y attaquer.
Denise Brahimi
« UNE FAROUCHE LIBERTE » de Gisèle Halimi avec Annick Cojean (Grasset, 2020)
Gisèle Halimi est morte il y a quelques semaines (été 2020) à l’âge de 93 ans. Elle était avocate de profession et elle a vécu comme une combattante pendant 7O ans de sa vie, au service de quelques causes qui n’ont jamais cessé d’être les siennes et qui l’ont rendue célèbre voire scandaleuse à certains moments de sa vie. La principale d’entre elles est la cause féministe, et c’est beaucoup là-dessus, évidemment, que la fait parler la journaliste  Annick Cojean qui a pris l’initiative de ce livre, composé d’une demi-douzaine d’entretiens.
Annick Cojean qui a pris l’initiative de ce livre, composé d’une demi-douzaine d’entretiens.
Bien que le ton du livre ne soit pas testamentaire (ce qui voudrait dire triste et cérémonieux), Gisèle Halimi y fait une sorte de bilan de ce qu’ont été ses principales actions et elle y ajoute pour finir des recommandations destinées aux femmes qui lui survivront, pour que jamais ne cesse un combat qui est encore bien loin d’être abouti.
De manière quasi juridique, on pourrait l’appeler le combat pour la parité mais cette formulation serait un peu restrictive car le féminisme de Gisèle Halimi n’a pas consisté seulement à essayer de faire passer des lois favorables aux femmes, et heureusement. En effet, elle souligne elle-même que dans ce domaine proprement politique, où elle a tenté de se lancer sous l’influence de François Mitterrand et lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, ses résultats ont été plus que médiocres, voire extrêmement décevants.
Il faut donc remonter plus avant, au moment où elle se consacre à sa carrière d’avocate, pour trouver les grands moments de son histoire, professionnelle certes, néanmoins soutenue par la force d’une intense passion.
C’est peut-être en essayant d’analyser ce qu’elle n’est pas qu’on peut tenter de définir ce qui fait l’essence de sa personnalité. Elle n’est pas une théoricienne du féminisme au sens où l’a été Simone de Beauvoir, même si d’emblée elle a voué au Deuxième Sexe et à son auteure la plus grande admiration. Ce qui l’éloigne de ce type d’action est qu’elle n’y trouve pas assez de passion, pour revenir à ce mot qui mieux que tout autre la définit. Avocate plus que juriste, elle a besoin d’aimer ceux et surtout celles qu’elle défend, et son action est motivée par le désir de les aider, contre l’injustice dont elles sont victimes. Finalement lorsqu’il s’agit de décrire ses motivations, elle en revient toujours à la formule qu’elle a faite sienne dès l’enfance, pour dire son refus et son indignation : « Ce n’est pas juste ! » disait la petite fille chaque fois que ses père et mère favorisaient outrageusement les garçons de la famille et obligeaient les filles, dont Gisèle, à les servir comme d’odieux petits chefs ; mais le pire était encore, chez les parents et surtout chez la mère, l’absence d’amour pour l’enfant Gisèle qui du seul fait qu’elle était une fille ne méritait que leur indifférence.
Arrivée au terme de sa vie, elle n’a pas oublié cette insoutenable injustice qui associe la prétendue infériorité féminine à la douleur de n’être pas aimée. On comprend par là pourquoi le combat féministe ne peut pas être dissocié, chez Gisèle Halimi du monde de l’amour, de l’affection et des sentiments.
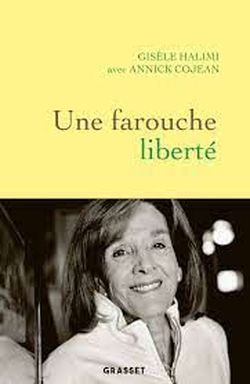 Il n’est pas difficile de comprendre comment la formule « ce n’est pas juste » a pu guider nombre de ses engagements et de ses choix. On la trouve évidemment à l’origine de l’engagement de Gisèle Halimi dans les combats menés par les peuples colonisés pour leur indépendance, là où elle les a suivis au plus près, en Algérie et en Tunisie. Le soutien qu’elle a apporté (1961-1962) à la militante algérienne Djamila Boupacha est exemplaire : celle-ci ayant été odieusement torturée par l’armée française, celle qui devient son avocate ameute, avec l’aide de Simone de Beauvoir, toutes les consciences humanistes de l’époque, au nom d’une compassion pour cette jeune femme martyrisée, et en dehors de toute adhésion à tel ou tel parti politique, le FLN ou autre. C’est de la même manière que Jean-Paul Sartre qu’elle a été proche du parti communiste, par une sorte de générosité personnelle qui la met du côté des opprimés et des victimes de l’injustice. Elle dit d’ailleurs très chaleureusement toute la sympathie qu’elle ressent pour l’homme Sartre, qui est pour elle l’image même de la bonté.
Il n’est pas difficile de comprendre comment la formule « ce n’est pas juste » a pu guider nombre de ses engagements et de ses choix. On la trouve évidemment à l’origine de l’engagement de Gisèle Halimi dans les combats menés par les peuples colonisés pour leur indépendance, là où elle les a suivis au plus près, en Algérie et en Tunisie. Le soutien qu’elle a apporté (1961-1962) à la militante algérienne Djamila Boupacha est exemplaire : celle-ci ayant été odieusement torturée par l’armée française, celle qui devient son avocate ameute, avec l’aide de Simone de Beauvoir, toutes les consciences humanistes de l’époque, au nom d’une compassion pour cette jeune femme martyrisée, et en dehors de toute adhésion à tel ou tel parti politique, le FLN ou autre. C’est de la même manière que Jean-Paul Sartre qu’elle a été proche du parti communiste, par une sorte de générosité personnelle qui la met du côté des opprimés et des victimes de l’injustice. Elle dit d’ailleurs très chaleureusement toute la sympathie qu’elle ressent pour l’homme Sartre, qui est pour elle l’image même de la bonté.
Dans l’histoire des femmes, Gisèle Halimi s’est rendue célèbre par le procès de Bobigny (octobre-novembre 1972), où elle a plaidée la cause d’une jeune femme qui avait avorté avec l’aide de sa mère pour avoir subi un viol. Pour les femmes impliquées dans cette affaire, dont la principale victime, son empathie a été totale, prenant la forme d’une amitié fervente, et active ô combien. Gisèle Halimi est une femme qui « paye de sa personne » selon une formule populaire, qui ici souligne le caractère très pratique et très concret de l’aide qu’elle apporte. Les jeunes femmes qu’elle prend en charge en tant qu’avocate deviennent pour elle bien plus que des clientes, ce sont des amies et l’on irait presque jusqu’à dire ses filles, du fait qu’elle dit par ailleurs son regret de ne pas en avoir eu (en plus de ses trois fils).
Cette sorte d’implication personnelle, qui est sa manière propre, n’est évidemment pas sans danger, pour commencer physiquement (où l’on retrouve l’expression « payer de sa personne ») et l’on s’étonne du courage dont elle a fait preuve, alors qu’elle-même, rétrospectivement, en fait si peu état. Certaines féministes diraient que cette sorte de modestie et d’effacement de soi est justement ce qui différencie les femmes des « héros » masculins beaucoup plus portés à valoriser leurs hauts faits pour leur propre gloire. Dans la lutte pour dépénaliser l’avortement, Gisèle Halimi a certainement joué un rôle essentiel mais peu importe que la loi qui a marqué finalement cette immense avancée dans la cause des femmes ne porte pas son nom, on croit comprendre à lire les réponses obtenues par Annik Cojean que ce qui compte pour elle n’est pas la célébrité mais bien davantage la chaleur des amitiés partagées. Et c’est très émouvant.
Denise Brahimi
« LA PETITE DERNIERE » par Fatima Daas, roman, éditions Noir sur blanc, collection Notabilia, 2020
Ce livre a été annoncé comme l’un des plus beaux fleurons de la rentrée littéraire 2020, premier roman d’une personne de 25 ans qui se définit elle-même, nous dit-on, comme une féministe intersectionnelle, ce qui veut dire que toutes les formes de discrimination dont elle s’estime victime doivent être vues comme un ensemble au sein duquel ce qui compte est leur interaction. Pour résumer ce qui est raconté dans le roman (d’ailleurs assez court), les deux ou trois discriminations qui pèsent principalement sur Fatima  peuvent être dites assez simplement. D’une part elle est née dans une famille algérienne de France, dans une banlieue parisienne à Clichy-sous-Bois ; et elle est vraiment musulmane, non seulement parce qu’elle suit en cela tous les autres membres de sa famille, mais parce qu’elle adhère personnellement à l’islam et se soucie beaucoup d’être fidèle aux préceptes du Coran. D’autre part, elle découvre assez vite son orientation sexuelle particulière, qui dès l’enfance fait d’elle un garçon manqué et plus tard une lesbienne, lorsque à l’adolescence elle éprouve de l’attirance pour les femmes exclusivement. Or il va de soi que cette homosexualité est réprouvée par l’islam.
peuvent être dites assez simplement. D’une part elle est née dans une famille algérienne de France, dans une banlieue parisienne à Clichy-sous-Bois ; et elle est vraiment musulmane, non seulement parce qu’elle suit en cela tous les autres membres de sa famille, mais parce qu’elle adhère personnellement à l’islam et se soucie beaucoup d’être fidèle aux préceptes du Coran. D’autre part, elle découvre assez vite son orientation sexuelle particulière, qui dès l’enfance fait d’elle un garçon manqué et plus tard une lesbienne, lorsque à l’adolescence elle éprouve de l’attirance pour les femmes exclusivement. Or il va de soi que cette homosexualité est réprouvée par l’islam.
On assiste, mais sans que l’aspect psychanalytique de son cas soit particulièrement développé, aux difficultés qui en résultent pour le personnage principal du livre jusqu’à ce qu’elle ait une trentaine d’années—alors que Fatima Daas elle-même n’en a encore que vingt-cinq. On est donc en présence d’un genre très répandu et peut-être surtout dans l’écriture féminine, l’auto-fiction. Il est évident que Fatima Daas prête à son personnage un certain nombre de ses propres caractéristiques, nous ne pouvons pas savoir ce qu’elle a modifié ou remodelé, mais on est rassuré à la lire sur ce qu’on pourrait appeler la sincérité de son témoignage. Le livre, bien qu’il en soit au tout début de sa carrière a déjà été beaucoup prévendu si l’on peut dire les choses ainsi grâce à une présentation aguichante et bien dans l’air du temps, être femme, être musulmane, être passionnée par l’islam et fréquenter assidûment les imams pour leur demander conseil, et par-dessus tout être homosexuelle aussi éloignée que possible, physiquement et mentalement, de ce qui est désigné dans le livre comme l’hétérosexualité cisgenre (le contraire de transgenre ), attribuée plus particulièrement à l’homme blanc pour faire bon poids dans l’ensemble des tares dont ce dernier est accablé aujourd’hui.
Ce type de présentation médiatique, qui d’ailleurs n’est pas une falsification mais plutôt une sorte de distorsion, a de quoi inquiéter. Disons tout de suite que la lecture du livre lui-même vaut beaucoup mieux que cette enveloppe scandaleuse. Virginie Despentes, qui vient à l’appui du livre de Fatima, en souligne ce qu’elle n’appellerait sans doute pas sa pudeur, mais en tout cas « la délicatesse de son style », sa discrétion et sa « tendresse inouïe pour les siens ». Pour parler de cette heureuse surprise, un moyen possible est de dire tout ce que le livre de Fatima n’est pas et ne cherche pas à être.
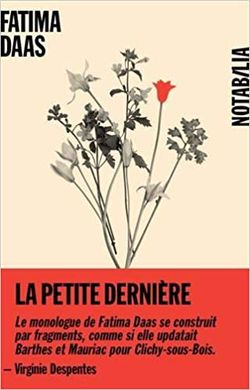 La petite dernière n’est pas un livre féministe au sens où l’héroïne refuserait (consciemment ou pas) d’être femme parce que ce statut serait irrémédiablement une marque d’infériorité. Comme dans toute société restée traditionnelle on constate que les rôles sont radicalement séparés, le domaine réservé à la mère étant la cuisine, mais on peut dire qu’elle y règne en donnant à ce verbe son sens le plus fort. Et son influence au sein de la famille est certainement supérieure à celle de son mari. Globalement d’ailleurs, dans la petite portion de société que le roman donne à voir, le machisme ne semble pas sévir, pas plus que l’autre fléau social si souvent dénoncé, à savoir le racisme. Il n’est pas l’une des cibles du livre de Fatima : dans ce roman d’une Algérienne de France, le racisme ordinaire est fort peu présent, c’est une intéressante singularité !
La petite dernière n’est pas un livre féministe au sens où l’héroïne refuserait (consciemment ou pas) d’être femme parce que ce statut serait irrémédiablement une marque d’infériorité. Comme dans toute société restée traditionnelle on constate que les rôles sont radicalement séparés, le domaine réservé à la mère étant la cuisine, mais on peut dire qu’elle y règne en donnant à ce verbe son sens le plus fort. Et son influence au sein de la famille est certainement supérieure à celle de son mari. Globalement d’ailleurs, dans la petite portion de société que le roman donne à voir, le machisme ne semble pas sévir, pas plus que l’autre fléau social si souvent dénoncé, à savoir le racisme. Il n’est pas l’une des cibles du livre de Fatima : dans ce roman d’une Algérienne de France, le racisme ordinaire est fort peu présent, c’est une intéressante singularité !
S’agissant du fait qu’elle est musulmane, et très désireuse de l‘être profondément, on ne voit pas non plus que personne l’en empêche, et comme il y a des Françaises, ou chrétiennes, parmi les amies de cœur qu’elle fréquente à l’âge adulte, on croit pouvoir dire que la différence de religion n’intervient jamais entre elles, en tout cas pas directement. Ici encore, la sincérité de l ‘auteure se voit au fait qu’elle ne se sent nullement tenue de reprendre les poncifs et les clichés qui à un certain niveau semblent depuis longtemps des « must » du roman algéro-français.
Fatima Daas prend au sérieux les différences propres au milieu qui est le sien en s’attachant au langage, c’est-à-dire à l’arabe populaire et dialectal que parle sa mère essentiellement. Est-ce parce qu’il y en elle une vocation d’écrivaine, c’est-à-dire une passion pour les mots ? En tout cas beaucoup d’auteurs, qui pourraient le faire de la même façon, s’en tiennent en général à quelques mots ou formules en arabe, qui jouent beaucoup plus comme une convention que dans le sens de l’authenticité.
Cette volonté d’authenticité est encore plus flagrante dans la façon dont elle fait le portrait d’une jeune femme musulmane, vivant en France et s’interrogeant sur ce que signifient les préceptes du Coran : Fatima n’a par ailleurs rien de commun avec les dévotes voilées qui semblent une part non négligeables des ouailles formées par les islamistes. Le livre encore une fois nous amène à nous interroger sur la valeur de ces images dominantes dont nous sommes abreuvés par les médias, d’autant plus sans doute que les dites ouailles, hélas, se trouvent parfois mêlées de très près au terrorisme et aux crimes qu’il commet.
Les problèmes que pose Fatima Daas ne sont pas ceux auxquels on (=les médias) donne la plus grande visibilité et l’on pourrait croire que les tentatives d’ajustement entre la foi et les mœurs sont ou ont été l’apanage d’une élite pensante de la chrétienté. Etant donné la proportion bien connue (et souvent déplorée !) de Musulmans dans la société française, il est important et précieux qu’une jeune femme comme Fatima Daas, à partir de son exemple personnel, montre très simplement que ce type de difficulté existentielle se trouve dans toutes les communautés. Difficulté de savoir ce que veut dire « être soi », pour une jeune femme comme elle qui essaye de faire tenir ensemble toutes les composantes de sa personnalité. « Je m’appelle Fatima Daas », écrit-elle en tête de chaque chapitre. Et dès les lignes qui suivent, on voit les problèmes affluer !
Denise Brahimi
« RETOURS D’HISTOIRE, L’ALGERIE APRES BOUTEFLIKA » par Benjamin Stora, Bayard 2020
Ce petit livre renvoie à beaucoup d’œuvres du même auteur, qui sont nombreuses comme on sait.
Publié un an après le début du hirak, il en signale évidemment l’importance, très grande aux yeux de son auteur. Mais il est clair que Benjamin Stora est historien, non prophète, il ne peut donc pas parler d’une Algérie après (ou pendant) le covid, ni répondre aux nombreuses questions qu’on se pose sur l’état tout à fait actuel du pays. En revanche il remonte dans le passé pour expliquer comment on en est arrivé au hirak, et cette remontée le ramène à l’indépendance du pays en 1962. Il montre comment les jeunes qui se sont manifestés, notamment pour refuser un nouveau et ennième mandat de Bouflika, évidemment insensé et inacceptable, ont un rapport tout à fait contemporain et inédit à la guerre d’indépendance : d’une part, ils reviennent volontiers au nom et au souvenir de ses  acteurs et Benjamin Stora insiste sur leur pluralité qui a été gommée pendant plusieurs décennies, du fait que le FLN voulait être le seul à s’imposer. D’autre part le nationalisme qui a été l’idéologie dominante (et c’est peu dire) pendant celle même période n’est pas la doctrine à laquelle s’attachent les jeunes manifestants du hirak, en fait il semble même qu’ils évitent toute doctrine par laquelle ils risqueraient d’être éventuellement récupérés, au profit d’une revendication pour la démocratie—mot immense, certes, mais dont le sens est pourtant bien clair. L’une des conséquences qui en découle est la volonté d’en finir avec toutes les équipes dirigeantes qui ont prétendu gérer l’Etat-Nation depuis 1962 et qui immanquablement l’ont fait à leur profit.
acteurs et Benjamin Stora insiste sur leur pluralité qui a été gommée pendant plusieurs décennies, du fait que le FLN voulait être le seul à s’imposer. D’autre part le nationalisme qui a été l’idéologie dominante (et c’est peu dire) pendant celle même période n’est pas la doctrine à laquelle s’attachent les jeunes manifestants du hirak, en fait il semble même qu’ils évitent toute doctrine par laquelle ils risqueraient d’être éventuellement récupérés, au profit d’une revendication pour la démocratie—mot immense, certes, mais dont le sens est pourtant bien clair. L’une des conséquences qui en découle est la volonté d’en finir avec toutes les équipes dirigeantes qui ont prétendu gérer l’Etat-Nation depuis 1962 et qui immanquablement l’ont fait à leur profit.
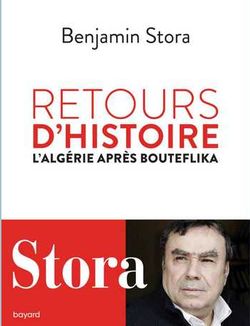 Avant même les événements de 2020, comportant le coup de frein considérable et imprévu apporté par la pandémie, s’est posée la question de savoir ce qu’il en serait du gouvernement élu en décembre 2019.On sait que les élections ont mis au pouvoir le Président Tebboune, qui y est encore aujourd’hui. Au moment où Benjamin Stora écrit ces Retours d’histoire, il est bien trop tôt pour trancher et c’est sans doute encore le cas aujourd’hui. La volonté de mettre un terme à la corruption s’est manifestée clairement, par de nombreuses et rudes condamnations. Cependant, dans toute la partie historique du livre, qui a justement été annoncé comme « retours », on s’est remis en mémoire un certain nombre d’événements plus ou moins violents qui auraient pu déboucher sur une révolution et qui ne l’ont pas fait, en ce sens qu’ils n’ont pas entraîné de changement politique essentiel ou même de changement à un sens beaucoup plus large (comportant le passage désiré à la démocratie). Le Président Tebboune pourrait-il être l’homme de ce changement ? Rien ne permet de le supposer. Et pourtant on ne peut croire disparues les aspirations exprimées par les gens du hirak (en plus des actifs, il est certain que le mouvement a suscité un très grand nombre de supporters). La question pourrait être : sous quelle forme, quand et comment feront-elles leur réapparition ?
Avant même les événements de 2020, comportant le coup de frein considérable et imprévu apporté par la pandémie, s’est posée la question de savoir ce qu’il en serait du gouvernement élu en décembre 2019.On sait que les élections ont mis au pouvoir le Président Tebboune, qui y est encore aujourd’hui. Au moment où Benjamin Stora écrit ces Retours d’histoire, il est bien trop tôt pour trancher et c’est sans doute encore le cas aujourd’hui. La volonté de mettre un terme à la corruption s’est manifestée clairement, par de nombreuses et rudes condamnations. Cependant, dans toute la partie historique du livre, qui a justement été annoncé comme « retours », on s’est remis en mémoire un certain nombre d’événements plus ou moins violents qui auraient pu déboucher sur une révolution et qui ne l’ont pas fait, en ce sens qu’ils n’ont pas entraîné de changement politique essentiel ou même de changement à un sens beaucoup plus large (comportant le passage désiré à la démocratie). Le Président Tebboune pourrait-il être l’homme de ce changement ? Rien ne permet de le supposer. Et pourtant on ne peut croire disparues les aspirations exprimées par les gens du hirak (en plus des actifs, il est certain que le mouvement a suscité un très grand nombre de supporters). La question pourrait être : sous quelle forme, quand et comment feront-elles leur réapparition ?
Denise Brahimi

« ADN », film de Maïwenn, octobre 2020
Tous les gens qui ont l’Algérie au cœur—et à Coup de soleil ils sont évidemment nombreux—seront émus par l’enthousiasme de Maïwenn à l’égard de ce pays. Il est présenté dans le film comme le lieu unique où, pour le dire très banalement, elle se sent bien ; ou encore si l’on emploie le langage des psy, comme celui où elle éprouve une « levée d’angoisse », soulageant le mal être qui est ordinairement le sien. Qu’il s’agisse d’une Algérie rêvée ou en tout cas refaite et réinventée selon ses désirs, on ne peut en douter lorsqu’on entend l’hommage exalté qu’elle lui dédie à la fin du film, et qui ne correspond guère,  évidemment, à ce qu’on sait de l’Algérie du moment. Mais déjà bien auparavant, on a vu poindre chez elle cette sorte de mythe ou d’utopie qui vient à point nommé se substituer à ce qui semble avoir été sa raison de vivre des années durant. Car elle ne la trouvait qu’en la personne de son grand-père maternel, vieil Algérien qu’on voit mourir au début du film, laissant toute la famille dans le plus profond désarroi. Tous savent très bien qu’il était le seul à assurer la cohésion de ce groupe disparate, indocile, constamment en état de brouille et se chamaillant sans modération !
évidemment, à ce qu’on sait de l’Algérie du moment. Mais déjà bien auparavant, on a vu poindre chez elle cette sorte de mythe ou d’utopie qui vient à point nommé se substituer à ce qui semble avoir été sa raison de vivre des années durant. Car elle ne la trouvait qu’en la personne de son grand-père maternel, vieil Algérien qu’on voit mourir au début du film, laissant toute la famille dans le plus profond désarroi. Tous savent très bien qu’il était le seul à assurer la cohésion de ce groupe disparate, indocile, constamment en état de brouille et se chamaillant sans modération !
L’héroïne du film, Neige, qui représente en partie Maïwenn elle-même, est plus que désemparée par la disparition de ce grand père adoré qui d’ailleurs avait déjà perdu depuis quelque temps ses facultés, mais restait, du moins symboliquement, celui autour duquel toute la famille pouvait s’entendre et se regrouper. Avant même que ne soit finie la cérémonie d’incinération, les dissensions recommencent et Maïwenn s’emploie à les faire proliférer sous les yeux du public, pris comme elle-même entre rire et malaise, ou effarement. Dans son propre cas, il faudrait d’ailleurs pour le dire un mot beaucoup plus fort que malaise : on la voit souffrir dans tout son être, y compris physiquement, jusqu’à une sorte d’exténuation de son corps vidé de toute substance par l’anorexie. Il y a ou il y a eu quelque chose que Maïwenn (ici en la personne de son double Neige) n’a pas pu ou ne peut pas supporter, et c’est justement de cela qu’une partie de ses films sont faits, comme si filmer était le seul moyen qu’elle ait trouvé de coexister avec son passé ( n’est-ce pas aussi le cas de François Truffaut, pour ne prendre qu’un exemple parmi les plus célèbres ? ) Cet sorte d’enfer familial, dont on sait et dont on sent qu’il dure depuis l’origine des temps, Maïwenn excelle à le montrer, dans les moments de ses films les plus proches de l’autobiographie, même si elle en retravaille les données dans ce qu’il vaudrait sans doute mieux appeler de l’autofiction. On a parfois l’impression qu’elle s’acharne avec une insistance excessive et mauvaise à le mettre en scène dans ses moindres détails ; mais comme le terme même d’ADN nous incite à le comprendre, elle s’y attache comme au terreau intime et profond duquel elle tire à peu près toute sa substance— peut-être jugera-t-elle un jour qu’il est épuisé, mais ce n’est manifestement pas encore le cas aujourd’hui.
 L’intérêt de cette façon de faire (ou de cette manière d’être) est qu’il y a à la fois ressassement et variations. On croit en tout cas percevoir dans ce dernier film « ADN » l’esquisse d’un mouvement et d’un élargissement de ce lieu où elle creuse depuis des décennies pour y puiser sa raison d’être, si toxique qu’elle soit : le mot toxique est employé plusieurs fois dans le film, aussi bien pour parler du couple parental à son égard que d’elle-même à l’égard des autres, ses proches parfois très proches et qui sont nombreux. Maïwenn a maintenant 44 ans et on commence à sentir à travers Neige qu’elle n’est plus une jeune femme. Un fait sans doute déterminant est que Neige, comme il est montré dans le film (en de jolis moments) est mère de trois enfants, ce qui ne peut manquer d’avoir un effet, conscient ou non, sur son rapport à la maternité et sans doute, sur une certaine idée de la transmission—ouvertement impliquée par le titre qu’elle a choisi. Pour commencer par le plus proche, c’est-à-dire le rapport à la mère, on peut aussi penser qu’il est influencé par l’actrice qui est chargée de l’incarner, ici Fanny Ardant. Celle-ci, même dans ses moments de violence, incarne une authentique conviction et elle n’est jamais dépourvue d’un certain charisme. Elle n’apparaît pas comme la cause unique ni même principale de la difficulté d’être qui caractérise sa fille. Cette charge est équitablement répartie sur l’autre parent, c’est-à-dire le père, dont le portrait, nettement satirique, est moins marqué par l’angoisse et l’ambiguité. Il y a certes une effrayante cruauté dans les propos que Neige tient à sa mère dans une sorte d’ultime affrontement qui a lieu à la sortie du cimetière du Père Lachaise où le grand-père vient d’être enterré. Mais le film prend aussi en compte la douleur de la mère, non sans compassion. On croit percevoir des signes d’une évolution qui amènerait la réalisatrice à se chercher bien au-delà de la relation avec le couple parental, dans un rapport avec l’origine qui a été longtemps incarnée par le grand-père aujourd’hui défunt. Défunt mais toujours présent en ce sens qu’il est la voie dans laquelle elle sent irrésistiblement qu’elle doit et qu’elle veut s’engager. Cette ultime étape n’est pas moins que les autres marquée par l’humour et le drôlerie propres à Maïwenn et causes de son succès. Elle est ici bien aidée par son acteur Louis Garrel , constamment désopilant . Mais non moins drôle est l’acteur franco-algérien connu pour cette qualité, Lyes Salem qui se charge de procurer à Neige les papiers dont elle a besoin pour aller en Algérie, et ce par pure sympathie pour sa naïveté et sa fantaisie.
L’intérêt de cette façon de faire (ou de cette manière d’être) est qu’il y a à la fois ressassement et variations. On croit en tout cas percevoir dans ce dernier film « ADN » l’esquisse d’un mouvement et d’un élargissement de ce lieu où elle creuse depuis des décennies pour y puiser sa raison d’être, si toxique qu’elle soit : le mot toxique est employé plusieurs fois dans le film, aussi bien pour parler du couple parental à son égard que d’elle-même à l’égard des autres, ses proches parfois très proches et qui sont nombreux. Maïwenn a maintenant 44 ans et on commence à sentir à travers Neige qu’elle n’est plus une jeune femme. Un fait sans doute déterminant est que Neige, comme il est montré dans le film (en de jolis moments) est mère de trois enfants, ce qui ne peut manquer d’avoir un effet, conscient ou non, sur son rapport à la maternité et sans doute, sur une certaine idée de la transmission—ouvertement impliquée par le titre qu’elle a choisi. Pour commencer par le plus proche, c’est-à-dire le rapport à la mère, on peut aussi penser qu’il est influencé par l’actrice qui est chargée de l’incarner, ici Fanny Ardant. Celle-ci, même dans ses moments de violence, incarne une authentique conviction et elle n’est jamais dépourvue d’un certain charisme. Elle n’apparaît pas comme la cause unique ni même principale de la difficulté d’être qui caractérise sa fille. Cette charge est équitablement répartie sur l’autre parent, c’est-à-dire le père, dont le portrait, nettement satirique, est moins marqué par l’angoisse et l’ambiguité. Il y a certes une effrayante cruauté dans les propos que Neige tient à sa mère dans une sorte d’ultime affrontement qui a lieu à la sortie du cimetière du Père Lachaise où le grand-père vient d’être enterré. Mais le film prend aussi en compte la douleur de la mère, non sans compassion. On croit percevoir des signes d’une évolution qui amènerait la réalisatrice à se chercher bien au-delà de la relation avec le couple parental, dans un rapport avec l’origine qui a été longtemps incarnée par le grand-père aujourd’hui défunt. Défunt mais toujours présent en ce sens qu’il est la voie dans laquelle elle sent irrésistiblement qu’elle doit et qu’elle veut s’engager. Cette ultime étape n’est pas moins que les autres marquée par l’humour et le drôlerie propres à Maïwenn et causes de son succès. Elle est ici bien aidée par son acteur Louis Garrel , constamment désopilant . Mais non moins drôle est l’acteur franco-algérien connu pour cette qualité, Lyes Salem qui se charge de procurer à Neige les papiers dont elle a besoin pour aller en Algérie, et ce par pure sympathie pour sa naïveté et sa fantaisie.
S’agissant de la réalisatrice elle-même, on est amené à se dire que son art est sans doute beaucoup moins naïf et spontané qu’elle ne veut en donner l’impression. Car il y a finalement dans « ADN », entre les forces de la vie et du rire d’une part et celles de la destruction et de l’autodestruction d’autre part, un équilibre remarquablement géré. Son mélange très personnel du rire et des larmes est d’un effet captivant.
Denise Brahimi
Un autre regard:
L’ouverture du film ADN se fait autour du Grand Père Emir, qui représente le pilier,
« la colonne vertébrale » de la famille. Tout semble normal, il est entouré de ses
enfants et petits enfants, mais à à sa mort, dans un EPAHD, en France, les tensions au
sein de la famille éclatent. Tout devient source de conflit, le choix du cercueil, en
carton ou en bois, le tissu qui doit tapisser l’intérieur du cercueil, la cérémonie
religieuse… Contre toute attente, la seule chose qui n’est pas discutée est son
incinération.
 Les conflits familiaux, les rancunes étouffées s’expriment à travers des répliques
Les conflits familiaux, les rancunes étouffées s’expriment à travers des répliques
assassines et drôles. On pleure, on rit. Côté dialogues, Maïwenn a laissé toute liberté
aux plus doués de ses acteurs.
Les EHPAD ne sont pas épargnés et en prennent pour leur grade.
La cérémonie des funérailles donne lieu à des scènes cocasses.
Neige, contraction de Nedjma , prénom que son père d’origine franco-vietnamienne a
refusé de lui donner, adore son grand-père et est en quête d’identité algérienne. A
travers son Algériannité, elle essaye de retrouver les repères affectifs qu’elle n’a pas
eu avec sa mère, une femme dure, qui elle, est algérienne et ce père distant et
indifférent, avec qui elle ne s’entend pas.
A travers Neige, torturée, écorchée vive, Maïwenn nous montre à quel point la double
appartenance peut être douloureuse pour les plus fragiles. Autant son frère et ses
soeurs, le vivent bien, autant cette double , voire triple identité la perturbe. Sa vie est
entièrement et désespérément tournée vers l’Algérie, au point qu’elle ne comprend
pas que sa future belle-soeur soit heureuse de prendre le nom de famille de son mari
et de s’appeler « ROBERT ».
Cela devient obsessionnel au point de nuire à sa santé. Elle finit par faire une
recherche ADN dont le résultat ne semble pas la satisfaire….pas assez algérienne à
son goût, et tente de persuader son père de lui donner sa salive afin de faire une
recherche de son côté.
Elle finit par s’apaiser lorsqu’elle obtient la nationalité algérienne afin de renouer
avec les racines de son grand-père.
Elle se sent tellement, et enfin en accord avec elle même ….. et avec sa quête
d’appartenance au Pays, qu’elle se rend à Alger au moment du Hirak, ville que Maïwenn
connait bien puisqu’elle y passait ses vacances auprès de son grand-père durant toute
son enfance.
Zahia Merzoug

Notre association nationale doit d’urgence remettre en état son site internet. Il lui faut pour cela recueillir des soutiens financiers.
Si vous souhaitez contribuer à cet important élément de vie de notre association, merci de cliquer ICI, et d’apporter votre obole via Hello Asso.

La recrudescence de la pandémie a une fois de plus mis à mal nos projets qui étaient nombreux en cette fin d’année. Nous les reporterons pour l’essentiel à des temps où la rencontre sera possible sans en craindre des conséquences sanitaires. D’autres beaux projets sont à l’étude. Patience! Et prenez soin de vous.
Ne vous privez pas en cette période de repli, de lire tous les beaux livres que nous commentons pour vous.
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


Merci Denise Brahimi pour le travail de lecture accompli.
Puisque nous sommes re.confiné.e.s, nous lirons ces livres achetés en librairie, guidé.e.s par tes lignes tentantes.
Avec toute ma sympathie, prends soin de ta santé comme chacun.e d’entre nous.
À bientôt pour faire la fête, Annie.
Comme chaque mois une lettre à savourer et plus puisque pleine d’enseignement.
Si coup de soleil n’existait pas il serait grand temps de l’inventer.
Un grand merci à toute l’équipe avec toute ma solidarité.
Pierre
Pingback: ADN, film de Maiwenn – Coup de Soleil Sud
Pingback: ADN, film de Maiwenn | Coup de Soleil