Lettre culturelle franco-maghrébine #60
ÉDITO
Vous avez sans doute pris l’habitude de trouver dans chaque Lettre la présentation d’un film récent, eh ! bien cette fois, vous en trouverez deux, du fait que Coup de soleil est de plus en plus sollicité pour présenter des films en salle au moment de leur sortie. C’est le cas pour Leur Algérie de Lina Soualem (film tourné à Thiers dans le Puy de Dôme).De plus le film de Nabil Ayouch, Haut et fort, qui flirte avec la comédie musicale, peut passer pour un cadeau de Noël que nous fait le réalisateur !
La Lettre présente aussi deux romans aussi dont le trait commun est d’être publiés par le même éditeur : Un si proche ennemi de Gilles Gauthier et Mustapha s’en va-t-en guerre de David Hury, l’un et l’autre aux éditions Riveneuve
Et deux ouvrages de réflexion historique voire philosophique sur des grands sujets problématiques, en tout cas en débat sinon occultés : vous en trouverez un dans le livre de Faouzia Charfi , L’islam et la science, et l’autre dans un numéro de la revue Historia, « La Traite arabo-musulmane » où il est question de l’esclavage en terres d’islam, sous la direction de Salah Trabelsi.
Nous voulions vous présenter depuis quelque temps déjà un livre coup de poing, remarquable et remarqué puisqu’il a déjà obtenu plusieurs prix, ce « Bel Abîme » du Tunisien Yamen Manaï, que nous devons aux éditions Elyzad, comme son précédent livre, L’amas ardent (2017)
De cette grande créativité on pouvait avoir une idée, malgré les restrictions sanitaires, au Model (Maghreb-Orient des livres) de février dernier. Claude Bataillon continue à nous en envoyer des résumés (qu’on peut également trouver sur Youtube).
Denise Brahimi

« UN SI PROCHE ENNEMI » par Gilles Gauthier, roman, Riveneuve, 2021
Ce roman inspiré de faits réels renvoie à deux dates que séparent une dizaine d’années. Le moment présent, (néanmoins suivi d’un épilogue plus récent) se situe en 1994, c’est-à-dire du point de vue algérien, en plein pendant la décennie noire lorsque sévit dans toute sa force le terrorisme islamique, ici sous la forme d’une prise d’otages entre la France et l’Algérie. Ce présent est mis en relation avec un passé un peu plus ancien, daté de 1984 et qui à partir de cette date s’est prolongé un peu dans le temps. Les deux épisodes bien distincts chronologiquement prennent dans le livre la forme de chapitres alternés, mode de composition à la fois simple et efficace, un peu mécanique peut-être—du moins y a-t-il dans ce récit une parfaite clarté, d’autant que les deux personnages principaux restent les mêmes, un jeune Français Marc qui lorsque l’histoire commence s’est engagé à titre d’enseignant coopérant comme on disait à l’époque et se trouve à ce titre nommé au lycée de Biskra, et un adolescent algérien Noureddine qui fait partie de ses plus grands élèves.
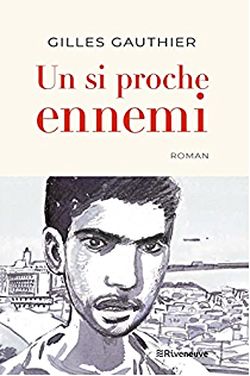 Tout se joue dans leur relation, un temps heureuse avant de devenir tragique. Le premier moment est sans doute le plus plaisant à lire et paraît le plus réussi, peut-être parce que nourri de souvenirs personnels, en tout cas très touchant lorsqu’une histoire d’amour se développe entre les deux garçons. Le temps n’est plus des histoires qui avaient ravi André Gide dans ce même lieu (1895), c’est à peine s’il y est fait allusion, et cet amour n’est nullement enfermé dans une description de la jouissance érotique, même si elle y est bien présente. Il n’est pas non plus conflictuel pour des raisons de mœurs ou de moralité, en revanche il se perd dans une autre sorte de conflit, celui que Noureddine n’arrive pas à surmonter entre son sentiment amoureux pour Marc et ses exigences religieuses qui sont celle d’un Musulman de plus en plus marqué par l’islamisme.
Tout se joue dans leur relation, un temps heureuse avant de devenir tragique. Le premier moment est sans doute le plus plaisant à lire et paraît le plus réussi, peut-être parce que nourri de souvenirs personnels, en tout cas très touchant lorsqu’une histoire d’amour se développe entre les deux garçons. Le temps n’est plus des histoires qui avaient ravi André Gide dans ce même lieu (1895), c’est à peine s’il y est fait allusion, et cet amour n’est nullement enfermé dans une description de la jouissance érotique, même si elle y est bien présente. Il n’est pas non plus conflictuel pour des raisons de mœurs ou de moralité, en revanche il se perd dans une autre sorte de conflit, celui que Noureddine n’arrive pas à surmonter entre son sentiment amoureux pour Marc et ses exigences religieuses qui sont celle d’un Musulman de plus en plus marqué par l’islamisme.
Tous ceux qui connaissent un peu l’histoire récente de l’Algérie à la fin du 20e siècle savent que la montée de l’islamisme s’y manifeste de plus en plus dans les années 1988, 1990-91 et ensuite à peu près juste à la fin de cette décennie. L’islamisme est lié à un violent rejet du gouvernement en place et on voit peu à peu comment Nourredine n’a pour celui-ci que haine et mépris, en même temps qu’il déteste toutes les influences occidentales et la mentalité française, même supposée de gauche, dont il prend connaissance lorsqu’il vient passer des vacances en France avec Marc.
 On comprend que Noureddine désormais séparé de Marc a été gagné à la cause islamiste, lorsqu’on entre dans la deuxième série d’événements, ceux de 1994, c’est-à-dire la prise d’otages d’un avion par les terroristes, à l’aéroport d’Alger puis à Marignane. Marc travaille désormais dans la diplomatie française au quai d’Orsay et à dire vrai ce n’est pas une surprise lorsqu’on comprend que le chef des terroristes est ce même Noureddine qu’il n’a jamais cessé d’aimer. En raison de cette ancienne relation dont il fait l’aveu, Marc est choisi pour tenter d’aller négocier dans l’avion, ce qui échoue comme on pouvait s’y attendre, mais on a le temps d’assister à la longue conversation qui permet entre les deux hommes et anciens amis une sorte de rapprochement très intime et très fort, même s’il n’est pas suivi d’effet. La scène n’est sans doute pas très réaliste ni vraisemblable, pourtant elle est d’une part émouvante et d’autre part essentielle pour l’auteur Gilles Gauthier qui s’engage vaillamment pour la défense d’une cause sans doute difficile à faire entendre par les temps qui courent, notamment auprès du lectorat français. « Un si proche ennemi » en effet prend partiellement la défense des terroristes, sans approuver leurs crimes évidemment, mais en essayant de montrer qu’ils ne sont pas des monstres, et qu’ils se trouvent entraînés aux actes meurtriers qu’ils commettent par un ensemble de circonstances et de raisons dont ils sont les premières victimes —et autres arguments auxquels réfléchiront les lecteurs du roman.
On comprend que Noureddine désormais séparé de Marc a été gagné à la cause islamiste, lorsqu’on entre dans la deuxième série d’événements, ceux de 1994, c’est-à-dire la prise d’otages d’un avion par les terroristes, à l’aéroport d’Alger puis à Marignane. Marc travaille désormais dans la diplomatie française au quai d’Orsay et à dire vrai ce n’est pas une surprise lorsqu’on comprend que le chef des terroristes est ce même Noureddine qu’il n’a jamais cessé d’aimer. En raison de cette ancienne relation dont il fait l’aveu, Marc est choisi pour tenter d’aller négocier dans l’avion, ce qui échoue comme on pouvait s’y attendre, mais on a le temps d’assister à la longue conversation qui permet entre les deux hommes et anciens amis une sorte de rapprochement très intime et très fort, même s’il n’est pas suivi d’effet. La scène n’est sans doute pas très réaliste ni vraisemblable, pourtant elle est d’une part émouvante et d’autre part essentielle pour l’auteur Gilles Gauthier qui s’engage vaillamment pour la défense d’une cause sans doute difficile à faire entendre par les temps qui courent, notamment auprès du lectorat français. « Un si proche ennemi » en effet prend partiellement la défense des terroristes, sans approuver leurs crimes évidemment, mais en essayant de montrer qu’ils ne sont pas des monstres, et qu’ils se trouvent entraînés aux actes meurtriers qu’ils commettent par un ensemble de circonstances et de raisons dont ils sont les premières victimes —et autres arguments auxquels réfléchiront les lecteurs du roman.
Ce livre est celui d’un connaisseur du monde arabe contemporain ; l’auteur en a trouvé la matière dans une actualité qu’il a été amené à côtoyer en divers lieux et à divers moments et dont il a certainement raison de penser que les mélodrames, drames et tragédies y abondent, plus que dans n’importe quelle fiction.
Denise Brahimi
« MUSTAPHA S’EN VA-T-EN GUERRE » par David Hury, éditions Riveneuve, 2021
Ce roman historique s’appuie sur une documentation riche et précise, qui nourrit ses 625 pages et recouvre, à certains égards du moins, une bonne part du 20e siècle, après la première guerre mondiale que certains historiens considèrent comme la fin du 19e siècle et jusqu’à la fin de tous les empires coloniaux, auxquels se substituent des Etats nationaux qui ont conquis leur indépendance. C’est l’idée de liberté qui sert de fil conducteur à ces nombreuses péripéties. Elle est à l’origine des comportements de Mustapha dont on fait connaissance dès le titre du roman, dans lequel il apparaît aussi sous d’autres noms ou prénoms, celui de Gustave renvoyant à sa part française, tandis que Mustapha est celui qu’il a reçu à sa naissance, dans sa famille qui est marocaine et vit à Figuig, une oasis située aux confins de la frontière algéro-marocaine, à l’extrême-est du Maroc. Cette position géographique explique que le point de départ de Figuig vers la France soit le port 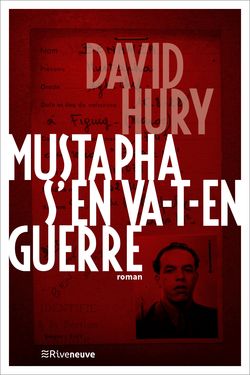 de la ville algérienne d’0ran. A l’époque où naît Mustapha, dans les années 1920, le Maroc est certes déjà un Protectorat français mais la manière dont on y vit est encore tout à fait traditionnelle, tandis qu’Oran fait partie des grandes villes occidentalisées qui se sont développées en Algérie, devenue colonie française depuis près d’un siècle.
de la ville algérienne d’0ran. A l’époque où naît Mustapha, dans les années 1920, le Maroc est certes déjà un Protectorat français mais la manière dont on y vit est encore tout à fait traditionnelle, tandis qu’Oran fait partie des grandes villes occidentalisées qui se sont développées en Algérie, devenue colonie française depuis près d’un siècle.
Cette différence entre les deux pays du Maghreb est considérable, et on la découvre à travers la personnalité de Mustapha, qui dès l’enfance montre son attachement à l’autonomie de son pays, et le rejet de son absorption dans l’ensemble du mode de vie français ; ce dernier passerait évidemment par l’établissement d’un régime politique « à la française », à l’égard duquel le jeune Marocain est instinctivement réticent et le sera de plus en plus.
Le roman raconte une bonne soixantaine d’années de la vie de Mustapha, qui pour l’essentiel se passent en France. Il y est parti en principe pour y faire ses études à la fin de son adolescence, mais les événements historiques qui vont alors déferler ne lui permettront de revoir Figuig que 25 ans après, et l’on sait évidemment de quels événements il s’agit, ceux de la deuxième Guerre mondiale. Mustapha n’hésite pas un instant à s’engager du côté de la France, et à faire, après la cuisante débâcle que connaît celle-ci, le choix de la Résistance organisée depuis Londres par le Général De Gaulle. Cette participation, très active et qui manque plusieurs fois de lui coûter la vie, est une des formes que prend son refus de tout asservissement : comme le joug colonial que la France prétend imposer aux Marocains, le joug de l’Allemagne hitlérienne imposé à la France ne peut manquer de jeter Mustapha dans les rangs de la Résistance clandestine, jusqu’à la libération— souvent aux côtés des communistes, bien qu’il ne partage pas leurs idéaux.
Peu après la fin de la guerre commence une nouvelle forme de combat pour la liberté, celui des pays colonisés qui s’organisent pour conquérir leur indépendance. Mustapha ne peut manquer de s’y sentir impliqué. Et c’est ainsi qu’on le retrouve, alors qu’il est en France pendant la guerre d’Algérie, aux côtés d’Algériens du FLN, ce qui n’est évidemment pas sans danger, d’autant qu’étant désormais marié et père de trois enfants, il est vulnérable à travers sa famille. La police française et ses supplétifs mais aussi l’OAS, sont au début des années 60 les nouveaux adversaires (et les nouveaux tortionnaires) contre lesquels il n’en continue pas moins fidèlement le combat.
 Les deux autres fils directeurs du récit sont d’une part l’amour de Mustapha pour une Française, Annette, qu’il a connue pendant la résistance, et d’autre part la relation complexe, contradictoire, qu’il entretient avec Armand, un Français de son âge, connu pendant leur commune enfance à Figuig. D’Annette il finira par se séparer sans que soient brisés pour autant leurs liens profonds ; avec Armand ils forment un couple de frères ennemis que leurs idées et leurs choix politiques opposent avec beaucoup de violence, mais qui n’arrivent pas à rompre avec une sorte de fascination réciproque. En quoi le roman est moins manichéen qu’il ne semble à certains moments, comme l’explique finalement à Mustapha Armand qui est sans doute une des voix de David Hury et qui oblige le lecteur à revenir sur des opinions trop tranchées.
Les deux autres fils directeurs du récit sont d’une part l’amour de Mustapha pour une Française, Annette, qu’il a connue pendant la résistance, et d’autre part la relation complexe, contradictoire, qu’il entretient avec Armand, un Français de son âge, connu pendant leur commune enfance à Figuig. D’Annette il finira par se séparer sans que soient brisés pour autant leurs liens profonds ; avec Armand ils forment un couple de frères ennemis que leurs idées et leurs choix politiques opposent avec beaucoup de violence, mais qui n’arrivent pas à rompre avec une sorte de fascination réciproque. En quoi le roman est moins manichéen qu’il ne semble à certains moments, comme l’explique finalement à Mustapha Armand qui est sans doute une des voix de David Hury et qui oblige le lecteur à revenir sur des opinions trop tranchées.
D’ailleurs le livre ne cherche pas à être très novateur en matière d’idéologie ni de psychologie. Il cherche surtout, semble-t-il, à bien intégrer dans le récit romanesque une masse importante de données historiques, et il y parvient. Plus de 170 notes historiques sont là pour aider le lecteur en difficulté mais de toute façon la narration est suffisamment prenante pour se suffire à elle-même et soutenir l’intérêt.
L’un des procédés employés par l’auteur pour donner une sorte de dynamique et de diversité à son récit est un découpage chronologique inattendu, qui évite la forme du récit linéaire. On circule dans le temps entre une douzaine d’épisodes dont les dates, chaque fois différentes, ne se succèdent pas dans l’ordre habituel, mais une stricte datation fait qu’on ne risque pas de s’y perdre, et qu’un tissu à peu près continu finit pas se constituer, sans hésitation possible : le récit est finalement plus classique qu’il ne le laisse paraître, et l’auteur a trop à dire pour s’engager dans des recherches purement formelles. En tout cas ce retour sur le 20e siècle ne peut laisser indifférent des lecteurs qui en ont tous connu personnellement une plus ou moins grande partie.
Denise Brahimi
« L’ISLAM ET LA SCIENCE » par Faouzia Charfi, éditions Odile Jacob, 2021
Le sous-titre de ce livre : « en finir avec les compromis », est riche d’enseignements. Si elle souhaite en finir c’est que l’auteure a le sentiment d’avoir déjà et depuis longtemps déployé une immense énergie au service de la cause qui lui tient à cœur : séparer toute croyance religieuse de la vérité scientifique qui ne peut être ce qu’elle doit être que si son autonomie est assurée. Elle l’a déjà dit dans ses deux livres précédents, « La Science voilée » (2013) et « Sacrées questions … Pour un islam d’aujourd’hui » (2017) et y revient dans les 5 chapitres de son dernier livre que nous évoquons ici : y sont abordés aussi bien la réception faite à Darwin que certaines exégèses contemporaines du Coran, mais le titre le plus significatif pourrait bien être celui du chapitre 2 : « Le détournement de la science ». L’emploi d’un mot aussi fort que détournement est nécessairement dénonciateur ; de plus il indique une action volontaire et intentionnelle, on peut aller jusqu’à dire qu’il implique des coupables à dénoncer et à combattre … s’il se peu
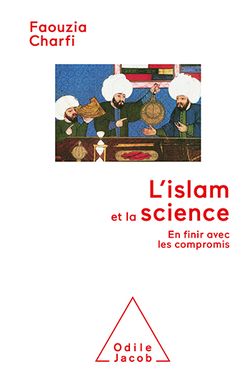 Cependant l’auteure s’appuie toujours sur des bases historiques et c’est ce qu’elle fait ici dans son premier chapitre consacré aux débuts de la science « arabe » : les guillemets sont d’elle et on comprend vite pourquoi elle les utilise. En fait il y a deux raisons pour faire un sort particulier au mot « arabe », à propos de la science ou des sciences dont elle veut parler : d’une part, géographiquement les pays concernés par ces avancées scientifiques sont aussi bien perses ou hindous et donc beaucoup plus variés que ceux du seul monde arabe, et de toute manière leur science puise dans la tradition grecque antérieure ; mais d’autre part la caractéristique de ces travaux scientifiques est d’être écrits en langue arabe, il s’agit d’une nouvelle tradition scientifique commençant au 8e siècle lorsque les Abbassides succèdent aux Ommeyades (en 750) : un immense travail de traduction vers l’arabe va durer pendant deux siècles. Les mécènes de cette entreprise étaient aussi bien des Arabes ou des non Arabes, des Musulmans ou des non Musulmans. La culture générale alors répandue comporte aussi bien des composantes religieuses, littéraires et scientifiques. En tout cas les sciences arabes ne constituent pas une science islamique, elles sont arabes, comme on l’a dit, pour une question de langue, mais c’est seulement par l’effet d’une déviation soutenue par le courant fondamentaliste qu’elles sont dites islamiques. Pour mieux discréditer toute science qui se voudrait autonome, ses détracteurs la dénoncent en tant qu’occidentale, ou universelle— mot qui de ce fait prend lui aussi un sens péjoratif ; à l’opposé se trouve mis en place un relativisme scientifique qui autorise la prise en compte des préceptes islamiques dans l’enseignement des sciences.
Cependant l’auteure s’appuie toujours sur des bases historiques et c’est ce qu’elle fait ici dans son premier chapitre consacré aux débuts de la science « arabe » : les guillemets sont d’elle et on comprend vite pourquoi elle les utilise. En fait il y a deux raisons pour faire un sort particulier au mot « arabe », à propos de la science ou des sciences dont elle veut parler : d’une part, géographiquement les pays concernés par ces avancées scientifiques sont aussi bien perses ou hindous et donc beaucoup plus variés que ceux du seul monde arabe, et de toute manière leur science puise dans la tradition grecque antérieure ; mais d’autre part la caractéristique de ces travaux scientifiques est d’être écrits en langue arabe, il s’agit d’une nouvelle tradition scientifique commençant au 8e siècle lorsque les Abbassides succèdent aux Ommeyades (en 750) : un immense travail de traduction vers l’arabe va durer pendant deux siècles. Les mécènes de cette entreprise étaient aussi bien des Arabes ou des non Arabes, des Musulmans ou des non Musulmans. La culture générale alors répandue comporte aussi bien des composantes religieuses, littéraires et scientifiques. En tout cas les sciences arabes ne constituent pas une science islamique, elles sont arabes, comme on l’a dit, pour une question de langue, mais c’est seulement par l’effet d’une déviation soutenue par le courant fondamentaliste qu’elles sont dites islamiques. Pour mieux discréditer toute science qui se voudrait autonome, ses détracteurs la dénoncent en tant qu’occidentale, ou universelle— mot qui de ce fait prend lui aussi un sens péjoratif ; à l’opposé se trouve mis en place un relativisme scientifique qui autorise la prise en compte des préceptes islamiques dans l’enseignement des sciences.
 Faouzia Charfi s’engage alors dans une dénonciation de l’embrigadement obscurantiste auquel se trouve soumise la jeunesse musulmane. Elle s’appuie sur plusieurs historiens contemporains pour montrer l’évolution subie par l’enseignement des sciences rationnelles au cours des siècles dans les pays d’islam. Tous ceux qui souhaitent des précisions à ce sujet les trouveront dans ce qu’elle explique, de manière à la fois très claire et très bien informée. Dans l’histoire qu’elle reconstitue, on voit comment les sciences traditionnelles vont l’emporter sur les sciences de la raison. La volonté de Dieu est substituée à la relation causale, on assiste à la négation de cette dernière chez le célèbre et prestigieux philosophe Ghazali qui vécut en Iran au 11-12e siècles. Et c’est évidemment un moment déterminant dans cette évolution. Il y a eu réduction des sciences à leur rôle instrumental, c’est dans ce contexte qu’a eu lieu le déclin des sciences en terre d’islam, Faouzia Charfi étant évidemment très préoccupée de trouver à celui-ci une explication.
Faouzia Charfi s’engage alors dans une dénonciation de l’embrigadement obscurantiste auquel se trouve soumise la jeunesse musulmane. Elle s’appuie sur plusieurs historiens contemporains pour montrer l’évolution subie par l’enseignement des sciences rationnelles au cours des siècles dans les pays d’islam. Tous ceux qui souhaitent des précisions à ce sujet les trouveront dans ce qu’elle explique, de manière à la fois très claire et très bien informée. Dans l’histoire qu’elle reconstitue, on voit comment les sciences traditionnelles vont l’emporter sur les sciences de la raison. La volonté de Dieu est substituée à la relation causale, on assiste à la négation de cette dernière chez le célèbre et prestigieux philosophe Ghazali qui vécut en Iran au 11-12e siècles. Et c’est évidemment un moment déterminant dans cette évolution. Il y a eu réduction des sciences à leur rôle instrumental, c’est dans ce contexte qu’a eu lieu le déclin des sciences en terre d’islam, Faouzia Charfi étant évidemment très préoccupée de trouver à celui-ci une explication.
Les grandes révolutions scientifiques auxquelles sont attachés les noms de Copernic et de Galilée n’ont pas d’équivalent dans le monde musulman, qui a évité la rupture violente entre le monde de la science et celui de la tradition religieuse mais le prix à payer a été une stagnation et un déclin dû à l’incapacité d’apprécier les prodigieuses avancées théoriques qui étaient le fait du monde occidental, principalement dans le domaine de l’astronomie. Et dans le même temps, les pays arabes ont perdu l’avance qu’ils avaient dans le domaine de la diffusion des livres du fait de l’interdiction de l’imprimerie.
Faouzia Charfi consacre son 3e chapitre à analyser ce qu’a été au 19e siècle la Nahdha ou Renaissance musulmane, vaste projet initié par des réformistes, qui ne pouvaient manquer de réfléchir à la place de la science dans la modernité. Incontestablement, la question de la séparation entre science et religion a alors été posée, mais le choix qui a prévalu a été celui d’une voie moyenne et non celui de la sécularisation (qui aurait consisté à soustraire la science à l’influence des institutions religieuses). Tel est l’enjeu de l’opposition soigneusement décrite par l’auteure entre le cheikh musulman égyptien Muhammad Abduh et le Libanais Farah Antun très féru de culture française. Ce dernier pense que c’est une erreur de vouloir concilier science et religion et s’appuie pour cela sur la pensée d’Ibn Rushd connu en Occident sous le nom d’Averroès. Abduh semble préconiser lui aussi une position rationaliste, notamment sur la question des miracles (dont l’acceptation est évidemment problématique pour un esprit moderne) et il manifeste beaucoup d’intérêt pour les inventions scientifiques ; mais il reste convaincu que l’islam est suffisamment rationnel pour maîtriser les sciences modernes et qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les deux formes de pensée ou de rapport au monde. Or il représente la majorité des réformistes, pour lesquels l’islam est ami de la science et n’a pas à son égard l’intolérance du christianisme.
Historiquement il y a coïncidence entre la Nahdha des pays d’islam et la publication par Darwin de ses principaux écrits (1859-1871). Les réformistes ne pouvaient manquer de s’y intéresser mais on constate qu’ils l’ont fait de manière mitigée, refusant le matérialisme que ces écrits impliquent, tout en acceptant l’idée d’un progrès lié à l’évolution positive des sociétés.
A l’époque actuelle se développe une tendance déraisonnable qui consiste à affirmer que toutes les supposées découvertes scientifiques sont déjà dans le Coran. Cette exégèse biaisée, appelée le concordisme, est en fait une machine de guerre contre l’Occident. Le concordisme est évidemment pseudo-scientifique, reste que les problèmes d’exégèse coranique sont à l’origine de polémiques extrêmement violentes (au Caire en particulier). La liberté dans l’approche des questions religieuses reste un fait très minoritaire en pays d’Islam.
Denise Brahimi
« LA TRAITE ARABO-MUSULMANE », articles de Salah Trabelsi dans « Historia », novembre 2021
 Salah Trabelsi, universitaire et lyonnais, aborde dans ce numéro de la revue « Historia » un sujet dont il dit lui-même qu’il est trop peu traité. Il faut donc apprécier à sa juste valeur le gros dossier qu’il présente ici, une dizaine d’articles dont il a lui-même écrit une bonne partie, dans une présentation accessible pour tout public, mettant en valeur l’importance encore méconnue d’un phénomène qui pendant treize siècles a concerné vingt millions de personnes.
Salah Trabelsi, universitaire et lyonnais, aborde dans ce numéro de la revue « Historia » un sujet dont il dit lui-même qu’il est trop peu traité. Il faut donc apprécier à sa juste valeur le gros dossier qu’il présente ici, une dizaine d’articles dont il a lui-même écrit une bonne partie, dans une présentation accessible pour tout public, mettant en valeur l’importance encore méconnue d’un phénomène qui pendant treize siècles a concerné vingt millions de personnes.
On est en effet ahuri d’en avoir si peu entendu parler, alors que sont innombrables aujourd’hui les écrits en tous genres, historiques, littéraires etc. qui parlent de l’autre traite, dite transatlantique, celle qui emmenait par bateau en Amérique des Africains rendus esclaves au profit de maîtres blancs.
La comparaison entre ces deux traites, plus ou moins fondée, n’est que partiellement le sujet abordé dans le dossier d’ « Historia », car elle mériterait à elle seule un examen critique qui une fois de plus éloignerait l’attention de la traite arabo-musulmane. Contrairement à ce qu’on imagine peut-être en faisant de celle-ci un phénomène sporadique et difficile à appréhender, il nous est affirmé que l’esclavage en terre d’islam, du 7e au 20e siècle, a été un système « redoutablement bien organisé (…) de l’Inde à l’Afrique centrale, de l’Espagne à l’Irak ».
S’agissant de l’esclavage « en terre d’islam », on ne peut se contenter de prendre ce dernier mot à son sens géographique, et il faut évidemment se demander comment cette religion a pu coexister pendant si longtemps avec la pratique esclavagiste, ce qui implique pour commencer un retour au Coran lui-même et à ce qu’il nous dit sur la question. A quoi s’ajoutent de nombreux textes arabes beaucoup plus récents (17e siècle) qui sont évidemment des témoignages sur l’esclavage puisqu’ils tentent de le réglementer. Il existe d’ailleurs une iconographie, dont le dossier donne quelques exemples, très suffisante pour qu’on se représente concrètement ce marché odieux, d’autant que s’y ajoutent quelques cartes montrant ce que furent historiquement les grands circuits de la traite.
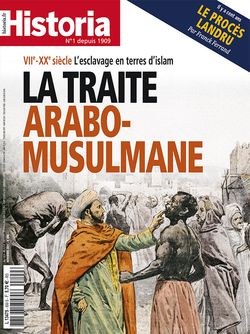 S’agissant du Maghreb, qui intéresse principalement « La Lettre » de Coup de soleil, il en est beaucoup question dans plusieurs articles et ce qui apparaît d’emblée est que le Maghreb a surtout vu dans le commerce des esclaves le moyen de réaliser de grands profits économiques, se trouvant dans une position géographique privilégiée entre l’Afrique Noire, la Méditerranée et les pays arabes. Des Européens ont eu la possibilité de représenter ce qu’étaient ces « marchés aux esclaves » où l’on voit clairement comment des êtres humains étaient achetés et vendus sans vergogne comme de pures marchandises, évalués pour leur valeur marchande—alors même que certaines présentations de cette autre traite voudraient faire croire que « les esclaves dans le mode arabo-musulman aient joui du respect de leur personne et bénéficié de droits les mettant à l’abri des violences de leurs maîtres ».
S’agissant du Maghreb, qui intéresse principalement « La Lettre » de Coup de soleil, il en est beaucoup question dans plusieurs articles et ce qui apparaît d’emblée est que le Maghreb a surtout vu dans le commerce des esclaves le moyen de réaliser de grands profits économiques, se trouvant dans une position géographique privilégiée entre l’Afrique Noire, la Méditerranée et les pays arabes. Des Européens ont eu la possibilité de représenter ce qu’étaient ces « marchés aux esclaves » où l’on voit clairement comment des êtres humains étaient achetés et vendus sans vergogne comme de pures marchandises, évalués pour leur valeur marchande—alors même que certaines présentations de cette autre traite voudraient faire croire que « les esclaves dans le mode arabo-musulman aient joui du respect de leur personne et bénéficié de droits les mettant à l’abri des violences de leurs maîtres ».
Aux 7e et 8e siècles, la conquête du Maghreb par les Arabes amène ces derniers à capturer par dizaines de milliers des populations locales (berbères) et à les expédier vers l’Orient, notamment en Syrie. Jusqu’au moment où les Berbères deviendront eux-mêmes importateurs d’esclaves et (riches) marchands. De toute façon, le commerce des esclaves est très actif et fait l’objet d’une forte demande, les plus grands personnages lui doivent une partie de leur richesse. A noter, parmi les usages des esclaves, le fait que certains d’entre eux seront utilisés comme soldats par les souverains musulmans, tandis que d’autres se choisiront des concubines parmi les plus belles des captives.
On est frappé par l’amplitude des échanges, qui sont internationaux et ne cessent de se renouveler en fonction des besoins que font apparaître l’évolution des états et leur développement économique. L’Egypte par exemple, au cours du 19e siècle, utilise la traite pour financer sa modernisation. Au 20e ce sont les états de la péninsule arabique qui utilisent l’esclavage pour les besoins de l’industrie pétrolière.
Cependant, il semble que le dossier arrête l’étude de cette traite vers 1920—peut-être du fait que la colonisation française introduit des notions humanitaires (quoi qu’il en soit par ailleurs de certains de ses effets qui le sont fort peu !) dans son rapport à l’esclavage, comme le prouve un court article intitulé « La grande évasion d’une esclave». Il y est question d’une jeune femme noire qui en 1887 réussit à s’enfuir d’une caravane venue de Libye et se retrouve à Gafsa en Tunisie, où elle sera émancipée par les autorités françaises. Des gens qu’on appellerait aujourd’hui des lanceurs d’alertes dénoncent la brutalité dont ils sont témoins en Afrique dans les marchés d’esclaves et mettent à profit le développement d’une sensibilité européenne qui n’apparaît guère avant le 19e siècle.
Il faut mettre à part parce qu’elle a été beaucoup plus étudiée et nourrie de nombreux documents, notamment des récits autobiographiques, ce qu’on appelle « la Course » en Méditerranée, c’est-à-dire la piraterie exercée, du 16e au 19e siècle, par des Corsaires dont le but unique est d’échanger des rançons substantielles contre la libération de leurs captifs. Les familles de ces derniers sont invitées à y contribuer, et des ordres religieux de « rédempteurs » se chargent d’aller sur place verser les rançons. L’aspect commercial de ces transactions est absolument évident, le sort subi par les captifs provisoires est variable selon les cas, et il arrive que certains d’entre eux se fassent musulmans, leur position de renégats leur permettant ensuite de participer eux aussi à de juteux commerces. Faut-il parler « d’activités prédatrices » en Méditerranée ou, comme le fait Fernand Braudel, d’un « échange forcé » ? En tout cas il y eu bel et bien une « économie de la rançon » avant que, pour des raisons diverses, elle ne tombe en désuétude.
Ce sont comme annoncé plus de dix siècles d’histoire qui sont à revisiter selon les pistes très utilement ouvertes par ce dossier.
« BEL ABÎME »par Yamen Manaï, éditions Elyzad, 2021
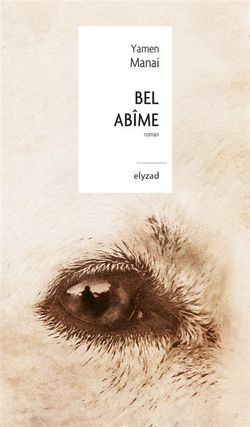 Ce court récit est un conte cruel, qui est dit à la première personne et fait entendre la parole d’un accusé, répondant à son avocat et sans doute au psychiatre préposé pour l’assister. Mais pas un seul instant il ne s’agit d’une auto-défense ni d’un auto-plaidoyer de l’accusé qui au contraire ne cesse de revendiquer les actes pour lesquels il a été arrêté et sera de toute évidence condamné prochainement, sans circonstance atténuante, puisqu’il se refuse à en demander.
Ce court récit est un conte cruel, qui est dit à la première personne et fait entendre la parole d’un accusé, répondant à son avocat et sans doute au psychiatre préposé pour l’assister. Mais pas un seul instant il ne s’agit d’une auto-défense ni d’un auto-plaidoyer de l’accusé qui au contraire ne cesse de revendiquer les actes pour lesquels il a été arrêté et sera de toute évidence condamné prochainement, sans circonstance atténuante, puisqu’il se refuse à en demander.
Celui qui parle, le coupable donc, bien qu’il récuse ce mot (impliquant le plus souvent repentir ou demande de pardon) est un adolescent révolté, dont la parole exprime continûment un rejet violent, celui de la société tout entière dans laquelle il a vécu et ne veut plus vivre d’aucune façon. Au sein de cette société, le cercle le plus proche est celui de la famille, notamment son père, une sorte de notable et d’intellectuel qui n’a jamais eu pour son fils le moindre geste d’affection et qui au contraire l’a toujours brimé, quoique sur un mode hypocrite, pour ne pas mettre en cause son prestige social. Mais la révolte du jeune garçon concerne plus largement l’état des lieux dans lesquels il est enfermé et qui sont à peu près à l’abandon, dans un état de déliquescence lamentable voire repoussant : ne semblent actives que les forces de répression.
Parmi celles-ci, le récit donne à voir celles qui font l’objet particulier d’une violence très cruelle : la mise à mort des chiens, une des manières qu’a le pouvoir de se débarrasser des indésirables, d’autant qu’ils sont faibles et sans moyen de défense. On comprend que cette mise à mort impitoyable et sans état d’âme est largement symbolique, mais dans la trame narrative qui est le fil conducteur de ce récit, elle joue un rôle crucial du fait que la seule raison d’être du jeune révolté était l’amour réciproque pour la chienne Bella qu’il  avait adoptée. Bella elle aussi est à la fois vraie et symbolique, elle est chaleureuse et tendre, une merveilleuse porteuse d’amour. Lorsque le père la livre aux massacreurs de chiens qui sévissent dans le pays, il trahit son fils et détruit ce qui était sa seule raison de vivre. Acte irréversible, irrémédiable, ne laissant d’autre choix à l’adolescent que de commettre des actes de violence qui sont une autre manière de provoquer sa propre mort.
avait adoptée. Bella elle aussi est à la fois vraie et symbolique, elle est chaleureuse et tendre, une merveilleuse porteuse d’amour. Lorsque le père la livre aux massacreurs de chiens qui sévissent dans le pays, il trahit son fils et détruit ce qui était sa seule raison de vivre. Acte irréversible, irrémédiable, ne laissant d’autre choix à l’adolescent que de commettre des actes de violence qui sont une autre manière de provoquer sa propre mort.
Le récit suit une ligne unique et si l’on peut dire sans faille, sans diversion et sans remords. Il est impressionnant par sa netteté imparable, et ne conduit que vers une seule issue, qui justement n’en est pas une puisque le révolté n’oppose à ses interlocuteurs que son refus. Il incarne la révolte à l’état pur, du fait que de part et d’autre il n’y a pas de concession possible, ni de la société à son égard ni de sa part à l’égard de la société. En ce sens, l’auteur ne laisse à son personnage aucune chance de devenir un personnage de roman, bien que « Bel Abîme » revendique cette définition. C’est plutôt d’un poème tragique qu’il s’agit, il a la fulgurance d’un cri.
Denise Brahimi
MAGHREB-ORIENT DES LIVRES 2021 « Mémoires algériennes » Claude Bataillon
Notre collègue Claude Bataillon nous propose de revenir sur quelques aspects du MODEL 2021qui pour des raisons d’ordre sanitaire n’a pu toucher l’ensemble de son public habituel, avec notamment cette table ronde Mémoires algériennes.
Avec Stéphane Beaud, La France des Belhoumi (La Découverte, 2018), Stanislas Frenkiel, Le football des immigrés : France-Algérie, l’histoire en partage (Artois Presses Université, 2021), Tramor Quémeneur, La guerre d’Algérie revisitée – Nouvelles générations, nouveaux regards (Karthala, 2016), Benjamin Stora, France- Algérie, les passions douloureuses (Albin Michel, 2021), Naïma Yahi, Sexualités, identités & corps colonisés. XVe siècle – XXIe siècle (CNRS, 2019)
● Modération : Georges Morin, enseignant universitaire en science politique
 Benjamin Stora nous dit que son expertise sur les mémoires algériennes a été demandée (mais pas forcément suivie d’effets…) par les cinq derniers présidents de la République française : on se souvient ainsi du discours de Constantine de Sarkozy, du rôle de Gisèle Halimi, de la « disparition » de Maurice Audin, de l’assassinat de l’avocat Boumendjel… Pour son rapport de l’automne 2020, il souligne qu’il a voulu faire à la fois un état des lieux et des préconisations concrètes : Cécile Renault en est chargée à L’Elysée. La relance d’un musée à Montpellier serait une action très importante. Son rapport a donc des effets franco-français. Pour le franco-algérien, il faut attendre.
Benjamin Stora nous dit que son expertise sur les mémoires algériennes a été demandée (mais pas forcément suivie d’effets…) par les cinq derniers présidents de la République française : on se souvient ainsi du discours de Constantine de Sarkozy, du rôle de Gisèle Halimi, de la « disparition » de Maurice Audin, de l’assassinat de l’avocat Boumendjel… Pour son rapport de l’automne 2020, il souligne qu’il a voulu faire à la fois un état des lieux et des préconisations concrètes : Cécile Renault en est chargée à L’Elysée. La relance d’un musée à Montpellier serait une action très importante. Son rapport a donc des effets franco-français. Pour le franco-algérien, il faut attendre.
Stéphane Beaud s’est fait l’anthropologue de la famille Belhoumi : dans les mémoires de celle-ci, la guerre d’Algérie n’existe pas, contrairement à la décennie noire. Il a pu aussi dialoguer avec une autre famille « algérienne » chez qui se conserve une mémoire très vive de cette guerre d’Algérie : ils vivaient déjà en France. Il souligne que le choix d’immigrer en France implique le silence devant les enfants sur ce qu’est l’Algérie, en guerre mais aussi après. Enfin, répondant à une question il remarque que les échanges universitaires franco-algériens sont très limités, contrairement à l’époque autour de 1970 où ont enseigné à Alger Bourdieu, Jean Lecat et tant d’autres.
Stanislas Frenkiel a travaillé avec Naïma Yahi (absente) sur les élites algériennes en France. 60 entretiens avec des sportifs lui ont permis de comprendre toute la complication d’une « Equipe de foot du FLN » où certains se rappellent que c’est en jouant en France que pour la première fois on les appelait « Monsieur ». Plus de la moitié des joueurs étaient en couple (marié on non) avec des Françaises. Actuellement dans l’équipe nationale algérienne de foot une grosse majorité ont la nationalité française. Il existe une amicale des joueurs de foot algériens émigrés en Europe…
Tramor Quemeneur travaille sur les « post-mémoires » coloniales en multipliant les entretiens. Si depuis peu la mémoire des appelés français au service militaire est mieux connue (Raphaelle Branche ), le silence persiste bien plus chez les fils de Harkis ou fils d’Algériens « normaux » pris dans cette guerre, alors que le milieu pied-noir mélange silences et débordements mémoriels, ceux-ci plus fréquents récemment. Le travail de l’historien est de traiter historiquement et de nuancer ces mémoires. Les mémoires traumatiques dominent et gomment les situations « positives ». Plutôt que d’idéologiser ces souvenirs, il importe de promouvoir des actions concrètes, qui seraient loin d’être des « petits pas », comme d’ouvrir les dossiers concernant les disparus, les essais nucléaires au Sahara.
Claude Bataillon
Plusieurs questions de la salle concernent les insoumis dans la guerre, la situation des chibanis par rapport aux nouvelles générations, les mémoires de la colonisation ottomane. Sur ce dernier point Benjamin Stora remarque que cette dernière ne pouvait être aussi « négative » que celle des Français, parce qu’ils étaient musulmans et que l’islam pour les Algériens a servi de seul socle disponible pour imaginer une nation. Autour de 1917 les victoires militaires de la Turquie face aux franco-anglais ont cimenté des espoirs pour un nationalisme algérien à peine naissant.

« LEUR ALGERIE », film documentaire de Lina Soualem, 2020
Ce film est un documentaire, plus long que la taille habituelle dans ce genre et dont l’action appartient aux seuls personnages dont la réalisatrice a décidé de se préoccuper, à savoir son grand-père et à sa grand-mère et à un moindre degré son père, connu en France comme acteur. Est-ce à dire qu’on n’y sent pas la volonté pédagogique qui veut que le documentaire se caractérise par la quantité importante d’informations qu’il procure à ses spectateurs ? Oui et non. Pour prendre l’exemple le plus frappant, le film ne nous dit pas d’emblée où il se situe, il attend même longtemps pour le faire, et pourtant il n’est pas facile de repérer immédiatement la ville de Thiers, qui n’est certainement pas des plus connues en France et moins que jamais maintenant où elle souffre d’un déclin économique comme le montre le film. Thiers ville de la coutellerie, c’est ce qu’en auront retenu les bons élèves d’école primaire, et Lina Soualem nous montre en effet un Musée de la coutellerie qui expose de fort belles œuvres (superbes !), mais de couteliers point, ils sont tous partis comme le dit le grand-père avec une sorte de dérision, et il est bien placé pour le savoir puisque c‘est justement dans ce domaine qu’il a travaillé lorsqu’il a quitté son village algérien de Laaouamer pour venir en France, abandonnant leur mère à sa misère, comme l’ont fait tour à tour tous les enfants de celle-ci.
 Peut-on dire alors que le film est un documentaire sur ce qu’ont été les travailleurs immigrés de la première génération, ceux qui sont nés en Algérie et ont eu le temps de la connaître avant de partir pour la France ? C’est un peu trop généraliser le sujet, qui ne vise pas à faire un portrait collectif, bien au contraire. Lina est visiblement fascinée par ses deux grands-parents et elle est prise soudain par un grand désir de les connaître, y compris et surtout dans la longue durée, car elle s’accuse de n’avoir pas du tout cherché à le faire jusque là. Il est vrai que mine de rien ils en valent la peine et les portraits que leur petite-fille en fait montrent des individualités très affirmées, très différentes l’une de l’autre , qu’elle ne cherche pas à rendre exemplaire de ce qu’a été le destin des immigrés. Dans le titre « Leur Algérie », « leur » est un pluriel qui implique la diversité. Le film vaut beaucoup par le regard que Lina porte sur eux et qui n’est jamais dépourvu d’une pointe d’humour ; d’ailleurs, on dirait que sous le regard de la caméra, ils sont assez contents de jouer leur rôle, peut-être à cause de leur fils Zinedine comédien lui-même et qui en a introduit d’autres dans la famille. La grand-mère, très extravertie, très sociable, d’ailleurs coquette à plus de quatre-vingts ans, a choisi de quitter le mari avec lequel elle a vécu plus de soixante ans (mariée à 15 ans !) parce qu’à l’inverse il ne veut voir personne et juge toute conversation inutile. Elle continue à le nourrir mais se trouve beaucoup mieux de vivre dans un autre appartement que lui. Le quasi mutisme du vieil homme le rend assez revêche, mais on pourrait dire qu’il n’en pense pas moins, et que ses rares remarques sont sagaces, révélant son intelligence et son don d’observation. Il s’est intégré à sa manière dans la population de la petite ville auvergnate qui ne contient sans doute pas que de grands causeurs. En tout cas, aucun des deux grands-parents ne geint sur un éventuel rejet qu’ils auraient subi, ni sur la dureté de leur vie, ni sur celle de la vie en général. En cela parmi la très grande abondance de films consacrés de nos jours au sort des Algériens immigrés, celui-ci est original par le fait qu’il n’est pas dans la plainte, ni dans la récrimination. On se dit que c’était peut-être une chance, pour eux, de se retrouver dans une petit ville, beaucoup moins conflictuelle et violente que les tristement célèbres banlieues. Mais peut-être faut-il interpréter avec précaution les rires très fréquents de la grand-mère, qui sont son principal moyen d’exprimer toute la gamme de ses émotions. A dire vrai, celles-ci ne comportent sans doute pas que de la joie, mais c’est plutôt elle qui ne dispose pas de moyens variés pour en dire d’autres. Elle s’exprime fort bien mais en restant dans la sphère de ses occupations habituelles, tandis que le grand-père réfléchit davantage, même ou justement parce qu’il s’exprime peu (et refuse en tout cas de papoter avec elle !).
Peut-on dire alors que le film est un documentaire sur ce qu’ont été les travailleurs immigrés de la première génération, ceux qui sont nés en Algérie et ont eu le temps de la connaître avant de partir pour la France ? C’est un peu trop généraliser le sujet, qui ne vise pas à faire un portrait collectif, bien au contraire. Lina est visiblement fascinée par ses deux grands-parents et elle est prise soudain par un grand désir de les connaître, y compris et surtout dans la longue durée, car elle s’accuse de n’avoir pas du tout cherché à le faire jusque là. Il est vrai que mine de rien ils en valent la peine et les portraits que leur petite-fille en fait montrent des individualités très affirmées, très différentes l’une de l’autre , qu’elle ne cherche pas à rendre exemplaire de ce qu’a été le destin des immigrés. Dans le titre « Leur Algérie », « leur » est un pluriel qui implique la diversité. Le film vaut beaucoup par le regard que Lina porte sur eux et qui n’est jamais dépourvu d’une pointe d’humour ; d’ailleurs, on dirait que sous le regard de la caméra, ils sont assez contents de jouer leur rôle, peut-être à cause de leur fils Zinedine comédien lui-même et qui en a introduit d’autres dans la famille. La grand-mère, très extravertie, très sociable, d’ailleurs coquette à plus de quatre-vingts ans, a choisi de quitter le mari avec lequel elle a vécu plus de soixante ans (mariée à 15 ans !) parce qu’à l’inverse il ne veut voir personne et juge toute conversation inutile. Elle continue à le nourrir mais se trouve beaucoup mieux de vivre dans un autre appartement que lui. Le quasi mutisme du vieil homme le rend assez revêche, mais on pourrait dire qu’il n’en pense pas moins, et que ses rares remarques sont sagaces, révélant son intelligence et son don d’observation. Il s’est intégré à sa manière dans la population de la petite ville auvergnate qui ne contient sans doute pas que de grands causeurs. En tout cas, aucun des deux grands-parents ne geint sur un éventuel rejet qu’ils auraient subi, ni sur la dureté de leur vie, ni sur celle de la vie en général. En cela parmi la très grande abondance de films consacrés de nos jours au sort des Algériens immigrés, celui-ci est original par le fait qu’il n’est pas dans la plainte, ni dans la récrimination. On se dit que c’était peut-être une chance, pour eux, de se retrouver dans une petit ville, beaucoup moins conflictuelle et violente que les tristement célèbres banlieues. Mais peut-être faut-il interpréter avec précaution les rires très fréquents de la grand-mère, qui sont son principal moyen d’exprimer toute la gamme de ses émotions. A dire vrai, celles-ci ne comportent sans doute pas que de la joie, mais c’est plutôt elle qui ne dispose pas de moyens variés pour en dire d’autres. Elle s’exprime fort bien mais en restant dans la sphère de ses occupations habituelles, tandis que le grand-père réfléchit davantage, même ou justement parce qu’il s’exprime peu (et refuse en tout cas de papoter avec elle !).
 Parmi ses réflexions sur la vie telle qu’il l’a connue, il y en a manifestement une qui lui est rappelée à chaque moment de sa vie quotidienne et qui est une constante pour tous ceux qui vivent en France, Français d’origine ou pas, depuis au moins deux générations. C’est la disparition des petites villes à l’ancienne, avec leurs entreprises qui pour être locales n’étaient parfois pas si petites, et dont l’exemple pourrait être la coutellerie à Thiers. On peut sans doute parler d’une ère pré-industrielle, qui s’inscrivait souvent dans la géographie des lieux, comme l’abondance d’eau courante à Thiers, et leur permettaient de survivre à des conditions naturelles difficiles ou tout simplement à leur enclavement. On se dit que la mémoire de ce temps-là, qui paraît si typiquement français, s’est maintenue pour une bonne part sinon principalement chez les ouvriers amenés d’ailleurs par l’immigration (naturellement, leurs descendants en sont tout aussi oublieux que n’importe quel Français de leur âge !). Et puisque Thiers est en Auvergne, on peut se permettre une plaisanterie faisant allusion au célèbre « nos ancêtres les Gaulois » d’époque coloniale : ces Algériens-là sont nos ancêtres dans la mesure où ils incarnent la pré-modernité. Modernité qui semble avoir assez peu gagné la ville de Thiers, sinon sous la forme des HLM encore appelés résidences. Le résultat paradoxal est que cette ville de Thiers ressemble étrangement à Laaouamer montré dans la partie du film tournée en Algérie, sans doute parce que la neige est la même partout mais surtout parce que ce sont des aspects du monde pré-moderne qui ont disparu des grandes villes vouées aux effets du capitalisme libéral.
Parmi ses réflexions sur la vie telle qu’il l’a connue, il y en a manifestement une qui lui est rappelée à chaque moment de sa vie quotidienne et qui est une constante pour tous ceux qui vivent en France, Français d’origine ou pas, depuis au moins deux générations. C’est la disparition des petites villes à l’ancienne, avec leurs entreprises qui pour être locales n’étaient parfois pas si petites, et dont l’exemple pourrait être la coutellerie à Thiers. On peut sans doute parler d’une ère pré-industrielle, qui s’inscrivait souvent dans la géographie des lieux, comme l’abondance d’eau courante à Thiers, et leur permettaient de survivre à des conditions naturelles difficiles ou tout simplement à leur enclavement. On se dit que la mémoire de ce temps-là, qui paraît si typiquement français, s’est maintenue pour une bonne part sinon principalement chez les ouvriers amenés d’ailleurs par l’immigration (naturellement, leurs descendants en sont tout aussi oublieux que n’importe quel Français de leur âge !). Et puisque Thiers est en Auvergne, on peut se permettre une plaisanterie faisant allusion au célèbre « nos ancêtres les Gaulois » d’époque coloniale : ces Algériens-là sont nos ancêtres dans la mesure où ils incarnent la pré-modernité. Modernité qui semble avoir assez peu gagné la ville de Thiers, sinon sous la forme des HLM encore appelés résidences. Le résultat paradoxal est que cette ville de Thiers ressemble étrangement à Laaouamer montré dans la partie du film tournée en Algérie, sans doute parce que la neige est la même partout mais surtout parce que ce sont des aspects du monde pré-moderne qui ont disparu des grandes villes vouées aux effets du capitalisme libéral.
La génération de Zinedine père de Lina vit une situation ambiguë entre stabilité du monde ancien et évidente mobilité du monde actuel. Le film en donne une preuve dans le déni opposé par Zinedine à la séparation de ses parents : non, il ne veut surtout pas de rupture dans ce monde ancien qui reste son monde de référence (où bien évidemment il ne vit pas) et d’ailleurs, dit-il, il reviendra toujours à Thiers quoi qu’il en soit ! Décidément, ce petit film loin des clichés joue assez subtilement avec mélanges et contradictions.
Denise Brahimi
« HAUT ET FORT », film de Nabil Ayouch, sorti en novembre 2021
Ce film est ou était très attendu, non seulement à cause de son apparition remarquée à Cannes et de la notoriété de son réalisateur mais justement aussi parce qu’il a été senti comme différent des autres films de celui-ci. Ce qui veut dire notamment que Nabil Ayouch, tout juste cinquantenaire, se sent maintenant tout à fait libre de faire les films qu’il veut et comme il veut, c’est-à-dire d’y mettre ce dont il a envie, sans se soucier de savoir dans quelle catégorie son film va être rangé— et notamment, dans le cas présent, s’il s’agit plutôt d’un documentaire ou d’un film de fiction.
 La première de ces deux assignations vient du fait que Haut et Fort est essentiellement consacré à montrer quel rôle joue et peut jouer le hip hop pour les jeunes déshérités d’un quartier populaire comme Sidi Moumen à Casablanca. Rappelons que ce genre musical fondé sur le rythme a été créé à New York dans le Bronx au début des années 70.
La première de ces deux assignations vient du fait que Haut et Fort est essentiellement consacré à montrer quel rôle joue et peut jouer le hip hop pour les jeunes déshérités d’un quartier populaire comme Sidi Moumen à Casablanca. Rappelons que ce genre musical fondé sur le rythme a été créé à New York dans le Bronx au début des années 70.
Le centre culturel où se passe l’action existe bel et bien, c’est Nabil Ayouch qui l’a créé, et il a eu recours pour le film à un certain nombre d’acteurs non professionnels, qu’il montre dans des situations tout à fait réelles. Cependant il faut ajouter aussitôt que nombre de références sont de l’ordre de la fiction et s’expliquent par les données personnelles, la volonté ou le plaisir du réalisateur. Derrière la présence bien réelle de Sidi Moumen, il y a aussi des souvenirs de Sarcelles en France où il a habité et où ne manquaient pas certains aspects de banlieue difficile ou déshéritée. Nabil Ayouch a donné à son film une petite ressemblance avec les westerns dont il a été nourri, et son héros Anas débarque sur les lieux du Centre culturel où il va travailler, cigare en bouche comme Clint Eastwood et autres héros solitaires, découvrant en même temps que le spectateur le lieu désolé qui va devenir celui de son action. Autre référence au cinéma américain et plus précisément à West Side Story que Nabil Ayouch dit avoir beaucoup aimé, une scène tout à fait étonnante de Haut et fort, dont on se demande d’abord si on doit en croire ses yeux : une magnifique chorégraphie où s’affrontent en deux groupes les rappeurs et les islamistes, comme représentants de deux gangs ou de deux bandes rivales.
C’est évidemment le signe d’une très grande liberté de la part du réalisateur et cette liberté peut passer pour exemplaire parce qu’elle est totalement en accord avec le thème du film où l’on voit l’éducateur inculquer à ses élèves, avec toute la force dont il est capable, l’idée qu’ils doivent s’émanciper de tout modèle et de toute contrainte dont ils n’éprouvent pas la nécessité. Cette éducation entièrement tournée vers l’apprentissage de la liberté fait partie d’une pédagogie assumée par le film, et d’ailleurs signifiée d’emblée par le fait que Anas se présente comme professeur — finalement on ne saura rien d’autre de lui. Nabil Ayouch nous dit dans ce film ce qu’il en est de sa position assez complexe : certes il est le réalisateur et se donne des droits à sa convenance, mais il n’est pas question pour lui de faire n’importe quoi car ce qui le guide est un but hautement affirmé : faire comprendre aux jeunes Marocains et Marocaines (avec une urgence sans doute plus grande encore pour les filles que pour que pour les garçons) les plus déshérités que leur avenir est entre leurs seules mains et, si difficile qu’il soit pour eux de l’affirmer, dépend de leur seule volonté.
 Cette leçon apparaît dès le début du film, c’est-à-dire dès la première leçon du professeur à ses élèves du Centre culturel. Il y fait preuve d’une froideur et d’une dureté qui paraissent un peu surprenantes voire énigmatiques et qui auront bien du mal à se détendre jusqu’à l’ultime dénouement. Sans doute s’agit-il de faire comprendre que le hip hop est un genre plus qu’exigeant malgré son apparence facilité due au grand rôle qui joue l’apparente improvisation. Il ne suffit pas de comparer Sidi Moumen au Bronx newyorkais, il faut retrouver la violente révolte que les Noirs opprimés voulaient exprimer à travers le hip hop. Et donc le souci du professeur est de ne pas laisser ses élèves réutiliser, même avec talent, les codes d’un genre musical désormais bien répertorié. C’est de la source qu’il faut chaque fois partir, et même des sources, car elles sont nombreuses : le désir d’argent en fait partie, au moins autant qu’une certaine dérision que ce désir peut inspirer, les effets de la pauvreté dans le milieu familial étant un constat quotidien qui ne peut qu’entretenir l’indignation. Pour les filles ce constat va de pair avec celui de l’infériorité dans laquelle elles sont maintenues. L’un des très beaux moments du film est le rap de la révolte exprimée par l’une d’entre elles, qui de l’extérieur n’apparaît pas ostensiblement comme émancipée mais qui s’exprime avec une force et une conviction admirables. Ce n’est pas de théorie qu’il s’agit mais de comportements concrets voir physiques, on voit dans le film les frères aînés et les pères venant récupérer les filles par la force pour les empêcher de participer à la pratique du hip hop, que ce soit au Centre ou a fortiori à l’occasion d’un concert ; celui-ci d’ailleurs a lieu mais il dégénère et tourne à la bagarre organisée.
Cette leçon apparaît dès le début du film, c’est-à-dire dès la première leçon du professeur à ses élèves du Centre culturel. Il y fait preuve d’une froideur et d’une dureté qui paraissent un peu surprenantes voire énigmatiques et qui auront bien du mal à se détendre jusqu’à l’ultime dénouement. Sans doute s’agit-il de faire comprendre que le hip hop est un genre plus qu’exigeant malgré son apparence facilité due au grand rôle qui joue l’apparente improvisation. Il ne suffit pas de comparer Sidi Moumen au Bronx newyorkais, il faut retrouver la violente révolte que les Noirs opprimés voulaient exprimer à travers le hip hop. Et donc le souci du professeur est de ne pas laisser ses élèves réutiliser, même avec talent, les codes d’un genre musical désormais bien répertorié. C’est de la source qu’il faut chaque fois partir, et même des sources, car elles sont nombreuses : le désir d’argent en fait partie, au moins autant qu’une certaine dérision que ce désir peut inspirer, les effets de la pauvreté dans le milieu familial étant un constat quotidien qui ne peut qu’entretenir l’indignation. Pour les filles ce constat va de pair avec celui de l’infériorité dans laquelle elles sont maintenues. L’un des très beaux moments du film est le rap de la révolte exprimée par l’une d’entre elles, qui de l’extérieur n’apparaît pas ostensiblement comme émancipée mais qui s’exprime avec une force et une conviction admirables. Ce n’est pas de théorie qu’il s’agit mais de comportements concrets voir physiques, on voit dans le film les frères aînés et les pères venant récupérer les filles par la force pour les empêcher de participer à la pratique du hip hop, que ce soit au Centre ou a fortiori à l’occasion d’un concert ; celui-ci d’ailleurs a lieu mais il dégénère et tourne à la bagarre organisée.
Ce moment qui se trouve près de la fin du film pourrait être décisif car on a l’impression que tous les élèves, en larmes, sont sur le point d’abandonner. Mais c’est alors que le professeur Anas, qu’il n’est pas interdit de confondre avec le réalisateur (une certaine ressemblance physique, peut-être ?) provoque par ses seuls mots un superbe retournement, faisant passer les jeunes du désespoir à l’énergie positive, et l’on a encore le temps, avant que le film ne s’achève, de constater que son message a été entendu et que les jeunes sont déjà en train de redémarrer. Ce qui nous vaut pour finir un sourire d’Anas, fait jusque là rarissime.
Les très nombreux épisodes de rap, rythme, chansons et danse qui ponctuent le film, l’apparentent au genre de la comédie musicale dont plusieurs cinéastes semblent soucieux d’explorer ces temps-ci les (riches ?) possibilités. En tout cas Haut et fort est un exemple du fait qu’il n’y a pas contradiction entre la volonté d’émanciper et de libérer tous ceux que leur situation opprime et le plaisir que donne une expression musicale originale, encore trop peu connue malgré sa grande qualité.
Denise Brahimi
Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.
 – Utiles
– Utiles
de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun
Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains
de Leila Saadna
Cliquez ici pour voir le film,
Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,
chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

- Jeudi 2 décembre, à la Cinémathèque de Saint-Etienne , projection de Ne nous racontez plus d’histoire de Ferhat Mouhali et Carole Filiu Mouhali, en présence du réalisateur
- Samedi 4 décembre à 15h à la Bibliothèque Kateb Yacine de Grenoble Hommage à la Poésie de Mohamed Dib, suivi d’n Cabaret poétique « L’Aube Ismael » par Hadda Djaber
- Le vendredi 10 décembre, à 20h au cinéma Le Mélies de Calluire Film « Haut et fort de Nabil Ayouch puis débat avec Luc Chauvin spécialiste de rap au Maghreb.
- Le mercredi 15 décembre, dans les Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon à 18h Table ronde « Guerre d’Algérie: des mémoires blessées? » avec Emilie Goudal, Françoise Lantheaume, Abderrahmen Moumen et Tramor Quemeneur.
N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.


Pingback: Bel Abyme de Yamen Manaï, IMA 3 Décembre 2022 | Coup de Soleil